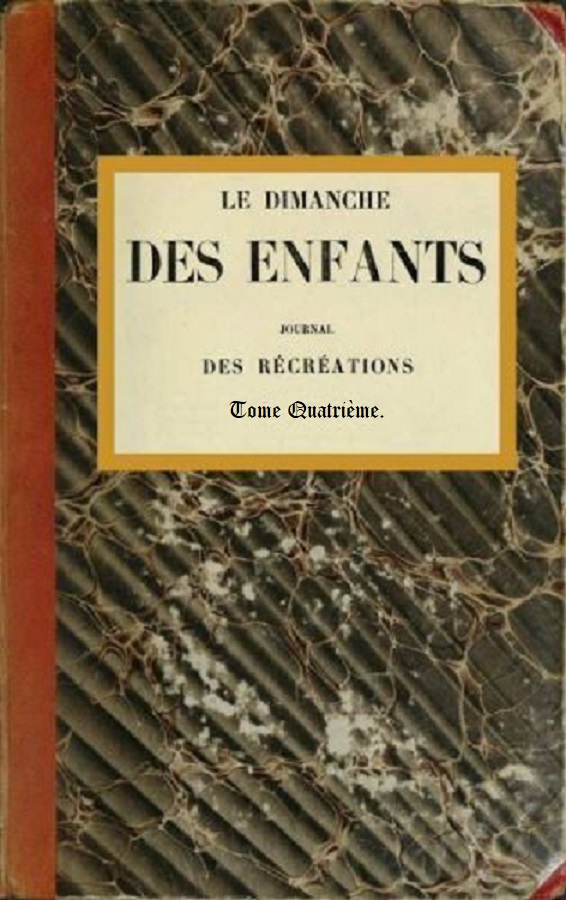
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: Le Dimanche des Enfants-Tome 04 (Le Dimanche des Enfants #4)
Date of first publication: 1840
Editor: Janet, Louis
Author: Guillemart, Charles
Author: Patry, Edouard
Author: Saurel, Agnès
Author: Enduran, Lodoix
Author: Fourtier, Alphonse
Author: Bouchery, Emile
Author: D’Abrantès, Junot
Author: De Latour, A.
Author: Essarts, Alfred des
Author: Essards, Gustave des
Author: Guérin, Léon
Author: Foa, Eugénie
Author: de Mirbel,Léonide
Author: Valchère, Caroline
Author: Bouilly, J. N.
Author: Fouinet, Ernest
Author: De Saint-M***
Author: Barrière, Théodore
Author: Essards, Alfred des
Author: Saunders, Lucy
Illustrator: Lassalle, Louis
Date first posted: February 14, 2025
Date last updated: February 14, 2025
Faded Page eBook #20250210
This eBook was produced by: Marcia Brooks, Cindy Beyer & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
This file was produced from images generously made available by Internet Archive.
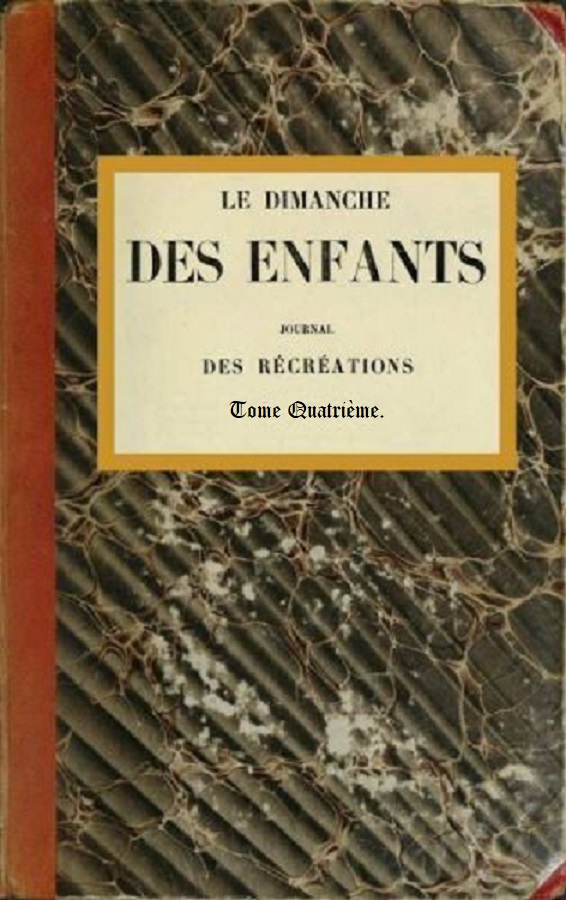
LE DIMANCHE
DES ENFANTS
Imprimerie de Ducessois, 55, quai des Grands-Augustins.
(Près le Pont-Neuf.)
LE DIMANCHE
DES ENFANTS
JOURNAL
DES RÉCRÉATIONS
——
Tome Quatrième.
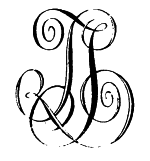
PARIS
VEUVE LOUIS JANET, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
RUE SAINT-JACQUES, 59.
TABLE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME

| Pages | |||
| L’Ange consolateur | 1 | Charles Guillemart. | |
| Histoire du grand-papa Saturne et de ses enfants | 9 | Edouard Patry. | |
| L’Orpheline | 22 | Mme Agnès Saurel. | |
| Je suis heureuse | 35 | Lodoix Enduran. | |
| L’enfant de Pesaro | 36 | Alphonse Fourtier. | |
| Marie, la bonne | 41 | Gustave des Essards. | |
| Saint Nicolas (légende) | 53 | Alphonse Fourtier. | |
| Benjamin Franklin | 57 | Emile Bouchery. | |
| L’ermite et le paysan | 64 | Anonyme. | |
| La Blanche-Nef | 65 | Mme Junot d’Abrantès. | |
| La leçon maternelle | 72 | A. De Latour. | |
| Pauvre Étienne | 73 | Alfred des Essarts. | |
| Juan le capitaine | 90 | Charles Guillemart. | |
| Julien l’auvergnat | 98 | Gustave des Essards. | |
| Bergeronnette et la vraie Fée | 105 | Léon Guérin. | |
| Bernardin de Saint-Pierre | 111 | Mme Eugénie Foa. | |
| Le roi coupable et le pâtissier innocent | 121 | Emile Bouchery. | |
| Les fraises | 130 | Mlle Léonide de Mirbel. | |
| Mort d’une poule noire et d’un duc de Bretagne | 140 | Gustave des Essards. | |
| Le singe à Guillaume | 145 | Mme Caroline Valchère. | |
| Le petit pâtre tourangeau | 152 | Alphonse Fourtier. | |
| Les soupes populaires | 155 | J. N. Bouilly. | |
| A brebis tondue, Dieu mesure le vent | 165 | Ernest Fouinet. | |
| La paire de sabots | 174 | De Saint-M***. | |
| Les deux bouquets | 177 | Théodore Barrière. | |
| Le petit Bas-Normand | 183 | Alphonse Fourtier. | |
| Le morne aux chacals | 189 | Mme Caroline Valchère. | |
| Tout pour Arthur | 198 | Alfred des Essards. | |
| Pauvre mère! | 206 | Mlle Lucy Saunders. | |
FIN DE LA TABLE.
LISTE
DES VIGNETTES DE CE VOLUME.
DESSINS DE M. LOUIS LASSALLE.

| Pages | ||
| 1. | L’ange consolateur | 1 |
| 2. | L’orpheline | 22 |
| 3. | L’enfant de Pesaro | 36 |
| 4. | Marie la bonne | 41 |
| 5. | La Blanche-Nef | 65 |
| 6. | Pauvre Étienne | 73 |
| 7. | Juan le capitaine | 90 |
| 8. | Bergeronnette et la vraie Fée | 105 |
| 9. | Bernardin de Saint-Pierre | 111 |
| 10. | Les fraises | 130 |
| 11. | Les soupes populaires | 155 |
| 12. | Les deux bouquets | 177 |
| 13. | Le morne aux chacals | 189 |

L’Ange consolateur.
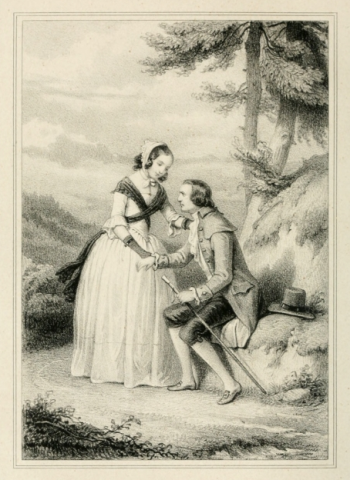
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Vous ne mourrez point lui dit-elle, et sous peu de jours vous reverrez Henri.» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
LE
DIMANCHE DES ENFANTS
JOURNAL DES RÉCRÉATIONS

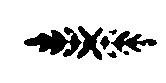
C’était à la tombée du jour. Un homme d’une quarantaine d’années se promenait à pas lents sur le versant d’une des plus riantes collines de la Suisse. Son visage respirait la souffrance; sa maigreur était extrême, et sa main droite s’appuyait tremblante sur une canne à pomme d’argent; sa main gauche avait pour soutien le bras d’une jeune fille de la plus grande beauté. Elle était silencieuse, cette jeune fille, et bien triste comme son compagnon sur qui elle portait à la dérobée ses yeux mouillés de larmes. Elle le voyait si malade! Elle savait que les médecins l’avaient condamné, et cet homme était son père...
M. Dargy était, ce soir-là, plus accablé qu’à l’ordinaire. Il avait reçu, le matin, de son fils Henri dont il pressait depuis longtemps le retour, une lettre, qui ne lui prouvait que trop que l’amour des plaisirs lui faisait oublier, à Paris, les devoirs les plus sacrés de la piété filiale. Ne voulant point affliger Julia, sa fille bien-aimée, il put, jusqu’à la nuit, refouler dans son cœur les douloureuses nouvelles qu’il avait reçues; mais, au moment de regagner son chalet, il ne fut plus maître du chagrin qui l’oppressait; il s’arrêta, et dit à sa fille: «Julia, je mourrai sans embrasser Henri; il ne quittera Paris que dans dix jours!
—Il lui est impossible, sans doute, de partir plus tôt...
—Impossible! qui peut donc empêcher un fils d’accourir vers son père malade! Non; Henri ne m’aime plus! que lui font mes souffrances, mes derniers instants? Je te le répète, Julia, je mourrai sans le voir...»
En prononçant ces mots, M. Dargy laissait couler d’abondantes larmes. Julia pleurait aussi; mais, comprimant avec violence la peine qu’elle éprouvait, elle essaya de consoler son père, et de faire revivre, en son cœur, l’espérance qui s’éteignait: «Vous ne mourrez point, lui dit-elle; et, sous peu de jours, vous reverrez Henri; il se joindra à moi pour vous guider dans les sentiers fleuris, sur les montagnes, dans les vallons. Les soins les plus tendres ne vous manqueront pas, et, avant l’automne, vous rentrerez dans notre beau pays de France. Soyez donc moins soucieux, mon bon père, oubliez vos chagrins.»
M. Dargy se laissa bercer, cette fois encore, par les douces paroles de sa fille, et, moins triste, il regagna sa modeste demeure. Avant de se coucher, Julia se hâta d’écrire à son frère une lettre très-pressante, et l’envoya, le soir même, à la ville la plus voisine. Dès sa réception, Henri se mit en route pour la Suisse.
M. Dargy, qui l’attendait sur son lit de mort, le reçut avec la joie la plus vive. Près de rendre le dernier soupir, il le bénit, et dit à Julia: «Ma fille, Henri a perdu la meilleure des mères, demain je ne serai plus; seule, tu lui resteras: j’ai confiance en ton amour; promets-moi donc de veiller constamment sur lui, et je mourrai consolé.»
Julia n’eut pas de peine à faire une semblable promesse à son père, qui expira bientôt dans ses bras.
Cette vertueuse jeune fille, après avoir rendu les derniers devoirs à l’auteur de ses jours, revint habiter, sous la protection d’un tuteur respectable, une petite ville située à dix lieues de la capitale. Henri, qu’on avait eu le grand tort d’émanciper, rentra dans Paris, où il ne tarda pas à s’abandonner à tous les écarts d’une jeunesse fougueuse. Les conseils de sa sœur ne purent, un seul instant, l’arrêter sur le penchant de sa ruine; elle fut consommée au bout de trois ans.
Se voyant sans ressource, n’osant plus vivre dans la société de ceux qui avaient été les témoins de son luxe et de ses profusions, Henri résolut d’embrasser la carrière militaire. Julia, qui avait fait des efforts inutiles pour prévenir sa perte, le supplia d’accepter auprès d’elle une existence paisible jusqu’à ce qu’elle pût, devenue majeure, partager avec lui sa fortune; il repoussa cette offre généreuse, et s’enrôla.
A cette époque (c’était au commencement du règne de Napoléon), vingt peuples étaient sous les armes; les batailles, les triomphes, les défaites se succédaient de toutes parts avec rapidité, et les jeunes gens, ambitieux, nourrissaient, au milieu de cette grande agitation de toute l’Europe, l’espoir de se créer une position brillante. Henri était instruit, courageux; en peu de mois, il parvint au grade d’officier. Bientôt après il quitta la France pour entrer en Espagne. C’est là que s’évanouirent ses hautes espérances: blessé et fait prisonnier dans un combat sanglant, on le conduisit dans l’île à jamais célèbre de Cabréra, où, fort heureusement pour lui, il demeura peu de temps, car il fut du nombre des huit cents Français que les Anglais transportèrent à Portsmouth, en 1810. On l’envoya dans l’intérieur des terres avec tous les officiers; mais il tenta de s’échapper; alors on le ramena bientôt à Portsmouth; il y fut jeté dans le château de Portchester où gémissaient déjà des milliers de Français. Les chagrins, les mauvais traitements et les privations de toute nature ne tardèrent pas à l’abattre; bref, il eût succombé à ses souffrances sans un ange consolateur, que le ciel lui envoya dans son infortune.
Julia, qui n’avait cessé de le pleurer, avait appris enfin en quels lieux il était captif. Libre, maîtresse de sa fortune et ne consultant que l’impulsion de son cœur, elle partit pour la Hollande, d’où, avec l’aide d’une famille respectable, elle put se rendre en Angleterre. Des obstacles sans nombre l’attendaient dans ce pays; elle les surmonta tous, et arriva à Portsmouth au mois de juillet 1813.
Sans avoir pris un seul instant de repos, elle se dirigea vers le château de Portchester, et s’arrêta au delà du village de Portchester-Castle, en attendant l’heure du marché, qui s’ouvrait à neuf heures du matin[1]. Les marchands anglais affluaient déjà de tous côtés; une femme, âgée de près de soixante ans, portant deux petits paniers remplis de fruits, aperçut Julia; et, après l’avoir suivie quelque temps des yeux, elle s’approcha d’elle, et lui dit: «Parlez-vous anglais, ma belle demoiselle?
—Oui, madame, répondit Julia.
—Écoutez-moi donc, reprit la marchande. Vous êtes Française, votre costume anglais ne saurait m’abuser; vous êtes venue en ces lieux tout exprès pour voir un père ou un frère.»
Julia, émue et surprise, hésitait à répondre; la marchande ajouta: «Croyez-le bien, ma fille, je ne viens pas ici pour espionner. Ayez confiance en moi; j’aime les Français en dépit de toute l’Angleterre. La marchande Makely est pauvre; mais elle a bon cœur, et elle vous offre ses services. Voyons, ma chère demoiselle, regardez-moi bien, et contez-moi vos peines à voix basse.» Julia, ne doutant point de la sincérité de la vieille marchande, avoua franchement le but de son voyage et les espérances qu’elle avait conçues.
La bonne Makely lui dit alors, après l’avoir écoutée attentivement: «Vous n’avez point de retraite sûre, je vous offre ma pauvre maison, elle est à vous. Vous voulez délivrer votre frère; vous réussirez, grâce à l’or que vous possédez, et surtout grâce à moi, car, dussé-je devenir le jouet de la populace de Portsmouth, je vous aiderai à sauver un Français. Ah! ah! notre gouverneur traite trop mal ses prisonniers... M’est avis qu’il ne faut pas se montrer cruel envers des malheureux... et puis, j’ai une dette à payer, moi!...»
La marchande Makely essuya quelques larmes qui venaient de s’échapper de ses yeux, et reprit aussitôt: «Hélas! j’avais un fils qui servait dans la marine du roi, il y a bien longtemps de cela; il fut pris dans un combat naval par les Français, qui l’emmenèrent dans leur pays. Traité avec bonté par les vainqueurs, le pauvre garçon ne se plaignait de sa captivité que parce qu’elle le séparait de sa mère. En pensant à elle, il pleurait et se sentait mourir. Un sergent de France eut pitié de ses maux, lui donna tout l’argent qu’il possédait et me le renvoya. Ai-je pu oublier un tel bienfait, surtout depuis que mon pauvre enfant, mort il y a peu d’années, m’a dit avant d’expirer, les larmes aux yeux et la main sur le cœur: «Mère, si vous rencontrez jamais un Français dans la peine, vous le secourrez pour l’amour de moi; vous me le promettez, n’est-ce pas...» Ombre chérie! mon pauvre fils! réjouis-toi; car j’ai déjà tenu ma promesse; mais ma dette n’est pas encore payée; aussi, ma belle demoiselle, M. Henri sera bientôt libre; je vous apprendrai à tromper la vigilance de nos gardiens... Ecoutez... la cloche se fait entendre, le marché s’ouvre: prenez un de mes paniers, suivez-moi, et, sans parler, jouez un petit rôle de marchande, afin que de mauvaises gens ne fassent pas attention à vous.»
En un instant, les marchands anglais eurent étalé leurs boutiques ambulantes tout le long des palissades; les portes du château s’ouvrirent ensuite aux prisonniers, qui vinrent faire choix des objets dont ils avaient besoin. Bientôt Julia découvrit son frère; elle allait se précipiter vers lui, l’appeler; Makely l’arrêta: «Laissez-moi faire, lui dit-elle, et attendez-moi là.» Alors l’excellente femme se rapprocha de la palissade, et, par ses gestes multipliés et ses petites agaceries de marchande, elle réussit enfin à attirer Henri auprès d’elle. Elle lui vanta d’abord à haute voix la beauté de ses fruits; puis elle en vint à l’entretenir, à voix basse, de choses bien autrement intéressantes. Quand elle l’eut préparé au bonheur qui l’attendait, elle fit approcher Julia, dont la présence et les paroles affectueuses rendirent au prisonnier toutes ses espérances.
Avant de s’éloigner, mademoiselle Dargy promit de revenir chaque matin, et vous pensez bien qu’elle tint parole. A dater de ce jour, Henri n’eut plus à désirer que la liberté; car, grâce à l’argent de sa sœur, il ne manquait de rien, et cette douce liberté, qu’il appelait de tous ses vœux, ne pouvait tarder à lui être rendue. Au bout de deux mois, Julia avait gagné, à prix d’argent, un des gardiens du château. Un soir, à la sortie du théâtre de Portchester[2], Henri, à qui on avait procuré un costume anglais, se mêla aux étrangers qui assistaient à la représentation, et s’évada ainsi de la forteresse, sans exciter les soupçons des soldats.
Julia, qui l’attendait au village de Portchester-Castle, le conduisit dans la maison de Makely, où il demeura caché pendant plusieurs mois. Le moment de partir secrètement pour Londres était enfin arrivé, lorsqu’on apprit l’entrée des puissances étrangères à Paris. Cet événement extraordinaire ouvrait à tous les Français les prisons d’Angleterre; Henri put, dès lors, reparaître sans danger dans Portsmouth, et s’occuper avec sécurité des apprêts de son départ. Julia fit tout pour décider la bonne Makely à la suivre en France; n’ayant pu y parvenir, elle laissa à cette excellente femme une somme d’argent assez considérable qui la mit à l’abri du besoin pour le reste de ses jours: ensuite elle s’embarqua avec Henri sur un vaisseau anglais. Elle revit sa patrie dans les derniers jours du mois de mai 1814.
Revenue aux lieux qui l’avaient vue naître, Julia espéra vivre désormais tranquille en continuant de veiller sur son frère, qu’elle avait déjà sauvé de tant de malheurs; elle lui fit don de la moitié de sa fortune. Cette fois, Henri promit d’user noblement des biens qu’il tenait de la générosité de sa sœur; pendant près d’une année, en effet, sa conduite fut irréprochable. Julia, qui s’était fixée à Paris pour le voir plus souvent, crut à la sincérité de ses promesses; on la trompait. Henri se fatigua des douceurs d’une vie paisible; les désirs de sa première jeunesse se réveillèrent tout à coup; il se rapprocha des anciens compagnons de ses plaisirs; il fut perdu.
Ruiné pour la seconde fois, le malheureux eut encore recours à sa sœur, qui ne sut rien lui refuser; il abusa de ses nouveaux bienfaits, et elle ne se plaignit pas, et lorsqu’elle fut réduite enfin à la nécessité de travailler pour vivre, Julia, la pauvre Julia ne songea même encore qu’aux besoins de son frère, dont elle espérait toujours toucher le cœur par sa patience et son dévouement.
Hélas! bientôt elle ne le revit plus, ce frère ingrat! en vain le chercha-t-elle de tous côtés! Alors sa douleur fut extrême; ses larmes ne cessèrent de couler nuit et jour. Un soir d’hiver, elle entendit frapper rudement à sa porte; elle ouvrit toute tremblante, et un vieillard pâle, agité, s’offrit à ses regards, et lui dit: «M. Henri, votre frère, qui souffre tant depuis qu’il habite le misérable toit où je suis né, m’a remis, il y a au plus une heure, une lettre pour vous: «Père Julien, m’a-t-il dit d’une voix affaiblie, je sens que ma vie touche à sa fin; dans quelques jours, demain peut-être, je ne serai plus. Avant de quitter ce monde, j’ai voulu faire mes adieux à ma tendre sœur; ma main défaillante vient donc de tracer cette lettre; vous la lui porterez quand j’aurai rendu le dernier soupir, et lui direz que son frère est mort accablé de regrets et de repentir.» Après avoir prononcé ces mots, M. Henri m’a serré la main, puis il est retombé tristement sur son grabat. Le pauvre jeune homme! il serait cependant bien à plaindre de mourir ainsi loin de sa sœur, qu’il n’ose appeler près de lui parce qu’il l’a trop offensée! Non, cela est impossible... Aussi n’ai-je pas voulu attendre; voici la lettre; mademoiselle, lisez-la, et venez, je vous en prie, consoler votre frère...»
Julia prit la lettre, la lut en versant d’abondantes larmes; elle dit ensuite au père Julien: «Merci, bon vieillard, merci de votre amitié pour Henri... hâtons-nous de sauver ce frère tant aimé; il en est temps encore...» Et, entraînant le vieillard sur ses pas, elle s’élança vers le faubourg Saint-Antoine. Il était plus de dix heures du soir, lorsqu’elle pénétra dans l’allée obscure d’une petite maison, située tout près de la barrière du Trône. Épuisée de fatigue et brisée de tant d’émotions, elle gravissait péniblement les marches difficiles d’un escalier étroit et sombre, quand une femme très-âgée, sortie soudain de sa chambre, s’écria d’une voix désespérée: «Vous arrivez sans doute trop tard, ma pauvre enfant.
—Hélas! serait-il mort? interrompt le père Julien consterné.
—Non, non, reprend Julia, suivez-moi...»
Et la courageuse jeune fille s’élance vers la chambre qu’on lui a indiquée; elle ouvre la porte et voit étendu sur un misérable grabat, son frère qu’elle cherche depuis si longtemps: «Henri!» s’écria-t-elle en se précipitant vers le mourant...
A la voix de sa sœur, Henri soulève sa tête, et, tout tremblant, il répète: «Julia, Julia! que viens-tu faire ici...? Qui t’a envoyée vers moi...?
—C’est le ciel, ô mon frère! le ciel qui veut que tu vives pour mon bonheur.» En prononçant ces mots, Julia inonde de ses larmes le mourant, dans le sein duquel elle rappelle enfin la vie par ses consolantes paroles, par ses douces caresses.
Lin mois après cette entrevue touchante, Henri avait recouvré la santé. Dès lors commença pour lui une existence toute nouvelle; ses talents, son zèle, son activité, ramenèrent peu à peu l’aisance autour de lui, et chaque soir il put s’entretenir, à côté de sa sœur, de l’avenir le plus riant. Il habite aujourd’hui une campagne agréable, où ses modestes désirs sont toujours satisfaits; le père Julien, qui ne le quitte jamais, l’égaie par ses bons mots, et Julia, l’heureuse Julia continue de l’entourer de sa tendresse et de ses soins, qui font, pour lui, de cette terre un véritable paradis.
Mes jeunes amis, que les infortunes de Henri vous soient une leçon utile! Souvenez-vous que toute faute appelle un châtiment, et que l’inconduite ne procure que chagrins et remords. Heureux celui qui revient à la vertu après avoir commis de grandes fautes; mais plus heureux encore celui qui a toujours laissé couler ses jours au sein de la paix et de la sagesse!... Et vous, mes jeunes lectrices, n’oubliez pas les belles actions de la sœur de Henri. Si Dieu devait mettre un jour votre dévouement à semblable épreuve, vous ne reculeriez pas, n’est-il pas vrai, devant tous les sacrifices qui vous seraient imposés: vous seriez douces, patientes, résignées, et, comme Julia, vous mériteriez le nom d’anges consolateurs.
[1] A midi, la cloche annonçait le départ des marchands anglais, auxquels succédaient les Français chargés de vendre les produits de l’industrie des prisonniers. On trouvait dans ce second marché des chapeaux, des gants, des tabatières, et surtout de la dentelle, à la fabrication de laquelle trois mille hommes étaient occupés.
[2] Les prisonniers avaient fondé un théâtre qui eut, dans le pays, un succès extraordinaire.

«Allons, femme, pourquoi tout ce chagrin? il faut bien accomplir une promesse d’où dépend notre bonheur! Donne-moi donc ce petit mioche! que je le dévore, comme les autres!... Je n’ai que trop tardé pour mon honneur... Trois jours!... De quoi ne serait pas capable mon frère aîné Titan, s’il revoyait encore aujourd’hui cet enfant? hier, ne le regardait-il pas déjà de travers?»
Celui qui parlait ainsi était Saturne, roi du ciel, de la terre, des enfers et des mers, vieillard à cheveux blancs, tenant une faux dans sa main droite, et, de sa gauche, un serpent qui se mordait la queue. Il s’adressait à sa femme Cybèle, bonne grosse maman, assise dans un char traîné par deux lions et poussé par la troupe légère des vents, jeunes et jolis garçons, quoique un peu joufflus.
«Hélas! soupira Cybèle, quelle cruauté! Ne pourriez-vous tromper votre frère, et, par quelque ruse, conserver au moins la vie à ce pauvre enfant?
—Y songes tu? Titan y voit trop clair! et, que deviendrait ma couronne, s’il se doutait seulement que je pusse le tromper! Tu sais bien qu’il ne me l’a cédée qu’à la condition que je dévorerais tous mes enfants mâles. Jusqu’ici j’ai loyalement tenu ma parole; j’ai croqué mes deux premiers garçons, Neptune et Pluton; il faut que ce petit Jupiter y passe à son tour: sinon, plus de trône pour moi, plus de royaume...
—Ah! rendez ce trône à votre frère, plutôt que de faire ce vilain métier d’ogre.» Puis, serrant avec force son enfant dans ses bras: «Non, mon enfant, tu ne mourras pas; ma tendresse saura déjouer de si cruels desseins!»
—Eh! pourquoi te plaindre, femme adorée? n’as-tu pas deux filles que tu aimes, qui te consolent de la perte de tes garçons? N’as-tu pas Vesta et Junon... laisse donc les choses suivre leur cours, et donne-moi vite cet enfant!»
Et, disant ces mots, il s’avançait pour saisir le petit Jupiter, qui poussait des cris horribles, lorsqu’un grand bruit se fit entendre. Cybèle, heureuse d’un contre-temps qui lui offrait l’occasion et le loisir d’exécuter certain projet qu’elle venait de concevoir, se retira dans son palais. A peine fut-elle partie, qu’après une violente secousse, les portes du ciel s’ouvrirent, et Titan entra.
C’était un géant, haut comme douze fois les tours de Notre-Dame. Il tenait à la main une épée nue, longue d’une demi-lieue; à sa ceinture pendait un petit pistolet, à peu près grand et gros comme la colonne de la place Vendôme. Il se plaça, d’un air menaçant, en face de Saturne, qui, se sentant coupable, tremblait alors de tous ses membres; puis, agitant sa terrible épée au-dessus de sa tête, il lui cria enfin d’une voix de tonnerre:
«Eh bien! frère, as-tu fait ton devoir?... As-tu dévoré ce fils qui t’est né, il y a trois jours?... Tu ne réponds pas... Je vois à ton silence que tu as violé tes serments... ne cherche pas à t’excuser... Ah! je sais d’avance que tu vas en rejeter la faute sur ta femme... tu n’en es que plus coupable... Retiens donc ceci: dans une demi-heure, si cet enfant, que je déteste, existe encore, ton sort est entre mes mains, et, alors, je serai impitoyable... non-seulement je reprends mes droits à la couronne; mais, pour t’apprendre à vivre, je te mets à mort, toi et toute ta famille.» Puis, sans ajouter un mot de plus, il descendit du ciel sur la terre en trois enjambées.
Une fois seul, Saturne, bien moins effrayé des menaces de son frère que honteux d’avoir paru manquer à sa parole par pure faiblesse pour sa femme, se hâta d’aller chez Cybèle; et, se précipitant sur elle, sans lui laisser le temps de se reconnaître, sans même lui adresser un mot, il lui arracha soudain d’entre les bras le pauvre entant qui, cette fois, ne poussa pas le plus petit cri et se laissa avaler le plus gentiment du monde. Cybèle, elle-même, comme persuadée que la résistance ne servirait de rien, laissa faire son mari avec tant d’impassibilité, que celui-ci, tout glorieux d’une pareille obéissance, l’embrassa tendrement pour sécher ses larmes, et lui demanda même pardon de la violence avec laquelle il lui avait enlevé l’enfant. Puis, la conscience aussi nette que s’il eût fait un repas ordinaire, il envoya à Titan un message pour le prévenir que tout était en ordre.
Il y a bien longtemps de cela; le Ciel, le plus ancien et le plus puissant des dieux, épousa la Terre, la plus ancienne et la plus puissante des déesses. Vivant toujours en parfaite harmonie, ils eurent six enfants; trois garçons: Titan, Saturne, l’Océan; trois filles: Cérès, Thétys et Cybèle. D’après une fort ancienne coutume abolie, du reste, depuis quelques milliers de siècles, Saturne, devenu grand, épousa sa sœur Cybèle, et l’Océan, sa sœur Thétys. Quant à Titan, il était si laid et si monstrueux, que Cérès ne voulut jamais se marier avec lui.
Après avoir longtemps et très-sagement gouverné le monde, le vieux Ciel voulut enfin se reposer. Il était décidé à résigner le souverain pouvoir entre les mains de son fils aîné Titan, lorsque la Terre, qui n’aimait pas cet enfant à cause de la violence de son caractère, supplia instamment son mari de céder le trône à son second fils Saturne, sous le prétexte qu’étant plus doux, plus humain, il serait plus capable de le remplacer dignement; mais, en réalité, parce qu’elle l’aimait beaucoup et qu’il était d’ailleurs marié à Cybèle, sa fille chérie. Le vieillard se laissa facilement persuader par sa femme; mais il ne fut pas aussi aisé de faire consentir Titan à se dessaisir de son droit d’aînesse; il ne le céda qu’à la condition que Saturne n’élèverait aucun enfant mâle, afin qu’après lui la couronne retournât dans la famille des Titans; et, pour être bien assuré du strict accomplissement de cette condition, Saturne devait dévorer lui-même tous les garçons qui lui naîtraient. Voilà pourquoi Titan était sans cesse aux aguets. Aussi, dès que Cybèle donnait un garçon à Saturne, cet excellent frère ne manquait-il jamais de monter bien vite au ciel pour être bien sûr qu’on ne lui manquait pas de parole; et toujours Saturne accomplissait religieusement sa promesse. Il avait déjà dévoré, comme nous l’avons dit, ses deux premiers garçons, Neptune et Pluton; et s’il avait tant tardé à en faire autant de Jupiter, c’est qu’aussi jamais Cybèle ne s’était montrée si suppliante; nous avons vu que la visite de Titan avait tout régularisé.
A peine celui-ci, pleinement rassuré par la nouvelle que lui avait fait parvenir Saturne, se fut-il en allé bien loin pour surveiller ses ouvriers qui élevaient, en ce moment, presque jusqu’au ciel, les murs de son palais, que Cybèle, enveloppée dans un grand manteau, et d’un air mystérieux, d’un pas furtif, descendit sur la terre, dans l’île de Crète; et là, rencontrant sur le mont Ida des bergers qui dansaient en chantant et battant des mains, elle leur imposa silence, les réunit autour d’elle, et leur dit à voix basse et les larmes aux yeux:
«Heureux mortels, vous chez qui l’ambition n’a pas étouffé le cri sacré de la nature, ayez pitié d’une mère éplorée, condamnée à voir périr tous les garçons que le Destin lui envoie. Reine du monde entier, je ne puis conserver la vie aux enfants mâles que j’ai portés dans mon sein; une loi inexorable leur inflige la mort la plus cruelle, dès qu’ils ont vu le jour. Déjà j’ai été mère de trois garçons: deux, hélas! je frémis de le dire, ont été dévorés par leur père, le grand roi Saturne; et le troisième qui devait subir le même sort, que son père et surtout son oncle Titan croient mort à jamais, le voilà, bergers Crétois, le voilà, c’est Jupiter... c’est mon fils... il a trois jours... je vous le confie... élevez-le parmi vous... mais, cachez-le bien... que jamais son existence ne soit seulement soupçonnée du reste de sa famille!» Et, en disant ces mots, elle présentait, aux bergers attendris, un joli petit enfant qu’elle venait de tirer de dessous son manteau. C’était bien Jupiter, frais comme une rose, riant à se fendre la bouche jusqu’aux oreilles.
Cybèle, au moment où elle s’était réfugiée dans son palais, l’avait soigneusement caché pour le soustraire à tous les regards; et, ne doutant pas qu’après son entrevue avec Titan, son vorace mari ne vînt le croquer encore pour contenter son frère, elle avait mis sur ses genoux, à sa place, une grosse pierre bien emmaillotée, qu’elle berçait amoureusement, quand Saturne vint la lui arracher avec tant de violence. Grâce à la précipitation aveugle de son mari, la ruse avait parfaitement réussi; et le gosier du dieu du ciel, élargi déjà par le passage qu’avaient dû s’y frayer Neptune et Pluton, avait très-aisément englouti la pierre. Nous apprendrons plus tard si elle fut bien digérée.
Émus jusqu’aux larmes, les bergers promirent donc à Cybèle d’élever son fils avec le plus grand soin, et surtout dans le plus rigoureux silence. Mais, comme l’enfant, en criant et pleurant (tâche dont il s’acquittait fort bien,) quoique fils d’un dieu courait risque de se faire entendre, soit de Saturne, soit de Titan, ils convinrent avec la mère que, chaque fois que le petit dieu ferait le méchant, ils étoufferaient ses cris en se livrant à la danse bruyante et singulière au milieu de laquelle ils avaient été surpris.
Ce témoignage d’intérêt toucha vivement le cœur de la bonne déesse; elle adressa aux Crétois, gardiens de son fils, les remerciements les plus affectueux, et, pour ne pas éveiller les soupçons de Saturne par une trop longue absence, elle remonta dans le ciel à la hâte.
La manière dont Jupiter fut élevé, ne fit que justifier toute la confiance qu’avait témoignée Cybèle aux bergers de l’île de Crète; ils tinrent si fidèlement les promesses qu’ils avaient faites à la grande déesse! Jamais on ne vit plus de soins empressés, plus de sollicitude autour d’un berceau. Deux jeunes filles, Adrastée et Ida, les plus jolies qu’on eût put trouver, d’ailleurs si douces et si bonnes qu’on les surnomma les Mélisses (du mot met, qui signifie miel), se tenaient constamment près de lui, prévenant ses moindres besoins, ses moindres désirs; l’amusant, le berçant et le couvrant de mille baisers s’il lui arrivait de faire la plus petite moue, tant elles craignaient de l’entendre pleurer! Dans un antre profond, appelé Dicté, elles lui avaient dressé un berceau de feuillages, qu’elles tapissaient à toute heure de fleurs nouvellement écloses; et c’est lorsqu’il était mollement étendu sur cette couche parfumée, qu’elles lui amenaient sa nourrice, la chèvre Amalthée, dont le lait vivifiant le rendit, en peu de temps, si fort et si vigoureux.
Malheureusement, ces prévenances outrées à l’excès, tout en développant d’une manière surprenante les qualités physiques du petit dieu, gâtèrent horriblement son moral. Habitué à voir tout céder à ses caprices, il devint opiniâtre, emporté et colère; rien ne devait lui résister; et, comme s’il eût compris que son silence devait être obtenu à tout prix, il le faisait payer cher. A tout moment, pour les motifs les plus futiles, c’étaient des cris, des pleurs qu’on s’empressait d’apaiser ou au moins d’étouffer. Les bergers, qui avaient sans cesse présente à la mémoire la recommandation de Cybèle, faisaient tous leurs efforts pour empêcher le petit Jupiter de se faire entendre de son père ou de son oncle; mais ce n’était pas pour eux chose facile. Déjà, épuisés de fatigue, tant il leur fallait danser de fois dans un jour, et dans l’impossibilité d’ailleurs de couvrir, par leurs chants et leurs battements de mains, la voix de plus en plus criarde de Jupiter, ils avaient inventé une autre espèce de danse, dans laquelle ils frappaient à coups redoublés sur des boucliers d’airain. Néanmoins (tant est puissante la voix d’un dieu, quelque petit qu’il soit), il arriva plus d’une fois que Cybèle tressaillit sur son char aux cris de son fils, et, même au risque d’éveiller les soupçons de Saturne, qu’elle le quittât brusquement pour venir en Crète apaiser elle-même le chagrin du méchant petit Jupiter. Aussi, malgré ses excessives précautions, cette bonne mère vivait-elle dans une inquiétude perpétuelle.
Un soir d’été, après une journée des plus mauvaises, pendant laquelle Cybèle impatientée avait fait plus de vingt fois rouler son char dans le ciel pour étourdir Saturne, Adrastée et Ida faisaient prendre le frais au petit Jupiter, afin de calmer ses nerfs irrités; il pouvait avoir alors de quatre à cinq ans. La promenade produisait en lui un effet merveilleux; la douceur de l’atmosphère, le calme de la nature, semblaient pénétrer dans son âme; il riait, causait, jouait paisiblement; enfin, chose étonnante! il était gentil depuis un grand quart d’heure. Déjà les Mélisses présageaient une nuit tranquille; de leur côté, les bergers, auxquels leurs fonctions fatigantes avaient fait donner le nom de Corybantes, avaient aussi détaché leurs lourds boucliers pour aller se livrer au sommeil dont ils étaient si souvent privés, lorsque tout à coup la Lune, que des nuages avaient cachée jusqu’alors, brilla de son plus vif éclat, et vint se refléter aux pieds du petit dieu, dans un ruisseau au bord duquel il jouait.
O Lune! tu fus, en cette nuit fatale, la cause et le témoin de bien des malheurs!
Soit que le fils de Saturne eût senti bouillonner en lui le sang des dieux, soit qu’il eût désiré seulement avoir un jouet nouveau et brillant, il se baissa pour ramasser la lune qu’il voyait dans l’eau. «Ça, ça, s’écriait-il en se démenant et gesticulant: la lune!... je veux la lune!... prenez la lune!... donnez-moi la lune!...» Et il tirait Adrastée et Ida, par leurs robes, pour les faire aller plus vite. Celles-ci, voyant avec effroi qu’une crise se préparait, crise d’autant plus violente qu’il leur était cette fois impossible de satisfaire aux désirs du petit obstiné, firent semblant de chercher à la prendre, tout en lui donnant des bonbons et des gâteaux pour détourner le cours de ses idées; mais quand Jupiter, après avoir tout mangé, s’aperçut que la lune leur échappait aussi bien qu’à lui, il entra dans une colère terrible, se mit à pousser des cris perçants, à trépigner des pieds, à grincer des dents, à battre ses Mélisses, sa bonne chèvre, et jusqu’aux corybantes qui commençaient déjà leur affreux tintamarre avec les boucliers; et, à chaque coup, à chaque cri, il demandait la lune. En vain ses bonnes gouvernantes cherchaient-elles, par tous les moyens possibles, à lui faire comprendre qu’il était impossible de lui donner la lune; et, pour compenser cette petite privation, lui promettaient-elles les jouets les plus beaux; rien ne pouvait apaiser sa colère; il ne répondait toujours que par ces cris: «Je veux la lune, je la veux, donnez-la-moi;» et il ne cessait de crier toujours de plus en plus fort. Les corybantes suaient sang et eau; il fallait les voir se démener, frapper à coups redoublés leurs singuliers instruments, chanter, crier à réveiller les morts... mais tout fut inutile. Il arriva un moment où Jupiter monta sa voix sur un diapason si aigu que toute la vallée en retentit, et que l’écho la répéta au loin sur les montagnes. Par malheur Titan n’était pas fort éloigné.
Surpris d’entendre des cris si puissants, quoique poussés par un enfant, il fait quelques pas vers le lieu d’où ils partent, prête une oreille plus attentive, et entend le concert que font les corybantes pour les couvrir. Dès lors, il soupçonne quelque ruse. D’une enjambée, il traverse la mer qui le sépare de l’île de Crète, et paraît tout à coup au milieu de la scène que nous avons décrite.
«Quel est cet enfant qui trouble ainsi mon sommeil? crie-t-il d’une voix de canon, en lançant des regards terribles sur cette foule naguère si animée, maintenant silencieuse et tremblante... Quel est son père? Ah! vous ne répondez pas... Eh bien! je le saurai, ou il mourra!»
Et, prenant l’enfant par le milieu du corps, il se disposait déjà à l’écraser, comme une mouche, entre ses doigts, lorsque les Mélisses effrayées s’écrièrent: «C’est Jupiter, c’est le fils de Saturne.» «Jupiter! je m’en doutais, murmura Titan; mais... je vais me venger!»
Prompt comme l’éclair, il emporte avec lui Jupiter, grimpe au ciel plutôt qu’il n’y monte, fait voler les portes en éclat, se fraie partout un passage, en foulant sous ses pieds les sentinelles endormies, et pénètre jusqu’auprès de Saturne, que Morphée, c’est-à-dire le sommeil, tenait mollement dans ses bras. Cybèle avait tout vu du haut du ciel, et elle arrivait tout effarée près de son mari, au moment même où Titan, le secouant rudement par le bras, lui criait, en lui présentant le petit Jupiter, qui tremblait comme la feuille:
«Frère, c’est moi... c’est Titan... réveille-toi... Je viens punir ta trahison et ton mensonge... Ah! tu t’es joué de moi!... tu n’as pas craint ma colère!... subis-en donc aujourd’hui les effets terribles...»
Et Saturne, suppliant, voyait déjà la longue épée de son frère près de le percer, lorsque la généreuse Cybèle, lui faisant un rempart de son corps, s’écria:
«Arrêtez, ô mon frère! je suis seule coupable: c’est à moi seule qu’il faut ôter la vie. Saturne n’a été ni traître, ni menteur; il a cru dévorer son fils; et c’est moi, égarée par mon amour maternel, qui l’ai trompé, en lui donnant une pierre à manger. Epargnez ses jours, et arrachez les miens!» Cela dit, comme épuisée par tant d’efforts, elle alla tomber aux pieds de Titan, qu’elle baigna de ses larmes.
—S’il est vrai, frère, reprit Titan un peu calmé, que tu n’aies pas cherché à me tromper, écoute l’arrêt plus doux, mais irrévocable, que prononce ma justice. Ta bonne foi et le désespoir de ma sœur te sauvent de la mort; mais c’est tout ce que je puis faire pour toi. Je reprends la couronne, dont l’existence de Jupiter te dépossède, d’après nos conditions; et, pour ne plus entendre parler de vous, aussi bien que pour ma sûreté personnelle, je t’emprisonne pour toujours, toi, ta femme, ton fils et tes deux filles dans le noir Tartare.»
Et comme il avait dit, il fit.
Depuis plus de vingt ans déjà, Saturne expiait aux enfers, dans la douleur et les privations, la supercherie de sa femme Cybèle, et Jupiter avait eu le temps de grandir. C’était à vingt-cinq ans un jeune Dieu plein de grâce, de résolution et de courage. Surpris de se trouver dans une position qui ne répondait guère à ses premiers souvenirs d’enfance, il avait souvent questionné sa mère, et il avait appris d’elle, en détail, la terrible histoire de sa famille; ainsi, la cruauté de Titan les avait tous plongés dans un noir cachot, sans leur laisser même l’espoir d’en sortir un jour. Ces récits, plus tard confirmés par son père, par ses sœurs, avaient fait sur lui une impression telle, qu’il n’entendait jamais prononcer le nom de son oncle sans frémir d’indignation; il brûlait du désir de se venger, de venger son père, et de le replacer sur le trône dont il avait été si indignement chassé. Mais quel moyen d’accomplir un si beau dévouement? Seul, sans appui, sans conseils même, car le vieux Saturne subissait son sort avec trop de résignation pour chercher à l’améliorer, Jupiter ne pouvait que concentrer sa rage en lui-même, et attendre des temps meilleurs; ils ne tardèrent pas à arriver.
Parmi les personnes charitables qui venaient, de temps à autre, visiter les illustres bannis dans leur prison, se trouvait une grande dame appelée Métis ou la Prudence. Jupiter, par ses gentillesses lorsqu’il était petit, et plus tard, par son caractère franc et généreux, avait su se faire aimer d’elle; il en recevait toujours des consolations, et souvent aussi des promesses pour un avenir plus heureux.
Un jour, en effet, après une longue conversation dans laquelle il parut à Métis plus noble, plus beau que jamais, elle lui dit d’un ton prophétique: «Jeune dieu, la générosité de vos sentiments m’est un sûr garant que les temps sont venus pour vous d’accomplir les grandes choses auxquelles vous êtes destiné. Prenez-moi ce paquet d’herbes, faites-les bouillir pendant cinq ou six mois, puis donnez-les à boire à votre père. Je n’ai que cela à vous dire; l’événement vous suggérera, en temps et lieu, ce que vous aurez à faire. Adieu, n’oubliez jamais Métis.» Puis, après lui avoir donné un petit paquet bien ficelé, elle lui souffla sur le front, et disparut pour toujours.
Six mois après cette scène singulière, Jupiter présentait à Saturne une coupe remplie, jusqu’aux bords, d’une liqueur jaunâtre. «Buvez, mon père, lui dit-il; la tristesse affaiblit; vous avez besoin de réparer les forces que le chagrin vous ôte.» Mais à peine le vieillard eut-il approché ses lèvres de la coupe, qu’il les retira avec dégoût. «Eh quoi! mon fils! quel est ce poison?—Buvez, père, buvez sans crainte; c’est la bonne Métis qui vous l’envoie, elle ne vous veut pas de mal; d’ailleurs il y a un charme puissant renfermé dans ce breuvage.» Persuadé, ou feignant de l’être, Saturne avala d’un seul trait, non sans faire d’horribles grimaces, la boisson fatale.
Tout à coup, ô prodige! la coupe lui échappe des mains; un tremblement aussi violent que subit s’empare de tous ses membres; d’affreuses coliques d’estomac lui arrachent des cris douloureux; sa bouche s’ouvre, s’agrandit, s’ouvre encore, et, après mille efforts convulsifs, inouïs, il vomit... quoi? la pierre encore tout emmaillotée, ensuite le petit Pluton, puis le petit Neptune. Après quoi sa bouche se referme, les coliques cessent, le tremblement se dissipe, et Saturne se frotte les yeux, comme s’il sortait d’un rêve.
Mais, ô surprise plus grande encore! pendant que Cybèle, Junon et Vesta prodiguent à Saturne des soins dont il n’a que faire, Neptune et Pluton qui, dans la débâcle générale, étaient tombés sur le dos, se roulent, se traînent, détirent leurs membres longtemps engourdis et se relèvent aussi grands, aussi beaux, aussi forts que Jupiter lui-même. «Mes fils, mes chers fils! s’écrie le vieillard, tremblant encore, mais d’émotion, et les serrant tous deux contre son sein; quoi! c’est vous! vous vivez! votre père, que l’ambition avait rendu si cruel à votre égard, peut encore vous embrasser! Quel bonheur est le mien!» Et c’étaient des caresses, des larmes à n’en plus finir. La bonne mère Cybèle couvrait ses deux fils de baisers; Junon et Vesta, les confondant l’un pour l’autre, se les arrachaient. Tout le monde se livrait à la joie la plus vive.
Jupiter seul, qui venait de comprendre, à la vue de ses deux frères, la portée des paroles de Métis, avait conservé son sang-froid. C’est qu’inspiré par la Prudence, il mûrissait un projet important.
En effet, après les premiers moments d’effusion, quand les transports d’allégresse furent un peu calmés; quand Cybèle, assise entre Neptune et Pluton, qu’elle ne pouvait se lasser de regarder, eut fini de bercer, en riant, la pierre au maillot, pour montrer à Saturne comment elle l’avait trompé autrefois; quand Saturne eut enfin déclaré que cette pierre, qu’il nomma Abdir, recevrait les honneurs divins: «Mes frères, dit Jupiter d’une voix solennelle, quoique vous soyez nés avant moi, je suis cependant votre aîné, car votre naissance ne doit en réalité dater que d’aujourd’hui. Ecoutez donc ce que j’ai à vous dire. Notre père Saturne, qui gémit ici dans la captivité depuis vingt ans, était le maître du ciel, de la terre, des enfers et des mers; il avait reçu la couronne de son père, le Ciel; mais son frère Titan, notre oncle, la lui a ravie, parce que moi, Jupiter, je n’ai pas éprouvé le sort cruel que, dans sa faiblesse, mon père vous a fait subir; parce que, je n’ai pas comme vous, été dévoré. Que pensez-vous d’un oncle qui a osé contraindre son frère à commettre de si grands crimes, et qui l’a indignement puni, pour n’avoir pas violé, une troisième fois, les lois de la nature? Ne mérite-t-il pas tout notre courroux? Allons donc venger l’affront fait à notre père, fait à nous-mêmes; que l’odieux Titan, qui tient le monde enchaîné sous sa redoutable tyrannie, reçoive enfin le châtiment dû à ses forfaits.»
Ces paroles enflamment le courage de Neptune et de Pluton; ils se lèvent, l’œil en feu, courent à Jupiter, lui pressent la main, et jurent solennellement tous trois de laver l’insulte faite à leur père, dans le sang du farouche Titan. Puis, sans écouter les tendres adieux de leurs parents, ils brisent les portes de la prison, terrassent les gardiens, montent au ciel, y surprennent leur oncle sans défiance et sans armes, l’enchaînent, le garrottent, le précipitent à son tour dans le Tartare, sous la garde des Hécatonchires, géants qui avaient cent mains; ils poursuivent partout ses partisans, au ciel, sur la terre, aux enfers, et jusque dans les eaux. Ce fut pour eux une rude, mais glorieuse journée.
Après la victoire, Jupiter appelle près de lui Neptune et Pluton: «Frères, leur dit-il, aujourd’hui nous avons conquis le monde entier; nous sommes les plus puissants des dieux. Mais qu’allons-nous faire de notre conquête? la rendrons-nous à notre père, qui s’en est déjà laissé déposséder? Il est vieux, nous sommes jeunes; il est faible, nous sommes forts; à lui le repos, à nous les embarras et le soutien d’un trône non affermi encore, car les Titans ne sont que vaincus; bien que privés de leur chef, ils peuvent relever la tête. Qui les détruira, si ce n’est nous? Restons donc les maîtres du monde, nous l’avons bien gagné; et, pour que notre père ne puisse nous nuire, exilons-le sur la terre... qu’en pensent mes frères?
—Jupiter a deviné nos intentions.» Telle fut la réponse de Neptune et de Pluton.
Quand Saturne entendit son arrêt, il n’en manifesta ni joie ni douleur. Il se retira en Italie, dans une province où régnait Janus, depuis appelée Latium (du mot latin latere, qui veut dire cacher). Ce roi, touché de ses malheurs, lui fit l’accueil le plus amical et partagea même son trône avec lui. Ils régnèrent tous deux avec justice et bonté. Saturne enseigna aux peuples l’agriculture; il inventa la monnaie pour faciliter le commerce, et rendit ses sujets si heureux, qu’on appela âge d’or le temps qu’il passa en Italie. Janus lui-même ressentit les effets de sa bonté. Pour le récompenser du bon accueil qu’il en avait reçu, le père de Jupiter le doua d’une rare prudence, et lui accorda deux visages pour voir en même temps le passé et l’avenir. Il lui donna, en outre, une clef pour ouvrir l’année; en effet, le mois de janvier (en latin januarius) lui est consacré; enfin, il le fit mettre au nombre des petits dieux. Inspiré par la prudence, Janus inventa les couronnes et les barques.
En mémoire du séjour de Saturne dans le Latium, les Romains célébraient, tous les ans, au mois de décembre, des fêtes en son honneur, appelées saturnales. Pendant leur durée, tous les travaux étaient suspendus, les écoles fermées; les maîtres servaient leurs esclaves, et l’on s’envoyait des présents. C’est là l’origine de notre jour de l’an.
Si donc, au commencement de cette histoire, grand papa Saturne nous a fait peur en dévorant ses enfants, nous devons bien l’aimer d’avoir été, dans sa vieillesse, la cause d’une si belle coutume que celle de donner et de recevoir des étrennes et des bonbons au premier jour de l’an.
Ainsi finit l’histoire du grand papa Saturne.
Quant à ses trois fils, ils se partagèrent ainsi le monde: Jupiter, qui s’était montré le plus courageux, fut aussi le plus puissant; il eut le ciel et la terre; Pluton obtint les enfers, et Neptune, les mers.
Cybèle, incapable de nuire à son fils, remonta au ciel, et n’eut d’autre fonction que celle de veiller à la nourriture du genre humain. Junon épousa son frère Jupiter, et Vesta, qui ne se maria pas, devint la déesse du feu et de la virginité.

Paul Romieux, un de ces jeunes garçons sans peur et sans souci, qui marchent fièrement la casquette sur l’oreille, les deux mains dans les poches, en sifflant toujours l’air le plus nouveau; battant de droite et de gauche le pavé de la grande ville, et s’y donnant leurs aises, comme de grands seigneurs sur leurs domaines; insoucieux et folâtres jusqu’à l’insolence, mais ordinairement d’un naturel bon et compatissant.—Paul, enfin, le type peut-être de ces gamins de Paris, dont le nom a fait le tour du monde, passait un soir sa revue sur le boulevard du Temple, au milieu des marchandes d’oranges, de pralines, de sucre d’orge, de bâtons de guimauve, de glaces à la framboise, au citron, à deux liards le verre.
Paul était gourmand, en sa qualité de gamin de Paris, et les glaces surtout, les bienheureuses glaces, tentaient sa convoitise et peut-être aussi sa vanité; car il est si doux, au cœur du gamin, de singer le grand seigneur qui se fait servir des glaces à ses soirées, ou l’élégant dandy qui les consomme avec délices sur ses brillants boulevards! Mais le pauvre garçon avait fait bourse nette la veille, et vainement il avait fouillé, plusieurs fois, jusqu’au fond de ses poches.
Il allait donc, à jeun de glaces, retourner au logis, lorsqu’il se sentit tirer par le pan de sa veste. Il se détourne, et se trouve en face d’une belle dame en voile noir qui venait de descendre de fiacre. Sa première pensée fut que cette belle dame avait deviné son envie de glaces à la framboise, et déjà le joyeux Paul ouvrait la main pour recevoir, et la bouche pour remercier; car le gamin de Paris accepte avec reconnaissance tout ce qu’on veut bien lui offrir: ce n’est pas une aumône qu’on lui fait, non, sa fierté la rejetterait avec dédain; c’est un prêt qu’il rendra, soyez-en sûr, à la première occasion et au premier camarade venu.
Paul Romieux ne se trompait qu’à demi: la dame voilée ne lui présentait pas une sale pièce d’un sou, ou de deux sous même; mais elle faisait briller à ses yeux éblouis une blanche pièce de cinq francs.
l’Orpheline.
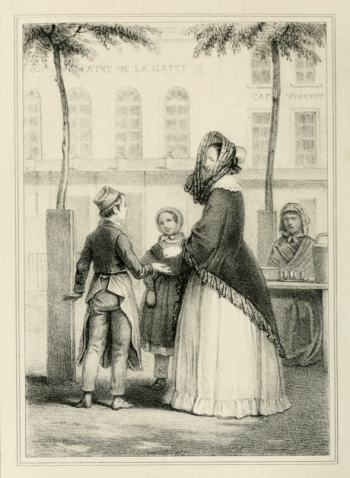
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Mon ami lui dit-elle, pourrais-tu me rendre le service de garder cette petite fille quelques instants?» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
—«Mon ami, lui dit-elle, pourrais-tu me rendre le service de garder cette petite fille quelques instants? j’ai affaire près d’ici; il faut que je sois seule; je vous rejoindrai dans une demi-heure au plus tard.
Et en même temps elle glissait la pièce de cinq francs entre les doigts de Paul Romieux, en lui donnant la main d’une charmante enfant de huit à neuf ans, que les préoccupations gastronomiques de celui-ci ne lui avaient pas laissé d’abord apercevoir.
—De grand cœur, madame, répondit Paul en prenant l’enfant et la pièce blanche; vous pouvez être tranquille: Paul Romieux aura soin de la petite, et il veillera sur elle en vrai chevalier français.
Il n’avait pas achevé ces paroles, que la dame au voile noir avait disparu.
—Elle est donc bien pressée, ta mère? demanda Paul, qu’elle s’en va si vite.
—Ce n’est pas ma mère, répondit la jeune fille, presque en pleurant; vous avez bien vu que c’est une grande dame. Elle est venue me chercher chez maman nourrice, bien loin, bien loin, et nous avons passé deux nuits en voiture. Elle ne m’a pas parlé tout le long de la route; et, à peine arrivée à Paris, elle m’a fait manger vite, puis m’a fait monter dans une autre voiture qui nous a amenées par ici. En vous apercevant, elle a dit: «Voilà un petit jeune homme qui me paraît bien bon, et qui ne me semble pas trop occupé; je vais le prier, mademoiselle, de vous garder un instant, pendant que j’irai faire une commission là-bas.» Alors elle a crié au cocher d’arrêter, et nous sommes descendues.
—Cela me paraît un peu louche, se dit Paul Romieux; mais, à la garde de Dieu! il a mis cette petite fille entre mes mains, je ne l’abandonnerai jamais; j’en prendrai soin comme si c’était ma sœur; et, pour commencer: Petite fille, aimes-tu les glaces à la framboise, à la vanille, au citron?
—Je ne sais pas ce que c’est; mais j’aime bien les framboises.
—Ah! tu ne connais pas les glaces au citron et à la vanille! Ces pauvres provinciaux! il faut tout leur apprendre, quand ils viennent à Paris: à parler, à boire, à manger, et cætera.—A propos, comment te nommes-tu, que je puisse au moins t’appeler autrement que petite fille.
—Marie... Je n’ai pas d’autre nom; je suis une petite orpheline.
—Pauvre chère amie! Mais tu as un nom qui te portera bonheur; le nom de la bonne Vierge! Je t’aime encore mieux à présent, et je la prierai pour toi.
—On disait que les petits garçons de Paris n’avaient pas de religion, qu’ils ne faisaient pas leurs prières, qu’ils n’aimaient pas la sainte Vierge.
—Qui dit cela? répartit Paul avec un geste d’indignation. Nous! ne pas aimer la sainte Vierge, notre bonne mère à tous! n’avoir point de religion! ne pas faire nos prières! Ah! je voudrais bien savoir qui dit cela? Le gamin de Paris peut être espiègle, flâneur, querelleur, mais ce n’est pas un impie, va; et si quelquefois il oublie trop le chemin de l’église, le souvenir du bon Dieu reste toujours au fond de son cœur. Croirais-tu que je me sens toujours près de pleurer, chaque fois que je regarde Jésus-Christ mis en croix pour nos péchés?
—En ce cas, avez-vous lu l’histoire d’Isidore et de sa petite fille méchante, dans l’Instruction de la jeunesse? Comme c’est touchant, n’est-ce pas, quand il lui montre sur le crucifix toutes les souffrances du Sauveur!
—Tu sais donc lire, toi?
—Oh! je commençais un peu, quand cette grande dame est venue me chercher pour m’amener à Paris.
—Mais elle ne reparaît pas, cette grande dame! et la demi-heure doit être passée. Je crois que nous aurions le temps de consommer toutes les glaces du boulevard du Temple en l’attendant... C’est égal, cela ne nous empêchera pas d’en humer chacun deux. (Tirant sa pièce de cinq fr., et la considérant avec tendresse.) J’aurais pourtant bien voulu garder cette belle pièce blanche, mais il y a trop longtemps que j’ai soif d’une glace au citron; tant pis pour la pièce. (S’approchant de la marchande.) Une glace, deux glaces, trois glaces, quatre glaces; total, dix centimes ou deux sous; en voilà cent, rendez-moi quatre fr. quatre-vingt-dix centimes, si vous voulez.
—Si ce n’est que deux sous à payer, dit alors Marie à Paul, pendant qu’il buvait déjà son premier verre, il ne faut pas changer votre pièce. Tenez, j’ai quatre sous à moi, prenez-les. (Paul remet d’une main le verre vide à la marchande, et de l’autre reçoit un second verre plein.)
—A merveille, ma petite Marie; au moins nous pourrons redoubler sans attaquer la pièce de cinq fr. Mais pardon, excuse, mademoiselle, j’avais un terrible besoin de me rafraîchir la gorge. (Passant et repassant la langue sur ses lèvres.) Délicieuses et pas chères! (Présentant à Marie un verre à la framboise.) A votre tour présentement; avalez cette jolie couleur rose.
—Ah! que c’est froid! comme cela fait mal aux dents! (Déposant le verre, moitié plein, sur la table de la marchande.) Je n’en veux plus, M. Paul; je n’aime pas les glaces.
—Ce sera donc à moi de tout prendre; il suffit alors de quatre. Bonjour, la marchande; voici deux sous, au revoir.
—Mais elle ne revient pas, cette dame, interrompit Marie, les larmes aux yeux; et que vais-je devenir?
—Je suis sûr, moi, qu’elle t’a amenée à Paris pour t’égarer, pour se défaire de toi. En vain l’attendrions-nous encore; depuis bientôt deux heures elle n’est pas de retour, elle ne reviendra pas, la méchante femme! ah! c’est décidé, elle l’a fait exprès, elle t’a perdue!...
—Perdue!... s’écria soudain Marie en joignant les mains et regardant le ciel en pleurant. Mon Dieu, je suis perdue!... ayez pitié de moi! Que vais-je devenir? Bonne sainte Vierge, n’abandonnez pas Marie l’orpheline!
—Ni moi non plus, pauvre Marie! je ne t’abandonnerai pas, répliqua Paul en essuyant ses propres larmes et serrant fortement la main de la petite fille qu’il entraîne avec lui. Viens chez mes parents: je leur conterai ton aventure; ils ne sont pas riches, eux, mais ils sont humains, ils te recevront, ils t’adopteront, te chériront comme leur fille; et, s’il faut travailler pour les aider, j’ai bon œil, bon bras, bonne jambe, et, à douze ans passés, on peut bien gagner sa vie.
—Ah! merci! M. Paul, dit Marie (et déjà elle s’acheminait avec Paul vers la maison de son père); merci! le bon Dieu vous bénira, et moi aussi je le prierai pour vous.»
Un passant, qui avait entendu la fin de cette conversation, se dit à lui-même: Les prières de l’innocence sont toujours exaucées, et ce jeune homme fait une trop belle action pour qu’il n’en reçoive pas la récompense. Puis, s’adressant à Paul: «Voulez-vous, mon ami, me donner votre nom et votre adresse?
—Paul Romieux, chez son père, ouvrier ébéniste, faubourg Saint-Antoine, nº 95.
—Votre conduite me touche et m’intéresse vivement, brave enfant de Paris, répliqua l’inconnu en mettant un rouleau de papier dans la main du jeune homme; je regrette d’être pressé en ce moment, je vous aurais accompagné chez vous, pour féliciter vos parents de posséder un tel fils, et les inviter à prendre un soin tout paternel de cette pauvre orpheline. Je vais à la campagne, où je suis attendu; annoncez ma visite à votre père pour la semaine prochaine, et dites-lui que je serai charmé de le connaître.»
Paul, après avoir remercié et salué le généreux inconnu: «Tu vois, dit-il, petite Marie, que déjà le ciel nous vient en aide; un rouleau de dix pièces de cinq fr.! et celle de ta vilaine dame: en tout, cinquante-cinq francs. Quelle surprise pour mon père et ma mère! Je ne sais si jamais ils ont vu tant d’argent à la fois.»
En discourant ainsi, Paul arriva, avec sa petite protégée, au domicile paternel. Marie fut accueillie par l’honnête ébéniste comme un second enfant que lui envoyait la Providence; puis il regretta l’intervention de cet étranger qui menaçait de lui ravir en partie la joie et le mérite de sa bonne action.
«Nous n’avons point de fille, dit-il à Marie, et tu seras la nôtre; ma femme et moi nous te traiterons comme notre enfant propre, et Paul sera ton frère et ton ami. Quant à cet argent, femme, il n’y sera pas touché; nous le rendrons à l’homme bienfaisant qui l’a remis à notre fils, et il pourra servir à faire du bien à d’autres; grâces à Dieu et à notre travail, nous pourrons nous en passer, et cette petite n’en sera pas moins bien chez nous. Elle vivra comme nous, donc, et nous comme elle.»
Le soir, tous les locataires du nº 95, déjà informés de l’événement arrivé à Paul Romieux et de la belle conduite de cet enfant et de sa famille, voulurent voir la petite fille abandonnée. Pendant plus de deux heures, le logement de l’ébéniste ne désemplit pas; chacun vint à son tour complimenter ces dignes voisins; on accabla la pauvre orpheline de caresses, de bonbons, et plus encore peut-être de questions curieuses. L’un voulait savoir si elle connaissait, d’ancienne date, la dame voilée qui l’avait perdue, ou si elle ne l’avait connue qu’au moment où elle était allée la chercher chez sa nourrice; l’autre lui demandait si cette dame était jeune ou vieille, brune ou blonde; celui-ci l’interrogeait sur le nom de son pays, sur les bois, les vignes, les montagnes, les rivières qui s’y trouvaient ou qui ne s’y trouvaient pas; celui-là, sur le nom de sa nourrice et des habitants de l’endroit, d’où il était peut-être, lui.
Enfin, la pauvre enfant, toute fatiguée qu’elle était, ne fut pas quitte, avant minuit, des visiteurs et des questionneurs qui prolongèrent leurs importunités huit jours durant.
Le comte de Blandy traversait en chaise de poste la route de Paris au Mans. Il allait recueillir un héritage presque inespéré; mais son cœur était triste, sa bouche laissait échapper de fréquents soupirs. Ce n’est pas la richesse qui fait le bonheur. Et cependant, que de pauvres voyageurs n’ont pas envié le sort de ces heureux du monde, en voyant passer sous leurs yeux cette élégante voiture qui franchit si vite, au claquement bruyant du fouet agité dans l’air, l’espace que leurs pieds fatigués ont tant de peine à mesurer lentement!
Ils ne se doutent guère, les pauvres voyageurs, que cet heureux mortel, devant qui s’aplanissent les montagnes, se rapprochent les distances, en l’honneur duquel l’obséquieux postillon fait si bien claquer son fouet et met ses chevaux hors d’haleine; ils ne se doutent guère que, sur les coussins moelleux de sa douce berline, il s’estime le plus malheureux des hommes, et se prend parfois à envier leur propre sort!
Il était riche, le comte de Blandy, et il allait le devenir davantage encore; mais il était aussi riche en peines, en soucis qu’en terres, en châteaux et en argent. Jeune encore, il s’était marié, contre le gré de ses nobles parents, à la fille d’un honnête marchand: à ses yeux, la religion et la vertu devaient l’emporter sur l’or et le parchemin, et il préférait mille fois une épouse chrétienne et bonne mère de famille à ces femmes coquettes dont le grand monde est si prodigue. La sœur du jeune Blandy, vaine et méchante au suprême degré, s’était surtout indignée de cette union déshonorante, disait-elle, et, n’ayant pu l’empêcher, elle n’avait rien négligé pour en punir son frère; elle alla jusqu’à tenter de le faire déshériter par leur père mourant: la voix de la religion arrêta seule la main du faible vieillard. Le jeune comte de Blandy aimait tendrement son père; or, il pleura longtemps sa perte, quoique, depuis son mariage, il fût réellement perdu pour lui, et qu’il eût fait d’inutiles efforts pour être admis à ses embrassements. Mais sa mémoire ne lui resta pas moins chère, et toujours il l’entoura de la plus tendre vénération; tandis que sa sœur, dans sa fureur jalouse, reporta sur le vieillard, dans la tombe, la haine qu’elle avait vouée à l’héritier de son nom.
A peine au sortir des funérailles paternelles, l’implacable marquise de Misdan, plus âgée que son frère (elle s’était mariée cinq ans auparavant) intenta au comte de Blandy un procès dont celui-ci sortit avec honneur; et cette femme alors jura de se venger, à quelque prix que ce fût.
Sur ces entrefaites, la petite marchande, comme elle appelait avec dédain la femme de son frère, mit le comble au bonheur de celui-ci, en lui donnant une fille charmante; mais six mois après, un événement affreux, et dont la cause demeura enveloppée d’un sombre mystère, vint plonger le comte de Blandy dans un deuil inconsolable: sa femme mourut presque subitement. De noires pensées s’élevèrent dans l’esprit du comte; mais il craignit de se tromper, et il se fit un devoir de repousser, comme des tentations coupables, les horribles soupçons dont il était assiégé.
Sa fille lui restait: c’était son unique consolation. Tout à coup elle disparut, à peine âgée de deux ans: toutes les recherches faites par toute la France pour la découvrir, toutes les récompenses promises par la voie des journaux, à quiconque en donnerait des nouvelles, n’aboutirent qu’à désespérer davantage le malheureux père, et à le convaincre de l’impossibilité de retrouver jamais cette pauvre enfant, dernier et seul objet de son amour.
Dès lors il n’y eut plus de bonheur, plus d’espoir pour lui sur la terre; toutes ses pensées, toutes ses affections se tournèrent vers le ciel. Il y voyait sa femme bien-aimée, l’invitant à la venir rejoindre, et lui tendant les bras au milieu des anges qui la portaient sur leurs ailes; sa petite fille était mêlée parmi d’autres anges, dont elle n’était pas le moins gracieux, et sa mère la lui montrait en souriant.
Mais ces douces images ne venaient pas toujours consoler son âme. Le plus souvent, il ne pouvait se persuader que sa fille fût morte, et son esprit, ingénieux à le tourmenter, la lui représentait dans les positions les plus tristes. Tantôt, il s’imaginait la voir au milieu d’une troupe de sales Bohémiens qui torturaient ses membres délicats pour les exercer à des tours d’adresse; tantôt, il se la figurait conduite de porte en porte par d’ignobles mendiants qui s’en faisaient un instrument de commisération. Des rêves pénibles agitaient aussi son sommeil, et toujours il y voyait son enfant, sa chère enfant, malheureuse et souffrante.
Plusieurs années se passèrent ainsi, et la profonde blessure faite au cœur de l’infortuné père allait s’élargissant.
Lorsque nous l’avons rencontré tout à l’heure sur la route du Mans, son cœur était en proie aux plus amères douleurs; ses réflexions étaient encore plus cuisantes que de coutume.
«Pauvre enfant! se disait-il, elle est orpheline aussi, égarée, perdue comme ma fille!... Oh! que je plains son père, si son père a eu le malheur de lui survivre! Mais elle, du moins, elle a rencontré sur sa route un cœur sensible et bienfaisant! Et ma fille! la Providence lui aura-t-elle envoyé un Paul Romieux, un brave ouvrier de Paris? O mon Dieu! prenez pitié de l’orpheline; étendez sur elle cette main paternelle qui soutient dans leur vol les oiseaux du ciel, et fournit la pâture à leurs petits. J’ai mis tout mon espoir en vous, Seigneur, Dieu de bonté, et vous ne permettrez pas qu’il soit déçu; vous me conserverez, vous me rendrez ma fille!» Et le voyageur continuait: «Rue Saint-Antoine, nº 95, Romieux, ébéniste. Je suis impatient de connaître ces honnêtes gens, de participer à leur bonne œuvre. Que dis-je?... mais si je prenais cette enfant, si je l’adoptais? Ce serait une amie, une sœur pour ma fille, si je suis assez heureux pour la retrouver un jour; et si je l’ai perdue, hélas! pour ne la revoir jamais, celle-ci la remplacera auprès de moi, elle m’aimera comme elle, et je tâcherai de l’aimer autant. C’est à peu près le même âge, la petite est gentille, elle paraît spirituelle, et, qui mieux est, sensible et reconnaissante. J’ai hâte de la revoir. Qui sait? le ciel me l’envoie peut-être. Oui, je me suis trouvé là bien à propos; la Providence a voulu que je suivisse ces deux enfants, que je prêtasse l’oreille à leur touchant entretien. Ah! je n’en saurais douter, la Providence a eu ses desseins; c’est moi qu’elle a choisi pour en être l’instrument.»
Ces pensées religieuses dissipèrent le nuage épais qui obscurcissait le cœur et le front du comte de Blandy, et il se trouva tout autre qu’il était d’habitude en arrivant au Mans. Pressé d’accomplir son projet de bienfaisance, il ne voulut pas attendre la conclusion de ses affaires, et chargea du soin de ses intérêts un notaire de l’endroit.
Trois jours après, sa voiture s’arrêtait dans la rue Saint-Antoine, au nº 95. En demandant M. Romieux, il s’enquit en même temps de la petite orpheline.
«Oh! la jolie enfant! répondit la concierge, c’est une procession continuelle pour la voir; si bien que M. Moutonnet, mon mari, avait envie, ce matin, de la faire descendre dans la loge, sauf le bon plaisir de M. Romieux. Cette petite a de l’esprit comme feu notre Célina (que le Seigneur garde son âme!), et je ne crois pas, à vous dire vrai, qu’elle vive longtemps non plus. Tout fruit qui mûrit trop vite est bientôt piqué des vers. Mais vous la connaissez donc, monsieur, cette petite, que vous venez en voiture la visiter?
—Certainement, je la connais, dit le comte de Blandy, et je lui veux du bien.
—Elle le mérite, repartit la portière; elle est bonne et mignonne comme feu notre Célina (que le Seigneur garde son âme!). Ah! si vous l’aviez connue, Célina? n’est-ce pas, monsieur Moutonnet?»
M. Moutonnet, qui raccommodait de vieux souliers dans un coin de la loge, fit un signe d’approbation, et madame Moutonnet continua: «Avec cela, elle est gentille à croquer, comme feu notre Célina (que le Seigneur garde son âme!): des cheveux blonds, comme Célina; des yeux bleus, comme Célina; des lèvres roses, des dents blanches et une peau item, comme Célina.
—Vous aviez une vive affection pour cette charmante Célina? demanda le comte; il n’y a pas longtemps que vous avez eu la douleur de la perdre?
—Trente-trois ans, six mois et cinq jours, répondit la portière, en faisant mine d’essuyer une larme qu’elle ne put trouver dans ses yeux.
—Je vous félicite, madame, répondit M. de Blandy, en lui glissant deux pièces de cinq francs dans la main; je vous félicite de conserver à ceux qui vous ont été chers un souvenir aussi durable. Veuillez maintenant me conduire au logement de M. Romieux.»
La vieille portière, ne se possédant pas de joie, précéda le comte, en faisant mille signes de la tête et des yeux à toutes les personnes qu’elle rencontrait dans la cour et les escaliers, comme pour leur dire: «Regardez-bien ce monsieur, il n’en vient guère de pareils dans notre maison; je le mène à la petite fille perdue; c’est peut-être son père, ou quelque chose d’approchant.»
Enfin, on entre chez l’ébéniste, qui était, avec son fils, en train de travailler; sa femme et la jeune fille causaient auprès de la fenêtre.
«Père, dit Paul, c’est le monsieur qui m’a donné les cinquante francs.»
La femme et la jeune fille se levèrent pour offrir un siège à l’étranger, et le père dit, en lui présentant l’argent qu’il avait serré précieusement dans une armoire:
«Monsieur, vous avez été trop généreux; tout en vous remerciant de votre bon cœur, nous ne pouvons accepter cet argent. Mon travail suffisait largement pour nous faire vivre trois; à présent que le bon Dieu nous a envoyé une quatrième bouche, il me donnera le moyen de la nourrir; je ne veux partager cet honneur avec personne.»
Le comte de Blandy opposa vainement les meilleures raisons à l’honnête ébéniste; vainement aussi, la portière étonnée essaya de lui faire entendre, par ses hochements de tête et ses clignements d’yeux, qu’il avait très-grand tort de ne pas accepter l’argent qu’on lui avait donné et celui qu’on lui offrait: tout fut inutile.
La seule faveur qu’obtint le comte fut que Paul et Marie lui rendraient visite tous les dimanches. Il avait pris un vif plaisir à faire causer la gentille orpheline; il s’en retourna, le cœur vide et désolé, de n’avoir pu décider le brave Romieux à la lui confier.
«Puisque le ciel nous l’a envoyée, redisait sans cesse celui-ci, je ne la remettrai jamais qu’à son père ou à sa mère; en attendant, ma femme et moi nous lui en tiendrons lieu.»
Plusieurs mois se passèrent. Paul et Marie furent toujours ponctuels à visiter le comte de Blandy chaque dimanche, comme M. Romieux le lui avait promis, et chaque dimanche ils étaient accueillis avec un nouvel empressement. Le père infortuné s’attachait de plus en plus à l’intéressante orpheline, qui rappelait à son imagination les traits chéris de son épouse regrettée, et le souvenir douloureux de sa propre fille.
«Si c’était elle?» se disait-il souvent. Et, comme poussé par une main invisible, il courait vers le faubourg Saint-Antoine, et faisait à la petite Marie maintes questions déjà cent fois reproduites, et auxquelles cent fois elle avait répondu ou n’avait su répondre.
Sur ces entrefaites, M. de Blandy était parvenu à rentrer dans les bonnes grâces de sa sœur, ou du moins il le croyait, d’après les apparences. La marquise de Misdan, récemment arrivée de province, s’était installée dans son hôtel, à Paris, et lui faisait payer, par ses caprices et ses exigences, le prix de leur réconciliation.
«Quels sont ces petits drôles à qui j’apprends que vous faites tant d’accueil? dit-elle avec émotion, un dimanche qu’elle aperçut, de la chambre de son frère, Paul et Marie entrer dans l’hôtel. Vous ne tenez pas votre rang, M. le comte; et je vous avoue que, pour ce qui me regarde, je suis humiliée de partager vos affections et vos égards avec cette canaille. Je m’enferme dans ma chambre, pour n’être pas témoin de votre épanchement roturier; et, si vous ne me promettez de ne plus recevoir désormais ces marmots pendant mon séjour ici, je suis décidée à quitter immédiatement votre hôtel.»
Et la marquise se retira, affectant une vive indignation.
«Toujours la même! soupira son frère; toujours sa fierté révoltante et ridicule!—Entrez néanmoins, mes chers enfants, ajouta-t-il, en ouvrant à Paul, qui déjà frappait à la porte de sa chambre, pendant que Marie, un peu souffrante, montait lentement l’escalier; et si vous avez entendu sortir de la bouche de ma sœur des paroles fort dures sur votre compte, n’en comptez que davantage sur mon amitié.
—Votre sœur! exclama Paul. Je ne l’ai aperçue que par derrière, au moment où elle sortait précipitamment de votre chambre; mais sa voix m’a fait bien mal... Et ce n’est pas, voyez-vous, parce qu’elle nous méprisait! non, non; c’est un mal que je ne saurais expliquer. Oh! je voudrais bien voir madame votre sœur?
—Y penses-tu, mon garçon! n’est-elle pas trop fière pour y consentir.
—C’est égal, M. le comte, il faut que je la voie; je veux la voir, je la verrai.
—Eh! mais, répliqua le comte tout étonné, je ne suis pas accoutumé à t’entendre parler de la sorte. Tu n’es guère respectueux aujourd’hui.
—Pardon, M. le comte, mais j’ai cru reconnaître cette voix... elle n’a pas cessé de retentir à mes oreilles depuis qu’elle m’a parlé sur le boulevard du Temple... Oui, c’est elle qui m’a dit: «Gardez cette petite fille, je viendrai la reprendre dans une heure!...»
—Ah! grand Dieu! serait-il possible! s’écria le comte tout hors de lui et sonnant avec précipitation... Et toi, Marie, reconnaîtrais-tu la dame qui t’a conduite à Paris?... serais-tu ma fille, pauvre enfant? ma fille, enlevée si jeune à mon amour par cette sœur perfide?... Oh! viens, viens! que je t’embrasse, que je te presse sur mon cœur! Et vous, mon Dieu, soyez à jamais béni! (S’adressant au valet, qui attendait ses ordres.) Faites descendre la marquise de Misdan sans retard, à l’instant même...
—Il est trop tard, M. le comte, répondit le valet; madame la marquise écoutait à la porte de monsieur, lorsque je suis arrivé; à mon approche, elle s’est hâtée de descendre. Je pense qu’elle a quitté l’hôtel.
—La perfide!... elle vous a reconnus, mes enfants, dès le premier instant où vous avez paru dans la cour, et c’est pour cela qu’elle m’ordonnait de vous chasser de chez moi... Ah! que Dieu lui pardonne!»
Le comte de Blandy s’empressa d’envoyer chercher les parents de Paul Romieux, et ils mettaient le pied sur le seuil de la porte, en même temps qu’un commissionnaire qui apportait au comte le billet suivant:
«Oui, c’est ta fille!... mais garde-la bien, car je ne mourrai contente qu’après vous avoir éternellement séparés.»
La méchante femme comptait sans la justice de Dieu, car elle était morte avant que son horrible menace fut parvenue à l’hôtel de son frère, et une apoplexie foudroyante venait de la frapper. Le commissionnaire, à qui elle avait prescrit de venir la retrouver sur-le-champ, revint apporter cette nouvelle, qui dissipa toutes les craintes pour l’avenir.
Le brave Romieux tint sa parole: il rendit l’orpheline à son père; mais le comte n’oublia point ce qu’il devait à cette estimable famille. Il contraignit l’honnête ébéniste à accepter une rente de 1,200 fr. Il voulut se charger aussi de l’avenir de Paul; il le retint auprès de lui, lui donna des maîtres, et l’ex-gamin de Paris est en train, aujourd’hui, de devenir un avocat distingué.

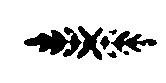
Oh! laissez-moi ma vague rêverie,
Mon océan d’azur et mon ciel toujours bleu,
Ma douce promenade au fond de la prairie,
Mon ignorance encor des choses de la vie,
Ma confiance en Dieu.
Oh! laissez-moi mon crucifix d’ébène,
Et ma longue prière à l’aube du saint jour,
Et la danse, le soir, à l’ombre du vieux frêne,
Sa rustique chanson à la vierge du chêne,
Dame du saint amour.
Je suis, dit-on, l’enfant de la nature,
Je me plais à bondir avec mon jeune agneau,
A jouer avec lui sur la fraîche verdure,
A suivre le courant d’une onde toujours pure,
A me mirer dans l’eau.
Le soir aussi, quand la cloche sonore
A la tour du village a tinté l’angélus,
Le soir a ses plaisirs; car, le soir, on adore
Celui que l’on pria le matin, dès l’aurore,
Le saint Enfant-Jésus.
Et c’est alors, qu’en pleurant, mon vieux père
Vient doucement croiser mes deux mains sur mon cœur,
Murmurer à voix basse, à l’ombre de ma mère,
Les doux et saints versets que dit, dans sa prière,
L’enfant de la douleur.
Puis le sommeil que la fatigue appelle,
M’endort bien lentement au doux bruit de sa voix;
Le songe, aux ailes d’or, à mes yeux étincelle,
Il me montre ma mère, et la bonne Isabelle
Vient se pencher vers moi.
Je suis heureuse auprès de mon vieux père;
On dit qu’ailleurs on pleure, on vit dans les douleurs,
Je ne pleure jamais qu’au tombeau de ma mère,
Lorsque je viens, le soir, au cyprès funéraire,
Entrelacer mes fleurs.

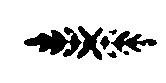
Le jour touchait à son déclin, et déjà tout le peuple de Bologne, qu’une chaleur suffocante avait tenu jusque-là renfermé dans ses maisons, commençait à se répandre par la ville, lorsqu’un homme, les vêtements en désordre, entra dans une rue qui avoisine la grande place Saint-Pierre. A sa démarche, tour à tour lente et précipitée, et plus encore à l’air soucieux de son visage, il était aisé de voir que cet homme était absorbé par de graves préoccupations. Arrivé à quelques pas d’une auberge de mince apparence, dont la vue le lit pâlir, il s’arrêta tout à coup comme s’il n’osait franchir les quelques pas qui l’en séparaient. Savez-vous bien ce qui troublait ainsi cet infortuné? Dans cette auberge, il allait trouver les deux êtres qu’il affectionnait le plus au monde: sa femme et son fils, en proie aux plus pressants besoins, à la faim, et il n’avait pas même un morceau de pain à leur donner. Jugez s’il devait souffrir! Mais bientôt il sembla rassembler toutes ses forces, et franchit lestement les degrés de la maison.
L’enfant de Pesaro.
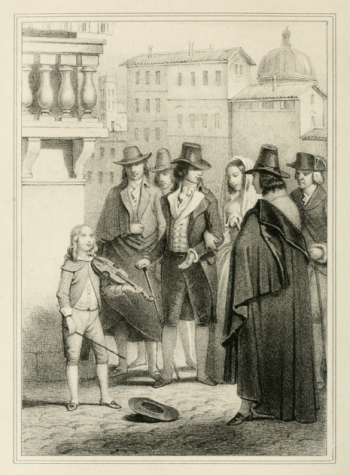
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «......Il plaça son chapeau à ses pieds puis préluda par un Chant plein de douceur et de mélancolie.» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
A sa vue, une femme aux traits fatigués, mais beaux encore, s’élança vers lui:
«Paolo, lui dit-elle, ton visage dirait-il vrai? nous apporterais-tu de mauvaises nouvelles?
—Oh! bien mauvaises, ma chère Carlotta... pendant cinq heures, j’ai attendu devant le palais du légat, et Perelli n’est pas venu au rendez-vous qu’il m’y avait assigné, et même...
—Ainsi, dit en l’interrompant certain gros homme ceint d’un tablier d’une blancheur douteuse, et qui s’était approché des époux alors qu’ils échangeaient ces mots, vous ne me paierez pas encore aujourd’hui ce que vous me devez. Voilà tout à l’heure huit jours que je vous héberge, vous, votre femme et votre fils. Je suis las à la fin.
—Hélas! mon brave hôtelier, reprit Paolo, vous me voyez plongé dans la désolation. Nous sommes venus, comme vous le savez, de Pesaro, notre pays, à Bologne, afin de trouver de l’emploi dans quelque troupe de comédiens ambulants, ma femme comme chanteuse, moi, comme joueur de cor; mais c’est en vain que nous avons frappé à toutes les portes, nous n’avons trouvé partout que des refus. Enfin, un directeur qui forme en ce moment une troupe pour la foire prochaine de Sinigaglia, m’avait donné rendez-vous aujourd’hui même auprès du palais du légat; non-seulement il n’y est pas venu, mais, après cinq longues heures d’attente, j’ai appris qu’il venait de quitter Bologne après avoir complété sa troupe. C’était là ma dernière espérance, et je l’ai perdue; si mon saint patron ne me vient en aide, je ne vois plus comment je pourrai m’acquitter envers vous.
—Faites ce que vous voudrez, répondit l’impitoyable hôtelier; mais je vous déclare qu’à l’avenir vous n’aurez rien de moi sans argent.»
Alors les deux époux se regardèrent effrayés; puis instinctivement ils se rapprochèrent de leur fils qui se trouvait assis au fond de la salle. C’était un bel enfant, aux joues fraîches et roses, à la physionomie vive et spirituelle; ajoutez à cela de grands yeux bleus d’une mobilité extrême, de longs cheveux blonds qui se déroulaient sur ses épaules, et vous aurez le portrait du petit Joachimo.
«A quoi penses-tu là, Joachimo? dit le père en l’embrassant tendrement.
—J’ai entendu toute votre conversation, mon père; je sais que vous n’avez pu trouver d’engagement et que l’hôtelier vous refuse tout crédit; je pensais donc que si nous étions à Pesaro, il me serait facile d’obtenir quelque argent des bons prêtres dans les églises desquels je chante ordinairement.
—Il n’est que trop vrai, mon pauvre enfant; tous les malheurs nous accablent ici. Il ne nous reste pas même de quoi souper, et, dans cette grande ville de Bologne, je ne connais personne qui puisse nous aider à sortir de cette position affreuse.»
De son côté, la bonne Carlotta pleurait; ce n’est pas qu’elle pensât à elle, non, c’était à son fils, son petit Joachimo, si digne de son amour, et qui, tout jeune, était condamné à ressentir les horreurs de la misère. Hélas! mes chers enfants, c’est là l’histoire de toutes nos mères. Lorsqu’enfant, les maladies menacent notre frêle existence, qui souffre plus que nous? c’est notre mère; lorsque devenant grands, nous entrons dans le monde, qui redoute avec tant de sollicitude les écueils que nous allons y rencontrer? c’est encore ce bon ange gardien! Ah! qui nous dira aimer tous les trésors de tendresse que renferme le cœur d’une mère!
Tout à coup, pendant que ses parents étaient plongés dans leurs tristes réflexions, Joachimo se lève et, sans être aperçu, il s’élance hors de l’auberge. Où allait-il? et qu’allait-il faire? Voici la pensée subite qui venait de lui traverser le cerveau: «On m’a dit souvent que ma voix était belle; pourquoi n’irais-je pas essayer de chanter, sur la place, quelques-uns des airs que j’ai entendu tant de fois exécuter par ma mère? peut-être recueillerai-je quelque argent, et alors, quel bonheur de le rapporter à mes bons parents et de leur dire: Vous êtes dans la peine, et voilà que, grâce à mes petits talents, vous allez pouvoir en sortir; maintenant quittons cette vilaine auberge et retournons à Pesaro, notre doux pays.»
Dans l’enthousiasme de sa joie, Joachimo ne fit qu’un bond de l’auberge à la place Saint-Pierre, sur laquelle la société la plus brillante de Bologne se rassemble chaque soir. Cependant il eut peur à la vue de tout ce beau monde, et, pour reprendre un peu de hardiesse, il lui fallut plus d’une fois penser à ses pauvres parents; sûr maintenant de sa voix, il plaça son petit chapeau à ses pieds, puis préluda par un chant plein de douceur et de mélancolie.
En entendant ce chant si pur et si harmonieux, les promeneurs s’arrêtèrent d’abord étonnés et firent bientôt cercle. Puis, comme l’enfant, encouragé par cet accueil, déployait insensiblement toutes les ressources de sa voix, l’auditoire se mit à applaudir avec un véritable enthousiasme. Les pièces de cuivre commencèrent dès lors à tomber dans le petit chapeau, et après les pièces de cuivre vinrent les pièces d’argent. Joachimo rayonnait de joie; aussi s’empressa-t-il de choisir dans son répertoire le morceau le plus brillant, celui d’ailleurs qu’il savait le mieux, afin de témoigner toute sa reconnaissance au bienveillant auditoire. Quand il eut lancé les dernières notes de ce chant, Joachimo vida dans ses poches les pièces grosses et petites qui remplissaient son chapeau, et il s’apprêtait à prendre congé des assistants par un gracieux salut, lorsqu’un homme à cheveux blancs, devant lequel la foule avait respectueusement ouvert ses rangs, s’avança vers lui, et lui dit:
«Mon enfant, qui t’a appris les airs que tu viens de chanter? tu parais avoir huit ans à peine, et déjà tu abordes les difficultés de l’art avec l’aplomb d’un musicien consommé.
—C’est que, monsieur, répondit Joachimo joyeux, je suis d’une famille d’artistes; mon père est un joueur de cor et ma mère une chanteuse; nous courons les foires de Fermo, de Forli et de toutes les villes de la Romagne pour gagner notre vie; il ne m’a donc pas été difficile d’apprendre tous ces airs. Quant aux règles de la musique, je ne les connais guère, et Dieu sait combien je désire les apprendre, car je pourrais soulager mes parents qui sont quelquefois bien malheureux.
—Très-bien, mon enfant, dit le bon vieillard; ces sentiments sont ceux d’un bon fils; j’aime à te les entendre exprimer. Tes parents doivent être à Bologne, conduis moi vers eux, je veux leur parler.
—Très-volontiers, dit l’enfant auquel la figure aimable du vieillard inspirait toute confiance; si vous voulez bien me suivre, ils demeurent à quelques pas d’ici.»
Alors l’enfant et le vieillard se mirent en route. Le vieillard s’appelait Matei, l’enfant Joachimo Rossini, celui que, depuis, l’Italie a salué du nom de Cygne de Pesaro.
Je ne vous dirai pas la joie des pauvres parents en revoyant leur fils, dont l’absence commençait à les inquiéter beaucoup, et surtout lorsqu’ils apprirent, de sa bouche, les détails de sa bonne action: elle se conçoit facilement. Quant le bon Matei put parler, il dit à Paolo et à Carlotta:
«Mes amis, je me trouvais parmi ceux qui applaudissaient sur la place Saint-Pierre aux talents précoces de votre fils. Il y a chez lui l’étoffe d’un grand musicien, confiez-le-moi, je me charge de son éducation, et, je vous en donne l’assurance, l’avenir est à lui.»
Ceci se passait en 1798.
Deux ans après, Joachimo, à peine dans sa dixième année, fut choisi pour diriger à Bologne, comme chef d’orchestre, la Création du monde et les Quatre saisons d’Haydn. Grand fut l’enthousiasme du public, quant il vit avec quelle intelligence le jeune chef d’orchestre s’acquittait de ses fonctions difficiles. A onze ans, grâce aux leçons de Matei et surtout au travail le plus opiniâtre, que soutenait le noble désir de venir en aide à ses parents, Joachimo Rossini fit représenter un opéra sur le théâtre de Ferrare. Depuis, chaque œuvre a été pour lui l’occasion d’un nouveau triomphe, et aujourd’hui Rossini est placé, à juste titre, au premier rang des compositeurs de musique de notre époque.
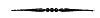
Marie la bonne.
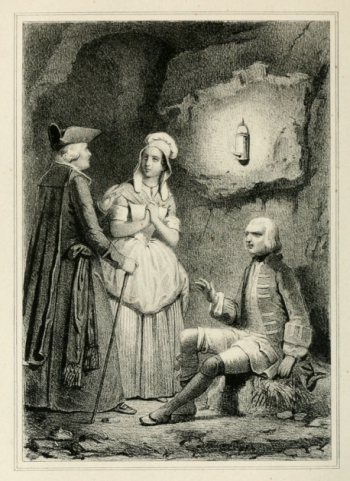
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Oui, Marie, dit il en se montrant, oui, vous êtes un ange!» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
Au fond de la Picardie, à quelque distance d’Amiens, on aperçoit un village dont les maisons blanches se détachent sur les masses sombres des bois qui l’entourent. Sa petite église, monument précieux du moyen âge, laisse percer, au-dessus de la cime des arbres, ses clochetons dentelés et ciselés à jour avec un art merveilleux. Plus loin, sur une colline qui domine tout ce frais vallon, s’élève un château moderne d’un caractère d’architecture plein d’élégance.
Au temps où se rapporte l’histoire que nous allons vous raconter, on voyait, à la place de ce château, les restes d’un vieux manoir. Deux tours crénelées, épaisses et sombres; des fossés profonds, dont les bords, taillés à vif dans le roc, étaient inaccessibles; un pont-levis tout bardé de fer et entouré de chaînes; une herse armée de pointes menaçantes; tels étaient les ruines de cette vieille demeure. Aujourd’hui elles ont à peu près disparu.
Il y a dans l’aspect de ce village, perdu au milieu des bois, quelque chose de mystérieux: ce silence que rien ne trouble, ce calme si profond, inspirent des pensées pleines de charme.
Ce village se nomme Salency. C’est là qu’avait lieu jadis la fête de la Rose et le couronnement de la Rosière. Vers le milieu du cinquième siècle, saint Médard l’habitait; il en était comme le seigneur, mais son autorité était toute paternelle; sa parole ne prêchait que la paix, la concorde, la charité, la bienfaisance.
Saint Médard chercha longtemps comment il pourrait, après sa mort, entretenir, chez les habitants de Salency, l’amour de la vertu, qu’il voyait avec bonheur s’y développer sous ses yeux: il voulait les rattacher à ce culte par une pensée naïve pour que tous pussent la comprendre, forte pour qu’elle résistât au torrent des âges. Il créa la fête de la Rose.
Treize siècles l’avaient respectée; la révolution française l’engloutit dans l’abîme qu’elle creusait sous nos vieilles institutions. Il n’en reste plus de nos jours que le souvenir, mais un souvenir plein de douces émotions.
Pour mériter ce chapeau de la Rose, il fallait d’abord être pure, modeste et pieuse... Mais on exigeait encore que cette pureté, cette vertu, existassent dans la famille. La faute d’un parent rejaillissait sur les siens. Aussi, quel frein puissant opposé aux mauvaises passions! quelle barrière au vice! On craignait de mal faire, non-seulement pour soi, mais encore pour sa sœur, pour sa fille, pour ses parents. Aussi, la couronne de roses, posée sur le front de la jeune élue, réflétait sa brillante auréole sur toute sa famille; et souvent un père, en voyant sa fille la recevoir, trouvait ainsi la récompense de soixante années de vertus.
Le grand jour approche: tous les cœurs sont émus, l’ambition les agite... noble et sainte ambition que celle-là! car le sentier qu’on a suivi, c’est celui de la vertu; le prix qu’on envie, c’est une simple fleur... une rose! Mais cette rose, c’est la plus belle, et souvent la seule richesse de toute une famille. Ici, point d’intrigues, de faveur... La justice... la justice seule préside au choix des rosières.
Le 1er juin, le prieur, le bailli et les gens de justice s’assemblent au milieu du village: là, ils choisissent trois jeunes filles, entre lesquelles le Seigneur de Salency doit nommer la rosière.
Puis, le 8 juin, la fête a lieu, et la rosière est couronnée.
Le 1er jour de juin 16**, à peine le soleil se levait-il sur l’horizon, que Salency se réveilla au bruit des cloches que maître Renaud, le bedeau, sonnait à toutes volées. Bientôt, tout prit un air de fête: les habitants revêtirent leurs plus beaux vêtements, et se dirigèrent vers la grande place. En moins d’une heure, la population tout entière s’y trouva réunie. Ce furent d’abord des cris de joie, des échanges de salut, des reconnaissances; puis on se forma en groupes, et les conversations commencèrent. On devinait l’importance de la solennité à l’air grave des vieillards, au maintien timide des jeunes filles, à l’émotion des mères. En effet, ce jour-là, on allait choisir les trois prétendantes à la rose.
Le nom de Marie, auquel on ajoutait ce surnom: la Bonne, était dans toutes les bouches; et les jeunes filles, ses rivales, vantaient elles-mêmes ses vertus, avec une sorte d’orgueil.
Après quelques instants, il y eut un mouvement d’agitation dans la foule; c’était maître Renaud, le bedeau-sonneur, qui sortait de l’église. Aussitôt, il fut entouré, pressé, étouffé, étourdi de mille questions qui se croisaient, se heurtaient les unes les autres.
«Holà! braves gens, dit-il enfin; vous criez plus fort que toutes les cloches d’Amiens; qui pis est, vous m’étouffez, probablement pour que je puisse plus facilement vous répondre. Par saint Médard! le moyen est ingénieux. Allons, allons, faites-moi place, que j’aille porter ces registres sur la table de M. le prieur.»
Et le bedeau, levant fièrement la tête, voulut s’avancer, vers l’enceinte formée par une barrière, au milieu de la place; mais la multitude le tenait enfermé dans un carcan de fer qui se rétrécissait toujours de plus en plus; et Dieu sait ce qui serait, advenu au pauvre Renaud, si l’attention générale ne se fût tout à coup dirigée vers un des coins de la place.
«Marie!... Marie! la Bonne!—Voilà Marie!» cria-t-on de tous côtés; et la foule laissa le sonneur s’esquiver, pour porter ses regards vers la nouvelle venue.
C’était une jeune fille de dix-huit ans environ. Une robe de toile blanche serrait sa taille souple et fine; un fichu blanc couvrait ses épaules; un petit chapeau de paille, placé sur le côté de sa tête, était retenu sous le menton par deux petits rubans. Ainsi vêtue, Marie avait une grâce charmante; ses moindres mouvements décelaient une timidité ravissante. La pauvre jeune fille semblait embarrassée de tous ces regards qui se fixaient sur elle, et ce trouble ajoutait encore à l’expression touchante de sa physionomie.
De larges bandeaux noirs descendaient sur son front; ses yeux bleus avaient une douceur d’ange, sa bouche laissait voir, en s’entr’ouvrant, des dents blanches comme du lait. Oh! certes, Marie, la Bonne pouvait être appelée aussi Marie, la Belle. Un peintre se fût arrêté devant elle pour admirer ses formes si pures et si harmonieuses ... La foule l’admirait aussi, mais pour ses vertus.
D’une main, elle soutenait la marche pénible d’un vieillard aveugle; de l’autre, elle conduisait trois petits enfants roses et blonds comme des chérubins.
Marie la Bonne était désignée d’avance, par tout le monde, pour prétendante à la rose, et chacun faisait des vœux pour qu’elle fût nommée rosière: sa vie, tout entière, était marquée par des actes de vertu.
Bien jeune encore, à l’âge de dix ans, elle se rendait utile à sa mère, en menant paître son troupeau, en soignant ses petits frères. Son père était mort depuis plusieurs années, et son grand-père, le vieux Marcel, habitait la chaumière. Ses petits soins, ses attentions pour lui, ne s’étaient jamais démentis un seul instant. Le jour, elle l’emmenait avec elle dans les herbages et le faisait asseoir à l’ombre; puis, pour le distraire, elle lui racontait les pieuses histoires qu’elle avait entendu lire à M. Stébens, le prieur. Le soir, rentrée dans sa chaumière, elle aidait sa mère aux détails du ménage, et, quand la nuit était venue, elle venait s’asseoir près de son aïeul et lui chantait, en tournant son rouet, quelque vieux noël qui faisait sourire le vieillard.
Une nuit, le feu prit à la chaumière; le vent soufflait avec violence; le toit, couvert de paille, s’abîma bientôt. Marie, réveillée par la clarté des flammes, se précipita au milieu du brasier, en arracha successivement son grand-père et ses trois frères; mais enfin, sanglante, mutilée, mourante, elle tomba sans forces, avant d’avoir pu sauver sa mère.
La pauvre enfant resta seule ainsi, à quinze ans, sans pain, sans asile, avec un vieillard aveugle et trois petits enfants. Toute autre à sa place fût morte de chagrin... Marie voulut vivre... pour son père, pour ces enfants, orphelins comme elle, et qui n’avaient d’autre appui au monde que le sien. Elle espéra en Dieu et prit courage.
Les habitants de Salency lui bâtirent une petite maison sur les ruines de celle qu’avait dévorée l’incendie. A force de travail, de peine, d’ordre et d’économie, elle parvint à gagner quelque argent; ses frères apprirent d’elle à tresser la paille et l’osier, et purent ainsi lui être moins à charge. Puis, le ciel semblait la favoriser: ses moissons étaient les plus belles, ses vaches les plus grasses, son lait le meilleur, son beurre le mieux fait. Mais aussi, que de courage, de persévérance, n’avait-il pas fallu à Marie pour supporter une pareille existence!
Au milieu de tous ces travaux, elle trouvait encore le moyen de faire du bien et d’être utile à ses voisins. Souvent, en allant à la ville, vendre son lait et son beurre, elle ralentissait le pas pour soutenir la marche de quelque femme âgée; alors elle prenait une partie de sa charge, l’aidait à vendre ses marchandises; puis elle revenait le soir au village, heureuse et contente, oubliant ses fatigues pour ne penser qu’au bonheur de revoir les siens.
Si quelque pauvre épuisé passait sur la route, elle allait au-devant de lui, le consolait, l’amenait dans sa chaumière, partageait avec lui son pain, réchauffait près du foyer ses membres engourdis, et ne le laissait partir qu’après s’être assurée qu’il pouvait, sans danger, poursuivre son chemin.
Chaque dimanche, elle allait à l’église; pieuse et recueillie, elle s’agenouillait dans un coin, sur la pierre humide, et restait longtemps ainsi, prosternée, priant pour sa mère.—Oh! c’était une sainte fille que Marie... Marie la Bonne, comme on l’appelait au village.
En attendant M. le prieur, on se racontait sa vie, on vantait sa bienfaisance, sa modestie, sa douceur, sa piété. Bientôt, un profond silence se fit dans la foule, les conversations cessèrent et chacun devint attentif. M. le prieur, le bailli, les gens de justice et les notables de Salency, s’avancèrent gravement et vinrent s’asseoir autour d’une table placée au milieu de l’enceinte.
Marie tremblait, son cœur battait avec force.
«Prends courage, ma fille, lui dit le vieil aveugle; rassure-toi, mon enfant; je me rappelle qu’il y a vingt ans, ce même jour, ta pauvre mère était là, comme toi, tremblante, attendant avec anxiété le jugement qu’on allait prononcer... Il y a vingt ans, elle fut choisie rosière... Tiens, petite, regarde, je ne l’ai pas oublié...»
Et le vieillard tira de sa poitrine une petite rose: Marie la prit dans ses mains, la pressa sur ses lèvres, et deux grosses larmes coulèrent de ses yeux.—En ce moment, une vieille femme passa près d’elle et la regarda en souriant avec méchanceté. Marie rencontra son regard et se troubla; ses joues pâlirent, son sang reflua vers son cœur, et ceux qui l’entouraient se fussent évidemment aperçus de son émotion, si, à cet instant même, M. Stébens ne se fut levé.
«Mes enfants, dit-il d’une voix émue, vous savez quelle sainte mission nous avons aujourd’hui à remplir... La justice doit seule nous guider... prions donc Dieu de faire briller à nos yeux la vérité tout entière.»
A ces mots, tous s’agenouillèrent. Oh! c’était un spectacle bien imposant que cette foule, la tête découverte, le front abaissé vers la terre et demandant à Dieu le secours de sa toute-puissance pour reconnaître la vérité. Quel cœur fût resté insensible! quelle âme n’eût pas été émue!
Lorsque les Salenciens se relevèrent, on vit à leur contenance, qu’ils avaient foi en leur prière et qu’ils croyaient que Dieu ratifierait leur choix. Alors commença la discussion pour le nom des trois prétendantes à la rose.
Marie la Bonne fut, d’un commun accord, nommée la première; quand son choix fut arrêté, le prieur se leva:
«Au nom de saint Médard, notre bienheureux patron, que tous ceux qui auraient à nous éclairer sur Marie se présentent devant nous et déclarent hautement et sans crainte ce qu’ils savent de sa conduite. Ses vertus, nous les connaissons... A-t-on quelques reproches à lui faire?»
Un profond silence régna dans l’assemblée.
Marie pleurait à chaudes larmes; la joie, le bonheur, remplissaient son âme.
«Oh! mon Dieu! faites que je puisse la voir! s’écriait Marcel en la pressant dans ses bras; et il essayait en vain d’entr’ouvrir ses paupières fermées.
—A-t-on quelque reproche à faire à Marie? répéta le prieur.
—Oui! s’écria tout à coup une voix au milieu de la foule.»
Un sourd murmure gronda parmi tous les assistants: Marcel redressa la tête avec anxiété, Marie devint plus pâle encore.
La porte de l’enceinte réservée s’ouvrit, et une femme s’approcha de la table: c’était celle qui avait regardé si singulièrement Marie.
«La mère Javotte! s’écria Marie avec terreur... oh! je suis perdue!
—Perdue! perdue! répéta Marcel... que veux-tu dire... grand Dieu?
—Parlez, qu’avez-vous à nous apprendre? fit le prieur.
—Monsieur le prieur, je... je viens vous dire que, depuis trois jours, Marie sort tous les soirs de sa chaumière, à la nuit tombante. Je l’ai vue se diriger vers les ruines de l’ancien cloître, puis elle a disparu, et alors j’ai entendu comme des voix étranges qui sortaient de la terre... Après être demeurée là pendant une demi-heure, elle est revenue en cherchant à se cacher... Voilà ce que j’ai vu.»
A peine Javotte avait-elle achevé sa déposition, que tous les regards se tournèrent vers Marie. La jeune fille semblait confondue; ses yeux, abaissés vers la terre, versaient d’abondantes larmes.
«Elle a menti, n’est-ce pas, Marie? disait Marcel... tu ne réponds pas, ta main tremble... oh! malheur... malheur à toi!
—Mon père! mon père! je ne suis pas coupable!
—Marie? dit M. Stébens, venez vers nous, mon enfant.»
La pauvre fille s’avança tout émue au milieu de l’assemblée qui la regardait avec bonté, espérant bien qu’elle ne manquerait pas de se disculper. Ses petits frères, accrochés à sa robe, la suivaient, jetant de tous côtés des yeux effrayés et cherchant à découvrir ce qui pouvait faire de la peine à leur bonne sœur.
«Marie, vous savez si nous vous aimons; l’exemple de vos vertus, votre piété, vous ont mérité les plus grands témoignages de notre estime: nous vous avons nommée prétendante à la rose. Vous avez entendu le reproche qui vient de vous être fait, expliquez-vous. Etes-vous sortie tous les soirs, depuis trois jours?
—Oui, monsieur.
—Vous vous êtes dirigée du côté des ruines de l’ancien cloître?
—Oui, monsieur.
—Qu’alliez-vous y faire?»
Marie resta silencieuse.
—«Réponds, réponds donc, Marie, cria Marcel en se levant.
—Qu’alliez-vous faire, le soir, dans ces ruines? répéta M. Stébens.
—Oh! monsieur! je ne puis vous le dire...
—Pourquoi vous cachiez-vous? continua le prieur.
—Ma fille! ma fille!» criait le vieux Marcel avec désespoir.
En entendant la voix de son père, Marie parut hésiter; une lutte pénible s’élevait en elle.
«Oh! non!... non... je ne puis le dire... Mon père, oh! pardonnez-moi!...»
Et la pauvre enfant tomba évanouie aux pieds de son aïeul.
Marcel s’était avancé au milieu de l’enceinte: sa démarche était assurée; lorsqu’il sentit Marie, qui pressait ses genoux de ses mains suppliantes, il la repoussa violemment.
«Enfant, qui déshonore mes cheveux blancs... oh! sois à jamais maudite! Je n’ai plus de fille... va-t’en!»
Les Salenciens avaient regardé, avec douleur, cette scène terrible que suivit un grand tumulte.
Geneviève et Julie, deux autres jeunes filles de Salency, furent aussi nommées prétendantes à la rose.
Le lendemain, M. Stébens se dirigea de bonne heure vers la chaumière de Marcel. Il trouva le vieillard abattu sous le coup qui l’avait frappé; de grosses larmes inondaient son visage; les rides de son front semblaient plus profondes, sa taille, plus voûtée encore que la veille. Les petits enfants tressaient silencieusement des paniers d’osier dans un coin, et n’osaient parler. Dès le point du jour, Marie était partie pour le marché.
«Eh bien! mon bon Marcel, comment allez-vous ce matin?
—Ah! c’est vous, M. Stébens, dit le vieillard en reconnaissant la voix du prieur.
—Oui, mon ami.
—Merci, monsieur, merci... ça va bien, je ne vivrai plus longtemps...
—Allons, Marcel, du courage; votre fille...
—Ma fille... Oh! je n’en ai plus, interrompit l’aveugle d’une voix étouffée.
—Mais elle n’est pas coupable, j’en suis convaincu.
—Alors pourquoi n’a-t-elle pas parlé?
—Il y a là un mystère que je saurai découvrir. Marie est la gloire de Salency, et je ne puis croire qu’elle ait, en un instant, oublié toute une vie de vertus et de piété.
—Oh! monsieur! si elle eût encore vécu, sa pauvre mère serait morte de douleur... car la honte de Marie rejaillit sur moi, sur ces chers enfants, sur nous tous qui l’aimions tant!
—Ecoutez: ce n’est que demain que nous présentons à notre seigneur la liste des prétendantes à la rose... peut-être d’ici là... Adieu, père Marcel, prenez courage, vous dis-je... espérez.»
Quand la nuit fut venue, Marie revint tristement et sans oser rien dire, car elle craignait que le son de sa voix ne fît mal à son père; elle prépara le souper de la famille, puis, vers neuf heures, elle sortit de la chaumière, emportant un peu de pain, des fruits, et quelques morceaux de toile. La jeune fille, émue, tremblante, semblait glisser plutôt que marcher sur la terre, tant sa course était rapide. Au milieu de la route, elle s’arrêta, jeta un regard en arrière, comme pour revenir sur ses pas.
«Oh! non, dit-elle... non, sans moi il mourrait... Je ne puis l’abandonner.»
Et avec un nouveau courage, elle continua à marcher. Parfois il lui semblait entendre derrière elle un bruit de pas: elle s’arrêtait alors, demeurait immobile. «C’est le vent qui balaie les feuilles mortes, pensait-elle;» et elle avançait toujours.
Bientôt elle arriva aux ruines de l’ancien cloître. Au milieu des débris amoncelés en cet endroit, elle prit un petit sentier à peine frayé, et, se glissant à travers les murailles à demi renversées, elle disparut dans une profonde cavité qui s’ouvrait sous l’emplacement de l’ancienne église du couvent.
A cet instant, deux personnes parurent sur la lisière du chemin.
«Eh bien! M. le prieur, vous voyez que je ne vous avais pas trompé.
—C’est vrai, Javotte; attendez-moi ici, je vais revenir.»
Le digne homme suivit la même route que Marie, et entra sous la voûte de la chapelle; il marcha avec précaution, lentement, les mains étendues en avant dans la crainte de tomber en se heurtant contre les pierres détachées de la muraille. Après quelques instants d’une marche pénible, il crut distinguer une faible lumière; il se dirigea vers ce point, et se trouva bientôt à l’entrée d’un caveau profond. Là il s’arrêta et se prit à regarder le spectacle qui s’offrait à sa vue, éclairé par la lueur tremblante d’une petite lampe accrochée contre le mur.
Un homme, jeune encore, mais vieilli par la douleur, était étendu sur la terre, à peine recouverte d’une légère couche de paille... ses traits amaigris, ses yeux éteints, sa pâleur, attestaient de longues souffrances.
Marie, agenouillée près de lui, pansait une large blessure qui déchirait sa jambe... Le pauvre malade la regardait avec respect.
«Oh! merci, mademoiselle; je me sens bien mieux aujourd’hui... Sans vous, je serais mort sur la route... vous m’avez sauvé... Oh! soyez bénie! dans quelques jours, je pourrai marcher, et alors j’irai prier pour vous.
—Que dites-vous, M. Paul? votre jambe ne va pas bien encore; la moindre imprudence pourrait compromettre votre guérison; d’ailleurs, avez-vous donc oublié que vous ne pouvez quitter cette retraite; qu’un affreux danger, je ne sais encore lequel, vous menace? Quand j’ai voulu vous conduire au village et vous faire transporter dans la chaumière de mon père, ne vous êtes-vous pas écrié avec effroi: «Si quelqu’un me voyait, je serais perdu!»
—Oh! oui sans doute, Marie, je vous ai dit que ma vie était entre vos mains, que j’étais un homme mort si vous disiez un seul mot; apprenez donc ce secret que je ne dois plus vous taire, à vous, mon ange sauveur! Je suis de Salency: il y a cinq ans, un sergent racoleur passa dans le pays; j’étais grand et fort, il me vit, je lui convins. Dès lors, il m’entoura de soins, de prévenances; si bien qu’un jour, je me trouvai engagé au service du roi. Oh! quand il fallut quitter ma mère, ma sœur, mes amis, mon pays, je crus que j’allais mourir, car c’était ma vie entière, mon bonheur, que je laissais derrière moi. Je devins soldat... Souvent, je pensais au village; il me semblait entendre ma mère qui m’appelait, ma sœur qui me tendait les bras, mes amis qui m’attendaient... Longtemps, je résistai à cette vision qui m’attirait à Salency, mais enfin un jour... oh! maudit soit ce jour fatal!... je quittai le régiment, je m’enfuis, je désertai[3]!... Après des fatigues sans nombre, poursuivi, blessé à la jambe, je tombai mourant sur la route; vous reveniez du marché, je vous vis, et, inspiré par le ciel, je vous criai: «Pitié! oh! par pitié, sauvez-moi!» Et vous, généreuse et bonne, vous m’avez traîné ici, dans cet asile où, chaque soir, je vous vois apparaître comme un ange de douceur et de bonté... C’est vous qui me nourrissez, qui me pansez; c’est à vous que je dois la vie... Oh! merci! merci, mademoiselle; mais c’est au ciel que vous trouverez votre récompense, car je vous j’ai dit, vous êtes un ange!
—Mais pourquoi ne pas vous être confié à votre mère?
—La douleur rend indiscret, et je n’ai osé me fier qu’à vous.»
Le prieur avait écouté, en pleurant, ces paroles du déserteur... Il regardait Marie comme on regarde le ciel...
«Oui, Marie, dit-il en se montrant; oui, vous êtes un ange!
—M. le prieur, s’écria Marie en se levant, oh! vous ne perdrez pas cet infortuné jeune homme!... Si vous savez tout, si vous l’avez entendu... Oh! par pitié, sauvez-le!
—Je continuerai votre œuvre, mon enfant. Paul, dans une heure, je viendrai vous chercher.»
Et M. Stébens sortit, entraînant Marie sur ses pas.
«Eh bien! M. le prieur, dit Javotte, qu’avez-vous vu?
—Votre fils, mère Javotte, que Marie arrachait à la mort...
—Mon fils! mon fils! sauvé par Marie! Et moi qui l’accusais, cette chère enfant, devant tout Salency. Oh! malheureuse que je suis!» cria la vieille femme. Et, conduite par le prieur, elle se trouva bientôt près de son fils.
«Père Marcel, dit M. Stébens en entrant précipitamment avec Marie dans la chaumière du vieillard, je sais tout... votre fille est digne de vous, ouvrez-lui vos bras!»
L’aveugle sentit comme un poids énorme tomber de sa poitrine...
«Marie... mon enfant... oh! pardon, pardon, ma fille!» Et l’heureux vieillard embrassait Marie avec transport.
Le lendemain, Marie fut élue rosière par le seigneur de Salency, et le prieur obtint le congé du malheureux déserteur.
Le dimanche suivant, le nom de la jeune fille fut proclamé au prône; chacun, dès lors, se prépara à fêter dignement le grand jour.
Le huit juin, le seigneur de Salency vint à la chaumière de Marcel chercher la rosière. Marie parut bientôt, appuyée sur son bras. Au milieu de son triomphe, elle conservait encore cet air de modestie qui la rendait si charmante.
Douze jeunes filles, vêtues de blanc, et décorées d’un cordon bleu passé en écharpe, en souvenir de celui que Louis XIII envoya à la rosière avec une bague d’argent, marchaient à côté d’elle, suivies de douze jeunes garçons portant les livrées de la fête.
Le cortège, ainsi composé, s’avança, précédé d’une musique harmonieuse, et traversa les rues de Salency.
Des cris de joie accueillirent la rosière: les vieillards se levaient pour la suivre, les mères pleuraient de joie, et, la montrant à leurs enfants, leur disaient toutes ses vertus.
Arrivée à l’église, Marie, entourée de son cortège, se plaça sur un prie-Dieu, au milieu du chœur. Après l’office, le clergé se mit en marche; le seigneur prit la main de Marie, et, accompagné de toute la population du pays et des environs, on se rendit à la chapelle de Saint-Médard. Les portes en restèrent ouvertes, pour que tout le monde pût voir la cérémonie.
Le prieur officiait lui-même ce jour-là; il bénit le chapeau de roses, et, se tournant vers l’assemblée, il rappela, en quelques mots simples et touchants, l’origine de la fête, puis il parla de Marie, et raconta ce qu’il avait vu aux ruines.
A ce moment, tous les cœurs étaient émus, tous les yeux humides; Marie elle-même, cédant à son émotion, versait des larmes de bonheur. Lorsque le prieur plaça sur son front le chapeau de roses, le clergé entonna le Te Deum, que la foule répandue sur la place répéta avec ivresse.
Au moment où Marie, couronnée, allait sortir de l’église, un jeune homme (c’était Paul), appuyé sur le bras de sa mère, s’avança péniblement vers elle, et, se mettant à genoux, lui présenta un bouquet de petites fleurs bleues, tandis que Javotte, de son côté, baisait ses mains qu’elle inondait de larmes.
Le seigneur de Salency offrit ensuite une collation champêtre à tout le village, et jusqu’au lendemain, on dansa devant le château. Souvent encore, de nos jours, on parle à Salency de Marie la Bonne.
[3] A l’époque à laquelle remonte cette histoire, la désertion d’un soldat était punie de mort. De nos jours, ce crime est puni d’une peine infamante.
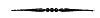
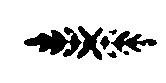
N’avez-vous pas quelquefois remarqué, mes jeunes amis, au-dessus de la porte de quelque vieille auberge de village, certaine peinture due au Raphaël de l’endroit, représentant un évêque couvert de ses habits sacerdotaux et se tenant debout auprès d’un baquet dans lequel étaient trois enfants nus, les mains levées vers le ciel? La singularité d’une pareille scène ne vous a-t-elle pas engagés à vous arrêter un moment devant cette porte, pour chercher à en deviner le sens? et très-probablement vous n’en serez pas venus à bout. Eh bien! cet évêque est saint Nicolas; ces trois enfants, des écoliers auxquels il vient de rendre miraculeusement la vie.
Certes, il y a peu de temps encore, les écoliers ne passaient guère devant cette image sans lui sourire et la saluer; car ils savaient tous que saint Nicolas est le patron des écoles; ils se rappelaient que, dans le mois de décembre, il y avait pour eux un jour de joie et de bonheur: celui de la fête du bon saint Nicolas. Hélas! aujourd’hui que cette fête est presque oubliée de tout le monde, l’image du saint évêque vous trouve froids et indifférents; elle est devenue pour vous sans souvenir comme sans émotions. Il ne faut pas qu’il en soit tout à fait ainsi: apprenez donc comment et à quelle occasion saint Nicolas accomplit son grand miracle; vous comprendrez alors pourquoi (il y a bien des siècles de cela) les écoliers se plaçaient sous son invocation. Je vais, à cet effet, vous traduire une scène empruntée à l’un des plus curieux mystères du treizième siècle, dit de saint Nicolas, lequel est noté en plain-chant et écrit en mauvaises rimes latines; il se chantait, en déclamant et gesticulant.
PERSONNAGES:
Saint Nicolas. Trois écoliers. Un vieillard, aubergiste; sa femme.
(Les écoliers frappent à la porte du vieillard, en poussant des lamentations.)
LE PREMIER ÉCOLIER. Le désir de nous instruire dans les sciences nous a conduits dans des pays étrangers, et à cette heure, que les rayons du soleil s’éteignent, nous cherchons un asile.
LE SECOND ÉCOLIER. Déjà le soleil est près de plonger dans la mer avec ses coursiers rapides; cette contrée nous est inconnue; demandons au plus tôt l’hospitalité.
LE TROISIÈME ÉCOLIER. Voici une femme âgée qui vient à nous; touché de nos prières, le maître de cette maison se montrera bienveillant sans doute.
TOUS LES TROIS EN CHŒR. Cher hôte, par amour de l’étude, nous avons quitté notre patrie; accordez-nous l’hospitalité pour cette nuit seulement.
LE VIEILLARD. Que Dieu, créateur de toutes choses, vous héberge, car, certes, ce ne sera pas moi; à cela, je ne vois ni profit ni agrément.
LES ÉCOLIERSà la femme du vieillard. Que ce soit vous, chère dame, qui nous obtienne ce que nous demandons, et, pour récompenser ce bon office, Dieu peut-être vous rendra mère d’un fils.
LA FEMME, au vieillard. Par charité, au moins, nous ne pouvons leur refuser l’hospitalité; quel mal y a-t-il à cela?
LE VIEILLARD, à sa femme. Ton conseil est bon, et je vais les introduire. (Aux écoliers.) Entrez, entrez, messieurs les écoliers, ce que vous souhaitez vous est accordé.
(Ici les écoliers se couchent et s’endorment.)
LE VIEILLARD, à sa femme. Tiens, regarde donc leurs escarcelles; que d’argent! Il ne tient qu’à nous d’avoir en nos mains ce trésor.
LA FEMME. Depuis notre naissance nous portons le fardeau de la misère, mon ami; mais leur mort peut nous en affranchir: arme-toi donc de ton épée; leur mort va nous enrichir pour le reste de nos jours, et personne ne connaîtra jamais cette action.
(L’hôte égorge les écoliers et les cache dans un coffre de bois comme de la chair à saler.)
NICOLAS, chantant à la porte de la maison. Pauvre voyageur, accablé de fatigue, mes pieds refusent à marcher; pour cette nuit, je vous en prie en grâce, donnez-moi l’hospitalité.
LE VIEILLARD, à sa femme. Celui-ci mérite-t-il d’être accueilli, chère épouse, qu’en penses-tu?
LA FEMME. Son extérieur est respectable, il faut le recevoir.
LE VIEILLARD, ouvrant la porte. Étranger, vous nous semblez un homme recommandable, entrez ici, et si vous souhaitez souper, vous n’avez qu’à commander.
NICOLAS, assis à table, considérant les mets. Je ne veux rien de tout cela: ce que je veux, c’est de la chair fraîche.
LE VIEILLARD. Je vous donnerai la viande que je possède, mais non pas de la chair fraîche, car je n’en ai point.
NICOLAS. Tu mens, vieillard, tu mens; il y a ici de la chair toute fraîche, et cela par suite du crime horrible que t’a fait commettre la soif de l’or.
LE VIEILLARD ET SA FEMME, ensemble, tombant aux genoux du saint. Ayez pitié de nous! nous reconnaissons en vous un saint du Seigneur; notre crime est abominable; mais n’en saurions-nous être absous?
NICOLAS. Apportez ici ces cadavres, et priez avec une âme repentante; ces malheureux seront rendus à la vie par la bonté divine, et vous obtiendrez votre pardon.
(On tire du coffre le bassin où sont les trois corps, et le saint s’agenouillant, dit:)
O mon Dieu! dont la main a créé toutes choses, le ciel, la terre, l’air et l’eau, permets que ces enfants revivent, et tu les entendras chanter tes louanges.
(Les trois enfants ressuscitent, et tous les acteurs entonnent en chœur: Te Deum laudamus, etc.)
Lorsqu’au moyen âge, à l’exemple de tous les corps de l’État, les maîtres d’écoles se formèrent en confréries, ils choisirent saint Nicolas pour patron. Le jour de sa fête, ils se réunissaient pour assister aux offices; le lendemain, il y avait un service funèbre où ils priaient «pour les âmes de leurs confrères et sœurs, maistres et maistresses trespassés, et des bienfaiteurs de la confrérie.» Une fois ces devoirs pieux accomplis, le reste de la journée était consacré à la joie. Les élèves dressaient des théâtres dans les cours de leurs collèges, et, en présence de la multitude assemblée, ils représentaient des scènes dramatiques qu’on appelait soties, mystères ou moralités. Le mystère de saint Nicolas ne faisait pas faute à cette solennité; on l’accueillait toujours avec enthousiasme; en outre, les écoliers habillaient l’un d’entre eux en évêque, et le promenaient, en grande pompe, par toute la ville. Cet usage n’a été aboli qu’en 1789.

Voici les premières années d’un grand homme; plus tard, mes amis, vous lirez avec admiration l’histoire de cette vie si belle et si bien remplie. Ce fut, d’un bout à l’autre, celle d’un homme de bien, un modèle constant de vertu, de sagesse, de travail. Le deuil public des deux mondes a honoré la mort de Franklin, et la postérité ratifiera l’hommage de ses contemporains.
La famille de Franklin est originaire d’Angleterre, où ses aïeux, francs-tenanciers[4], exploitèrent pendant trois cents ans trente acres de terre au village d’Ecton, dans le Northamptonshire. A cette industrie ils en joignaient une autre: celle de forgeron. Vous voyez de quelle humble souche descend notre héros: héros assurément, car la patience, la droiture, l’exercice persévérant du devoir, ont bien aussi leur héroïsme.
Et cependant n’allez pas croire que, bien que voués aux pénibles travaux de la charrue et de la forge, les grands parents de Benjamin fussent tout simplement d’honnêtes rustres, de grossiers paysans.
L’ignorance n’était pas alors la conséquence immédiate de l’obscurité de condition. Des savants illustres admettaient à leur intimité de pauvres artisans, et rien n’était plus commun que de voir, réunis au même foyer, le laird (seigneur) et son fermier, le magistrat et son clerc, le ministre et les plus simples de ses paroissiens.
A ces causes, vous ne serez pas étonnés d’apprendre que, tout en battant avec ardeur le fer de sa forge, un des oncles de Benjamin (Thomas Franklin) se livra si bien à l’étude des sciences, qu’un beau jour il se trouva en possession d’une licence d’avocat. Ce fut le premier de cette famille qui exerça une profession dite libérale; les autres demeurèrent attachés à la pratique de l’agriculture et du rude métier de saint Éloi. D’eux d’entre eux cependant se firent teinturiers, et l’un de ces derniers (Josiah) fut le père de Benjamin.
Plus tard, des causes graves, des persécutions plus ou moins méritées ayant déterminé l’émigration de Josiah, celui-ci, qui s’était marié jeune, emmena sa femme et ses enfants, au nombre de trois, dans la Nouvelle Angleterre (aujourd’hui les États-Unis d’Amérique). Quelque temps après son arrivée aux colonies, il perdit sa femme et se remaria. Ce fut de sa seconde femme, Abiah Folgier, que naquit Benjamin, le huitième enfant du deuxième mariage. Cette naissance eut lieu le 17 janvier de l’année 1706.
M. Franklin avait fixé sa résidence à Boston. Il y exploita d’abord sa première industrie, celle de teinturier; mais, s’apercevant que les gains qu’il tirait de ce métier ne lui suffisaient pas pour élever sa nombreuse famille, il le quitta, et se fit fabricant de savon et de chandelles. Ne souriez pas, mes amis! Sans doute, si M. Franklin n’eût consulté qu’un sot amour-propre, un fol orgueil, au lieu d’embrasser ce sage et honnête parti, eut-il pu, comme tant d’autres, chercher la fortune dans ses talents, c’est-à-dire dans quelques-unes de ces jolies professions qu’on exerce en manchettes et en bas de soie, sauf à mourir de faim ou à faire des dettes. Comme plus d’un de ses compatriotes à qui plus tard lui-même ouvrit sa bourse, M. Franklin eût pu s’essayer à donner des leçons de violon, de dessin ou de danse: ce qui est bien la plus pitoyable ressource dans une colonie qui se fonde, et surtout dans un pays comme l’Amérique. Mais, outre que M. Franklin était excellent musicien, bon dessinateur, et même, malgré sa gravité naturelle, danseur assez présentable, il pensait aux siens avant de songer à lui-même. Préoccupé des intérêts de sa famille, il voulut lui assurer par son travail le bien-être et le bonheur. Il se fit épicier, et fit bien; son commerce prospéra. Il mit en apprentissage les plus âgés de ses fils; les filles furent élevées à la maison, sous les yeux et par les soins de leur mère, qu’elles aidaient dans le ménage. A huit ans, Benjamin fut envoyé à l’école; son père l’avait destiné à l’Église.
Cependant le jeune Benjamin ne resta guère qu’une année à l’école: cette dépense était trop lourde pour le père de famille; il dut abandonner ses projets, et se borna à faire apprendre à Benjamin l’écriture et le calcul; et ce fut maître Brownwell qui fut chargé de lui donner cet enseignement élémentaire.
A dix ans, c’est-à-dire peu de mois après, Benjamin prit congé de M. Brownwell, et là se bornèrent les frais d’éducation du pauvre petit bonhomme, que son père reprit chez lui. Là, on voulut en faire un apprenti et le ceindre du tablier; mais, si Benjamin avait été rebelle à l’arithmétique, ainsi que l’avait plus d’une fois déclaré maître Brownwell, il fut non moins hostile à l’épicerie, et montra tout d’abord sa maladresse, et, qui pis est, sa répugnance à couper les mèches de chandelles, à remplir les moules de suif et à faire les commissions.
A onze ans, Benjamin était incapable de ficeler le moindre paquet: décidément la vocation n’y était pas... Mais quelle était celle du jeune garçon? Le père crut l’avoir découverte un jour qu’ayant envoyé Benjamin porter en ville une brique de savon, il trouva monsieur son fils naviguant, au gré des vents et des flots, sur un étang situé près d’un marais salant, lieu de réunion de tous les enfants du pays, adonnés à la pratique de l’école buissonnière; en compagnie de trois de ces marmots, Benjamin avait détaché une barque du rivage.
Je vous laisse à penser la colère du père, l’inquiétude de la mère, quand elle apprit ce beau tour. Pour toute réponse, l’enfant dit qu’il voulait être marin. Marin, grand Dieu! celui qu’on avait primitivement destiné à l’Église! Madame Franklin conjura son mari de songer à quelque moyen de détourner leur enfant de si dangereuses idées. M. Franklin proposa une visite dans les différents ateliers de la ville, où l’on découvrirait peut-être bien le goût de Benjamin pour un métier plus sédentaire. La visite eut lieu, mais hélas! sans résultat. Master Benjamin se laissa promener, avec une superbe indifférence, chez tous les menuisiers, maçons, tourneurs, vitriers, serruriers, tanneurs et autres ouvriers de Boston, sur lesquels il se garda bien de manifester aucune opinion. Le père était désespéré. «Faudra-t-il donc le voir monter aux mâts et faire la manœuvre à bord d’un vaisseau! pensait l’excellent homme; ma femme en mourrait de chagrin!» Bons parents!
Nonobstant, et par provision, Benjamin fut confié à un coutelier, son cousin, Samuel Franklin, dont le père, parrain de notre héros, avait appris ce métier à Londres, et était venu l’exercer à Boston. Mais, sans exprimer pour ce dernier état, la même aversion que pour l’épicerie de son père, Benjamin ne déploya pas une extrême ardeur à tourner la meule et à polir l’acier; non qu’il songeât le moins du monde à d’autres excursions au marais salant; mais une nouvelle passion, la vraie, celle qui devait décider de l’avenir de cet enfant, s’était spontanément et irrésistiblement révélée en lui: la passion des livres! Il fallut donc encore, comme dit le proverbe américain, changer le cheval de bride. Benjamin entra chez un imprimeur. Cet état lui plut: la vocation était trouvée.
C’était chez son frère James qu’on avait placé le jeune Benjamin, alors âgé de douze ans. Le contrat d’apprentissage portait que Benjamin devait servir comme apprenti jusqu’à vingt-un ans, et ne recevoir de salaire qu’à partir de la dernière année. Quelque dures que fussent de telles conditions, Benjamin se mit avec ardeur au travail, et en peu de temps il fit de rapides progrès. Partagé entre les devoirs de son état et son goût pour la lecture, il sut les concilier, et ne dérober de temps qu’aux heures de son sommeil et à celles de ses repas. Il put ainsi lire en entier d’abord la bibliothèque de son père, composée en grande partie de livres de théologie, puis celle un peu mieux fournie de M. Adam Mathews, ami de la famille. Deux ouvrages remarquables: les Grands Hommes de Plutarque et un Essai sur les projets par Daniel de Foe, auteur de Robinson Crusoé, laissèrent dès lors, dans l’esprit du jeune Franklin, une trace ineffaçable.
Le premier de ces livres lui offrit des modèles d’héroïsme, l’autre l’instruisit de la pratique de la vie: à l’un, il dut d’être un grand homme; à l’autre, d’être un homme utile.
Par une transition bien naturelle, après s’être nourri des écrits des autres, Benjamin voulut écrire à son tour; et, par un choix non moins naturel, ayant à opter entre la prose et la poésie, ce fut à cette dernière qu’il consacra ses veilles. Il composa de détestables vers. Un naufrage horrible, récemment arrivé sur les côtes de la Nouvelle Angleterre, inspira la muse de Benjamin, et, sur ce sujet, il fit une déplorable complainte, «la tragédie du Fanal,» véritable chanson d’aveugle, dont il fut à la fois l’auteur, l’éditeur et le colporteur. Il eut le courage de la crier lui-même dans les rues; il l’eût criée jusques sur les toits. Faites donc taire un poète qui débute!
A la tragédie du Fanal succédèrent d’autres productions du même mérite, adroitement fourrées dans les poches de quelques passants inoffensifs. Boston en fut inondé. Il était temps que M. Franklin intervînt. Il arrêta ce débordement de poésie par ce mot plaisant adressé à son fils: «Malheureux! veux-tu donc me ruiner! Je suis obligé de racheter ta marchandise, qu’aucune de tes pratiques ne consent à garder après en avoir pris connaissance.» Benjamin qui était un garçon d’esprit, comprit l’ironie, se corrigea du travers de rimer, et échappa ainsi au danger d’être toute sa vie un mauvais poëte, c’est-à-dire la plus inutile chose qui soit au monde.
Le jeune Franklin avait fait, comme nous l’avons dit, chez son frère, de grands progrès dans son métier. Dévoré qu’il était du désir de s’instruire, une fois sa journée finie, il consacrait constamment à la lecture ses nuits, ses jours de fête, ses heures de repas. Pour acheter des livres, il économisait sur l’argent destiné à sa nourriture, et dînait le plus souvent avec du pain, des raisins secs et un verre d’eau.
Plus tard James Franklin entreprit de publier une nouvelle gazette; il n’y en avait eu jusqu’alors qu’une seule pour toute l’Amérique. La rédaction de ce journal attirait, à l’imprimerie, un assez grand nombre de gens instruits. Benjamin prenait un bien vif intérêt à leurs discours et aux jugements qu’ils portaient sur les divers articles; il voulut essayer ce qu’il pourrait faire en ce genre; mais comme son frère le traitait toujours comme un apprenti, et l’avait frappé déjà même en plusieurs circonstances, il travailla en secret, dans la crainte de s’exposer, ou à ses moqueries, ou à ses mauvais traitements, et, certain soir, il finit par glisser sous la porte de l’imprimerie, ses petites productions, en ayant eu bien soin de déguiser son écriture. A son grand étonnement, son frère les goûta, les imprima, et tout le monde en fit les plus grands éloges. Benjamin savoura donc tout à son aise le délicieux plaisir de s’entendre louer de chacun, sans être connu. Cependant cet incognito vint à lui peser; il se nomma, et dès lors tout le monde, à l’exception de son frère, commença à lui témoigner bien plus d’égards.
A peu près à cette époque, James inséra, dans sa gazette, un article qui offensa l’assemblée générale de la province; non-seulement on l’arrêta, mais il fut décidé qu’il n’imprimerait plus sa feuille. Pour éluder cette défense, que fit James, à l’instigation de ses amis? Il publia désormais sa gazette sous le nom de Benjamin, auquel il eut l’air de la céder; puis, afin de donner à cet arrangement toute l’apparence de la réalité, il annula l’acte d’apprentissage, en lui faisant toutefois signer une contre-lettre. Mais quelque temps après, de nouveaux débats s’étant élevés entre les deux frères, Benjamin réclama sa liberté, et, comme il l’avait prévu, James n’osa faire valoir publiquement sa contre-lettre. C’est cette action que plus tard Franklin se reprochait à peu près en ces termes: «Il était honteux pour moi de me servir de cet avantage; et je compte cette action comme une des premières erreurs de ma vie; mais le souvenir d’avoir été battu par mon frère m’avait excessivement aigri.»
De son côté, dès que James fut assuré que son frère le quittait, il se rendit chez tous les imprimeurs de Boston pour l’empêcher d’y trouver de l’emploi; alors, pour se soustraire à son mauvais sort, et sans rien dire à personne, le pauvre Benjamin résolut de se réfugier à New-York. Et le voilà bientôt éloigné de trois cents milles de la maison paternelle, à dix-sept ans, sans protection aucune dans un pays tout nouveau pour lui, et presque sans un sou dans sa poche; pour comble de malheur, il ne trouva pas plus d’ouvrage à New-York qu’à Boston. Tout aussitôt, le désespoir dans l’âme, il se dirigea sur Philadelphie, réduit qu’il était aux plus cruelles extrémités; car, sans le secours de quelques personnes charitables qu’intéressait sa bonne mine, il eût infailliblement péri de faim. Arrivé là, il réussit à entrer en relations avec un M. Keimer, imprimeur, qui lui fit d’abord ranger les casses do son imprimerie, puis enfin lui donna quelque ouvrage. Il était temps.
Un jour que Benjamin travaillait bien tranquillement à sa casse, le gouverneur de Pensylvanie, M. William Keith, vint tout à coup le visiter dans l’atelier et jusqu’à sa place, et, après lui avoir reproché de la manière la plus aimable de n’être pas descendu chez lui lors de son arrivée à Philadelphie, il lui offrit la direction d’une imprimerie qu’il désirait établir pour son propre compte, et lui proposa d’en aller chercher le matériel en Angleterre... Or, ce fut là, en apparence, un bien beau jour pour Franklin.
Avec quels témoignages de reconnaissance n’accepta-t-il pas cette offre bienveillante! Il s’embarque tout joyeux, sur le premier navire, avec des lettres de recommandation à bord. Mais, arrivé à Londres, il se trouve, par une fatalité déplorable, que ces lettres n’avaient aucun rapport avec lui. Le voilà donc encore une fois jetté au milieu d’un monde nouveau, sans crédit, sans connaissances, et fort léger d’argent. Il va, de maison en maison, solliciter de l’ouvrage; bref, il parvient à se lier avec un célèbre imprimeur du nom de Palmer, se fixe chez lui, s’y perfectionne dans son art.
Que vous dirai-je enfin, mes enfants? après tant d’années de constance opiniâtre, de travaux pénibles, de rudes épreuves, de tribulations, Franklin revint un beau jour à Philadelphie, où l’attendaient encore quelques vicissitudes. Mais, deux ans après, ses vœux si chers étaient comblés; il se trouvait enfin à la tête d’une imprimerie. Dès ce moment, sa fortune et son existence prirent un accroissement rapide... et son premier pas éclatant dans l’immense carrière qui s’ouvrit plus tard devant lui, fut son Almanach du bonhomme Richard, qu’il publia en 1732: excellent petit traité d’économie et de morale, si recherché, qu’il s’en vendit plus de dix mille exemplaires en une seule année: nous vous le ferons peut-être connaître un jour, car ce sont-là des trésors de sagesse qui ne vieillissent jamais.
Bientôt le modeste imprimeur de Philadelphie devint insensiblement l’un des hommes les plus célèbres de son époque; et tour à tour journaliste éloquent, savant illustre, immortel inventeur du paratonnerre, économiste profond, politique habile, mais surtout et toujours honnête homme, Franklin n’eut, durant sa vie, d’autre guide que sa conscience, d’autre but que le bien public.
[4] En anglo-saxon, Franklings, d’où la famille tire son nom.

Il y avait une fois un paysan qui vivait avec un ermite; dans toutes les occasions où le saint homme lui parlait de Dieu, celui-ci disait toujours qu’il ne comprenait pas comment Adam avait pu pécher pour une pomme; que, quant à lui, s’il s’était trouvé à la place du premier homme, dans le Paradis terrestre, à coup sur le serpent n’aurait pu le tenter, à l’aide d’une pareille amorce.
Ces bravades continuelles ennuyèrent l’ermite; il résolut donc d’y mettre un terme; or un jour, il cacha sous une jarre une souris qu’il avait prise à l’insu du paysan, et il recommanda mystérieusement à celui-ci de ne pas touchera la jarre pendant qu’il allait prier Dieu quelque temps à l’église.—A peine fut-il parti que le paysan s’imagina que le vase renfermait des merveilles; il ne put donc être assez maître de lui pour résister au désir de soulever la jarre, d’où la souris s’échappa avec une prestesse admirable.—A son retour, l’ermite ayant appris ce qui s’était passé, gronda vertement le paysan; après quoi il ajouta: Puisque tu m’as désobéi sans qu’il en résultât pour toi aucun plaisir, conçois-tu maintenant comment Adam a pu désobéir à Dieu pour la jouissance de manger une pomme?

La Blanche-Nef.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «A ta santé, mon ami, dit-il en riant de l’air prophétique du bon homme.» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
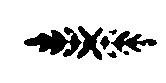
Le prince Guillaume venait d’atteindre sa dix huitième année. Tout lui riait, lui promettait le plus bel avenir. Il était le fils et l’héritier de Henri Ier, roi d’Angleterre: ce roi qui donna tant de soucis à Louis le Gros, roi de France, de glorieuse mémoire.
Au mois d’octobre 1120, Henri Ier se trouvait dans son duché de Normandie, qu’il tenait, par héritage, de son père Guillaume le Conquérant, chef de la branche des rois normands en Angleterre. Après quatre années de séjour et de vexations exercées en France, il se disposait à retourner dans son royaume; il venait de conclure, avec Louis le Gros, une paix toute à son avantage. Aussi jamais souverain ne rentra-t-il dans ses États avec plus de joie et d’orgueil. La noblesse anglaise, qui l’avait suivi, se réjouissait de revoir enfin ses castels et ses foyers domestiques.
Mais, avant de quitter la France, Henri voulait célébrer un événement qui achevait de combler ses vœux. C’était le mariage de son fils Guillaume avec la princesse Mathilde, fille du comte d’Anjou. Cette union importait également aux deux familles souveraines. Henri Ier ajoutait à ses États l’héritage d’une des plus belles provinces de France. Le comte d’Anjou devenait, à son tour, l’allié, et plus tard le père d’un des plus puissants rois de la chrétienté. Et les deux jeunes époux, élevés dès l’enfance dans la pensée de s’unir un jour, voyaient arriver cette époque avec une joie non moins vive.
Mathilde avait quatorze ans, Guillaume dix-huit. Mathilde était la plus belle princesse de son temps; elle avait été proclamée dame de la beauté dans plus d’un tournois. Déjà même plusieurs souverains l’avaient demandée en mariage, et toujours en vain. Mathilde avait constamment refusé d’unir sa destinée à tout autre prince qu’à celui, disait-elle, à qui elle avait été promise au sortir de l’enfance.
Ce fut le 15 septembre 1120 que ce mariage fut béni dans la cathédrale de Rouen. On partit ensuite immédiatement pour Harfleur, où Henri Ier devait s’embarquer, le lendemain, avec sa famille et sa noblesse.
La fête qui eut lieu au bord de la mer, à l’occasion du mariage du prince Guillaume d’Angleterre, est célèbre dans les chroniques du temps. Toute l’élite de la noblesse de France s’y trouvait conviée, ainsi que le haut clergé de Normandie, et les dames châtelaines des comtés les plus proches; et ceux qui ne purent y assister se firent raconter, bien longtemps encore après, tous les détails de ces réjouissances que tant de larmes devaient suivre de si près.
La princesse Mathilde éclipsa, ce jour-là, toutes les dames qui l’entouraient. La richesse de ses atours venait ajouter encore à sa beauté. Elle portait, selon l’usage des princesses et dames châtelaines de ce temps, un haut bonnet semblable à celui des Cauchoises d’aujourd’hui. A ce bonnet, enrichi de pierreries et de dentelles d’argent, pendait un long voile blanc, brodé en argent. Ses cheveux noirs étaient nattés avec des pierres précieuses; sa robe était de brocard à manches très-plates, sur lesquelles retombaient de larges manches de laine blanche descendant jusqu’aux pieds; la robe et le manteau étaient garnis d’une hermine superbe. La jeune princesse semblait plier sous le poids de ses riches vêtements.
Le prince Guillaume était aussi magnifiquement paré. Sa toque, brodée de pierreries, était ornée d’une longue plume bleu de ciel (c’était la couleur favorite de Mathilde); sa tunique, brodée en or; et sa hache d’armes, ciselée en or et enrichie de pierreries.
On était donc à Harfleur, d’où le roi Henri, sa famille et sa noblesse devaient s’embarquer pour retourner en Angleterre. Les fêtes durèrent trois jours; le banquet royal, dont Guillaume et Mathilde furent chargés de faire les honneurs, était le signal de la fin de ces réjouissances et du départ du roi, qui devait avoir lieu le soir même, après le festin.
La joie la plus expansive s’empara des convives. Ce qu’il y eut de coupes vidées, ce jour-là, dit la chronique, ne peut se compter.
Tout à coup, au moment, où la musique faisait entendre ses sons les plus doux, lorsque le dernier toast en l’honneur de Henri Ier fut porté, un vieillard, apparaissant à la porte de la tente du roi, demanda l’honneur d’être entendu. On le repoussa d’abord; un hallebardier faillit le renverser, en lui refusant de l’écouter; mais Henri, instruit de ce qui se passait, ordonna de laisser arriver jusqu’à lui l’inconnu.
Ses vêtements étaient pauvres, sa démarche lente et pénible.
«Seigneur le roi, dit-il en s’agenouillant à la porte, salut et bénédiction à toi et à tous les tiens.
—Ainsi, soit-il, répliqua le roi en souriant. Puis-je savoir, continua-t-il, quel sujet t’amène, en ce moment, près de moi?
—Monseigneur, répondit l’inconnu, tu ne m’as convié ni à tes fêtes, ni aux noces de ton fils, mais de moi-même j’y viens prendre part. Je n’ai rien à te demander, ajouta-t-il en relevant fièrement la tête et dégageant son front des cheveux blancs qui le couvraient; j’ai à t’apprendre quelque chose, hélas! que tu es loin de prévoir.—Parle, dit le roi, parle sans crainte.»
A l’accent de ces paroles, tous les assistants furent saisis d’émotion.
«Aurez-vous donc le courage de m’entendre? reprit alors le vieillard en élevant la voix. Je suis bien vieux et bien pauvre, moi! je puis parler de la mort et l’envisager sans effroi! Mais vous! oh! messeigneurs et maîtres! vous, le roi! vous, le prince, héritier d’un trône! vous, jeune femme! enfants de roi, princes et princesses! vous tous, châtelaines et chevaliers, écoutez bien! Avant l’aube de demain, la plupart d’entre vous seront couchés dans leurs cercueils!....»
A ces mots, des éclats de rire partent de tous cotés. Les grandes coupes s’entrechoquent et se vident. «A la santé du roi! s’écrièrent tous les convives; à la santé du prince Guillaume et de la belle Mathilde!»
Henri se leva alors, et dit, en portant la santé de tous: «Je vous remercie.» Puis, se retournant du côté de l’inconnu, qui était resté immobile à sa place: «A ta santé, mon ami, dit-il en riant de l’air prophétique du bonhomme.
—Peux-tu nous apprendre au moins, ajouta-t-il, de quelle mort nous devons passer de la terre à l’éternité?
—Je l’ignore, répondit l’inconnu; ce qu’il m’est permis de te dire, c’est que de tous ceux qui sont ici en si joyeux esprit, bien peu seront vivants demain à l’aube du jour, et celui qui sera sauvé, oh! monseigneur le roi, versera des larmes amères de n’avoir pu mourir aussi.»
En disant ces mots, il disparut, se frayant un passage d’un air d’autorité au milieu de la foule, et nui n’osa le retenir.
Les rires et les quolibets accueillirent son départ. Cependant quelques jeunes femmes étaient devenues pâles. Les accents de l’inconnu avaient quelque chose de saint et de prophétique qui les avait fait tressaillir; mais celle d’entre elles que les fatales paroles du vieillard avaient émue le plus vivement encore, c’était la princesse Mathilde. Cette crainte qui vient toujours troubler l’âme au sein du bonheur, la crainte de le perdre, s’était emparée de sa jeune âme, et lui ôtait tout son courage.
Guillaume tâchait vainement de calmer ses pressentiments. «Le cœur a ses prophètes aussi, s’écria-t-elle en se jetant dans les bras de son jeune époux, et tout m’annonce, au fond du mien, un affreux malheur.»
Le roi, voyant s’accroître la tristesse de sa belle-fille, mit fin au banquet, et tous les convives le suivirent, lui et sa famille, sur le bord de la mer, pour assister au tournoi, où l’on devait proclamer la beauté et la souveraineté de très-haute et très-puissante dame Mathilde d’Anjou, princesse royale d’Angleterre.
Le tournoi, la gaîté des assistants, les distractions dont elle fut environnée, dissipèrent peu à peu les pressentiments de Mathilde; et chacun allait bientôt faire ses dispositions pour s’embarquer à la fin du jour, lorsqu’un pilote, nommé Thomas Brizel, s’approcha du roi Henri, qui se promenait sur la plage, et lui présentant un marc d’or, en signe de vasselage, lui dit:
«Sire, Étienne Brizel, mon père, a servi le vôtre toute sa vie sur mer; ce fut lui qui transporta au rivage d’Angleterre le bon duc Guillaume, quand il alla, avec l’aide de Dieu et de son épée, entreprendre la conquête. Seigneur mon roi, je vous supplie de me donner en fief le même office. J’ai, pour votre royal service, un vaisseau tout neuf que l’on appelle la Blanche-Nef, parfaitement équipé, et manœuvré par cinquante rameurs habiles.
—J’ai choisi le navire sur lequel je dois monter, dit le roi, et je ne puis le changer, mais, pour faire droit à ta requête, je confie à ta garde Guillaume, mon premier-né et mon légitime héritier, Richard et Henri, mes deux autres fils, leur sœur Adélaïde, Mathilde, l’épouse de mon fils Guillaume, et avec eux un grand nombre de dames et de chevaliers, l’honneur de mon royaume.»
Le roi s’embarqua après avoir dit ces paroles. Il embrassa ses enfants, et leur donna rendez-vous, le lendemain matin, à Northampton, où ils devaient débarquer tous.
Le navire du roi quitta, le premier, le port d’Harfleur, par un vent du sud, et aborda heureusement à Northampton.
La Blanche-Nef tarda de plusieurs heures. Ses matelots, joyeux de l’honneur qui venait de leur être accordé, entouraient les princes de leurs acclamations, et faisaient éclater leurs transports. On leur avait distribué des muids de vin, qu’ils vidaient sans mesure et sans prévoyance; et la nuit venue les trouva dans les danses et l’ivresse la plus complète.
Assis tous deux à l’écart, Guillaume et Mathilde regardaient ces jeux et ces témoignages de joie, et souriaient doucement. Le soleil naissait à l’horizon; il allait se coucher brillant et pur dans le sein de l’Océan. Le temps était calme, et les matelots (ceux du moins qui avaient conservé encore un peu de raison) venaient d’entonner le chant du départ. Tout à coup les yeux de la princesse Mathilde se mouillèrent de larmes, et, pressant la main de son époux, elle lui dit:
«Guillaume! oh! mon bien-aimé! si cet homme avait dit vrai, et si le soleil, à son lever demain, ne devait plus luire sur notre bonheur!
—Enfant! reprit Guillaume en l’embrassant, toujours des craintes, et tu es si heureuse!
—Oh! c’est pour cela peut-être. Si j’allais mourir tout à l’heure! si tu étais destiné à me voir périr à tes côtés, sans pouvoir me sauver!... si toi-même!....
—A bord! à bord! crièrent les matelots; la lune se lève argentée et brillante, le vent est du sud, la mer est belle et digne de porter les fils du roi. A bord! à bord!»
Un des écuyers de la princesse s’approcha respectueusement pour l’avertir qu’on allait mettre à la voile. Elle jeta un dernier regard sur la ville joyeuse, sur le rivage jonché de fleurs qu’on avait semées sous ses pas; puis, serrant son époux contre son cœur, elle monta sur le vaisseau, et dit: «A la volonté de Dieu.» Le signal du départ est donné. Outre Guillaume et Mathilde, Richard, Henri et leur sœur Adélaïde, il y avait encore sur le navire les dames des premières familles du royaume, plusieurs évêques, cent quarante barons et chevaliers, l’élite des armées d’Angleterre et de Normandie. On comptait, en tout, trois cents passagers sur la Blanche-Nef.
Les nombreuses libations des matelots les avaient mis hors d’état de conduire le navire; et l’aveuglement fut tel que nul ne s’en aperçut; ils s’emparaient de tous les sièges indifféremment et se heurtaient sans se reconnaître.
Enfin la Blanche-Nef sortit du port au bruit des acclamations; mais, au moment d’entrer dans le raz de Catte, les matelots ivres s’imaginent de vouloir atteindre le vaisseau du roi, déjà loin en mer. La Blanche-Nef donne, de son flanc gauche, sur un rocher presque à fleur d’eau, que l’on croit être celui qui porte le nom de Quille-Bœuf. Alors les passagers poussent un cri de détresse qui retentit jusqu’au rivage: mais la mer était si belle et si calme, qu’on ne s’en occupa point d’Harfleur.
Au milieu de la confusion et des ténèbres, Thomas, le malheureux pilote, cherchait entre tous les passagers Guillaume, le fils aîné du roi. Il prit le jeune prince dans ses bras nerveux et le força de le suivre seul dans sa chaloupe; puis il alla chercher la princesse Mathilde qu’il descendit avec lui. Le prince était dans la chaloupe depuis un instant, lorsque les naufragés s’y précipitant en foule, elle chavira sous le poids énorme qui l’accablait: en un moment navire et barque, tout disparut dans la mer.
Ce fut alors un horrible spectacle! la mer, unie et calme comme un miroir, laissait entrevoir successivement une tête blonde et pâle, des mains délicates, quelquefois un bras fort et nerveux qui se roidissait contre l’élément; tantôt des cris de mort et d’agonie s’entendaient, jetés par une vague qui venait mollement se briser contre le rocher.
Le prince Guillaume, nageant avec ses habits dorés, apparut un instant à la surface de l’eau, tenant dans ses bras sa femme évanouie et mourante; il appelait à son secours, et nul ne répondait: chacun pensait à soi en cet instant suprême; tout à coup il disparut dans les flots, n’ayant pu supporter son fardeau plus longtemps et ne voulant pas survivre à sa bien-aimée. Thomas, le pilote, reparut une fois encore après avoir vainement tâché, dans les ténèbres, de découvrir le prince.
«Qu’est devenu le fils du roi? dit-il à un homme fort et vigoureux qui s’efforçait de gagner le rivage.—Il est mort comme les autres, répondit celui-ci en s’éloignant.—Malheur à moi! s’écria alors le pilote, et aussitôt il plongea dans l’abîme.»
Le lendemain de cette nuit terrible, la mer rejeta, sur la côte d’Harfleur, les corps des naufragés; on reconnut ceux des fils du roi et de la princesse Mathilde. Guillaume seul ne fut pas retrouvé; l’Océan devint sa sépulture.
Cependant le roi d’Angleterre, après une heureuse traversée, attendait sur le rivage l’arrivée du second navire. Tout le jour s’écoula dans l’inquiétude. La funeste nouvelle se répandit enfin vers le soir; mais personne n’osait l’annoncer au roi.
Ce fut un jeune enfant qui fut chargé de ce cruel message: il vint se jeter aux pieds de Henri, et lui apprit tout, en pleurant. A cette nouvelle, le malheureux père poussa un cri déchirant et tomba sans connaissance. Durant plusieurs jours, on craignit pour sa raison; il appelait tour à tour ses enfants chacun par leur nom. «Oh! mon frère Richard, s’écriait-il dans sa douleur, la main de Dieu me punit!... Ayez pitié de moi!... Oh! si je ne vous avais pas détrôné et fait mourir de désespoir dans une prison où je vous fis crever les yeux!... Si j’avais été bon et miséricordieux, peut-être mes quatre enfants vivraient encore, et je ne serais pas réduit à l’isolement et au malheur!»
Depuis ce jour, où tant de pertes sensibles vinrent accabler le roi, la douleur et le remords (disent les historiens) ne lui laissèrent plus un seul instant de repos. Il fit apporter les cercueils de ses enfants et les fit placer dans une chapelle ardente, à côté de la chambre royale. Il restait là des journées entières. Le cercueil de la jeune princesse Mathilde était adossé à un autre, doublé de velours noir, et qui était vide:—c’était celui du prince Guillaume. «Ce sera le mien,» disait le roi, chaque fois qu’il regardait ce cercueil.

A Saint-Cloud, sous le bois, tout rouge de colère,
Un enfant poursuivait sa bonne en la frappant;
Une dame passait, qui dit, le voyant faire:
«Ah! c’est mal, et toujours du mal on se repent.»
Et l’enfant, à ces mots, crut entendre sa mère,
Et derrière un tilleul se blottit tout tremblant;
Une larme brillait au bord de sa paupière,
D’un muet repentir signe doux et charmant.
La vie a des écueils, enfant, où le pied glisse;
Mais si tu sens un jour que ton âme faiblisse,
Souviens-toi de la dame et du bois de Saint-Cloud.
Cette voix entendue aux rives de la Seine,
C’est la voix de ton ange, il te suivra partout,
Et ce matin, enfant, il se nommait LA REINE!
Nota. Ce sonnet inédit, du précepteur de M. le duc de Monpensier, renferme une leçon qui parait avoir été effectivement donnée, devant le poëte, à un enfant inconnu, par une bouche qui a le droit d’être écoutée de tous, comme celle d’une mère.

Pauvre Étienne!

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Lorsque le jeune homme aperçut son image il ne put s’empêcher de fremir.» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
Le soleil colorait de ses derniers feux le village d’Ablons. A l’extrémité de la rue principale se trouvait une ferme jadis florissante; mais les malheurs de l’invasion de 1814, en frappant sur les campagnes voisines de la capitale, n’avaient pas épargné cette propriété. A peine quelques vaches restaient dans l’étable; le parc aux moutons ne contenait plus qu’un maigre troupeau; la basse-cour était silencieuse, et les plantes potagères languissaient faute d’engrais. Les valets et les filles de service avaient dû successivement chercher ailleurs de l’emploi, et les grandes bassines de fer ne suspendaient plus, au-dessus du feu de sarment, la soupe aux choux des moissonneurs.
Le fermier Jean Roger et Justine sa femme étaient assis dans une salle basse, et, afin de se désennuyer, ils jouaient ensemble une partie de cartes; mais leurs affaires les préoccupaient bien plus que l’atout, la dame de trèfle ou le roi de cœur. Roger se leva pour aller boire à un grand pot de cidre, puis, s’essuyant la bouche du revers de sa main:
«Ah! dit-il, les choses allaient mieux autrefois, ma pauvre Justine; le petit caporal n’avait pas perdu la partie, et nos braves soldats ne s’étaient pas encore gelé les pieds à marcher dans les neiges du Nord: maintenant l’ennemi nous entoure, et il faut le nourrir, tandis qu’on n’a pas de quoi se nourrir soi-même.
—Que veux-tu, mon ami! c’est le sort de la guerre.
—Oui, mais le laboureur paie pour tous. Nos champs ont été dévastés, la moisson est mauvaise, les impôts nous accablent: je ne sais comment tout cela finira.»
Et il but un second coup de cidre.
Un jeune garçon parut; son visage n’accusait pas plus de quinze ans; mais, à l’expression d’intelligence qui animait ses yeux et se lisait sur son front, on eût pu le croire plus âgé. Il était laid, on peut le dire; son nez, sa bouche, avaient des lignes communes, sa taille était sans grâce; mais, après tout, sa physionomie exprimait tant de douceur et de mélancolie, qu’on s’y habituait promptement, et qu’on ne l’eût peut-être pas voulu différente.
Il portait une bêche qu’il plaça dans un coin de la chambre.
«Que fais-tu là? lui dit Roger.
—Mon père, je range cette bêche...
—As-tu fini ta besogne?
—Jamais on n’a fini...
—Hein, qu’est-ce que c’est?
—Je veux dire qu’il reste toujours quelque chose à faire.
—Puisque tu es en si belle disposition, va voir dans le jardin si j’y suis.
—Mon ami, remarqua assez timidement la fermière, il me semble que tu le traites bien rudement. Ce pauvre Étienne n’a rien à se reprocher; au contraire, son assiduité au travail lui mérite toute notre tendresse.
—C’est bon, c’est bon, nous causerons de cela plus tard.»
Une larme brilla dans les yeux d’Étienne; mais le regard du jeune homme se posa tour à tour, avec une égale affection, sur son père et sa mère. Après avoir saisi une binette pour arracher les mauvaises herbes, il allait sortir quand un autre enfant moins âgé d’un an, vif et bruyant comme les êtres qui savent qu’on leur passe tous leurs caprices, entra en poussant des cris de joie:
«Papa, s’écria-t-il, regarde la belle pêche que j’ai faite; en voilà de gros barbillons! Quelle bonne friture maman nous servira au souper!
—Ah! c’est au bord de l’eau qu’était monsieur Félix,» dit le fermier avec un geste de menace comique; et feignant de lui donner une petite tape sur la joue, il l’embrassa tendrement.
«Comme il grandit, ce gaillard-là! bientôt il mangera des petits pâtés sur la tète de sa mère... Ah çà, es-tu allé à l’école ce matin?
—Oui, papa; c’est moi qui ai le mieux lu et le mieux écrit.
—Bien!... Si je fais des sacrifices pour ton éducation, au moins m’en dédommages-tu.
—Oh! c’est vrai, dit Étienne: hier j’ai rencontré le maître d’école; il n’y a pas de compliments qu’il n’ait fait de mon frère.»
Un sourire de satisfaction éclaira les traits de Roger: il ne s’aperçut pas qu’Étienne s’était éloigné en poussant un profond soupir.
Une demi-heure après, le fermier se disposait à sortir, lorsqu’un bruit de chevaux attira son attention: il vit deux cavaliers prussiens, un officier et un soldat, mettre pied à terre devant sa porte, et pensa tout de suite, non sans déplaisir, qu’un ordre du maire allait lui imposer ces nouveaux hôtes. L’officier, qui s’exprimait assez difficilement en français, lui présenta d’abord un billet de logement portant les noms du lieutenant Silback et de son domestique Fritz Kauffmann. Quand ils furent entrés, Silback prenant le fermier à part, lui expliqua de son mieux qu’il avait demandé à être logé chez lui, parce qu’il avait une lettre importante à lui remettre.
«O ciel! s’écria Roger, seriez-vous de Silésie?
—Ya, mein herr.
—Mon frère, qui a épousé une riche Allemande, est parti du pays depuis près de quinze ans; il a de belles propriétés aux environs de Glogaw. Moi, c’est différent, je n’ai pas fait fortune, malgré toutes les peines que je me suis données. Voyant que mes affaires tournaient mal, j’avais écrit, l’an dernier, à mon frère pour lui emprunter une somme d’argent, et relever ainsi ma ferme. Ne recevant pas de réponse, j’ai souvent accusé son cœur.
—Ah! répondit Silback, les gommunications n’affre point été très-vasiles tepuis ce temps; mais foilà la lettre en guestion.»
Roger, laissant le lieutenant occupé du soin de mettre ordre à son porte-manteau, courut rejoindre sa femme qui était descendue au jardin, tandis que Félix ne pouvait se lasser de contempler les uniformes des deux étrangers.
Le fermier décacheta la lettre avec une vive émotion que Justine partageait. Voici ce qu’ils lurent:
«Mon cher frère et ma chère sœur,
Je ne sais quand cette réponse vous parviendra. Les relations avec la France sont interrompues; et d’ailleurs j’ai de fortes raisons pour confier ma lettre à M. Silback, qui vous la remettra: c’est le fils d’un riche propriétaire de mon voisinage, un honnête jeune homme qui, un de ces jours, gagnera les épaulettes de lieutenant. Je ne sais quel sera le sort de la guerre; mais bien que je forme, comme tout bon Français, des vœux pour mon pays, je n’ose croire que la France résiste à tant d’ennemis ligués contre elle. Silback affirme qu’il viendra jusqu’à Paris avec son régiment, et qu’il pourra vous aller rendre visite. Si, comme je l’espère, il était arrêté à la frontière, il vous ferait parvenir ce paquet par la poste française, en prenant toutes les précautions possibles pour qu’il vous soit exactement remis; car je vous envoie en billets, sous ce pli, une somme de dix mille florins qui vous aidera à relever vos affaires.
Maintenant service pour service. J’ai de l’argent et vous n’en avez pas; mais ce qui me manque, ce sont des enfants, et vous en avez deux, deux dont vous me faites l’éloge. C’est pour mon cœur un grand chagrin que de ne jamais voir auprès de moi quelque tête bouclée de petit garçon ou quelque minois futé de petite fille. Envoyez-moi un de mes neveux; je me charge de son éducation et de son sort. Un refus me désobligerait beaucoup. Vous ne sauriez trouver de meilleur guide pour le fils, destiné à devenir le mien, que mon ami Silback. Je lui ai confié l’argent nécessaire pour acheter un cheval à mon neveu, qu’il m’amènera lorsque la paix sera signée. De cette manière, l’enfant voyagera agréablement et sans péril. Rien n’empêchera que, dans quelques années, nous nous réunissions tous.
Adieu, mes amis, je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Votre frère dévoué,
Louis Roger.»
A la lecture de cette lettre succéda un profond silence. Devenu plus juste en présence d’une si grave circonstance, ou bien, comprenant qu’il devait étouffer en cette occasion ses sentiments involontaires de préférence, le fermier n’osait s’arrêtera l’idée de se séparer d’un de ses deux enfants. La reconnaissance lui faisait cependant une loi de satisfaire au désir d’un frère qui venait de l’arracher à une ruine certaine. Il savait bien que l’enfant adoptif de Louis Roger trouverait une douce existence auprès d’un oncle riche et généreux; mais, sûr de l’affection de ses fils, il n’ignorait pas non plus que l’idée d’un départ, d’une séparation peut-être éternelle, leur briserait le cœur. Ce voyage se présentait d’ailleurs avec des dangers, ou au moins des fatigues. Pourtant si cette clause n’était pas remplie, il faudrait renoncer aux dix mille florins; car Roger ne pouvait profiter du don de son frère et en même temps le mécontenter. Absorbé dans ses réflexions, il avait fait un tour d’allée lorsque, en revenant sur ses pas, il aperçut Étienne qui, appuyé contre le sein de sa mère, versait d’abondantes larmes.
«Qu’est-ce donc? demanda-t-il avec une émotion mêlée d’étonnement.
—Mon ami, ne le gronde pas, s’empressa de répondre Justine: il avait tout entendu.
—Comment?
—Oui, pendant que tu lisais cette bonne et mauvaise lettre, Étienne était là derrière la haie, par hasard, occupé à sarcler, et c’est parce qu’il a entendu qu’il pleure ainsi.»
Le fermier pressa silencieusement la main de son fils Étienne, sans lever les yeux, dit d’une voix qu’il s efforçait de rendre calme:
«Mon bon père, il ne faut pas vous inquiéter. Avant tout, votre repos et votre fortune. Puisque Dieu vous a envoyé un secours inespéré, vous devez en profiter. Je suis bien content, oh! oui, bien content...»
Et ses larmes recommencèrent à couler. Pour les cacher, il alla ramasser la binette qu’il avait laissée à terre; puis revenant:
«N’est-ce pas, reprit-il, que vous me pardonnerez d’avoir écouté? Si vous le voulez, je ne dirai rien de tout cela à Félix... Mais non, il sera bien heureux d’apprendre que vos inquiétudes ont cessé.
—Étienne, s’écria le fermier, ne parlons plus de cette affaire aujourd’hui; demain il sera temps d’y revenir.
—C’est que je... désirerais pendant que nous sommes seuls...
—Voyons, qu’est-ce?—Eh bien! mon père, je puis vous épargner l’embarras d’un choix pénible. Je ne me dissimule pas que mon frère est plus aimable que moi.
—Peux-tu penser?...
—Oh! oui, Félix est gai; il a une jolie figure: plus tard, s’il va à l’école à Paris, il deviendra un beau monsieur, et maman sera fière de lui donner le bras. Vous ne pouvez donc pas hésiter entre nous, et c’est moi qui doit partir.
—Aucun des deux! s’écria Justine.
—Si, ma mère, et je vous promets de vous aimer toujours.»
Et pour mettre fin à cette scène d’émotion, Étienne s’enfuit en courant dans la direction du village.
Bientôt après on se réunit pour souper: hors Félix et le lieutenant, personne ne fit honneur au repas. Silback racontait avec bonhomie, dans un français mêlé d’allemand, ses aventures militaires. On arriva à causer de l’objet de sa venue, de la demande de Louis Roger.
«C’être un pien prave homme, disait Silback; l’enfant sera très-heureuse afec lui, et aura touchours de l’archent tans son poche.»
Félix, dont le caractère étourdi se pliait peu à la réflexion, dit en battant des mains:
«Oh! comme on doit s’amuser dans ce pays-là! Et mon oncle possède une belle maison?
—Ya, et une peau parc.
—Ah! je voudrais bien voir ça.
—Ainsi, dit le fermier en fronçant le sourcil, tu désirerais nous quitter?...
—Moi! pas du tout.
—Alors, pourquoi es-tu si curieux de connaître les propriétés de ton oncle?
—Songe donc, ajouta Étienne, aux fatigues du voyage. Tu ne sais pas seulement te tenir à cheval.»
Félix comprit, à l’air de tristesse de ses parents, qu’il avait eu tort de manifester une curiosité qui pouvait ressembler à de l’indifférence: il alla bien vite embrasser Roger et Justine, toujours disposés à lui pardonner.
Une semaine entière s’écoula dans les angoisses de l’incertitude; on ne s’expliquait pas, on attendait; enfin le lieutenant annonça que son régiment avait reçu l’ordre de regagner la frontière. Les habitants de la ferme échangèrent un regard plein d’une muette éloquence, et Étienne dit d’un son de voix déchirant:
«Il faut donc que je vous quitte!»
Sans donner à personne le temps de répondre, il monta à sa chambre, prit son costume de voyage, boucla ses guêtres de cuir et fixa à sa taille une ceinture qui contenait son petit pécule: il redescendit ensuite dans la salle commune où on l’attendait avec impatience. A sa vue, des larmes coulèrent de tous les yeux; mais lui-même maîtrisant son émotion, et heureux d’être payé de son sacrifice par de touchantes marques de regret, il fit observer à ses parents que ce départ était nécessaire, et ajouta:
«Peut-être un jour, fatigués de travailler, viendrez-vous chercher du repos auprès du frère qui vous aime. Je serai là, moi, pour avoir bien soin de vous. Ayons donc du courage: il ne faut jamais penser, n’est-ce pas, que l’on se sépare pour toujours?
—Tu as raison, ma foi! s’écria Roger; les bienfaits de ton oncle valaient bien la peine que l’on se conformât un peu à son désir. Va, mon garçon, ne te laisse manquer de rien sur ta route: voilà de l’argent.
—Merci, mon père, je n’en ai pas besoin; ne vous privez pas, mes économies me suffiront.
—Allons, vous verrez qu’il ne voudra rien emporter.
—Oh! si fait, répondit Étienne en dirigeant ses regards vers Justine. Maman a quelque chose que je désirerais bien lui demander.
—Qu’est-ce, mon fils? dit-elle.
—Votre petite croix d’ébène. Je la porterai sur mon cœur; elle me protégera; et puis je lui parlerai, et il me semblera que vous m’entendrez encore.»
Justine, toute émue, n’eut pas la force de détacher le cordon de soie qui retenait la croix.
«Prends-la, murmura-t-elle, mon pauvre fils.»
Étienne poussa un cri de joie, et enlaçant le cou de sa mère, il l’embrassa en se saisissant du talisman si précieux pour lui.
Au même instant la voix de Silback se fit entendre au dehors:
«Eh pien! cheune homme, fous bartez pas? le cheval être prête.»
A cet appel, Étienne répondit douloureusement: «Me voilà!»
Quelques moments après, il était en selle et gagnait, avec le lieutenant et Fritz Kauffmann, la route de Corbeil.
Tant qu’Étienne fut en vue du village d’Ablons, il se crut sous l’influence d’un rêve; il ne pouvait admettre l’idée d’un voyage, d’un exil peut être éternel.
Comme autrefois, la rive opposée étendait sous ses yeux un large tapis de verdure. A l’horizon, les détours de la rivière lui laissaient encore apercevoir la cime des arbres de Yilleneuve-Saint-Georges. Enfin, la vieille église d’Ablons n’avait pas cessé de lui offrir l’aspect de son clocher en ruine; mais lorsque la rive tourna brusquement, lorsque tous ses objets chéris se furent effacés des regards d’Étienne, celui-ci se trouva seul dans l’univers, et comme perdu au milieu de l’immensité. En vain la route multipliait-elle des spectacles enchanteurs, de beaux parcs, de jolies maisons de campagne, des paysages pittoresques; il était insensible à tout ce qu’il voyait; sa pensée seule avait des yeux pour regarder en arrière. La cordialité de Silback, la brusque franchise du soldat Fritz, n’avaient pas le pouvoir de le distraire. Plus il avançait, plus son désespoir devenait sombre. Il ne prenait de nourriture qu’autant qu’il en fallait pour ne pas tomber exténué. Aussi, en huit jours, avait-il horriblement maigri, lorsqu’il entra en Champagne avec le régiment de Silback.
Les Prussiens s’arrêtaient souvent, et, grâce au billet de logement, ils usaient largement de l’hospitalité et se regardaient comme en pays conquis.
De leur côté, les paysans qui avaient eu à supporter les malheurs d’une double invasion, voyaient avec répugnance ces étrangers prendre place au coin de leur feu, à leur table, et cherchaient toutes les occasions de leur faire payer en détail, derrière les haies, la nuit, à l’abri de quelque vieux mur, les chances trop favorables de la victoire.
Il ne se passait pas de jour sans qu’on retrouvât le corps de quelque Prussien ou Cosaque gisant sur le revers d’un chemin et victime de cette terrible guerre de représailles.
Non loin de Vassy, quelques hussards, sous les ordres de Silback, avaient été logés dans un grand bâtiment consacré à une filature, où n’habitait plus que la moitié des ouvriers, par suite des désastres du commerce. Les Prussiens avaient, selon leur coutume, et de crainte de surprise, laissé leurs chevaux tout bridés et sellés dans une salle basse; une sentinelle, l’arme au bras, veillait sur cette espèce d’écurie, et un autre se promenait, la carabine également chargée, dans une vaste cour, encadrée de hautes murailles.
Minuit avait sonné. La sentinelle de la cour marchait d’un pas égal, en portant les yeux sur l’ombre qui l’environnait. Le vent s’engouffrait, en gémissant, dans les longs corridors et les bâtiments déserts de la fabrique.
La sentinelle n’avait pas aperçu quelques lucarnes grillées, pratiquées dans l’un des murs de la tour. Soudain le bout du canon d’un fusil y fut appliqué, l’éclair d’une amorce brilla, une détonation se fit entendre, et le malheureux hussard tomba privé de vie.
A ce bruit, les Prussiens se lèvent en sursaut, étendent les mains dans l’ombre, se saisissent mutuellement; ils perdent un temps précieux à se reconnaître, à rattacher leurs sabres, et descendent en proférant des cris de mort.
Silback n’avait pas oublié son jeune ami: «Zuivez-moi, dit-il avec sang-froid, ce n’être rien, quelques mauvaizes têtes qu’il faudra gorriger.» Et, le sabre à la main, il se mêla à ses hommes en leur donnant des ordres.
Déjà une lutte désespérée s’était engagée dans l’escalier. A chaque étage, les ouvriers de la fabrique, embusqués, cherchaient à arrêter leurs ennemis, qui puisaient une nouvelle énergie dans le sentiment du danger. Lorsque les ouvriers étaient battus sur un point, ils se retiraient par des passages à eux connus, pour revenir d’un autre côté. Ce ne fut qu’avec beaucoup de peine que les Prussiens purent arriver jusqu’à l’écurie; mais ils y trouvèrent les brides de leurs chevaux coupées. Au même instant, Silback, qui descendait un des derniers, vit tomber à ses côtés le pauvre Étienne, sous la double atteinte d’une balle de pistolet et d’un terrible coup de sabre qui lui fendit la joue.
«Oh! ma mère! murmura le jeune homme, je suis perdu.
—C’est un Français! s’écria avec une expression de pitié l’un des assaillants, relevez-le et qu’on le soigne.»
Silback, outré de douleur de perdre l’enfant qu’on lui avait confié et d’entendre les cris des soldats auxquels la retraite était coupée, commanda de mettre le feu à la fabrique.
Cette inspiration termina le combat; craignant pour eux les suites de leur attaque et sachant que le signal d’alarme serait promptement donné par cet incendie aux troupes prussiennes campées aux alentours, les ouvriers se hâtèrent de fuir par des sentiers détournés, en ayant soin d’emporter leurs camarades blessés, et sans oublier Étienne. Les fermiers du voisinage leur offrirent en secret l’hospitalité et ne les laissèrent manquer d’aucun secours.
Silback, ayant reçu de puissants renforts, ordonna à son détachement de maîtriser l’ardeur de l’incendie, et fit rechercher partout son jeune protégé. Grande fut sa tristesse lorsqu’on revint lui dire que les perquisitions avaient été infructueuses.
Les cultivateurs qui avaient recueilli Étienne mourant, croyant voir en cet infortuné un prisonnier des Prussiens, se seraient bien gardé de le remettre entre les mains de Silback. Il fallut partir, et partir sans son dépôt. Le lieutenant était désespéré.... A la première ville, il dicta une lettre à un écrivain public qui, arrangeant en français ses phrases allemandes, fit comprendre à Roger et à Justine que leur fils n’existait plus...
Les souffrances d’Étienne furent longues et cruelles; avant l’extraction de la balle, on craignait pour ses jours. Pendant l’opération, faite par un vieux chirurgien militaire en retraite dans les environs, le jeune homme recueillit toutes ses forces et en puisa de surnaturelles dans la contemplation de la croix de sa mère: du reste, son âme était livrée à de poignantes incertitudes. Ne voyant plus autour de lui que des figures françaises, n’entendant plus l’accent du bon Silback, il cherchait involontairement des yeux l’étranger, et le souvenir vague du combat se représentant à son imagination lui faisait craindre, pour son ami le lieutenant, un sort plus funeste encore que le sien. Une fois seulement il demanda: «Où est monsieur Silback? de grâce où est-il?» Les paysans qui l’entouraient, chuchotèrent entre eux, et se dirent: «C’est la maladie qui lui trouble le cerveau... Silback!... qu’est-ce que c’est que ça?» Et comme Étienne répétait encore ce nom, un paysan répondit avec un gros rire: «Sois tranquille, mon garçon, si c’est un de ceux qui t’avaient empoigné, il y a longtemps qu’il est mort et enterré.» Étienne poussa un profond gémissement et perdit connaissance.
En revenant à lui, il se vit l’objet des soins les plus empressés. Le paysan qui l’avait effrayé par ses paroles imprudentes était au milieu d’un groupe, et tâchait de s’excuser. A partir de ce moment, Étienne se considéra comme séparé de Silback par un événement irréparable, tandis que le lieutenant était persuadé que la nuit du combat avait été mortelle pour son protégé.
Le ciel semblait vouloir faire épuiser à Étienne la coupe de l’adversité, comme pour mieux éprouver sa patience et sa résignation. A peine fut-il complètement guéri de ses blessures, qu’un fléau, terrible alors dans les campagnes où l’on n’avait pas adopté son puissant préservatif (nous voulons parler de la petite-vérole), vint atteindre le jeune homme et le rejeter pour un mois sur la couche de douleur. Quand il fut entré en convalescence et qu’il put se lever, il dit en souriant à la servante: «Jeanne, je dois être terriblement laid, n’est-ce pas?» L’expression de la pitié se peignit sur les traits de cette fille, qui n’osa répondre.
«Voyons, soyez franche, mes souffrances m’ont défiguré?
—Mais, monsieur Étienne, tout cela vous a un peu changé: c’est égal, vous avez toujours l’air bien bon et bien aimable.
—Rendez-moi, je vous prie, le service d’aller chercher un miroir; il faut que je me voie. Oh! faites-moi ce plaisir.»
La servante sortit et revint bientôt.
Lorsque le jeune homme aperçut son image, il ne put s’empêcher de frémir, tant il se trouva méconnaissable. Le coup de sabre avait laissé sur sa joue gauche un sillon horizontal, et sa dernière maladie avait gravé sur tout son visage une grande quantité de ces petits trous qu’on nomme vulgairement de la grêle. Mais, comme l’avait dit Jeanne, la physionomie d’Étienne n’était ni moins douce, ni moins expressive.
«Dans l’état où je suis, remarqua le jeune homme, personne ne me reconnaîtrait; ma mère elle-même hésiterait peut-être à voir en moi son fils.»
A la suite de ces paroles, il sembla comme frappé d’un trait de lumière; ses yeux s’animèrent d’un éclat étrange; la joie entrouvrit ses lèvres, donnant libre cours à des pensées que Jeanne ne pouvait comprendre:
«Oui, c’est cela, je suis sauvé! je pourrai vivre. Merci, mon Dieu qui m’avez défiguré! Si je ne suis pas avec ma chère famille, au moins ne serai-je plus loin d’elle... Car je ne puis revenir chez mon père; il me renverrait là-bas pour acquitter sa dette... Et le puis-je maintenant... et cependant il le faudrait... Mon oncle m’attend... Vous ne savez pas, Jeanne, comme c’est affreux d’avoir des parents qu’on aime, et de ne pouvoir être auprès d’eux. Mais, à présent, je ne suis plus forcé d’aller dans ce pays; j’ai payé la dette avec mon sang. Oh! c’est décidé, j’irai aux lieux où est resté mon cœur... Ils ne me verront pas; mais moi, Jeanne, je les verrai!»
A partir de ce moment, l’espoir, ce médecin de l’âme, doubla le courage d’Étienne et acheva sa guérison. Quinze jours ne s’étaient pas écoulés que déjà il était en état de soutenir les fatigues d’un voyage. Sa maladie l’avait fait grandir de près d’un pouce, tout en le maigrissant beaucoup: c’était là pour lui un espoir de plus de n’être pas reconnu. S’affermissant donc sans cesse dans sa pieuse résolution, il prit congé de ses hôtes après avoir échangé ses vêtements contre une blouse, un pantalon de toile et un large chapeau gris; il ne garda que l’argent qui lui était nécessaire, et laissa le reste comme gage de souvenir dans la chambre où il avait souffert si longtemps.
Le voyage d’Étienne ne fut marqué par aucun événement; d’ailleurs, pressé d’arriver, il ne s’amusait pas à faire d’observations sur la route. A une lieue au delà de Corbeil, il s’arrêta dans une auberge, et s’informa avec un air d’indifférence de son village, du nom des cultivateurs établis depuis peu au pays; et quand il sut tout ce qu’il voulait savoir, il se remit en marche, mais à plus grands pas que jamais. L’impatience le dévorait, son cœur battait à lui briser la poitrine.
Le jour baissait; mais il fallait qu’Étienne attendît encore pour entrer dans Ablons, car il craignait, non sans raison peut-être, de se voir reconnu. Attendre après s’être tant hâté!... Du moins, assis au bord de l’eau, avait-il le bonheur d’attacher ses regards sur les ardoises et le coq rouillé qui couronnaient le clocher.—Lorsqu’enfin l’obscurité lui parut assez grande, il se leva, et bientôt la porte de la maison paternelle s’offrit à ses regards: elle était ouverte... Étienne s’en approcha involontairement, et involontairement aussi il la poussa un peu: mais, avant qu’il n’eût rien vu, les aboiements d’un gros chien l’obligèrent à s’éloigner. De loin il entendit la voix joyeuse de Félix qui criait: «A bas, César, à bas!» Cette épreuve fut l’une des plus fortes qu’il eût supportées jusqu’alors. Bien que le sentiment de la jalousie fût étranger à son cœur, il ne put se défendre d’une certaine mélancolie en songeant au sort heureux d’un frère qui vivait parmi ceux qu’il aimait. Il se sentit encore plus isolé que la veille, et le voisinage d’êtres chéris ne lui fit que mieux comprendre combien il était séparé d’eux. Il avisa, sur le seuil de la porte d’une ferme, des figures qui lui étaient inconnues; s’approchant avec politesse, mais sans timidité, il demanda: «Mon bon monsieur, n’auriez-vous pas besoin par hasard d’un valet de ferme?»
Le paysan le toisa d’un air goguenard, et répondit:
«J’ai l’habitude de choisir des gaillards solides pour le service de ma ferme; quand il me faudra des enfants, l’école d’à-côté n’en manque pas.
—Monsieur, reprit Étienne avec une certaine fierté, vous ne me connaissez pas: depuis que j’existe, j’ai travaillé à la terre; et ce n’est pas pour me vanter, mais je connais toute espèce de culture.
—Déjà! et d’où venez-vous donc ainsi?
—De Champagne.
—Tout seul?
—Hélas! oui; j’ai perdu mes parents dans la guerre des alliés.
—Vraiment, pauvre garçon!... Et cette estafilade, est-ce que tu l’as reçue dans la mêlée?
—Mon Dieu, oui, avec ceci encore.»
Et il découvrit sa poitrine où la balle avait laissé une cicatrice assez profonde. Les maîtres de la ferme, émus de pitié, changèrent de ton avec lui. Il fut convenu qu’on le prendrait à l’essai pendant quinze jours, et que, s’il convenait, il aurait des gages au bout de deux mois. «Peu m’importe de ne gagner d’argent qu’à cette époque, pensa-t-il tout bas, pourvu que je puisse un jour acheter quelque chose pour la fête de mes chers parents.»
Laborieux et honnête comme il l’était, Étienne ne tarda pas à gagner la confiance des personnes de la maison: il leur devint indispensable. Sans connaître la cause de sa mélancolie habituelle, on respectait chez lui cette gravité prématurée. Il ne se mêlait pas aux jeux bruyants des autres serviteurs de la ferme; mais, le soir venu, il demandait la permission de sortir une heure, et cette heure précieuse qu’on lui accordait, il l’employait à se promener du côté de la maison de son père. Grande était sa joie quand la porte-charretière entr’ouverte lui laissait apercevoir les bâtiments et l’entrée du jardin potager. Quelquefois son père lui apparaissait de loin, et il remarquait avec chagrin que l’âge courbait de plus en plus sa taille; ou bien c’était sa mère qui, assise sous une tonnelle, filait au rouet en baissant la tête d’un air rêveur: mais souvent aussi Félix venait à passer, et sa gaîté, ses ébats avec le gros chien César, paraissaient ramener le bonheur au cœur de Roger et de Justine. Ces tableaux de la vie intérieure passèrent comme autant de rêves devant les yeux d’Étienne qui bientôt ne voyait plus rien, car des larmes brûlantes inondaient sa paupière. S’il n’eût écouté que l’ardeur de ses désirs, quelques pas l’eussent ramené au sein de cette famille qui se doutait si peu de sa présence: mais non, il n’osait encourir le mécontentement d’un père dont il n’avait pas acquitté la dette. Tous les dimanches, arrivé l’un des premiers à l’église et agenouillé sur les marches d’une chapelle latérale, il guettait furtivement l’entrée de sa mère. Oh! qu’il était heureux quand Justine se montrait avec sa robe de taffetas violet, son fichu de madras et sa coiffe bien proprette! Il cherchait ce qui pouvait manquer à la toilette de sa mère. S’étant aperçu qu’elle n’avait qu’une petite chaîne sans valeur, il songea avec ivresse qu’il pourrait, dans quelques mois, à l’époque de sa fête, lui en acheter une plus belle. Il attendit impatiemment le 26 septembre. Ce jour-là, il se rendit à Paris, y fit son emplette et mit la chaîne dans une petite boîte, avec ces mots seulement: «A Justine Roger, pour sa fête,—une personne qui l’aime tendrement et l’aimera toute sa vie.»—Il porta ce petit paquet à la diligence, et revint à pied en se livrant aux riantes idées que lui inspirait la certitude de causer une agréable surprise à sa mère. Que ne pouvait-il être là au moment où l’on ouvrirait la boîte!... Mais tout ce sait bien vite dans les villages; la nouvelle du cadeau mystérieux ne tarda pas à se répandre: on ne tarissait point en conjectures. Étienne seul paraissait ne prendre aucun intérêt à cette aventure; mais ses oreilles recueillaient avidement ce qui se disait autour de lui.
Le dimanche suivant, Justine vint à l’église, parée de sa chaîne d’or. Étienne la vit. Avons-nous besoin d’ajouter qu’il fut au comble de ses vœux?
Deux mois se passèrent, sans amener d’incident remarquable. Mais un jour le maître d’Étienne lui dit: «Pierre n’est pas là; il faut cependant que j’envoie chez le voisin Roger une charretée de fumier dont il a grand besoin, et que je lui ai vendue. Vous allez la conduire à sa ferme.»
Étienne demeura tout saisi, et ne put d’abord rien répondre. Mais, par nécessité, surmontant sa faiblesse, il s’écria: «Je ne puis aller chez monsieur Roger. Demandez-moi, hors cela, tout ce que vous voudrez.»
Son maître, qui avait l’habitude de trouver chez lui la soumission unie à la douceur, le regarda avec étonnement: il insista. Étienne resta inébranlable dans son refus, et dit avec calme:
«Dieu lit dans mon cœur, et sait que je n’ai point l’intention de vous fâcher.
—Eh bien! puisque vous mettez tant d’obstination à ne pas faire une commission aussi simple, c’est moi qui m’en charge; mais vous vous en souviendrez.»
Une demi-heure s’écoula entre le départ et le retour du fermier: ce fut presque l’éternité pour Étienne. Son maître reparut avec une physionomie empreinte d’une gaîté froidement ironique.
«Ah, ah! dit-il du plus loin qu’il aperçut son valet, Roger a bien ri du petit sauvage, et il se propose de venir voir celui qui a refusé de lui rendre visite. J’espère que c’est de l’honneur pour vous!...»
Étienne sentit son corps s’affaisser; une sorte de vertige le prit; mais bientôt, honteux d’avoir manifesté son trouble devant un étranger, il retourna à son travail en se disant:
«Mon père ne peut manquer de me reconnaître, s’il me fait parler. Il me faudra donc être exilé de nouveau. Que je suis malheureux!»
Mais cette visite qu’il attendait avec anxiété n’eut pas lieu ce jour-là, ni le lendemain non plus. Étonné de ne pas voir venir son père, dont il connaissait l’inflexibilité de résolution, le jeune homme se demandait, à chaque instant, ce qui l’empêchait ainsi d’accomplir ce qu’il avait annoncé, lui si exact, si ponctuel dans toutes ses promesses.
Au fond du cœur, un secret pressentiment lui disait d’aller au-devant des renseignements qu’il désirait obtenir. La crainte céda au besoin de nouvelles: Étienne rôda aux environs de la ferme, et, s’asseyant, en face, sur le banc d’une autre maison, rabattit sur ses yeux son large chapeau de paille, et il se mit en observation. Il remarqua beaucoup d’agitation dans la demeure de Jean Roger. On allait et venait; les valets de la ferme partaient dans diverses directions, comme pour faire des commissions pressées; l’un d’eux revint, un quart d’heure après, avec le médecin du canton; un autre, ayant amené le notaire, était ressorti tout de suite; Étienne s’élança vers lui, et, le saisissant fortement par le bras: «Grand Dieu! qu’y a-t-il donc? M. Roger serait-il malade?»
—«Parbleu! il a... il a... je ne sais plus comment ils appellent ça. Mais lâchez-moi, l’ami, il faut que j’aille avertir M. le curé. Bref, il est au plus mal.»
Étienne n’hésita plus. La nature lui dictait ses devoirs. Invoquant donc le ciel à travers ses larmes, il s’écria: «Au moins j’aurai sa bénédiction!»
En deux pas, il eut atteint le seuil de la porte. Personne pour lui barrer le passage: le chien, morne, abattu, le suivit d’un œil distrait. Étienne gravit l’escalier tortueux, et, arrivé sur le pallier, en face de cette chambre où étaient renfermés tous les êtres chers à son cœur, il s’arrêta, en comprimant avec force sa poitrine haletante.
Roger s’affaiblissant de plus en plus, mais sentant sans terreur le dernier moment venir, allait dicter ses dernières volontés au notaire, lorsque la porte s’ouvrit. Un grand jeune homme parut, il marchait d’un pas solennel en se couvrant le visage d’une de ses mains; arrivé au milieu de la chambre, il se précipita à genoux, et étendit les bras vers le lit du malade, en disant avec des sanglots:
«Me voici! mon père, me voici!
—Étienne!... Étienne vivant! cria tout le monde!
—Me voici, ma mère, mon frère, vous que j’aime! Oh! dites que je puis venir enfin!»
Justine était déjà près de lui, et le couvrait de baisers. Félix le pressait contre son cœur.
«Et moi! murmura le fermier en essayant de se soulever; est-ce qu’on ne m’embrasse pas?
—Ah!! mon père, mon bon père! C’est trop de bonheur, je n’aurai pas la force de le supporter. Il y a si longtemps que je souffre!
—Toi?
—Oh! que de fois j’ai voulu entrer dans votre maison, et implorer mon pardon d’être ici!
—Ici?
—Oui, mon père. Blessé, devenu méconnaissable, comme vous voyez, je conçus l’idée de revenir au village; car je ne pouvais vivre loin de vous... Mais je craignis votre juste sévérité, car mon oncle devait compter sur moi, j’eus peur d’être renvoyé en Allemagne. Aussi suis-je entré, comme valet, chez un de vos voisins.
—Depuis un an? s’écria Justine.
—Depuis un siècle, ma mère. Oh! mais n’est-ce pas que j’ai eu raison de revenir?
—Ah! pauvre enfant, dit Justine.—Nous t’avons tant pleuré... Et tu étais là, et tu nous voyais!
—Pas assez souvent.
—Et c’est toi peut-être qui m’as acheté une chaîne d’or?» Étienne ne répondit à Justine qu’en l’embrassant. Tous versaient des larmes, des larmes d’attendrissement.
Le curé entrait en ce moment; il vit la joie rayonner dans les yeux de Roger.
«Ah! dit-il avec cordialité, notre malade ne va pas mal. L’âme, chez lui, guérira le corps... Ah çà, qu’est-ce que je viens d’apprendre? votre fils, cet excellent sujet, vous a été rendu... Allons, allons, Dieu sait ce qu’il fait, et il ne voudrait pas vous séparer.»
Le bon prêtre avait dit vrai: Dieu ne sépara pas le père et le fils; et Étienne, en succédant à Roger dans les rudes travaux de la ferme, en acquittant bientôt, à force d’activité, la dette contractée envers l’oncle d’Allemagne, eut la douce satisfaction d’entendre ses parents bénir sans cesse le jour de souffrance, mais aussi de bonheur inespéré, où le fils absent avait été rendu à l’amour de sa famille.
Juan le Capitaine.
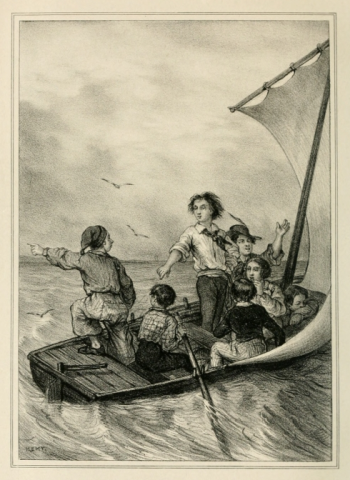
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Silence! Pilote, reprit Juan, qui ose donner des ordres en ma présence? Poltron!» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants

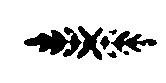
Juan, fils unique d’un des plus respectables habitants de Cadix, avait vu son enfance s’écouler, pure et riante, auprès de la plus tendre des mères. Jusqu’à l’âge de quatorze ans, il n’avait songé qu’à bien étudier, à mériter les récompenses réservées au travail et à la bonne conduite; nul désir insensé n’était venu troubler un seul instant le cours de sa paisible existence.
Mais hélas! un jour il s’éprit des récits merveilleux d’un vieux marin; et, comme il avait un oncle capitaine de vaisseau à bord du San-Pedro, ne se prit-il pas à croire qu’il devait être aussi, un jour, capitaine de navire. Dès-lors sa pensée alla se perdre au delà des mers, et l’ambition remplit son âme. Il oublia tout, jusqu’à ses jeux, pour ne rêver que de voyages et de navires; il n’écouta plus les leçons de ses maîtres; d’excellent écolier qu’il avait été jusqu’à ce moment, il devint musard et paresseux. Tous les jours, on l’eût pu voir au port de Cadix, et du haut de l’observatoire, petite tour qui s’élève au-dessus de la plupart des maisons de cette ville, promener ses regards sur la mer. Dès que les voiles d’un bâtiment apparaissaient à l’horizon, vite et vite il quittait son poste et volait au port pour assister au débarquement, causer avec les matelots, leur demander s’ils venaient de bien loin, et surtout s’ils avaient rencontré son oncle, le capitaine du San-Pedro. Les parents de Juan voyaient avec un profond chagrin cette conduite coupable, car sur lui reposait l’espoir de leur vieillesse; et l’idée qu’il pourrait les abandonner un jour, emporté par la fougue de son caractère, assombrissait leur vie qui s’était jusqu’alors écoulée si douce, si heureuse. Vainement essayèrent-ils de calmer l’ardeur insensée de leur fils chéri: Juan continuait à s’abandonner à ses rêves, à former mille projets plus fous les uns que les autres, de concert avec ses amis dont les plus dévoués étaient Fernandez, Pablo, Domingo, Gonzalez et Tomé.
Ces cinq étourdis ne l’appelaient jamais que mon capitaine; voici pourquoi: Juan était le plus fort, le plus hardi, le plus aventureux compagnon de toute la bande; on croyait déjà voir en lui le maître d’un vaisseau magnifique; alors on se montrait naturellement zélé, ardent, plein d’ardeur, dans l’espoir d’obtenir un jour quelque beau grade de ce vice-amiral en herbe.
Juan, tout fier des attentions de ses camarades, tranchait avec eux du vieux marin, engageait sa foi de capitaine, marchait le front haut, la poitrine tendue; il lui arrivait même, par distraction, de caresser de la main son menton et des moustaches encore à naître.
Il fallait surtout le voir, lorsqu’à la tète de sa petite escorte en bon ordre, il se dirigeait vers la cabane d’un vieux pêcheur nommé Marino, lequel avait conçu beaucoup d’affection pour lui. Vous eussiez dit un amiral s’en allant prendre le commandement de son escadre, car c’était toujours pour s’embarquer que Juan et ses amis s’éloignaient de Cadix. Leurs promenades maritimes avaient ordinairement lieu, le jeudi. De grand matin, don Juan le capitaine, ses officiers et ses matelots, se rendaient, chargés de provisions à la cabane de Marino; et celui-ci, moyennant une petite rétribution, leur livrait une de ses barques dont il confiait la conduite à son fils Angelo: alors on appareillait en poussant des cris d allégresse; il est vrai que la course n’était pas très-longue et que l’on se contentait de côtoyer le rivage pendant quelque temps, pour se diriger ensuite vers un îlot, terme ordinaire de ces expéditions nautiques.
Mais à peine descendus à terre, on feignait d’avoir parcouru une vaste étendue de mer; on simulait la fatigue, la méfiance, même la terreur, car on avait toujours relâché dans une île inconnue. Aussi un détachement partait-il à la découverte; les buissons étaient fouillés avec soin, puis on s’arrêtait pour écouter si des voix de sauvages ne se faisaient pas entendre; enfin, lorsqu’on se croyait bien en sûreté, on criait famine: on se révoltait, on allait même jusqu’à menacer le capitaine de le pendre, s’il ne procurait des vivres à son malheureux équipage.
Alors Juan, toujours digne, calme et impassible, comme le grand Colomb au milieu de ses matelots mutinés, prenait solennellement la parole et demandait un quart d’heure de répit pour aviser aux moyens de sortir d’une position aussi désespérée, puis il s’éloignait rêveur, pour revenir quelques instants après et montrer à ses compagnons d’infortune agréablement surpris, les provisions qu’il avait cachées sous l’herbe. Soudain des cris de joie accueillaient cette précieuse découverte, des distributions de vivres avaient lieu tout aussitôt, et cette fois, laissant pour un moment de côté toutes leurs parades d’emprunt, nos jeunes gens se mettaient à dévorer à qui mieux mieux, car ils se trouvaient munis d’un terrible appétit. Au reste, toute cette petite comédie se jouait avec un naturel qui eût fait envie à tous les Robinsons du monde. Lorsqu’on avait passé de longues heures dans l’îlot, on se rembarquait en entonnant quelques refrains de mer.
Un soir, Juan proposa à ses compagnons d’aller, le lendemain, à la rencontre de son oncle; car un navire, nouvellement arrivé, avait signalé en mer le San-Pedro; ceux-ci répondirent à cette ouverture par des cris d’enthousiasme. Le lendemain, tous s’étaient échappés furtivement de la maison paternelle, et ils se trouvaient au rendez-vous à l’heure indiquée, apportant chacun avec eux double ration. Fernandez, le favori intime du capitaine, fut chargé de la fonction la plus importante, celle de l’emmagasinage des vivres. On s’embarqua de bonne heure, et on fit relâche dans l’îlot accoutumé. Il faut savoir d’abord que le vieux pêcheur Marino n’avait pas été mis dans la confidence des projets arrêtés la veille, car, à coup sûr, il n’aurait pas consenti à louer sa barque pour une semblable expédition... Marino était un homme prudent. Quant à son fils, il avait beaucoup moins de prévoyance. Séduit tout à la fois par l’aspect des approvisionnements, par les arguments de Juan, comme aussi par l’appât de quelques pièces de monnaie, Angelo céda aux instances de tout l’équipage. Voilà donc nos marins triomphants qui, pour la première fois, quittent leur îlot d’adoption; le vent était frais et gaillard; ils louvoient un instant, puis tout à coup ils gagnent bravement au large.
C’est qu’aussi Juan, le capitaine, excitait ses hommes de la voix et du geste:
«Allons, enfants! du courage... Voguons en pleine mer; quelle fête nous attend à bord du San-Pedro! Nous oublierons là nos fatigues, vous, dans les bras des officiers et des matelots; moi, dans ceux de mon oncle; savez-vous bien qu’on le surnomme le Terrible, à cause de sa valeur... Je vois déjà d’ici la table des amis dressée en notre honneur dans la chambre du capitaine; j’entends déjà les hourras de tout l’équipage qui boit à notre santé... Attention, Pablo... Jouons de la rame... Très-bien, Gonzalez! et toi, Domingo, moins de nonchalance... Que vois-je! Tomé se croise les bras! Matelot fainéant, allons donc! rame en main... Garde à vous, pilote Angelo! gouvernons bien par notre saint patron, c’est sur vous et sur moi que repose la fortune de notre beau navire... Bien! très-bien! camarades... Le vent nous sourit, il nous pousse... Maintenant la voile nous suffira. Au repos donc la manœuvre, officiers et matelots. Et toi, Fernandez, verse dans nos coupes, tes vins de Rota, de Xerès et de Malaga.»
La manœuvre fut, en effet, suspendue comme par enchantement, et l’équipage devint tout oreilles.
«Capitaine, répondit Fernandez en portant militairement la main à son chapeau ombragé d’une plume verte; j’ai laissé à terre et dans nos caves les vins de Rota, de Xerès et de Manzanilla; mais voici d’excellent Malaga; il me coûte un peu moins de deux réaux[5] le cuartillo[6]. Ce nectar doit suffire à un équipage sobre et ami de la discipline.
—Une rasade donc à mes matelots altérés, s’écria le capitaine.»
Fernandez obéit, et le Malaga circula de main en main.
«A présent, reprit Juan d’une voix sonore, as-tu fait provision d’eau? Tu sais que notre traversée sera longue.
—Capitaine, je me suis muni d’eau de neige, qui me revient à quatre maravedis le verre[7]; l’Italien Mezoni n’a rien voulu rabattre de ce prix[8].
—C’est un peu cher, n’importe... L’eau est nécessaire aux voyages de longs cours. Et les vivres sont-ils abondants?
—Très-abondants et de première qualité. Domingo et Tomé ont fait les choses dignement; nous devons à leur générosité des gâteaux d’une pâte délicieuse. Je leur vote des remercîments au nom de tout l’équipage.
—Et moi, je leur pardonne la mollesse de leurs bras dans la manœuvre. Maintenant, Fernandez, distribue les rations.»
Fernandez ne se fit pas répéter cet ordre et chacun d’applaudir; bientôt nos marins s’abandonnèrent à toute leur belle humeur.
Cependant la chaleur, qui était excessive, ne tarda pas à les accabler. Le soleil dardait d’aplomb sur toutes ces folles têtes; il en résulta une démoralisation complète; on avait bien bu, bien mangé; or c’était à qui ferait la sieste... En vain Juan tenta de rétablir le bon ordre, il ne réussit qu’à s’enrouer à force de crier, «à vos places, à vos places... Paix ici, paix là...»
Au milieu de ce désordre, Angelo seul avait conservé toute sa présence d’esprit: il veillait à ce qu’il n’arrivât aucun malheur. Ainsi donc, vers les trois heures de l’après-midi, ayant signalé tous les signes précurseurs d’un gros temps, il s’écria:
«Allons, allons, citadins, plus d’imprudence. Voici le vent qui s’élève, un grain nous menace... Au nom de vos pauvres mères, regagnons l’îlot au plus vite.
—Silence! pilote, reprit Juan. Qui ose donner des ordres en ma présence? Poltron!
—Poltron!... plus de mauvaise plaisanterie! plus de capitaine! la farce est jouée, répliqua Angelo; c’est à moi de commander à présent; car je réponds de vous tous: je le répète, l’orage approche, et malheur à nous, si un coup de vent venait à nous jeter en pleine mer, nous serions perdus. Regardez les flots! comme ils s’élèvent menaçants déjà!
—Silence, encore une fois, maître Angelo! Nous croyons savoir notre métier tout aussi bien que vous..... Officiers, matelots, ramez en vrais corsaires, et gardez-vous de regagner terre.»
Cet ordre ne produisit pas grand effet; Gonzalez prit seul les rames. Fernandez se mit à chanter, tandis que Pablo dormait et que Domingo et Tomé s’amusaient à consommer en silence le reste des provisions. Quant à Juan, il continuait de quereller Angelo; mais celui-ci s’inquiétant fort peu de sa colère, n’en guidait pas moins toujours très-prudemment sa barque vers l’îlot encore bien éloigné. Soudain un violent coup de tonnerre vint fort à propos changer les dispositions de l’équipage. Nos pauvres citadins se mirent à ouvrir de grands yeux et à les reporter vers Angelo avec anxiété; Pablo, réveillé du coup, saisit une rame; Domingo et Tomé suivirent son exemple; Fernandez cessa de chanter.
Juan seul ne fut pas ému, et, s’obstinant dans son mauvais vouloir, il continuait de menacer de toute sa colère le pilote et l’équipage.
«Un capitaine de navire doit toujours être obéi quand même, s’écriait-il. Lâches matelots! je vous ferai tous pendre, entendez-vous? Ah! vous croyez que je ne suis plus capitaine... Vous vous rendez coupables d’une indigne trahison.»
Il achevait à peine ces mots que la tempête devint tout à coup plus terrible... Des éclairs réitérés sillonnaient la nue; des vagues énormes faisaient tourbillonner la barque et menaçaient à chaque instant de l’engloutir. «Ah! bonne Sainte Vierge, s’écrièrent alors d’un commun accord tous nos pauvres diables, pâles comme la mort, qu’allons-nous devenir! Nous sommes perdus, adieu nos pauvres mères!»
Et pourtant Juan pérorait toujours. «Courage! mes amis, courage! forcez de rames, répétait Angelo aux quatre jeunes gens, et vous silence! une fois pour toutes; il y va de notre vie ici.» Et comme Juan persistait à jouer encore son rôle de capitaine, d’un tour de main il le renverse et le garrotte au fond de la barque.
Cependant le danger devenait de plus en plus imminent; la petite embarcation, jouet constant des vents et des flots, était alternativement élancée sur la crête d’une lame comme sur une montagne, et de là précipitée dans un abîme, alors que celle-ci se retirait. Inondés d’eau de mer, couverts de sueur, épuisés de fatigues à force de ramer, nos infortunés navigateurs voyant tous la mort avec effroi, invoquaient tour à tour avec la plus ardente ferveur et leur patron, et la madone, et tous les saints du paradis. Enfin leurs vœux furent exaucés, et la barque vint échouer sur l’îlot tant désiré. Ah! il était grand temps.
Les voilà donc sauvés. «Mes amis, dit alors Angelo, remercions d’abord le ciel de notre délivrance.» Et tous les six s’agenouillèrent, et Juan tout le premier, car le pauvre capitaine depuis longtemps ne plaisantait plus; il avait l’oreille basse, il était confus, humilié. Il sentait trop bien qu’avec ses bravades, il avait compromis son existence et celle de tous ses camarades. Aussi, s’adressant à Angelo:
«Me pardonnerez-vous, lui dit-il, Angelo. J’étais un fou, et nous vous devons notre salut. Vous vous êtes conduit en pilote expérimenté. Mais maintenant, dites-moi, comment sortirons-nous d’ici. La pluie ne cesse de tomber à torrents; le vent souffle toujours avec violence; ces arbres sous lesquels nous voilà réfugiés, ne nous offrent qu’un abri passager.
—Nous en serons quittes, reprit froidement Angelo, pour passer la nuit en ce lieu.
—La nuit, dites-vous! répliqua Juan. Oh! que deviendront nos pauvres parents!
—Ma bonne mère, ajouta Fernandez, pleure déjà ma longue absence...
—Que j’ai de regrets de notre malheureuse équipée, interrompit Pablo; Dieu sait quelle correction m’attend.
—Ah! nous sommes bien coupables, soupira Gonzalez; résignons-nous. Quant à moi, si l’on me reprend jamais à faire semblable folie...
—Et nous donc! s’écrièrent ensemble Domingo et Tomé, tout en grelottant et faisant piteusement ruisseler l’eau de leurs vêtements... Peste soit de la mer et du capitaine!
—Allons, allons, la plainte est inutile, reprit Angelo. Songeons plutôt à nous tirer d’affaire et à bâtir une cabane pour nous mettre à l’abri de la pluie. Voyons, citadins, à l’œuvre; tout paresseux couchera dehors.»
A ces mots, tout le monde s’agita et courut au travail; les uns cassèrent çà et là des branches d’arbres; les autres les disposèrent, en forme de toit, sous la direction d’Angelo. En moins d’une heure, une cabane de feuillage était construite, et nos marins infortunés avaient au moins un abri pour la nuit.
Personne ne ferma l’œil, vous le pensez bien; on était glacé, trempé; tous nos pauvres jeunes gens mouraient d’ailleurs de faim; on n’entendit donc que des plaintes et des gémissements. Enfin, à deux heures du matin, les vents s’étant complètement apaisés, chacun était sur pied, on se rembarqua dans un morne silence; et, la tristesse au front, l’air bien piteux, on arriva chez Marino. Le vieux pêcheur avait veillé toute la nuit; il reprocha durement aux jeunes citadins et à son fils d’avoir abusé de sa confiance; puis, s’adoucissant à la vue du pitoyable état dans lequel se trouvaient ces imprudents navigateurs, il alluma un grand feu autour duquel chacun d’eux sécha ses vêtements... Au retour de l’aurore, Juan et ses amis pénétrèrent, silencieux et craintifs, dans la ville de Cadix, puis se séparèrent bientôt pour aller essuyer les justes reproches de leurs familles, qui toutes étaient plongées dans une inquiétude mortelle.
Deux jours après cette expédition, Juan revit ses compagnons de voyage: «La rude leçon que nous avons reçue, leur dit-il, nous profitera, n’est-ce pas? Quant à moi, dégoûté pour jamais des excursions maritimes, je reprends mes anciennes habitudes et ma vie simple et heureuse d’autrefois.»
Ses amis lui jurèrent qu’ils étaient de son avis, et qu’ils tiendraient de grand cœur les promesses qu’ils venaient de faire à leurs parents. En effet, nos ex-marins menèrent, dès ce moment, une conduite irréprochable. Juan, qui les avait longtemps entraînés dans le mal, fut toujours le premier à leur donner le bon exemple. Devenu rangé, studieux, il se fit chérir de tout le monde, et trouva sa plus douce récompense dans l’affection de son père et de sa mère, dont il ne s’éloigna plus jamais.
[5] Le réal vaut vingt-cinq centimes.
[6] Le cuartillo espagnol est le demi-litre français.
[7] Trois centimes valent quatre maravedis.
[8] L’eau ordinaire est très-mauvaise à Cadix. On est contraint d’acheter de l’eau de neige. La glace se conserve dans des caveaux généralement occupés par des Italiens.

A quelques lieues de Clermont, en Auvergne, il y a un tout petit village perché sur une haute montagne, dans lequel vivent plusieurs familles pauvres et malheureuses. La neige couvre la terre pendant presque toute l’année; aussi les habitants descendent-ils, pour passer l’hiver, dans les villes voisines, afin de s’y procurer, à force de travail, le moyen de vivre. Aussitôt qu’ils ont amassé quelque argent, ils reviennent dans leurs montagnes; car, malgré la tristesse de ce pays et le peu de ressources qu’il peut leur offrir, ils l’aiment avec passion, et souffrent tant qu’ils en sont éloignés.
Il y a quelques années, au commencement de l’hiver, une pauvre famille de ce pays était réunie dans une chaumière de chétive apparence; les murs, ébranlés par le vent, tombaient en ruine, et le toit, effondré par la neige, laissait voir le ciel à travers ses poutres disjointes: tout, dans cette demeure, avait un air de pauvreté et de misère qui serrait le cœur.
Ceux qui l’habitaient étaient tristement rassemblés autour de la cheminée, dans l’âtre de laquelle brillaient quelques pommes de pins embrasées. Un homme âgé, assis dans un coin, attachait une courroie en cuir sur une petite boîte; souvent il s’interrompait dans son travail, et tournait ses regards vers sa femme qui pleurait en arrangeant dans un sac quelques vêtements d’enfant.
Un petit garçon de huit ans, assis par terre, jouait avec une marmotte; il cherchait à faire tenir debout, sur ses pattes de derrière, le pauvre animal, qui paraissait prendre fort peu de plaisir à ce genre d’exercice. Plusieurs autres enfants plus petits couraient çà et là dans la chaumière: c’était là toute la famille du père Tranchon, le chaudronnier.
«Allons, Jeanne, dit le bonhomme à sa femme en mettant de côté la boîte qu’il venait d’arranger, allons, ne pleure pas comme ça... Ah! par Notre-Dame de Bon-Secours, notre enfant nous reviendra.
—Mais, en attendant, il faut qu’il parte!
—Eh! oui. Que veux-tu, femme; tu vois bien que le travail ne va guère, ça n’empêche pas les enfants d’avoir faim, et il faut leur donner à manger. Julien est notre aîné, il a huit ans, c’est un brave garçon, il fera comme j’ai fait moi-même autrefois; il ira à Paris et travaillera, afin de donner du pain à ses petits frères... puis, quand il sera grand et fort, eh bien! il reviendra au pays.»
Le pauvre père voulut continuer; mais l’idée de se séparer de son fils lui faisait trop de chagrin; il fut obligé de se taire; une larme brilla dans ses yeux, et il pressa contre son cœur le petit Julien. «N’est-ce pas, lui dit-il, tu seras bien sage, bien honnête?—Oui, père.—Tu prieras le bon Dieu pour nous? ajouta sa mère.—Oui; je lui demanderai qu’il me fasse la grâce de vous revoir bientôt.—Allons, mes enfants, dit le père Tranchon, venez auprès de votre frère; embrassez-le... car il part demain, et vous ne le verrez pas d’ici bien longtemps.» Les petits enfants embrassèrent Julien en pleurant. «Prions Dieu une dernière fois ensemble, dit la mère.» Toute la famille se mit à genoux et implora les bontés du ciel pour le pauvre petit voyageur.
Le lendemain, de grand matin, Julien quitta la chaumière; il portait son sac au bout d’un bâton sur son épaule, et la boîte en bois où se trouvait sa marmotte était retenue sur son dos par la courroie en cuir que son père y avait mise. La pauvre Jeanne suivit son fils jusqu’au bas de la montagne; et quand il eut disparu au détour du sentier, elle rentra bien triste en pensant qu’elle allait être séparée pour bien longtemps de son enfant. Le père Tranchon conduisit Julien jusqu’à Clermont, et le laissa sur la route de Paris.
Il y a bien loin, bien loin de Clermont à Paris, mes enfants; aussi le petit Auvergnat fut-il plus d’un mois avant d’y arriver; et cependant il fit la route sans trop de fatigue; car il était si gentil, que souvent les charretiers qui le rencontraient en chemin, lui permettaient de monter derrière leur voiture.
Aussitôt qu’il arrivait dans un village, il tirait sa marmotte de sa boîte et dansait avec elle en chantant une chanson de son pays; alors la foule se rassemblait autour de lui, et quand il faisait le tour du cercle pour demander un petit sou, il en tombait beaucoup, et souvent de gros, dans son chapeau.
Julien continuait alors à marcher, bien content d’avoir un peu d’argent à envoyer à sa mère.
Il arriva ainsi à Paris, et visita la grande ville avec Jeannette, sa marmotte. Ils allaient tous deux dans les endroits les plus fréquentés, le dimanche aux Champs-Élysées, les jours de la semaine dans les rues et sur les boulevards; il s’arrêtait devant les personnes qu’il voyait à leur fenêtre: mais souvent, hélas! en dansant il avait le cœur bien triste, car il n’avait pas encore gagné un sou, et il avait bien faim.
Et puis il se désolait, parce que Jeannette ne voulait pas apprendre à faire l’exercice; la pauvre bête aimait bien mieux dormir; mais Julien n’entendait pas raison sur ce point; il la posait dans un coin, sur ses pattes de derrière, lui mettait un petit fusil, grossièrement travaillé, entre les pattes de devant, et alors il s’évertuait à crier: «Portez arme!... Présentez arme!... En joue... feu!» Jeannette faisait les choses tout de travers, et la leçon d’exercice ne finissait jamais sans qu’elle reçut un certain nombre de chiquenaudes. Enfin, à force de patience, Julien arriva à faire de sa marmotte un bien mauvais conscrit, il est vrai, mais assez instruit cependant pour amuser la foule.
Un jour qu’il y avait fête aux Champs-Élysées, Julien s’y rendit. Le temps était superbe, la foule encombrait les allées; la journée promettait d’être fructueuse. Après avoir fait manœuvrer Jeannette d’un côté de la promenade, Julien voulut passer de l’autre; les voitures se pressaient dans la grande avenue, les cavaliers se croisaient en tous sens; le pauvre petit, heurté par un cheval, tomba sur la terre; on s’empressa autour de lui, on le soigna, et bientôt il rouvrit les yeux: il pensa aussitôt à Jeannette, et tira la corde qui l’attachait. Hélas, Jeannette, la bonne Jeannette avait été écrasée. Alors Julien pleura amèrement, car sa marmotte était la seule amie qu’il eût à Paris; elle partageait ses peines et ses plaisirs, dansait avec lui, mangeait quand il mangeait; c’était pour lui comme une sœur, c’était toute sa famille.
Le lendemain il partit de bonne heure pour aller chanter... lui qui avait tant envie de pleurer... mais personne ne le regardait; Jeannette n’était plus la pour faire l’exercice et amuser les passants. Le soir arriva, il n’avait gagné qu’un sou; il se coucha bien tristement, en cherchant comment il pourrait vivre désormais.
A son réveil, il descendit dans la rue, et vit un petit garçon qui marchait en criant de temps en temps: Haut en bas! haut en bas! Il était noir comme le tuyau d’une cheminée; son bonnet de coton, sa chemise, son pantalon, ses bas, tout cela était noir. Un morceau de cuir, auquel étaient fixés plusieurs instruments en fer, pendait de sa ceinture jusqu’au haut de ses jambes; un autre morceau semblable couvrait ses genoux.
«Qu’est-ce que tu chantes-là? lui demanda Julien.—Tiens, pardin’!... Haut en bas!—Et que fais-tu pour être si noir?—Je ramone les cheminées du haut en bas.—Est-ce que c’est amusant?—Quand la cheminée est large, ça va encore; mais quand elle est étroite, dam’ c’est pas drôle.—Gagne-tu beaucoup d’argent?—Nenni; mais j’ai un bon maître qui me donne à manger, tant que j’ai faim.»
En entendant ces paroles, Julien se rappela qu’il n’avait pas déjeuné. Il fouilla dans sa poche... elle était vide.
«Est-ce que ton maître me prendrait avec lui? dit-il.—Dam’, il faut lui demander... Tiens, justement le voilà.»
En effet, Julien vit venir à lui un gros homme dont la figure était toute noire, et qui tenait un grand sac sous le bras; il eut peur, et pensa à s’enfuir... mais il avait faim, et rien pour déjeuner... il resta.—Le lendemain, Julien était ramoneur.
Deux années s’écoulèrent ainsi, pendant lesquelles Julien travailla avec courage. Souvent il lui en fallait beaucoup, car il commençait à grandir, et avait beaucoup de peine à entrer dans les cheminées. Il en sortait quelquefois tout meurtri; ses mains et ses jambes étaient écorchées; mais il n’osait se plaindre, de peur d’être battu par son maître.
Un jour il alla dans une pension pour ramoner les cheminées; son maître n’était pas encore arrivé; il s’assit dans la cuisine en l’attendant. Madame Simon, la maîtresse de la maison, entra quelques instants après; l’air de souffrance de Julien l’intéressa elle se mit à causer avec lui.
«Quel âge as-tu, mon petit? lui dit-elle.—Dix ans, madame.—Comment te nommes-tu?—Julien.—Est-ce que tu travailles avec ton père?—Oh non! M. Jacques n’est pas mon père... c’est mon maître.—Où sont donc tes parents?—Bien loin, au pays.»
Au souvenir de ses parents, Julien ne put retenir ses larmes.
«Pourquoi pleures-tu, mon enfant? Est-ce que tu n’es pas heureux? lui demanda madame Simon.—Oh! non; maintenant surtout, car je me fais toujours du mal en ramonant... Tenez, ma bonne dame, regardez mes jambes.» Et Julien, relevant son pantalon, fit voir ses jambes toute meurtries.
«Pauvre petit, dit madame Simon... Si je te prenais chez moi pour faire mes commissions, serais-tu bien sage?—Oh! oui, madame, répondit Julien en levant ses beaux yeux vers elle: je vous aimerais comme ma mère.—Eh bien, nous allons tâcher d’arranger cela.»
Madame Simon fut trouver son mari, et lui proposa de prendre Julien comme domestique; il y consentit. Maintenant il fallait décider maître Jacques, et ce n’était pas chose facile; car le petit garçon était si sage, si rangé, si travailleur, qu’il l’avait pris en affection. Mais Jacques pensa que bientôt Julien serait trop grand pour le servir utilement: moyennant une légère somme d’argent, il se détermina à laisser le ramoneur à la pension.
Au bout de quelques jours, Julien fut méconnaissable; sa figure, toujours cachée sous une couche épaisse de suie, parut fraîche et rose. Il quitta ses vêtements noirs, qui le faisaient ressembler à un petit diable, pour en prendre d’autres un peu moins laids: il devint tout à coup un fort gentil garçon.
Dès que ses nouveaux maîtres le connurent bien, ils l’aimèrent comme leur enfant: il est vrai qu’il faisait tous ses efforts pour se montrer reconnaissant de leurs bontés. Dès le matin, avant le jour, il se levait et préparait tout dans les classes, qui n’avaient jamais été si propres et si bien tenues que depuis qu’il était chargé de les nettoyer. Tout le jour, il travaillait dans la maison, et cherchait à se rendre le plus utile qu’il pouvait. Sa propreté, sa complaisance, sa politesse, le faisaient remarquer de tous ceux qui venaient à la pension.
Le soir, il allait dans la chambre d’un vieux maître qui l’avait pris en affection: il apprenait à lire et à écrire. Après bien du travail, il parvint à surmonter les premières difficultés. Alors l’envie de s’instruire pénétra dans son cœur; il comprit qu’il pourrait s’élever au-dessus de sa condition par la science, et dès ce moment il ne pensa plus qu’à étudier.
Aussitôt que son ouvrage de domestique était fini, il prenait un livre et travaillait. Pendant que les élèves étaient en classe, il allait se mettre contre la porte pour entendre les leçons du professeur.
A quinze ans, Julien était devenu le plus fort de tous les élèves de la pension. M. Simon voyant ses progrès, le dispensa de son service et le fit étudier lui-même. Il suivit alors les cours du collège; et, à la fin de l’année, mes enfants, le petit ramoneur était couronné deux fois au grand concours, en présence de la reine, des princes, des ministres et de toute une assemblée illustre.
Deux ans après, Julien subit un examen pour l’école militaire de Saint-Cyr: il fut reçu le premier. Le roi, sachant la position dans laquelle il se trouvait, paya son trousseau, sa pension, et lui donna même quelque argent pour ses parents.
Après avoir passé deux années à l’École militaire, Julien en sortit le premier de tous ses camarades.
Aujourd’hui il est sous-lieutenant, et c’est l’un des officiers les plus distingués de l’armée. Chaque année, il envoie la moitié de sa solde à ses parents, qu’il est allé visiter dans leurs montagnes.
Le père Tranchon et Jeanne sa femme, heureux et fiers, parlent à tout le monde de leur fils Julien, le sous-lieutenant.
C’est ainsi, mes enfants, que par le travail on s’élève, et l’on acquiert dans le monde une belle et bonne réputation. Julien ne doit qu’à lui-même la position qu’il occupe; et souvent encore, lorsqu’il est triste, il regarde ses vêtements de ramoneur qu’il a conservés, et qu’il eût toujours portés peut-être, sans la bonne madame Simon.

Bergeronnette et la vraie Fée.
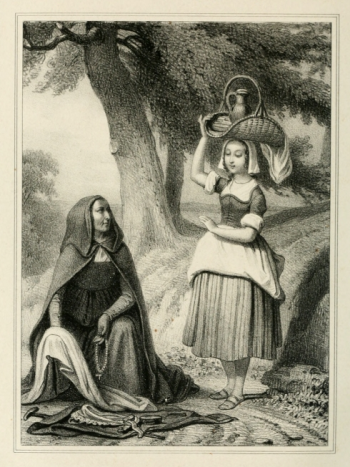
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Tiens, vois donc, un Fichu de dentelle, | |
| une robe, un collier!» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
A mademoiselle Louise Asseline.
Il était une fois une petite fille
Si leste, si proprette et mignonne et gentille,
Que, l’appelant du nom d’un beau petit oiseau,
Tous ceux qui la voyaient passer dans le hameau
Lui disaient: «Eh! bonjour! bonjour, Bergeronnette!
Comme te voilà belle!...» Et pourtant sa toilette
Était bien simple; mais à sa simplicité
La grâce et la fraîcheur tenaient lieu de beauté.
Comme c’était le temps où l’on croyait aux fées,
Il n’était bruit partout que de ses destinées
Auxquelles, disait-on, une fée un matin,
Sortant de son rocher profond et cristallin,
Avait dû présider le jour de sa naissance.
Le fait est que ce jour, à côté du berceau,
Une dame, inconnue aux sentiers du hameau,
Avait soudain paru comme vient l’espérance.
Déposant quelques dons dans les mains des parents,
La dame au doux sourire avait dit: «Bonnes gens,
Vous désirez beaucoup cette petite fille:
Il ne tiendra qu’à vous qu’elle soit bien gentille:
Pour elle, sachez mettre à profit ce présent
Que je vous fais exprès humble, mais suffisant.
Simples et frais atours, grâce de la nature,
Prévenance et douceur, âme candide et pure,
Des jeunes filles sont, même ailleurs qu’au hameau,
Le trésor le plus vrai, l’ornement le plus beau.
Un jour (je ne dis pas, bonnes gens, à quelle heure)
Je reviendrai savoir ce que vous aurez fait
De l’enfant de vos vœux, ainsi que du bienfait.»
Et la dame, à ces mots, avait fui la demeure,
Et personne depuis ne l’avait pu revoir.
Mais, selon ses conseils et selon son espoir,
Bergeronnette allait croissant en gentillesse,
Quand bientôt se changea son enfance en jeunesse.
Vers ce temps à peu près, voulant se marier,
S’en revint au pays un honnête ouvrier.
Comme en leurs premiers jeux ils étaient du même âge,
Quand ils étaient petits, Bergeronnette et lui,
On avait dit souvent qu’ils feraient bon ménage...
Et le pauvre garçon y pensait aujourd’hui.
De crainte et d’espérance à la fois, l’œil humide,
Il en fit aux parents l’aveu simple et timide.
Et les parents, charmés plus qu’ils ne le montraient,
Se regardant tous deux, lui dirent «qu’ils verraient;
Qu’il restât au pays de deux à trois années
Aux travaux assidus appliquant ses journées,
Et que des vœux de tous alors bien averti,
Avec Bergeronnette on prendrait un parti.»
Et lui qui, pour l’instant, n’espérait davantage,
Le sourire à la bouche et la joie en son cœur,
Il s’en alla rêvant de son futur ménage;
Puis il mit au travail une nouvelle ardeur.
Et chacun se disait: «C’est pour lui que la fée
Marqua dès le berceau la jeune protégée,
Et c’est encor pour lui qu’elle doit revenir;
Mais il le méritait, il faut en convenir:
Pas un n’est plus actif, plus sage, plus honnête;
Tout le monde au pays prendra part à sa fête.
Brave enfant du hameau, qu’il soit heureux toujours,
Et que Bergeronnette embellisse ses jours!»
C’est ainsi qu’on parlait dans toute la campagne;
Car il est de ces cœurs que chacun accompagne,
Et dont le bonheur même est le bonheur d’autrui:
Doux rayon de soleil qui dans notre âme a lui,
Du tableau des méchants qui console la vie,
Avec l’humanité qui nous réconcilie,
Et qui, dorant la coupe où l’on boit tant de fiel,
Nous donne sur la terre un avant-goût du ciel.
Depuis que la demande en avait été faite,
Un an avait encor grandi Bergeronnette.
Quoique toujours charmante et naïve et sans fard,
Ce n’était plus l’enfant qui sourit au hasard:
C’était la jeune fille aux paupières baissées,
Qui des yeux de sa mère attend toutes pensées.
Son charme en augmentait: car la timidité
Est un voile enchanteur qui sied à la beauté.
C’était, à ce qu’on dit, dans la saison d’automne,
Quand sur le point de voir s’effeuiller leur couronne,
Comme pour nous porter davantage aux regrets,
Des plus riches couleurs se parent les forêts.
Le soleil qui sourit, même à ce qui se fane,
Glissait sous leur mystère un rayon diaphane,
Et leur feuillage alors, améthyste, doré,
Pourpre, de jets de flamme à sa cime éclairé,
Et de mille reflets variant sa verdure,
D’une pompe royale escortait la nature.
Tout, des fleurs les derniers épanouissements,
Des oiseaux les derniers et doux gazouillements,
Sur l’herbe moissonnée, à des fêtes champêtres,
Tout semblait convoquer dans un dernier essor;
Tout semblait dire: «Allons, quand il est temps encor,
Jeunes filles, dansons, dansons sous les grands hêtres!»
Et se laissant aller à ces joyeux penchants,
Enfants, jeunes garçons, jeunes filles des champs,
Un dimanche, devaient danser à la vêprée;
Et par cet air de fête, elle-même inspirée,
Bergeronnette aussi, fleur d’à peine seize ans,
Devait mener ses pas au son des instruments.
Mais, la veille, à l’endroit où le sentier s’incline,
Voilà que, sous son bras portant riche paquet,
Une vieille commère à la voix pateline,
Et dont rien qu’au souris la ruse s’indiquait,
Par sa jupe tira soudain Bergeronnette:
«C’est toi que je cherchais justement, ma jeunette,
Lui dit-elle. Vois-tu, c’est qu’un brillant seigneur
Voulant que pour la fête au hameau préparée,
La plus charmante soit aussi la mieux parée,
M’a dit de t’apporter ce présent si flatteur.»
Bergeronnette fut, comme on croit, bien surprise,
Et ne sut que répondre avant d’être remise.
Profitant de ce trouble où jetait son abord,
La vieille déposa dans un coin sa béquille,
Dénoua le paquet devant la jeune fille,
Et lui détaillant tout pour la tenter plus fort,
S’écria: «Tiens, vois donc, un fichu de dentelle,
Une robe, un collier!... Mais, déjà la plus belle,
Avec cette toilette à l’aspect triomphant,
Tout le monde au hameau t’enviera, mon enfant!»
La vieille encor parlait, que du ciel inspirée,
Et fermant son esprit à la séduction,
Déjà Bergeronnette, avec émotion,
S’éloignait en disant: «Ah! la méchante fée
Qui vient, comme un serpent, glisser au fond des cœurs
Le goût des vanités, du luxe et des grandeurs!
Remportez vos présents qui me font peu d’envie.
La vieille, et laissez-moi ma douce et simple vie!»
Et puis, se rappelant la dame du berceau
Dont souvent ses parents l’avaient entretenue,
Elle ajouta, marchant d’un pied leste au hameau:
«C’est elle qui sans doute à mon aide est venue;
Merci, ma bonne fée! Oh! demeurez toujours,
Toujours à mes côtés, pour être mon secours!»
Le lendemain portant fraîche et simple toilette,
A la danse champêtre alla Bergeronnette,
Et sur son front brillait la grâce et la gaîté:
Car la grâce ingénue et la sérénité
Sont deux fleurs de jeunesse ainsi que de nature,
Au front de la vertu qui servent de parure.
Endimanché de neuf, l’humble et digne ouvrier,
Quoiqu’il fût de travail plus souvent que de danse,
A la fête non plus ne manqua pas, on pense;
Et celle qu’il devait du premier pas prier,
Tous la montraient d’avance entre les jeunes filles;
Et tous félicitant du regard les familles
Et de Bergeronnette et du jeune garçon,
Semblaient leur demander: «A quand le mariage?
Ne le verra-t-on pas avant qu’à la moisson
Ait encor succédé la chute d’un feuillage?
Ou bien pour réunir ces fleurs d’un même jour,
Attendra-t-on encor d’un printemps le retour?»
Avec celle qui seule appelait sa présence,
Bien heureux, le jeune homme allait ouvrir la danse,
Quand, à ses yeux frappés de soudaine stupeur,
Entre elle et lui survint un riche et beau seigneur:
«Un moment, mon ami; je suis aussi de fête,
Dit-il, et le premier avec Bergeronnette,
Si cela lui convient, la danse j’ouvrirai,
Et puis d’un grand projet, tout haut, je l’instruirai.»
La foudre avec l’éclair éclatant où l’orage
Ne s’est pas même encore annoncé d’un nuage,
Jamais ne produisit un plus terrible effet
Que de ce haut seigneur l’aspect n’en avait fait
Il avait tout pour lui, rang, puissance et richesse;
C’était des environs le plus riche héritier;
Et pendant que, tout pâle et muet, l’ouvrier
Restait là, lui reprit: «Je fais ici promesse
Que si Bergeronnette accepte mon anneau,
Elle sera ma femme et la reine au château.
Bergeronnette est belle, et de plus elle est sage;
J’en eus hier encor le plus assuré gage.
A celle qui n’a pas de mes présents voulu,
Je viens offrir ma main sans détour superflu.»
Plus que la veille encor l’enfant était saisie;
Des larmes dans ses yeux roulaient, et ses regards
Ne cherchaient que la terre, et sa force ravie
La laissait sans parole en de si grands hasards.
Et, dans l’anxiété, toute la foule agreste
Attendait qu’un seul mot, un seul regard, un geste,
Répondant au seigneur qui lui tendait l’anneau,
Fît de Bergeronnette une reine au château.
Mais pourtant, dans un coin de cette étrange scène
Que remplissait de lui le superbe héritier,
Les yeux se reportaient vers le pauvre ouvrier
Tout près de succomber sous sa cruelle peine,
Et que tous ses amis entouraient, mais en vain,
Quand tout à coup, ô grâce! ô surprise inouïe!
Bergeronnette en pleurs vers lui tendit la main,
Et rendit à sa lèvre un sourire et la vie!
Le seigneur, tout confus, sortit en ce moment,
Et ses traits renversés trahissaient son tourment.
Ce fut alors aussi que, de gloire éclairée,
Celle que les parents nommaient la bonne fée,
La dame qui jadis apparut au berceau,
Survint, mais cette fois devant tout le hameau.
«Plus sûrement encor, moi, je tiens ma promesse,
Que celui que tu viens, enfant, de refuser;
Me voilà: car en rien je ne sais abuser;
La véritable fée, ici c’est la sagesse
Qui vint sur ton berceau déposer un souris,
Et qui de la vertu t’offre aujourd’hui le prix,
Dit la dame en allant droit à Bergeronnette.
Ce prix est un joyau que le cœur seul reflète;
C’est le bonheur qui fuit quand vient l’ambition,
Le bonheur que l’on trouve au champ qui nous vit naître,
Et près de qui jamais ne peut nous méconnaître,
Plus qu’à changer de place et de condition.»
La dame, en achevant, disparaît... et la foule
Qu’anime et réjouit l’aspect des deux heureux,
Reprend avec transport ses danses et ses jeux,
Jusqu’à ce que la nuit sur les champs se déroule.
Et quand Bergeronnette et le digne ouvrier,
A peine un mois après, s’allèrent marier,
Celle que du hameau désormais la jeunesse,
Dans sa simplicité, nommait la Fée-Sagesse,
Revint encor, dit-on, au front plein de candeur
Attacher de sa main et le voile et la fleur.
Bernardin de Saint-Pierre.
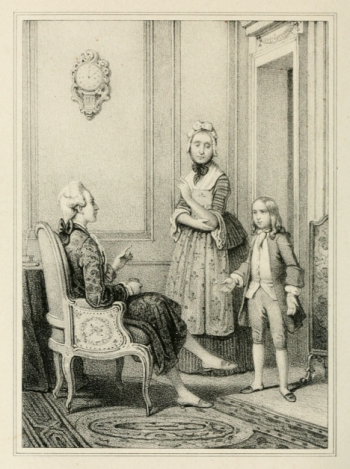
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Qu’avec vous à dire pour défense, mon fils, dit à son tour Mr de Saint-Pierre.» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
Un jeune enfant de neuf ans, blond et rose, était penché à la croisée d’une charmante maison située sur le port, dans la ville du Hâvre; il avait devant lui un bol plein d’eau de savon, et à la main une longue paille creuse; il s’amusait à faire des globules de savon. Tantôt il suivait, avec admiration, de l’œil, la bulle qui s’arrondissait sous son souffle, puis se balançait gracieuse en reflétant les rayons du soleil, puis se détachait, volait, brillante des couleurs de l’iris, jusqu’à ce que sa forme, devenue à chaque instant plus vaporeuse et diaphane, s’évanouît dans l’espace; tantôt interrompant ce jeu naïf, il se tournait vers le fond de l’appartement, avec un geste d’impatience.
Dans cette partie de la chambre, qui attirait si souvent l’attention de l’enfant, était une jeune femme assise devant une toilette; ses beaux cheveux blonds, épars et livrés aux soins d’une vieille femme, se tressaient, sous les doigts de cette femme de chambre, en nattes dorées, en boucles soyeuses.
«Maman, êtes-vous prête? demandait l’enfant chaque fois qu’il tournait la tête vers la jeune femme.
—Bientôt, mon enfant, répondait celle-ci.
—Bientôt, bientôt, reprit l’entant maîtrisant un moment d’humeur; depuis que vous le dites, maman, bientôt devrait être à présent.»
La jeune femme fronça le sourcil.
«Ces enfants n’ont pas plus de patience qu’une carpe dans un filet, dit la vieille bonne en lançant un regard sévère au petit faiseur de bulles de savon.
—Et ces femmes n’en finissent jamais avec leur toilette, répliqua l’enfant, rendant regard pour regard.
—De quelles femmes parlez-vous, Bernardin, répliqua la jeune dame d’un ton sévère.
—De... de... Marie Talbot, répondit Bernardin en hésitant, qui reste deux heures à chaque boucle qu’elle fait.
—C’est-à-dire, M. Bernardin, répliqua aigrement Marie tout d’une haleine, que ces femmes, cela veut dire, madame de Saint-Pierre, votre mère, et moi; et que, pour un enfant qui a reçu de l’éducation comme vous, à qui, matin et soir, on fait dire son catéchisme, et qui devrait alors savoir par cœur les dix commandements de Dieu, dans lesquels on trouve celui-ci, le principal de tous: Père et mère honoreras, afin de vivre longuement, vous auriez pu répondre plus poliment.
—Ta, ta, ta, interrompit Bernardin en imitant, avec la langue, la volubilité avec laquelle sa bonne avait parlé; ta, ta, ta, quel claquet de moulin!
—Sainte Vierge, mère de Dieu! s’écria Marie Talbot; un claquet de moulin, moi, Marie Talbot! m’entendre appeler claquet de moulin, et par qui, bon Jésus! par un enfant que j’ai vu pas plus gros que le poing, un enfant que j’ai vu naître, que j’ai tenu sur mes bras la première...
—Un enfant, un enfant, qui n’en est plus un, riposta Bernardin avec aplomb; quand on a dix ans...
—Dites donc, neuf ans, monsieur, neuf ans... interrompit la bonne d’une voix claire.
—Dix ans, mademoiselle, dix ans! répondit Bernardin, imitant le fausset de la vieille femme.
—Neuf ans, monsieur Bernardin; n’êtes-vous pas né le 19 janvier 1737?
—Oui, mademoiselle Marie Talbot; après...
—Ne sommes-nous pas au 20 mai de l’année 1746...
—Après... après...
—Comment, après!... cela ne fait-il pas neuf ans, quatre mois et un jour? je sais compter, peut-être.
—Dis-moi, Marie, reprit Bernardin se rapprochant de sa bonne; nous sommes en 1746, n’est-ce pas?
—Oui, eh bien! qu’a cela de commun avec...
—Écoute jusqu’au bout: n’as-tu pas entendu vingt fois mon père, ma mère, mon oncle Godebout, le capitaine de navire, dire que nous sommes dans le dix-huitième siècle; eh bien?...
—Eh bien! tu es dans ta dixième année aussi, reprit sa mère, mais ça ne complète pas plus tes dix ans, que cela ne transporte le siècle à l’an 1800... Allons, mon pauvre Bernardin, te voilà pris dans ton propre raisonnement, ajouta madame de Saint-Pierre en riant; ça ne t’amuse guère, n’est-ce pas?
—Ce qui m’amuse encore moins, dit Bernardin en retournant tête basse à la croisée, c’est qu’on m’a promis de me mener promener, qu’il fait un temps superbe, et qu’on ne m’y mène pas...
—Me voilà prête, dit madame de Saint-Pierre en se levant; je n’ai plus qu’à boire ma tasse de lait, mettre mes gants, prendre mon éventail, et...
—Quel bonheur! dit Bernardin sautant de joie.»
En ce moment Marie Talbot, qui s’était éloignée, revint la figure rouge de colère.
«C’est à n’y plus tenir, madame, dit-elle, s’adressant d’une main à sa maîtresse, et de l’autre menaçant l’enfant; c’est à demander son congé, à aller se jeter la tête la première dans l’Océan... à... à... à...
—A quoi encore? demanda l’enfant en riant.
—Voyons, explique-toi, ma bonne, ajouta la jeune femme avec bonté...
—Il rit... au lieu d’aller se cacher, reprit Marie Talbot; il rit... madame, ajouta la vieille femme avec explosion; madame, cet enfant finira mal!
—Ah! mon Dieu! tu me fais peur, cria Bernardin affectant tous les signes d’une grande frayeur.»
Madame de Saint-Pierre rit, et Marie Talbot reprit en sanglotant: «Eh bien! madame, apprenez que votre fils, M. Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, a bu votre tasse de lait, que j’avais mise au frais sur la croisée de votre cabinet de toilette, où le soleil ne donne jamais.
—Est-ce vrai cela, Bernardin? demanda madame de Saint-Pierre à son fils, qui était resté pétrifié sous le poids de cette accusation.
—Mais cette vieille femme est donc devenue folle? s’écria-t-il enfin avec indignation.
—Folle! folle! vous l’entendez, madame.»
Marie Talbot sortit et revint au même instant, portant un bol de porcelaine de Chine entièrement vide.
«Tenez, madame, voyez plutôt.
—Allons, Henri, lui dit sa mère avec douceur, si c’est toi qui as bu mon lait, dis-le; ce n’est pas un crime, et mentir en est un.
—Mais, maman, je vous jure... dit Henri tout ému et le cœur gros.
—Ne jure pas, et avoue...
—Oui, avouez, M. Bernardin, reprit la vieille bonne, vous en serez quitte pour recevoir le fouet, et tout sera dit.
—Mais je vous répète... interrompit Henri, en frappant du pied.
—Bernardin, reprit aussitôt madame de Saint-Pierre avec un air d’autorité calme et froide; il n’y a dans la maison que votre père, moi, Marie et vous; j’espère que vous ne soupçonnez ni votre père, ni moi, ni Marie, d’avoir été clandestinement boire cette tasse de lait; il n’y a donc que vous qui puissiez l’avoir bu; avouez-le, demandez-en pardon, car c’est un acte de gourmandise, et la gourmandise est un vilain défaut; vous en serez quitte pour cette légère remontrance, et nous irons, tout de suite après, nous promener.
—Oui, M. Bernardin, avouez, reprit Marie Talbot; votre mère vous pardonnera, je vous pardonnerai, nous vous pardonnerons tous.
—Eh! je n’ai pas besoin de pardon, puisque je n’ai pas commis de faute, répliqua Bernardin avec plus d’impatience; je n’ai pas bu le lait de maman, je ne l’ai pas bu.
—Gourmand et menteur; eh bien! il ne manquait plus que cela! grommela Marie.
—En vérité, vous me feriez mettre en colère, reprit de nouveau l’enfant en frappant du pied; es-tu donc sourde! vieille femme... quand je te dis que ce n’est pas moi qui ai bu le lait.
—C’est donc moi, alors, répliqua Marie; car enfin, ce lait ne s’est pas bu tout seul.»
L’enfant allait riposter, quand madame de Saint-Pierre, fatiguée de toutes ces discussions, prit à son tour la parole:
«Chut, Marie, dit-elle avec douceur en s’adressant à la bonne; quant à vous, Henri, ajouta-t-elle d’un air à moitié sévère en se tournant vers son fils, je ne vous punirai pas pour avoir bu le lait, mais pour avoir menti; rendez-vous dans votre chambre; vous y resterez tout le temps de la promenade. Marie, allez enfermer monsieur, et apportez-moi la clé de sa chambre.» Puis, comme Bernardin ouvrait la bouche pour protester encore de son innocence, la jeune mère fit un chut impératif, et répéta: «Allez»; force fut à lui d’obéir.
Ce fut la tète haute, l’œil étincelant de colère, que Henri suivit Marie Talbot; la vieille bonne marchait devant, tête baissée, de sorte qu’on eût pu croire que c’était elle qu’on punissait.
Pour se rendre dans la chambre du petit Bernardin, il fallait traverser celle de M. de Saint-Pierre; celui-ci s’habillait; en voyant passer la vieille bonne, le regard triste, la tête baissée, et son fils, le front haut, les joues en feu, il l’appela.
«Qu’est-ce que cela signifie? demanda-t-il; on dirait qu’il se passe ici quelque chose d’extraordinaire.
—Et l’on dirait vrai, monsieur, se hâta de répondre Marie, coupant ainsi la parole à Bernardin; M. votre fils a fait un mensonge, et je vais, par l’ordre de madame, le renfermer à clé dans sa chambre.
—Ne la croyez pas, papa, s’écria Bernardin vivement; je vous jure que je ne mens pas.
—Voyons l’histoire, dit M. de Saint-Pierre en s’asseyant dans un grand fauteuil, tandis que Marie et Bernardin se tenaient debout devant lui; il ajouta: c’est à l’accusateur public à prendre la parole, et, comme il paraît que tu en remplis l’emploi aujourd’hui, parle, Marie, je t’écoute.»
Marie, ainsi interpellée, raconta, d’un bout à l’autre, ce que vous savez déjà; et elle acheva son récit par cette réflexion toute concluante: «Il n’y a dans la maison que monsieur, madame, l’enfant et moi; ce n’est ni monsieur, ni madame, ni moi, donc c’est l’enfant.
—Qu’avez-vous à dire pour votre défense, mon fils, dit à son tour M. de Saint-Pierre.
—Que ce n’est pas moi qui ai bu le lait, répondit celui-ci d’un air de fierté indignée.
—Eh bien! moi, je suis obligé cependant de conclure comme Marie, reprit le père de Bernardin; et je suis désolé, je l’avoue, de voir un Saint-Pierre, un descendant d’Eustache de Saint-Pierre, s’abaisser jusqu’au mensonge pour éviter une légère humiliation: celle d’avouer qu’il a bu une tasse de lait. Apprenez ce que fit votre aïeul au siège de Calais, monsieur, et sachez que la noblesse des actions est aussi honorable que celle de la naissance, et que, dans ni l’un ni l’autre cas, on n’y doit déroger; écoutez: Lorsqu’en 1300, Édouard III, roi d’Angleterre, fit le siège de Calais, les habitants opposèrent une vigoureuse résistance; néanmoins Calais fut pris, et Édouard promit la vie sauve aux Calaisiens, à condition que six notables d’entre eux viendraient en chemise, nu-pieds et la corde au cou, se mettre à sa discrétion. Jean de Vienne, gouverneur de la ville, fit sonner la cloche, rassembla les habitants, et leur annonça la dure condition imposée par le vainqueur. Personne, comme vous le pensez, mon fils, ne pouvait se décider à aller ainsi donner sa vie pour racheter celle de son voisin; car il ne s’agissait rien moins que de mourir. Tous versaient des larmes, jusqu’à Jean de Vienne, qui pleurait plus fort encore que les autres. Alors le plus riche bourgeois de la ville, votre aïeul, Bernardin, se leva, et dit, dans le langage naïf du temps (je vous ferai lire cela dans Froissard): Seigneurs, grands et petits, grant meschief seroit de laisser mourir un tel peuple, quy icy est par famine ou autrement, quand on peut trouver aucun moyen, et feroit grant aulmosne et grace envers notre seigneur, qui de tels meschiefs les pourroit garder. Puis, ayant dit ces mots, il ajouta qu’il se dévouait le premier, avec l’espoir que Dieu lui accorderait le pardon de ses péchés, pour prix de cette action... L’élan donné, son exemple trouva des imitateurs. Jean d’Aire, autre bourgeois considérable, dit qu’il feroit compagnie à son compère sire Eustache; les deux frères Wissaut, leurs cousins, se joignirent à eux, ainsi que deux autres bourgeois dont on n’a pas conservé les noms; et tous six se dépouillant de leurs vêtements et ne gardant que la chemise, ainsi que l’avait prescrit Édouard III, s’avancèrent nu-pieds et la corde au cou, conduits par le gouverneur, vers la porte de la ville. Jean de Vienne les remit en cet état à Gautier de Mauni, officier du roi d’Angleterre, en lui disant tout haut, avec larmes et sanglots, auxquels répondaient les larmes et les sanglots des habitants de Calais, hommes, femmes et enfants: Je jure que ces six victimes sont les plus honorables et notables de corps, de chevances et de bourgeoisie de la ville de Calais. Gautier de Mauni les prit alors par la corde et les conduisit au roi; ils s’agenouillèrent, et, les mains jointes, Eustache parlant pour tous, dit à peu près: Gentil sire roi, voyez ici six bourgeois de Calais et grands marchands, qui vous apportons les clefs de la ville et du château, et nous mettons en votre pure volonté pour sauver le reste du peuple de Calais, qui a souffert beaucoup de maux, veuillez donc avoir pitié et merci de nous par votre haute noblesse. Loin de se laisser toucher, le roi, qui avait sur le cœur les grands dommages que les Calaisiens avaient fait souffrir sur mer aux Anglais, les regarda d’un air menaçant, et donna ordre qu’on leur tranchât à tous six la tête. Heureusement la reine était près du roi; émue de pitié en faveur de ces hommes recommandables, qui se dévouaient si généreusement, elle se jeta en larmes aux pieds d’Édouard, et le conjura, pour l’amour d’elle et de l’enfant qu’elle portait, de vouloir bien faire merci à ces six victimes dévouées. «Ah! madame, reprit le roi en la relevant après un moment de silence, je préférerais que vous fussiez ailleurs qu’ici; mais vous priez si bien que je ne puis rien vous refuser; je vous abandonne ces hommes, disposez d’eux.» Ainsi furent sauvés Calais et ses habitants, par l’admirable dévouement d’un de nos aïeux... Il est bien certain que, tout petit, Eustache de Saint-Pierre, qui avait pu sacrifier sa vie si noblement, n’aurait pas, au prix d’un mensonge, voulu s’épargner une légère punition; allez réfléchir sur celte histoire, mon fils, allez.»
Bernardin fit le geste de quelqu’un qui ne serait pas compris s’il parlait, et s’élança désespéré dans la petite chambre dont la porte se referma sur lui.
Quand Bernardin se vit seul, loin de tout regard, la fierté de son innocence, qui l’avait soutenu jusqu’alors, l’abandonna tout à coup: il fondit en larmes.
«Ainsi donc, criait-il, je suis enfermé comme un coupable, puni comme tel, et je ne le suis pas! Comment faire pour prouver mon innocence?... mais on aurait dû lire sur mon front, deviner dans mon accent, que je disais vrai; un enfant qui dit la vérité, ça devrait se voir, comme on voit qu’il fait jour... et je suis puni... et je ne vais pas promener... et, qui pis est, on me prend pour un menteur!... un menteur... moi!... Oh! mon Dieu! ajouta le pauvre enfant en s’approchant de la fenêtre ouverte et levant les yeux au ciel; oh! mon Dieu! vous qui pouvez tout... faites connaître mon innocence... tout de suite... avant que l’heure de la promenade ne passe... Faites-un miracle en ma faveur... Oh! je vous en prie, un tout petit avant que l’heure de la promenade soit tout à fait passée, pour que maman découvre mon innocence et vienne me délivrer!... Une... deux... trois... trois heures! reprit-il en comptant l’heure qui sonnait à la pendule de la chambre voisine; trois heures, déjà!... Oh! c’est fini, je n’irai pas promener d’aujourd’hui, ajouta-t-il en se levant désespéré et parcourant la chambre à grands pas; le bon Dieu n’a pas eu pitié de moi, de mon innocence; car, enfin, je ne suis pas coupable, moi, pour être puni... je n’ai fait de mal à personne, moi... Ah! le bon Dieu n’est pas juste, n’est pas bon, puisqu’il n’a pas fait un miracle en ma faveur.»
Et brisé de larmes, de sanglots, l’enfant alla tomber sur une chaise devant la croisée ouverte, et il se prit à regarder avec courroux les objets qui l’entouraient.
Cette immense étendue d’eau qui faisait paraître sa chambre plus petite; ce ciel élevé, contrastant si fort avec le plafond qui semblait peser sur sa tête; ces milliers d’oiseaux qui volaient dans l’air en chantant devant lui, pauvre prisonnier, et ce soleil dont l’éclat blessait sa vue, et tout ce peuple qui allait où il voulait, riant, causant, et sans s’inquiéter de lui le moins du monde, il voyait ce magnifique spectacle sans le regarder; il entendait, sans les écouter, ces mille bruits divers qui annoncent que tout vit dans la nature; mais peu à peu, calmé par la fatigue, Bernardin commença réellement à voir et à écouter; la mer s’anima, les vaisseaux qui lui paraissaient immobiles, il les vit bercés mollement sur les flots; ce paysage que l’amertume de ses pensées lui faisait paraître mort, il le vit tel qu’il était, inondé de lumière, verdoyant, embaumé; et ce soleil qui n’avait fait jusque-là que blesser sa vue, il le vit éclatant, répandre à profusion l’or de ses rayons et sa chaleur vivifiante sur cette nature de printemps.
Comment rester froid, insensible devant ce merveilleux tableau, dont chaque trait vient révéler la main divine qui le créa et l’anima! Enthousiasmé, Bernardin sentit un doux frisson lui parcourir le corps, et, se précipitant à deux genoux devant la croisée ouverte, il s’écria: «Oh! je suis un insensé; il y a un Dieu bon, il y a un Dieu juste.» Et il fondit une seconde fois en larmes, mais ce n’était pas des larmes de colère, de découragement; non, ces larmes coulaient sans amertume; elles soulageaient sa poitrine oppressée, elles lui faisaient du bien; c’était une rosée bienfaisante qui lui rafraîchissait le cœur!
Dans ce moment même de douce émotion, Bernardin leva la tête et aperçut sa mère qui revenait de la promenade; elle marchait vite et était suivie par une voisine, brave femme assez commune, qui occupait, au même étage de la maison, un logement dont les croisées étaient contiguës à celles de l’appartement de M. de Saint-Pierre.
La maman ne leva pas les yeux vers l’endroit où se tenait son fils; elle se précipita plutôt qu’elle n’entra dans la maison; un instant après, la porte de la chambre de Bernardin s’ouvrit, et il se trouva tout à coup dans les bras de sa mère, qui le serrait tendrement.
«Pauvre enfant! disait celle-ci en couvrant son front de baisers et de caresses... pauvre enfant, il avait bien raison de protester de son innocence.
—Ah! enfin, s’écria Bernardin, heureux de se voir justifié par ces paroles, on sait donc qui a bu le lait, on connaît le vrai coupable, on va donc le punir à son tour...
—Le voici, et je demande grâce pour lui, interrompit la voisine, en paraissant sur le seuil de la porte et présentant à la colère de Bernardin un gros chat noir, qui, d’un air qui n’avait rien de repentant, passait encore sa langue sur ses longues babines.—Le voici; profitant des croisées ouvertes à cause de la chaleur, Miaou n’a pu résister à la tentation d’aller déjeuner chez la voisine. Je suis arrivée trop tard, malheureusement, et comme il achevait de boire le lait... J’ignorais complètement les malheurs qu’avait occasionnés cet acte de gourmandise, lorsque rencontrant la voisine sur le port, je m’informai du petit, et j’appris avec chagrin la punition qu’on lui avait infligée pour une action dont Miaou s’est seul rendu coupable; et je viens, le pauvre Miaou dans les bras, demander grâce pour lui, il est si jeune, il a si peu d’expérience!
—Accordé, accordé, dit Bernardin, passant sa main sur le dos de Miaou; plus de punition, amnistie complète; seulement, j’exige que la voisine, toujours prenant la parole au nom de Miaou, vienne me disculper devant mon père, et lui prouver que son fils Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre n’est pas indigne de ses aïeux, au nombre desquels se trouve Eustache de Saint-Pierre, bourgeois de Calais, dont, à chaque faute que je commets, on me raconte l’histoire mémorable... Du reste, mon histoire, à moi, prouve une chose, c’est qu’il ne faut pas juger les enfants sur les apparences...
—Dame!... elles y étaient les apparences, répliqua Marie Talbot; soyez juste, M. Bernardin.
—Allons, allons, répondit l’enfant en riant, toi et Miaou vous êtes pardonnés... mais que cela ne vous arrive plus.»
Cet enfant, mes jeunes amis, dont je vous ai déjà parlé ailleurs, fut plus tard l’auteur de Paul et Virginie, livre charmant qu’il est impossible de lire sans répandre des larmes.
Né le 19 janvier 1757, Bernardin de Saint-Pierre mourut le 21 janvier 1814, à l’âge de soixante-dix-sept ans deux jours.
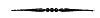
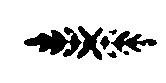
Il y avait une fois un roi... mais, avant d’être roi, et même après qu’il eut cessé de l’être (car, comme tant d’autres, sa royauté s’est éteinte), il était seigneur de la Popelinière.
Ce seigneur était avare au dernier point. On cite de lui des traits à faire rougir Harpagon. De plus, il était amateur passionné de la bonne chère: aussi ne dînait-il pas souvent chez lui. Il donnait six sous par jour à son valet; encore, sur cet ordinaire, le pauvre diable était-il obligé de se nourrir. Je vous laisse à penser s’il était maigre! c’était à faire pitié. Les voisins l’avaient surnommé l’Araignée. Son véritable nom était Claude. A l’époque de cette histoire, il était âgé de douze ans au plus.
Un jour, Claude ayant, en courant, renversé un garçon pâtissier qui portait une tourte en ville, M. de la Popelinière, à qui l’on vint se plaindre du dégât, battit si fort la chétive Araignée, que le maître pâtissier, M. Godiveau, touché des pleurs de la victime, résolut de l’arracher à cette misère. «Voulez-vous entrer chez moi en qualité d’apprenti? dit-il à Claude.» On peut penser si le pauvret accepta de grand cœur; et le lendemain, la transformation était faite. Ç’avait été l’affaire d’une veste blanche et d’un bonnet de coton. Un mois après, Claude avait des joues de chérubin. On le surnomma la Caille, et il devint gai comme un pinson. Claude était un garçon actif et intelligent; il ne renversa plus de tourtes, que celles qu’il portait lui-même; encore les raccommodait-il si artistement, que c’était à bouche qu’en sais tu.
Privé de Claude, M. de la Popelinière ne reprit plus d’autre laquais. C’était toute économie. Personne d’ailleurs n’eût consenti à refaire la toile de la pauvre Araignée; car de Saint-Sever à Cauchoise, de Saint-Paul au mont Riboudet, (ce sont les quatre points cardinaux de la ville de Rouen, qu’habitait M. de la Popelinière), l’insigne ladrerie de celui-ci était devenue proverbiale.
En l’année...—mais je ne vous dirai pas l’année, par la raison que je ne sais point laquelle, je vous dirai seulement que c’était dans les premiers jours de janvier, le 5, je crois;—M. de la Popelinière était dans son cabinet; il était magistrat et travaillait en ce moment à préparer un rapport dans une affaire qui l’occupait beaucoup: il s’agissait d’un procès entre une écaillère et un marchand de marée, à propos d’une perle trouvée au fond d’une huître. Le 5 de janvier, dis-je, à huit heures du matin, M. de la Popelinière, assis devant son bureau et vêtu de sa robe de chambre, fut tout à coup arraché à ses réflexions par de nombreux coups frappés à la porte de son domicile. Ce bruit lit tressaillir notre homme de la pointe des pieds à la pointe des cheveux... de sa perruque, laquelle était à marteau... Celui de la porte ne cessait de battre.
«Eh quoi! dit-il, serai-je donc toujours interrompu et assiégé par ces maudits plaideurs, car je suis sûr qu’ils ont encore quelque nouvelle impertinence à me faire; impossible de se débarrasser de celte engeance! Hier, ce sont deux bourriches que m’apporte l’écaillère; j’ai la faiblesse de les accepter et la curiosité de les manger. Vous verrez qu’aujourd’hui il me faudra recevoir de la partie adverse quelque esturgeon ou quelque brochet. A quelle sauce ces gens-là croient-ils donc que la justice se mette?»
Ce disant, le sieur de la Popelinière descendit de l’appartement qu’il occupait au premier étage de sa maison, et fut ouvrir le guichet de la porte de la rue, mais il ne reconnut ni l’écaillère, ni le marchand de marée. Un des gens de M. de la Neuville, président de la cour où siégeait M. de la Popelinière, se tenait là, une lettre à la main. Il la passa par le guichet à M. de la Popelinière, qui la prit aussitôt et se hâta de refermer le guichet, dans la crainte, sans doute, d’avoir à débourser quelque monnaie. Cette missive contenait une invitation à dîner, adressée par le président à son ami et confrère, pour le lendemain, 6 janvier, jour des Rois.
M. de la Popelinière fut charmé de l’invitation. La maison du président était tenue sur un excellent pied; on y vivait parfaitement: la table y était toujours splendidement servie, et M. de la Neuville recevait la meilleure société de Rouen.
Quelque sordides que fussent ses habitudes, M. de la Popelinière n’était point un sot; il aimait à conter et contait bien; et, comme à la table du président la conversation était toujours montée sur le ton le plus spirituel, M. de la Popelinière ne manquait jamais l’occasion de s’y faire remarquer par quelque anecdote heureusement placée, en quoi il s’était fait une certaine réputation.
Inutile de vous dire que, jusqu’au lendemain, M. de la Popelinière ne fit que rêver à l’excellent repas auquel il était convié.
Ce jour-là, et d’après sa coutume en pareille occurrence, il ne déjeuna que d’une soupe légère, dans la première cuillerée de laquelle il délaya une prise de rhubarbe pour préparer convenablement son estomac à la bataille gastronomique du soir. Dans le même but, et malgré la rigueur de la saison, il fit sur le midi une jolie promenade. Vers cinq heures il s’habilla, c’est-à-dire il mit une paire de bas de soie par-dessus ses bas de laine (M. de la Popelinière portait culotte); il se chaussa de ses souliers cirés à l’œuf, endossa son habit noir qui, à force d’être noir, était devenu blanc; et, s’étant coiffé d’un tricorne pelé orné d’une ganse en lézarde, il se mit en route, la canne à la main, pour la rue du Vert-Buisson, où demeurait M. de la Neuville (M. de la Popelinière, lui, demeurait rue aux Chiens, près de l’église Saint-Sever): il était précédé dans sa marche prudente par un polisson du voisinage, porteur d’un fallot[9], que le petit drôle tenait de manière à n’éclairer que les murailles.
Ordinairement le jour des Rois se fête en famille. Si donc le président avait invité M. de la Popelinière pour ce jour-là, c’est que le conseiller était veuf et n’avait point d’enfants: on ne lui connaissait d’ailleurs ni frères, ni neveux, ni cousins.
Quand M. de la Popelinière arriva chez le président, toute la société était réunie au salon situé, comme dans presque toutes les maisons de province, au premier étage: la salle à manger était au rez-de-chaussée. La société se composait, outre M. et madame de la Neuville, de leurs enfants et petits-enfants, savoir: leurs deux filles, mesdames du Hausset et de Lannoy, mariées, la première à un officier supérieur du régiment en garnison à Rouen, l’autre à un des premiers médecins de la ville. Ces dames étaient accompagnées de leurs maris, et de leurs fils Adéodin du Hausset et Frédéric de Lannoy, jeunes garçons de huit à dix ans, bien connus de M. de la Popelinière, et pour cause. Il n’y avait pas de niches qu’ils ne lui eussent faites: ce dont ils avaient été mainte fois réprimandés par leurs parents, mais inutilement.
Le conseiller n’eut pas été plutôt annoncé, que les deux espiègles se mirent en tête de le tourmenter selon leur habitude.
Dès qu’il parut, Adéodin lui sauta aux jambes. «Ah! dit-il, M. le conseiller qui a mis ses bas à l’envers!»
M. de la Popelinière jeta un regard d’épouvante sur ses bas: ils étaient à l’endroit. Mais cette maligne observation suffit à déconcerter le conseiller; il perdit le fil d’un superbe compliment qu’il adressait en ce moment à la compagnie. On ne put s’empêcher de sourire.
Pendant ce temps, Frédéric introduisait gravement jusqu’au milieu du salon le petit rustre qui avait accompagné M. de la Popelinière. Les salutations et l’accoutrement burlesques de ce domestique de nouvelle espèce, qui d’une main tenait ses sabots et de l’autre une lanterne de papier, achevèrent d’exciter la bonne humeur de l’assemblée. M. de la Popelinière eut le bon esprit de la partager et de demander grâce pour Adéodin et Frédéric, que leurs mères voulaient renvoyer à la cuisine avec Janiquet, le porte-fallot.
Quelques minutes après, on descendit dans la salle à manger: le dîner était servi.
Notre intention n’est pas de vous décrire minutieusement l’ordonnance du repas; il fut digne de celui qui le donnait, digne de ceux à qui il était offert. Une abondance bien entendue, une recherche de bon goût y avaient présidé. La chère y fut grande et délicate. Quant au vin, il venait de la cave de M. de la Neuville: c’est tout dire.
A table les enfants furent charmants, ni trop familiers, ni sournois, ni bavards, ni gourmands: c’était merveilleux. La conversation, tour à tour grave, enjouée, dut à la présence du conseiller d’être semée de traits originaux qui rajeunissaient les sujets les plus usés: on jouissait ainsi, à tous les titres, du plaisir d’être réunis. On but à toutes les santés. Enfin on n’oublia aucune des ressources de s’amuser à table.
Vint enfin le grand moment, l’instant solennel de tirer le gâteau des Rois, recouvert d’une serviette, et préalablement partagé par M. de la Neuville en autant de morceaux qu’il en fallait. Comme le plus jeune des convives, Adéodin, la part de Dieu réservée, remit à chacun celle qui lui revenait; et chacun allait chercher la fève, lorsque M. de la Neuville, prenant la parole, pria la société de surseoir un instant à la proclamation du roi ou de la reine.
«Et de quoi s’agit-il donc, mon cher président? demanda étourdiment M. de la Popelinière.
—D’une proposition qui, je l’espère, aura votre agrément, mon cher conseiller,—répondit M. de la Neuville.—De bons amis ne peuvent se voir trop souvent. Je propose donc que le roi ou la reine que le sort va nous donner, réunisse à huitaine ses sujets et sujettes en un nouveau gala.
—Adopté! adopté! dirent tous les convives, à l’exception du conseiller qui ne put réprimer une grimace.
—Quant à moi, continua le président, si le sort me favorise, je vous provoquerai de plus belle, conseiller, et vous me ferez raison le verre en main. Voyons, à la fève! à la fève! qui l’a?
—Ce n’est pas moi! ce n’est pas moi! ce n’est pas moi! dit chacun désappointé.
—Ni moi non plus, ajouta M. de la Neuville; serait-ce vous, conseiller? demanda-t-il à M. de la Popelinière.
—Ma foi... non, répondit le conseiller avec hésitation et se hâtant d’avaler sa part de gâteau, dont, en moins d’une minute, il eut fait disparaître jusqu’à la dernière miette.
—C’est unique! reprit-on, un gâteau des Rois sans fève, cela ne s’est jamais vu!
—Eh! mais, dit madame de la Neuville, la plaisante distraction que la nôtre! et Dieu que nous oubliions! vous verrez qu’il sera roi! Pour vous l’avoir rappelé, je demande à acquitter sa dette.»
Mais, même dans la part de Dieu, il n’y avait point de fève.
«C’est étrange! je n’y comprends rien! que c’est contrariant!» et dix autres exclamations du même genre se succédèrent en un instant.
Le conseiller prit un air aimable, mais évidemment composé.
—«Je gagerais, dit-il, que, dans cette affaire, le pâtissier est seul coupable, et qu’il a négligé de mettre une fève dans son gâteau. Ces gens-là n’ont ordinairement de mémoire que celui qu’ils nous présentent à solder. Ce sont de maîtres fripons[10], à qui chacune de nos dents rapporte plus d’un louis d’or par année. Passez-moi donc quelques macarons, président; trempés dans l’Alicante, je les préfère aux rôties.»
Et M. de la Popelinière se mit en devoir de prouver que, par cette préférence, il n’exprimait point une exclusion, car il mangea les uns et les autres: macarons et rôties, leur adjoignant même, si je suis bien informé, quelques biscuits, massepins et croquets.
Mais, en dépit de ces agréables manœuvres, l’attention n’était point tellement égarée, qu’on eût cessé de s’occuper de la fève absente; et, après tout, comme à cet égard les insinuations du conseiller n’étaient point sans quelque vraisemblance, on s’y arrêta définitivement, et il fut résolu qu’on ferait venir M. Godiveau, le pâtissier.
«M. Godiveau, dites-vous, est celui qui a fait le gâteau? demanda M. de la Popelinière.
—Oui, lui dit-on; vous le connaissez?
—Il a, je crois, tenu boutique dans notre faubourg: A la Boulette sans pareille. Un gros père? la mine rougeaude? un singulier corps!
—Un brave homme! Eh bien! à présent, il demeure près d’ici, rue Beauvoisine. Mais vous allez le voir, et nous allons l’entendre: Marguerite est allée le chercher.»
En ce moment, la porte de la salle à manger s’ouvrit, et un pâtissier s’avança respectueusement, son bonnet à la main.
«Le voici, s’écria-t-on.»
Mais ce n’était point M. Godiveau...
C’était Claude, dit l’Araignée, dit la Caille, ex-valet du sieur de la Popelinière, aujourd’hui premier apprenti du papa Godiveau, qui ne pouvant abandonner ses fourneaux près desquels le retenait un coup de feu (un travail pressant), avait dépêché Claude à titre de plénipotentiaire.
Cela fut dit par Claude avec un gentil salut que sa bonne mine rendit plus gracieux encore. Claude avait parfaitement vu M. de la Popelinière; mais sa modestie naturelle l’empêchait de témoigner en rien qu’il eut reconnu son ancien maître. Quant à celui-ci, il cligna les yeux et dit en guignant le petit pâtissier: «Mais il me semble que j’ai vu ce garçon-là quelque part?
—Chez vous, M. de la Popelinière, répondit Claude avec une humble assurance. J’avais l’honneur d’être encore à votre service.
—Il est vrai, petit, interrompit le conseiller, en effet... je me rappelle... Mais, comme te voilà grandi! Et sais-tu bien, mon fils, pourquoi on t’a fait venir? Ton maître nous a envoyé un gâteau sans fève.
—Sans fève, répliqua l’enfant; pardon, monsieur, si j’ose vous contredire; mais comme c’est moi qui ai mis les fèves dans tous nos gâteaux, je puis vous assurer...
—Allons, pourquoi te défendre si vivement d’une étourderie? interrompit de nouveau le bénin M. de la Popelinière; après tout, le tort n’est pas si grave, et ce qu’on t’en dit...
—Comment, pas si grave? dit M. de la Neuville; mais au contraire, et il est d’autant plus grave, que, si réellement ce garçon n’a point exécuté les ordres de son maître, il lui a causé un très-grand dommage. En effet, si, comme nous en étions convenus, un de nous, en sa qualité de roi de la fève, fût devenu notre nouvel amphitryon, un nouveau repas eût nécessité une nouvelle commande dont eût naturellement profité ce bon M. Godiveau. Eh bien! voilà ce digne pâtissier privé d’un gain peut-être considérable, par la faute de son apprenti. C’est ainsi qu’une négligence, légère en apparence, peut provoquer les plus déplorables résultats, peut amener les plus désastreuses conséquences.»
Cette remontrance, débitée sur le ton de la plus verte mercuriale, laissait chacun assez embarrassé de la figure qu’il devait faire, lorsque Claude, qui lui-même avait paru d’abord partager l’indécision générale, s’avança hardiment de quelques pas, et, se jetant aux pieds de M. de la Neuville:
«Je vous le jure, monsieur, s’écria-t-il! j’ai mis la fève, je l’ai mise..., je veux dire le diamant...
—Que veut-il dire? interrompit M. de la Popelinière, en se levant avec émotion.
—La vérité, continua l’enfant, sans quitter sa posture suppliante. Hier, M. Godiveau, en me donnant les fèves que je devais placer dans les gâteaux, m’en remit une trois fois plus grosse que les autres: «C’est la fève du gâteau de M. de la Neuville, me dit-il, remarque-la bien, Claude, elle est rouge, les autres sont blanches, et surtout ne va pas te tromper, mon garçon, tu nous ruinerais. Cette fève contient un diamant de la valeur d’un million que M. de la Neuville destine à celui qui sera roi de la fève.» Jugez si j’ai dû la perdre, cette fève!...
—Mais c’est moi qui l’ai! s’écria la Popelinière, ou plutôt qui l’avais..., mais non, je dis bien, qui l’ai...! Je l’ai avalée... par mégarde... une distraction... Et dire que j’ai là un si grand trésor, ajouta-t-il en se frottant l’estomac!
—Excusez-moi, monsieur, vous n’y avez qu’une fève, dit Claude, en se relevant; mais une fève de la plus belle espèce. Le diamant est de mon invention; et je vous prie de me pardonner une petite ruse...»
Le conseiller devint blême comme sa serviette.
«Ah! dit-il, en fronçant le sourcil, on m’a...» Il allait dire joué, mais il se ravisa et reprit avec le sourire le plus gracieux: «On m’a bien agréablement surpris, et j’allais vous avouer moi-même ma maladresse... et ma royauté, lorsque ce friponneau... Approchez, maître rusé, dit-il à Claude, vous méritez une récompense, et je veux vous donner quelque chose.»
L’enfant allait avancer la main; mais, par réflexion, il n’en fit rien. Il fit bien.
M. de la Popelinière ajouta: «Je veux vous donner un avis, un bon avis. Vous qui m’avez fait présent d’une fève, il est juste que je vous donne un pois: vous avez trop d’esprit pour être pâtissier, faites-vous procureur.
—Nenni dà! monsieur, répondit Claude, j’y perdrais plus que je n’y gagnerais. J’ai bon feu, bonne table et bon lit chez M. Godiveau, et je sais un bout de chanson qui dit:
Le petit clerc
Déjeune d’eau claire,
Dîne d’un œuf clair,
Et se chauffe au clair
De la lune.
—Bravo! bravo! fit l’assemblée.
—Bravo! mon ami Pierrot, s’écrièrent Adéodin et Frédéric.»
Ce mot décida la victoire en faveur de Claude.
Mais, en vainqueur généreux, Claude n’abusa pas de ses avantages. Il prit poliment congé de la compagnie à laquelle il venait de donner un roi, et dont en retour il reçut force dragées. Il en fit ce que le conseiller avait fait de la fève.
[9] Lanterne faite d’un cornet de papier, au fond duquel brûle un bout de chandelle.
[10] Fripons, mot à double sens dans la phrase du conseiller, par analogie avec friponnerie, synonyme de friandise (vieux style).
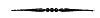
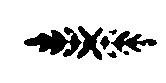
M. Mullens se promenait dans une forêt qui lui était inconnue, avec ses trois enfants, Ferdinand, Alfred et Amélie; c’était un beau jour d’été; il n’y avait pas un seul nuage au ciel.
Nouvellement arrivé de la ville dans un village renommé par ses bains, il se réjouissait de célébrer l’anniversaire d’un jour dont la mémoire lui était chère.
Il aimait beaucoup ses enfants; en père éclairé, il profitait de toutes les occasions pour former leur cœur au bien. Chaque fois qu’ils admiraient les beautés de la nature, soit à l’ombre d’un chêne, soit au bord d’un ruisseau, soit au sommet d’une colline, il élevait leurs pensées vers Dieu. Les voyait-il pénétrés des sentiments qu’il éprouvait, oh! alors il était heureux; il serrait ses enfants contre son cœur.
Les Fraises.
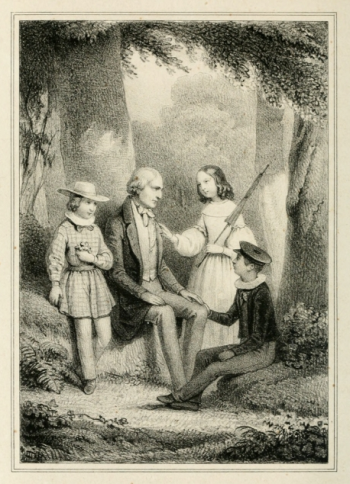
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Alors il leur dit: «Asseyez-vous ici, à côté de moi.» et il commença son récit.» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
A l’occasion do ce jour anniversaire, il s’était proposé de leur raconter l’histoire de sa jeunesse. Il y fut d’autant mieux amené, qu’Alfred, son fils cadet, avait cueilli un bouquet de fraises et l’avait offert à son père: or, les fraises lui rappelaient les plus doux souvenirs. En acceptant ce bouquet, le cœur profondément ému, il lui dit: «Cette petite offrande me fait bien plus de plaisir que tu ne le penses. Les fraises ont eu une grande influence sur ma vie: ce qu’aucun de vous ne savait encore. Eh bien! à l’instant même, je vais vous raconter mon histoire, afin que vous imploriez la Providence avec plus de ferveur que par le passé, et que vous priiez pour un homme bien respectable, auquel, après Dieu, je dois tout mon bonheur.»
Aussitôt il conduisit ses enfants au haut d’une colline où l’ombre de trois hêtres invitait au repos. Alors il leur dit: «Asseyez-vous ici, à côté de moi.» Et il commença son récit:
«Il y a trente ans, le jour de la Visitation de la Vierge, les habitants d’une ville située sur les bords du Rhin étaient en joie, parce que les troupes ennemies s’étaient retirées après un long siège; les flots de la foule envahissaient les promenades publiques et les avenues de la ville; le bourgmestre donnait, au nom de la commune, une fête aux autorités militaires, et, pour que la joie fût générale, on faisait des largesses aux indigents de la ville. Le ciel semblait vouloir contribuer lui-même à fêter ce beau jour: le soleil resplendissait, et une agréable fraîcheur répandue dans l’air en tempérait la chaleur.
»Pendant que toute la ville était en réjouissance et qu’un bien petit nombre d’habitants songeaient peut-être à rendre grâce à Dieu, de qui viennent tous les biens, il y avait un pauvre petit garçon, de dix ans, assis au coin d’une rue, sur la borne d’une grande maison; il regardait les passants d’un œil triste. Une chevelure blonde, des yeux bleus, un front élevé, lui donnaient un air mélancolique; la pâleur, que les tourments de la faim et les peines de l’âme avaient empreinte sur ses joues, le rendait digne de compassion. Mais on passait outre sans le remarquer; chacun était trop occupé du bonheur public; et d’ailleurs, comme il était étranger, personne ne le connaissait. Son habillement ressemblait a celui d’un mendiant; il avait une culotte de toile, une vieille veste de hussard, un chapeau usé et de lourds sabots. Cependant il ne songeait pas à mendier; il ne désirait que vendre les fraises qu’il portait dans une corbeille d’osier; mais il avait beau crier: «Voici des fraises, achetez-les, elles sont très-bonnes;» personne ne s’arrêtait. Néanmoins il ne se laissait pas décourager, et il offrait toujours ses fraises.
»Mais quand le soleil eut disparu, sans que personne lui eût acheté ses fraises, il tomba dans l’abattement et se prit à pleurer. «O mon pauvre père! disait-il en gémissant, mon pauvre père qui est malade, que d’inquiétude il aura si j’attends en vain. Hélas! qu’il me serait douloureux de ne pouvoir rien lui rapporter pour son souper!» Puis il mit le genou en terre et pria avec confiance: «O Dieu! toi dont la providence veille jusque sur l’oiseau qui se confie à l’air, jusque sur la fleur qui croît solitaire dans la prairie, sois propice à un enfant qui pleure et prie pour son père. Jusqu’à ce jour, tu m’as accordé la faveur de pouvoir nourrir mon père avec le produit des fraises que je cueillais dans la forêt; envoie-moi aujourd’hui quelque mortel, quelque ange à l’âme compatissante qui mette fin à ma douleur et aux anxiétés de mon pauvre père. Oh! oui, je suis prêt à souffrir la faim, pourvu que je puisse rapporter à la maison de quoi nourrir mon père; je suis prêt à passer toute cette nuit sans dormir, pourvu que mon père, après avoir mangé, puisse avoir un bon sommeil. Viens à mon aide, bon Dieu! procure-moi la vente de mes fraises; secours mon père, et tu m’auras secouru.»
»Reprenant courage, à peine essuyait-il ses yeux mouillés de larmes, qu’il vit un homme élégamment vêtu qui, avec attendrissement, lui glissa deux pièces d’argent dans la main en lui adressant ces paroles: «Donne-moi tes fraises avec le panier; prends cet argent, et va consoler ton père. N’oublie jamais de prier avec cette pieuse confiance, et tu seras toujours exaucé.»
»Aussitôt cet inconnu, ce bon monsieur, tenant à son bras la corbeille de fraises, entra dans la grande maison devant laquelle le pauvre enfant avait si longtemps exposé ses fruits en vente. Transporté de joie, l’enfant rendit grâce à Dieu dans son cœur, et implora sa bénédiction pour le bon monsieur. Il acheta de quoi nourrir son père, et précipita ses pas vers la forêt où était sa chaumière.»
M. Mullens interrompit un instant son récit, car il s’était aperçu que les yeux de ses enfants étaient dirigés sur lui, comme s’ils avaient deviné qu’il était ce pauvre garçon. La sensible Amélie pencha sa tête sur le sein de son père pour lui confier son émotion. Ferdinand lui baisa les mains et les serra fortement. Le petit Alfred avait déjà sur les lèvres le mot de l’énigme; mais le père lui fit signe de ne rien dire, et reprit son récit:
«Reportons-nous, en esprit, au milieu de cette forêt où le pauvre garçon dirigeait ses pas; là était une petite chaumière, menaçant ruine, adossée contre deux grands chênes; l’intérieur révélait la plus grande misère; dans un coin, on voyait un sabre rouillé et une jambe de bois; dans un autre, était un vieux invalide couché sur un porte-manteau et du feuillage; sa jambe droite et son bras gauche étaient restés sur le champ de bataille, et sa poitrine était couverte de cicatrices. Dans une cruche, il y avait de l’eau, puisée le matin à la source voisine, pour le désaltérer: c’était le seul remède qu’il possédât contre la fièvre.
»Où mon cher enfant reste-t-il si longtemps? disait en gémissant le pauvre vieillard. Puis, élevant vers le ciel le seul bras qui lui restât, il disait: «O Dieu! préserve-moi d’un nouveau malheur! Qu’il me serait triste d’apprendre, avant de quitter la vie, que mon enfant a été victime d’un accident! Prends cet enfant sous ta protection; aie pitié de moi, pauvre invalide, qui suis sur le bord de la tombe. Oh! non, mon Dieu! en qui moi et mon cher enfant mettons toute notre confiance, non, tu ne permettras pas un nouveau malheur!»
Après avoir donné un instant libre cours à ses larmes, M. Mullens essuya ses yeux, et reprit son récit:
«Durant la paix, l’invalide avait obtenu du roi, pour lequel il avait perdu son bras, sa jambe et reçu tant de blessures, une petite pension qui le tirait de la misère. Mais, en temps de guerre, tout avait été bouleversé; le paiement de la pension fut donc interrompu, et il resta en proie à l’indigence; en outre il s’était vu forcé de se soustraire au ressentiment des soldats ennemis, peu disposés à ménager un vieux guerrier qui avait si longtemps combattu contre eux. Voilà pourquoi l’invalide s’était réfugié dans cette chaumière menaçant ruine, où sa seule ressource pour vivre était le produit des fraises que cueillait le petit garçon.
»Après que M. Mullens eut bien prié, il tourna sa tête vers la muraille, consolé et tranquille, et peu après il s’assoupit. En rentrant, le petit garçon, dans la joie de son cœur, plaça à terre le bouillon et le pain qu’il avait achetés pour son père, s’assit aussi légèrement que possible sur sa couche, attentif aux mouvements de son père, pour lui offrir le fruit de sa journée. Qui pourrait décrire sa joie, lorsqu’après un quart d’heure l’invalide se souleva languissamment. «O mon père! s’écria-t-il, le bon Dieu m’a envoyé aujourd’hui un acheteur bien charitable, qui m’a payé vingt fois la valeur de mes fraises. Ainsi je pourrai te procurer quelques soulagements. O quel bonheur!»
«Eh bien! dit le père en élevant ses regards vers le ciel, rendons grâce à Dieu, et prions-le de bénir le bon monsieur auquel nous devons ce bienfait.»
»Alors l’enfant s’agenouilla pieusement à côté de son père et pria avec lui à haute voix.
»Tout à coup la porte s’ouvre, et un beau monsieur entre: c’était celui qui avait acheté les fraises.
«Ne vous étonnez pas, dit-il d’une voix affectueuse. Enfant, j’ai suivi tes pas pour connaître le père qui t’a enseigné à prier avec tant de confiance. Mais quelle misère! Dieu soit loué de m’avoir inspiré de venir jusqu’ici. Pauvre invalide! je veux vous secourir. Il faut que vous passiez le reste de vos jours près de moi. J’aurai soin de votre fils. Demain matin, ma voiture viendra vous chercher. Je vous ferai préparer, dans ma maison, un logement plus agréable que cette chaumière en ruine.»
»Le vieillard et l’enfant étaient hors d’eux-mêmes en entendant parler ce bon monsieur. Le vieillard lui tendit la main, et le fils, heureux du bonheur promis à son père, baisa respectueusement le bord de l’habit de l’étranger. Le monsieur dit: «Adieu, a demain; il est tard, bonne nuit.» Et il s’en retourna.»
Ici, M. Mullens fil encore une pause, mais un peu longue. Il était aisé de voir que la suite du récit affectait son cœur; un nuage de tristesse se dessinait sur son front; des larmes roulaient dans ses yeux.
Pendant cet intervalle, les enfants se disaient à demi voix: «Notre père, c’est le fils du hussard.»
«Oui, mes enfants, reprit alors M. Mullens d’une voix émue; oui, le vieil invalide était mon père. Mais ce n’est encore là que le commencement de l’action providentielle de Dieu sur moi. Écoutez mon histoire jusqu’à la fin, et alors vous vous agenouillerez, et nous rendrons ensemble grâce à celui qui veille sur nous, tous les jours de notre vie.
»Le lendemain, à la pointe du jour, j’étais à la ville, devant la porte de la maison, là où, la veille, j’avais exposé mes fraises en vente; mes yeux étaient rouges à force d’avoir pleuré; la douleur à laquelle mon âme était en proie m’avait abattu; enfin je tombai en défaillance.
»Quand je repris mes sens, je vis debout devant moi le bon monsieur; il me prit amicalement par la main et me demanda avec compassion: «Enfant, que t’est-il donc arrivé?»—«Eh! monsieur, le plus grand malheur, répondis je en pleurant; mon père bien-aimé est mort! Lorsque, ce matin, j’ai jeté les yeux sur lui, je l’ai vu, hélas! inanimé sur sa couche.» Alors le bon monsieur, tâchant de me consoler, me dit: «Ton père est heureux, bien heureux; il repose en paix, loin des agitations de la guerre, des tourments de la maladie, des misères de l’indigence: il est au ciel, que Dieu réserve aux hommes de bien. Quant à toi, je te garde auprès de moi; et comme ta conduite à l’égard de ton père me plaît, je veux que tu me nommes désormais ton père: le ciel ne m’a pas donné d’enfant, tu me serviras de fils.»
»Ah! mes chers enfants, comment pourrais-je vous exprimer ce que je sentis alors? Ces paroles versèrent dans mon âme un baume de consolation. Je ne savais que dire et comment peindre ma reconnaissance. Je tombai à ses pieds et je balbutiai. Ce trouble de mon âme dut vivement attendrir mon bienfaiteur, car il versa lui-même des larmes.
»Cependant je retournai à la chaumière et me jetai sur le corps inanimé de mon pauvre père, et je laissai à mes pleurs un libre cours. Là, je fis vœu de ne jamais oublier ses conseils; là, je priai; et, fortifié par la prière, je me confiai à Dieu.
»Je n’ai pas besoin de vous dire que je reçus de mon généreux bienfaiteur une bonne éducation. Il ne me lit pas seulement enseigner les diverses branches de la science; mais il eut bien soin aussi de me former à la vie chrétienne.
»Chaque fois que je me souvenais de ma vie passée, je bénissais le jour où j’étais entré dans la maison de ce bon monsieur. Il me disait souvent, le sourire sur les lèvres: «Vois-tu, mon cher Adolphe, c’est l’amour filial avec lequel tu nourrissais ton père, par le produit de tes fraises, qui t’a valu le bonheur dont tu jouis. N’oublie donc jamais, en voyant des fraises, que la divine Providence profite souvent d’un petit service rendu avec amour pour combler ses enfants des plus douces récompenses. Ne cesse d’accomplir tes devoirs, comme lorsque tu étais au coin de la rue pour vendre tes fraises; tu t’en trouveras toujours bien, et tu auras des enfants qui feront, à leur tour, ton bonheur.»
»Devenu plus tard capable de gérer les biens de mon bienfaiteur, je les administrai si sagement, que je ne tardai pas à jouir de toute sa confiance: mais un triste événement devait, hélas! nous séparer pour toujours!
»Le comte d’Halberg (c’était le nom de ce bon monsieur), homme délicat et vrai chrétien, ne pouvait garder longtemps le silence sur les malversations de plusieurs courtisans hypocrites qui trompaient le prince. Après leur avoir donné plusieurs avertissements, sans aucun résultat, il découvrit enfin au prince ce qu’il savait d’eux; en même temps, il lui demanda la permission de se démettre de ses fonctions, résolu qu’il était de ne plus paraître à la cour. Mais ces courtisans, devenus furieux, jurèrent la mort du comte. Trois hommes furent même apostés pour attenter à sa vie. Je les entendis, un jour, se concerter entre eux; c’était précisément l’anniversaire du jour où mon généreux protecteur m’avait acheté le panier de fraises; j’étais allé à la forêt pour cueillir de ces fruits en commémoration du bienfait que j’avais reçu: tremblant de frayeur, je précipitai aussitôt mes pas vers la ville et me hâtai de rapporter, au comte, les paroles que j’avais pu saisir, couché que j’étais derrière les broussailles. En écoutant mon récit, M. d’Halberg pâlit, effrayé; puis bientôt souriant d’un air affable, il accepta mes fraises, et dit: «Tu as par ces fruits, ou plutôt par la piété filiale avec laquelle tu voulais me procurer un plaisir, préservé ton second père du danger de la mort, comme tu avais sauvé le premier des tourments de la faim. Eh bien! prends ce papier revêtu de mon sceau, ouvre-le quand j’aurai disparu loin, bien loin d’ici; là se trouve écrit que je le reconnais pour mon légataire universel.» Frappé de stupéfaction, je ne pus proférer un seul mot, et je me jetai à son cou en versant des larmes.
»Avec mille ducats et, ce qui est bien plus précieux, avec une bonne conscience, le comte partit vers minuit; je l’accompagnai jusqu’en dehors de la ville; alors, me donnant sa bénédiction, il me dit tendrement adieu pour chercher la vie et la paix dans une fuite précipitée: quand je me séparai de lui, nous pleurâmes tous deux. Dès ce jour, je pris la résolution de n’envisager tout cet héritage que comme sa propriété, et de l’administrer avec zèle comme par le passé jusqu’à l’heureuse époque de son retour.
»Mais le comte d’Halberg, à qui nous devons tout, ne revint pas. Malgré mes informations et toutes mes recherches, je n’ai pu savoir le lieu de sa retraite. Et voilà, mes enfants, la cause secrète des larmes que vous m’avez vu verser si souvent. Vous l’ignoriez jusqu’ici; maintenant vous la connaissez. Par lui, j’ai reçu une bonne éducation que je puis vous transmettre; j’ai été élevé à une haute position, et j’ai échappé à la corruption du siècle. Que pouvons-nous pour le vertueux comte qui, en faisant mon bonheur, a fait le vôtre? Nous ne pouvons rien, hélas! que prier pour lui...»
A ces mots, M. Mullens et ses trois enfants s’agenouillèrent, et prièrent pour leur bienfaiteur. Après avoir fini, Ferdinand, saisissant la main de son père, lui dit: «Oh! papa, si le comte vivait encore, si nous apprenions quelque nouvelle de lui, quelle joie nous aurions à le remercier!» Et Amélie ajouta: «Il faudrait qu’il vint chez nous, qu’il demeurât avec nous, et tout ce que nous possédons serait de nouveau sa propriété.—Quand bien même il vivrait, reprit tristement le père, nous ne pourrions plus savoir où il est: lorsqu’on est vieux, on est inconnu.
—Venez, venez, s’écria le petit Alfred, venez par ici; il faut cueillir des fraises en l’honneur de notre bienfaiteur, et nous les mangerons en bas, dans la vallée, au bord du ruisseau.»
Le père et les autres enfants lui firent signe qu’ils allaient le suivre. Aussitôt Alfred se mit, en chantant, à sauter comme un chevreuil à travers les broussailles. Mais, quelques instants après, il revint effrayé sur ses pas, et raconta, tout hors d’haleine, ce qui lui était arrivé.
«Je cueillais, dit-il, des fraises, là, dans l’épaisseur du bois, et bientôt, sans m’en apercevoir, je me trouvai près d’une chaumière; devant la porte était assis un homme avec une longue barbe grise, mouillant de ses larmes un bouquet de fraises qu’il tenait à la main; il me demanda comment je m’appelais; et comme je disais: Alfred Mullens est mon nom, il se leva tout à coup et marcha vers moi; je fus si effrayé, que je me mis à crier et que je m’enfuis: mais il me semble qu’il m’a suivi, car j’ai entendu derrière moi du bruit dans les broussailles. Oui, oui, reprit-il d’une voix encore plus mal assurée, regardez, le voilà qui arrive.» Aussitôt Alfred se cacha derrière son frère.
M. Mullens, en voyant le vieillard s’approcher, alla respectueusement au-devant de lui, et lui dit: «Pardonnez, monsieur, à mon fils; il a eu peur de vous, comme un enfant a peur d’un inconnu.» Puis, le regardant plus fixement: «Ah! mon Dieu! s’écria-t-il; serait-il possible! mais, oui; c’est bien vous!
—O Mullens! ô mon fils! répondit le vieillard; non, je ne me trompais pas, c’est toi-même.
—Bon Dieu, s’écria M. Mullens en se jetant dans les bras du vieillard; je vous revois enfin, ô mon bienfaiteur! ô mon père!»
Lorsque Ferdinand et Amélie entendirent ces paroles, ils s’approchèrent, et embrassèrent les genoux du vieillard. Alors, le père leur dit:
«C’est bien, mes chers enfants; retenez-le, baisez ses mains; c’est notre bienfaiteur à tous.» Alors Alfred, tout à fait rassuré par ces paroles, s’approcha aussi. Le vieillard le prit dans ses bras, baisa son front, et bénit les trois enfants, en disant: «Dieu soit avec vous, mes chers anges. Puissiez-vous hériter des vertus de votre père, et lui donner autant de satisfaction qu’il m’en a donné à moi-même!»
Puis, le vieux comte se mit à raconter comment, dans sa fuite, il avait trouvé un lieu de repos dans cette petite cabane. «Le silence et la solitude de ce lieu, où j’ai appris à me suffire à moi-même, en ont fait un paradis que je ne veux plus quitter que pour aller au ciel.
—Comment! s’écria M. Mullens à ces mots; comment, mon père, vous ne voulez pas venir avec nous? vous ne voulez pas couler vos vieux jours dans le sein de notre famille? Nous vous entourerons de tant de soins, de notre amour.
—Oh! venez, venez, reprit Ferdinand en suppliant avec instances, ne nous quittez pas.
—Nous vous en supplions à genoux, s’écrièrent à leur tour Alfred et Amélie.
—Laissez-moi, mes enfants, répondit le comte, ne m’arrachez pas à ma paisible retraite. Je t’ai vu, cher Mullens; j’ai vu tes enfants; je suis heureux. Le peu de temps que j’ai encore à vivre, je veux le consacrer à la prière et à la méditation; mais, chaque année, vous pourrez venir dans ma cabane, nous y célébrerons les doux souvenirs du temps passé, et nous rendrons grâce à Dieu: alors aussi, cher Mullens, je bénirai tes enfants pour qu’ils croissent en vertus.»
L’année suivante, on célébra en famille, devant la cabane du comte d’Halberg, la fête des fraises. Le comte raconta aux enfants les principales anecdotes de sa vie. Le père raconta au comte les vertus de son épouse, morte, hélas! depuis bien longtemps. Ils ne se séparèrent qu’après avoir reçu la bénédiction du vénérable vieillard.
Lorsque M. Mullens arriva pour célébrer, une seconde fois, la fête des fraises, il trouva la cabane déserte, et apprit, en prenant des informations, que le comte était mort. Alors il conduisit ses enfants au cimetière; tous ils entourèrent la tombe du bienfaiteur, de fraisiers que, depuis ce jour, ils y cultivent pieusement. Bien souvent ils viennent pleurer et prier sur cette tombe, qui a des droits si touchants à leur souvenir.

CHRONIQUES DE BRETAGNE.
————
Vers l’année 1009, le duché de Bretagne était gouverné par Geoffroy, homme dur et impitoyable, dont le nom seul faisait trembler: ses cruautés et ses violences se renouvelaient chaque jour, et portaient la désolation dans toutes les familles.
La duchesse Haloïse, sa femme, bonne, douce, charitable, répandait au contraire ses bienfaits sur les malheureux, et cherchait, par tous les moyens, à réparer les crimes de son époux. Aussi le peuple, qui l’aimait et la respectait comme une sainte, avait-il souvent recours à elle pour la supplier d’apaiser les fureurs du prince.
Geoffroy sentit à la fin le remords pénétrer en son âme: le souvenir de ses cruautés ne lui laissait plus de repos. Il résolut, d’après les conseils d’Haloïse, de faire un pèlerinage à Jérusalem, au tombeau de Notre-Seigneur Jésus-Christ, afin d’y puiser les bénédictions promises à ceux qui visitent les lieux saints. Il partit accompagné de Gauthier, son mauvais génie, dont les conseils perfides le poussaient au mal.
La Bretagne, opprimée, goûta enfin le bonheur sous le gouvernement doux et pacifique de la duchesse Haloïse: sa sagesse lui avait concilié l’estime de ses sujets, et la justice, jointe à sa bienfaisance, lui méritait l’amour et presque l’adoration du peuple.
Le voyage de Geoffroy devait durer quelques années. On espérait que les grâces du Saint-Sépulcre auraient versé dans son cœur une partie des vertus que la duchesse faisait aimer; et l’avenir se présentait, aux yeux des Bretons, sous le plus favorable aspect.
Mais ce calme dura peu; ces espérances furent bientôt déçues. La nouvelle du retour de Geoffroy se répandit, et vint jeter le peuple dans la consternation. En effet, le duc n’était allé que jusqu’à Rome, et les conseils de Gauthier l’avaient décidé à revenir dans sa patrie.
Bientôt le peuple s’aperçut que son caractère n’avait pas changé. Des charges onéreuses vinrent le frapper; et les courtisans du prince imaginèrent, pour lui faire leur cour, d’établir un nouvel impôt qui, sous le nom de don de joyeux retour, pût lui témoigner le bonheur que chacun éprouvait à le revoir.
Le peuple, pauvre et misérable, épuisé par de longues guerres, ne pouvait supporter ces charges nouvelles. Alors les gens du duc parcoururent les campagnes, semant partout la désolation. Les plaintes ne furent pas écoutées, et les prisons se remplirent de gens qui ne pouvaient payer le nouvel impôt.
Lorsque la somme qu’on avait ramassée ainsi, à force de violence, fut assez considérable, les courtisans du prince pensèrent à la lui offrir: ils choisirent le jour où il rentrait dans son duché.
Ce jour-là, dès le matin, le petit village de Pelvey, ordinairement si calme et si tranquille, retentit d’un bruit inaccoutumé. Des hommes d’armes tout couverts de fer, des pages, des varlets conduisant des chevaux et des litières, vinrent s’établir sur la grande place. Les cloches de l’église sonnèrent à toute volée, comme aux jours de fête; et cependant les habitants regardaient ce spectacle d’un œil triste et morne; ils semblaient même craindre de se montrer.
Bientôt des charriots arrivèrent; ils contenaient beaucoup d’or et d’argent, des vases précieux, de riches vêtements, des armes magnifiquement ornées. C’était là ce qu’avait produit l’impôt du joyeux retour. Que de larmes avaient coulé! que de malheureux avaient été réduits à la misère pour que tant de richesses fussent amoncelées!
Vers le milieu du jour, des cavaliers accoururent à toute bride, annonçant l’arrivée de monseigneur le duc de Bretagne.
Le duc parut bientôt accompagné de toute sa cour, qui formait un cortège nombreux et brillant. Ses hommes d’armes se rangèrent en double haie sur la grande place. Il s’avança au milieu d’eux, monté sur un cheval noir tout bardé de fer; un long manteau de brocard d’or, semé d’hermine, descendait depuis ses épaules jusqu’à terre; sa tête était couverte d’un casque d’acier qui étincelait au soleil; une de ses mains s’appuyait sur la poignée de sa large épée; sur le poignet de l’autre, il portait un épervier, marque distinctive de son rang et de sa puissance.
Le sénéchal lui offrit les richesses du don de joyeux retour, et l’engagea à venir prendre quelques rafraîchissements sous une tente de belle toile blanche, décorée de rameaux verts.
Geoffroy y entra; mais, quelques instants après, il en sortit et vint s’asseoir, afin d’admirer les tours surprenants d’un jongleur qu’on avait fait venir pour le divertir.
C’était un petit homme si court, si gros, qu’il paraissait avoir été mis au monde plutôt pour rouler que pour marcher; il était affublé d’une grande robe dont la queue traînait à terre, et sur laquelle on voyait des animaux étranges, des étoiles, des signes diaboliques; sa petite tête, couverte d’un long bonnet pointu, ressemblait, à s’y méprendre, à un pruneau placé à l’ouverture d’un cornet de papier; enfin, jamais on ne vit personnage plus grotesque. Ses tours de jonglerie, les exercices qu’il commandait à un malheureux lapin blanc juché sur la bosse d’un chameau colossal, tout cela divertissait fort la foule.
Tout à coup un sourd murmure se fit entendre parmi les paysans rassemblés au pied de la croix élevée à l’extrémité de la place; les gens qui étaient chargés de percevoir l’impôt, les collecteurs, avaient établi en cet endroit le siège de leurs opérations; les habitants devaient leur apporter leur part du tribut, et déjà même ils faisaient vendre les meubles et les vêtements des malheureux qui ne pouvaient satisfaire leur avide cupidité.
A ce moment, on vit s’avancer une pauvre femme toute vêtue de noir, et dont la figure, belle encore, mais pâlie par la souffrance, exprimait une douleur profonde.
«Voilà la mère Raymond!... Place à la mère Raymond!» dirent les paysans, et ils se rangèrent pour la laisser passer.
La mère Raymond, comme l’appelaient les paysans, était une sainte et digne femme que le malheur avait éprouvée d’une manière terrible. En l’espace de quelques années, elle perdit successivement ses quatre enfants et son mari; elle resta seule au monde avec une petite-fille chétive et souffrante, seul bien qui la rattachât désormais à la vie.
Sa misère était profonde; à peine pouvait-elle, par son travail, parvenir à vivre. Menacée par les gens du duc, elle avait rassemblé tout ce qu’elle possédait et venait l’apporter pour payer sa part de l’impôt. Mais, hélas! c’était bien peu de chose, si peu, qu’il lui manquait encore deux deniers (environ douze sous de notre monnaie) pour s’acquitter entièrement.
La mère Raymond supplia les collecteurs de se contenter de ce qu’elle leur donnait. Ses pleurs, ses prières et sa douleur amère ne purent rien sur ces cœurs barbares: ils ordonnèrent à leurs varlets d’aller chez la veuve, de s’emparer de tout ce qu’ils trouveraient, et même de son lit.
«Mon lit! s’écria la pauvre femme... mais vous voulez donc que je meure... c’est mon seul bien... ma seule richesse... et je vous l’apporterais cependant moi-même si ma fille pouvait reposer ailleurs... Oh! pitié, messeigneurs, pitié pour elle.»
Les collecteurs la repoussèrent si violemment qu’elle tomba sur la terre. A la vue de cette cruauté, la foule indignée fit entendre un grand murmure qui attira l’attention du duc de Bretagne.
Geoffroy s’informa de la cause de ce bruit. Ses gardes s’écartèrent pour laisser approcher la veuve que les collecteurs traînèrent à ses pieds.
«Nous ne pouvons écouter tous ces gens, dit l’un d’eux; ils ont toujours mille raisons pour ne pas payer: quand ils ont bien vendu le lait et le beurre de leurs vaches, les œufs de leurs poules, ils cachent leur argent, contrefont les mendiants, et reçoivent ainsi de bonnes aumônes.
—Les œufs de leurs poules! s’écria la veuve, comme frappée d’une pensée subite... Oui, j’ai encore une poule... elle ne fait pas d’œufs; mais elle vaut encore bien deux deniers... Oh! ma fille... ma fille... tu ne mourras pas de froid... Merci, mon Dieu! c’est vous qui m’inspirez.»
Et la veuve éplorée s’élance vers sa chaumière. Bientôt elle revient avec la poule qui fait sa dernière espérance. Au moment où elle arrive sur la place, l’épervier de Geoffroy aperçoit la pauvre bête; il prend son vole, plonge sur elle, l’arrache des mains de la mère Raymond, l’enlève dans les airs et la déchire.
Tous les courtisans, les collecteurs, les gardes, le duc lui-même, se laissent emporter à un accès de gaîté folle.
Quelques instants après, Geoffroy remonte à cheval et part, abandonnant la malheureuse femme aux outrages des collecteurs.
«Ma poule noire!... ma poule noire! s’écrie-t-elle en proie au plus violent désespoir. Ma poule noire morte, mangée par ton oiseau!... Oh! puisses-tu la suivre en enfer!»
Aussitôt elle dirige sa course vers un buisson, près duquel devait passer le cortège: elle s’y cache et saisit une pierre.
Geoffroy paraît le premier; il porte sur son poing l’épervier, dont le bec est encore tout couvert des plumes de la poule noire. A cette vue, la mère Raymond ne peut maîtriser sa douleur; elle se lève, lance avec force la pierre quelle tenait à la main; et Geoffroy, duc de Bretagne, frappé au front, mortellement blessé, tombe et roule dans la poussière.
Et voilà quelle fut la mort d’une poule noire et d’un duc de Bretagne.
Le lendemain, on trouva la mère Raymond étendue sur la terre à côté de sa fille: toutes deux étaient mortes de froid.

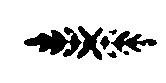
Tout Paris se souvient d’avoir vu, l’an dernier, sur le boulevard des Italiens, précisément en face le café Tortoni, un petit Auvergnat à la mine réjouie, qui, moyennant quelques sous donnés par les passants, faisait monter aux deuxième, troisième et quatrième étages des maisons, un singe nommé Jack, bizarrement accoutré en prince chinois. Qui n’a pas tiré de sa bourse une petite pièce de monnaie pour voir cette souveraineté en haillons tirer respectueusement sa révérence et présenter son chapeau aux assistants pour réclamer le prix de ses gambades. Une nuée d’enfants de tout âge et de toute condition formait, autour du jeune Guillaume et de son singe, une enceinte tellement compacte, que le spectateur en retard ne parvenait jamais à fendre la foule sans y laisser un pan de son habit; aussi le petit Auvergnat gagnait-il largement sa vie et rapportait-il chaque jour à sa vieille grand’mère 3 francs ou 3 francs 50 centimes qui servaient à payer les frais de loyer, de nourriture et d’entretien de la grand’mère et de l’enfant.
Entre le petit-fils et la grand’mère il y avait une touchante affection qui eût fait répandre des larmes d’attendrissement à quiconque se fût, un moment, glissé dans cet intérieur de famille; mais, entre Guillaume et son singe, il y avait un échange continuel de soins, de tendresse, de sollicitude; un mélange de paroles et de grognements, une parfaite réciprocité de petits services qui eussent servi d’enseignement à beaucoup d’hommes plus intelligents sans doute, mais souvent moins reconnaissants que certains animaux. Jack couchait, mangeait et se levait avec son maître. Tout était en partage entre les deux amis: la joie comme la souffrance, la fortune comme la misère. Quand on voyait le sourire épanouir les lèvres vermeilles de l’Auvergnat, on était sûr que Jack grimperait à l’étage le plus élevé de la maison, et retirerait son petit chapeau, garni de grelots, avec plus de dextérité qu’à l’ordinaire; mais quand la pluie ou le froid, chassant les promeneurs, ne permettait pas aux acteurs ambulants de réunir la somme nécessaire aux dépenses de chaque jour, Jack alors se montrait maussade, obstiné; les reproches de son maître n’avaient pas même le pouvoir de stimuler son adresse ou de dompter son humeur indocile.
Un dimanche que le soleil de juin avait attiré dans les Champs-Élysées un immense concours de monde, Guillaume résolut d’y faire manœuvrer son prince chinois. Dans l’espoir d’amasser un bon salaire, il mit, pour ce jour-là, sa veste de bure la plus propre, son petit chapeau le plus neuf et ses souliers les mieux ferrés; puis, ayant revêtu l’illustre Jack de ses vêtements les plus pompeux, ils prirent, l’un portant l’autre, le chemin des Champs-Élysées.
Aussitôt qu’ils parurent, une foule prodigieuse les entoura de toutes parts.
«Voyez donc cet étonnant petit animal! disaient les uns; il grimpe jusqu’au haut du plus grand arbre de l’avenue, et s’y balance comme dans un hamac, en nous faisant mille grimaces!
—Tiens! regardez-le donc maintenant, reprenait un autre, le voilà sur le siège d’un équipage à côté de ce gros cocher tout chamarré d’or et tout garni de fourrure!
—Pan!... le voyez-vous à présent qui mange les pommes de terre frites de la marchande! ajoutait un troisième; quel singulier espiègle! quelle jolie petite mine! ah! regardez donc, regardez donc...»
Et la foule grossissait, tandis que l’escarcelle de Jack s’emplissait de petites pièces de deux sous!...
«Tiens, mon garçon, lui dit soudain un commissionnaire, au moment où quelques gouttes de pluie commençant à disséminer les promeneurs, Guillaume regagnait le logis, tu m’as fait rire aux larmes avec ton chinois de paravent; aussi je veux te payer chopine; entre avec moi dans le cabaret; il faut que je te régale.»
L’Auvergnat, que les conseils de sa grand’mère avaient toujours détourné de ces lieux de débauche, refusa d’abord de suivre le commissionnaire.
«Et ce n’est pas pour te griser, mon ami, que je t’engage à trinquer avec moi, mais tout simplement pour lier connaissance ensemble, car je vois bien que nous sommes des pays.»
Ce mot de pays décida Guillaume qui, cette fois, n’opposa plus de résistance.
Ils entrèrent donc au cabaret voisin; aussitôt qu’ils furent attablés devant une bouteille de vin et deux fines côtelettes de porc frais, dont le fumet alléchait notre petit Auvergnat, Guillaume oublia tout à fait les recommandations de son aïeule.
«Bah! une fois n’est pas coutume,» se disait-il en chantant à tue-tête un refrain de ses montagnes. Bref, il mangea beaucoup, but à l’avenant, si bien qu’en sortant il se trouva étourdi au point de chanceler dans la rue.
«C’est singulier comme les maisons dansent aujourd’hui! se répétait-il à chaque instant; c’est probablement parce que c’est fête, qu’il faut que tout le monde s’amuse.» Jack seul était sérieux et de mauvaise humeur.
Comme Guillaume passait sur le boulevard des Italiens, un jeune homme d’environ quinze ans, suivi d’un domestique à livrée, l’arrêta tout à coup.
«Bonjour Guillaume, lui dit-il; eh bien! décidément aujourd’hui veux-tu me vendre ton singe? tu sais que voilà déjà deux fois que tu me refuses; je suis fou des singes.
—Mieux vaudrait me demander de vendre ma tête, répondit l’Auvergnat sans hésiter.
—En ce cas, tu n’auras pas mes belles pièces d’or, reprit le jeune Ernest de Beaulieu en tirant cinq napoléons de sa poche et les faisant briller à ses yeux.
—Oh les beaux jaunets! s’écria Guillaume en leur jetant un regard de convoitise; je voudrais bien les avoir.
—Il ne tient qu’à toi, imbécile; je te les offre encore une fois en échange de ton ami Jack, dont j’admire l’adresse depuis si longtemps; allons, veux-tu ces 100 francs? mon père me les a donnés pour en faire l’emploi qui me plairait, et tu vois, je donne la préférence à Jack.»
Les fumées du vin et la couleur de l’or montèrent, en ce moment, à la tête de Guillaume... «Voyons, dit-il en prenant et faisant sonner dans ses mains les napoléons.
—Décide-toi donc, continua Ernest: avec cette somme, tu vivras trois mois à ne rien faire.
—Mais ma grand’mère? que dira-t-elle en me voyant rentrer sans son singe... Et mon pauvre Jack, mon fidèle compagnon, mon meilleur ami!... C’est singulier comme tout tourne autour de moi! voilà le café Tortoni de l’autre côté du boulevard maintenant! je ne sais plus ce que je fais; allons, au petit bonheur; tenez, monsieur Ernest, j’accepte le marché, prenez mon singe et donnez-moi vos belles pièces d’or!...»
Ernest ne se le fit pas dire deux fois; il remit les cent francs à l’Auvergnat, saisit Jack, le passa au domestique, et partit.
Lorsque Guillaume eut atteint la rue des Fossés-du-Temple, où demeurait sa grand’mère, il se sentit si malade, si étourdi, si mal assuré sur ses jambes, qu’il fut obligé de s’arrêter au coin de la rue, et que là il s’endormit profondément. Deux ou trois heures se passèrent sans qu’il eut repris connaissance. Les vapeurs du mauvais vin de cabaret l’avaient jeté dans un engourdissement tel, qu’en se réveillant, il se souvenait à peine de ce qui s’était passé; mais la fraîcheur du soir ayant enfin secoué la somnolence de son cerveau, il se rappela tout à coup l’échange qu’il avait fait de Jack contre les cent francs, et comprit seulement alors de quelle détestable faute il s’était rendu coupable.
Son Jack, son ami, celui qui par son instinct et son adresse lui servait à la fois de compagnon et de gagne-pain, son cher Jack n’était plus auprès de lui!... Que dirait sa grand’mère qui aimait, soignait et choyait le pauvre animal presque autant que son enfant!... Les cent francs suffiraient à peine pour vivre trois mois, tandis qu’avec le singe, il y avait toujours du pain et du bois à la maison!...
Guillaume pleurait amèrement et n’osait rentrer au logis; pourtant il fallait s’y décider; sans cela, la pauvre grand’mère, ne le voyant pas revenir, serait capable de mourir d’inquiétude.
Mais quand il ouvrit la porte de la petite chambre, il était si pâle, si tremblant, si abattu, que la bonne mère devina tout du premier coup d’œil!...
«Malheureux! s’écria-t-elle avec angoisse, tu as perdu Jack!...
—Non, bonne mère, répondit-il honteusement... Je me suis laissé entraîner au cabaret, malgré vos conseils, je me suis grisé, et lorsque je n’ai plus eu ni raison, ni mémoire, j’ai vendu mon singe moyennant cent francs.
—O mon Dieu! mon Dieu! reprit la vieille avec désespoir, nous sommes ruinés!...»
Puis elle se mit à pleurer d’une manière si lamentable, que Guillaume sentit son cœur se fendre.
«Tenez, ma mère, dit-il en fouillant dans son gousset, voici de quoi vivre, jusqu’à ce que j’aie racheté un autre singe...»
Mais tout à coup ses membres se roidirent, et il tomba évanoui sur le carreau de la chambre; il n’y avait rien dans sa poche, rien!... les cent francs lui avaient été volés!...
Pauvre malheureux! Laissons Guillaume revenir à lui, et voyons ce que devint Jack, de son côté.
Jack avait été introduit dans l’un des plus somptueux hôtels du boulevard de Gand. La famille de Beaulieu, fort récréée de l’emplette d’Ernest, se mit en frais pour faire à l’illustre singe une réception digne de lui. Il fut d’abord convenu que le costume chinois, tout royal qu’il fût, serait remplacé par un joli petit costume de bandit espagnol, et qu’appelé plus pompeusement Fra Diavolo, il abdiquerait le nom trop vulgaire de Jack. On lui retira ses oripeaux fanés; on le couvrit de velours, d’or et de dentelles; enfin on l’accabla de bonbons, de fruits et de friandises.
Pendant les premiers jours de cette nouvelle condition, le singe, attristé de la perte de son cher Guillaume, se laissa habiller, toucher, retourner, avec une docilité vraiment exemplaire. Abattu par le chagrin, plutôt que courbé sous le joug, Jack ne songea pas d’abord à se roidir contre ces volontés étrangères; mais peu à peu le sentiment de sa propre dignité lui ayant apparemment suggéré un autre plan de conduite, il se cabra, mordit, égratigna, battit tous ceux qui osèrent l’approcher.
Trois jours suffirent pour que l’hôtel du comte de Beaulieu fût dans le plus épouvantable désordre. Un matin, Fra Diavolo brisa, en s’amusant, deux thés de porcelaines du Japon, une pendule d’albâtre, et une superbe coupe de cristal. Le soir, au moment où madame de Beaulieu se disposait à aller au bal, il déchira en mille morceaux une robe de tulle lamé et une superbe écharpe de blonde qui devaient composer sa parure; le lendemain, il creva un œil au chat de la maison, dévora trois serins, étrangla le perroquet; le surlendemain il enleva la perruque de M. de Beaulieu, cassa une glace de mille écus, et jeta par la fenêtre toutes les bagues de la comtesse.
Les choses en étaient à ce point, lorsqu’un matin, au détour de la rue de Vendôme, Ernest rencontra le pauvre Guillaume. Cette fois l’Auvergnat n’avait plus l’œil malin, le cœur joyeux, le nez au vent. De sales habits troués avaient remplacé la bonne veste de bure qu’il avait fallu vendre pour avoir du pain; des cheveux en désordre, des yeux rougis par les larmes, un visage pâli par la fièvre, avaient tellement changé le malheureux, que le jeune de Beaulieu put à peine le reconnaître. Guillaume demandait humblement l’aumône dans les boutiques, où on lui accordait quelques liards à force d’importunités... Hélas! quelle différence entre ce pauvre enfant si misérable et le gentil maître de Jack, dont le gousset était toujours si bien garni.
«Eh bien! Guillaume, lui dit Ernest en s’arrêtant pour le regarder, tu parais bien triste, bien pauvre, maintenant?
—Hélas! monsieur, répondit en pleurant l’Auvergnat, en vous vendant Jack, mon cher compagnon, j’ai perdu mon bonheur, mon repos, ma santé; on m’a volé vos cinq maudites pièces d’or, qui m’avaient tourné la tête; ma grand’mère est malade depuis ce temps, je ne gagne plus rien, et nous mourons de misère et d’ennui... O mon Dieu! mon Dieu! vous m’avez bien puni de ma fatale ambition!»
Et le pauvre Guillaume se remit à pleurer à chaudes larmes.
«Viens avec moi, mon pauvre garçon, dit alors le jeune homme, tout ému de ce récit; viens, je veux te faire voir ton ancien camarade.»
Et Guillaume suivit Ernest, qui se rendit, accompagné de son gouverneur, à l’hôtel de Beaulieu.
«Père, dit-il, en entrant, au comte qui déjeunait au coin d’un bon feu, j’ai une bien touchante histoire à vous raconter à propos de ce Fra Diavolo, votre bête noire.»
La comtesse entrait en ce moment. Après l’avoir embrassée à son tour, il leur raconta, à tous deux, la rencontre qu’il venait de faire, la triste aventure de Guillaume, la maladie de sa grand’-mère et la misère du pauvre Auvergnat.
«Malheureux enfant! interrompit la comtesse, il a donc tout perdu, l’or même que tu lui avais donné et son gagne-pain? Eh bien! que penses-tu que nous ayons à faire pour réparer tant de maux?
—D’abord, reprit Ernest, c’est de lui rendre bien vite ce scélérat de Fra Diavolo.
—Bien entendu, d’abord, ajouta le comte, car je ne veux plus qu’il entre de singe dans la maison.
—Et puis... reprit la comtesse, en interrompant de nouveau son fils...
—Et puis, répliqua Ernest d’un air timide, pour l’indemniser du vol qu’on lui a fait, et de la misère que je lui ai causée en lui achetant, presque de force, son prince chinois, j’aurais bien voulu pouvoir lui rendre...
—Les cent francs qu’on lui a pris, n’est-ce pas? interrompit le comte...
—Oui, mon père.
—Bien, bien, mon fils, reprit la comtesse à son tour. Eh bien! c’est ce que tu vas faire en notre nom.»
A peine madame de Beaulieu avait-elle achevé de parler, qu’Ernest courut vers la porte et fit appeler l’Auvergnat. Celui-ci parut. En apprenant qu’on lui rendait son singe, et de plus les cent francs qu’il avait perdus, Guillaume ne put articuler une parole; la joie, la surprise, le saisissement, semblaient avoir paralysé ses membres; et lorsqu’enfin Jack se précipita sur son épaule, et le couvrit de caresses, le pauvre enfant ne put résister à tant d’émotions successives, il tomba tour à tour aux genoux du comte, de la comtesse, du jeune Ernest, en les remerciant avec des pleurs d’attendrissement.
«Relève-toi, petit Guillaume, dit alors le vieux comte en lui tendant affectueusement la main, recommence ton métier comme auparavant, mais souviens-toi toujours d’une chose: C’est que la soif de l’or est aussi pernicieuse que celle du vin.»

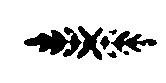
Aux portes de la vieille cité de Tours s’étendent, à perte de vue, de vertes et fertiles prairies, au milieu desquelles coulent tranquilles les eaux du Cher et de la Loire. Çà et là, quelques métairies font éclater au soleil leurs toits de briques rouges, et sur les coteaux qui enferment la vallée s’épanouissent de nombreuses maisons de campagne avec leurs contrevents verts et leurs girouettes qui chantent au vent; rien de frais et de réjouissant comme ce paysage.
Par une belle journée du mois d’avril de l’année 1838, un petit pâtre, de douze ans environ, avait conduit son troupeau dans une partie de la vallée voisine des rives de la Loire. Laissant ses moutons brouter tranquillement l’herbe, sous la garde intelligente et fidèle de son chien, il s’assit sur le tronc mort d’un vieux hêtre, et après avoir disposé symétriquement à terre quelques cailloux ramassés sur la grève, il se mit à les considérer en silence et comme absorbé par un travail intérieur. De temps en temps, il déplaçait du bout de sa houlette un des cailloux; puis il retombait dans une immobilité complète. Le costume de cet enfant accusait la misère la plus affreuse, mais on lisait sur son front large et saillant, dans ses grands yeux noirs, et enfin dans l’expression générale de son visage, les marques d’une si haute intelligence, que presque tous les passants s’arrêtaient involontairement pour le regarder; cependant il en était quelques-uns (et ceux-là portaient le costume des paysans des environs) qui semblaient s’éloigner de lui avec une sorte d’effroi.
Le pâtre était ainsi, depuis assez longtemps, perdu dans ses pensées, quand un voyageur s’approcha de lui et le frappa doucement sur l’épaule; en se sentant toucher ainsi, l’enfant sembla sortir d’un long rêve, et après avoir examiné curieusement l’étranger, il lui dit:
«Que voulez-vous, monsieur? Quelle heure est-il?
—Il est la moitié du tiers des trois-quarts de douze heures, lui répliqua-t-on.
—Alors, monsieur, répondit instantanément l’enfant, il est une heure et demie.
—Vous êtes bien Henri Mondeux, du village de Neuvy-le-Roi? lui dit l’étranger...»
L’enfant lit un signe affirmatif.
«Celui qu’on appelle le petit sorcier dans le pays; je vous cherche depuis longtemps: le bruit de votre réputation est venu jusqu’à moi, et j’ai voulu faire votre connaissance.
—Oui, ils disent comme ça que je suis un sorcier, parce que je résous de suite les calculs compliqués qu’ils me proposent. Quelquefois aussi je vais dans les maisons de campagne que vous voyez devant vous, et là, dans de beaux salons dorés, il y a de belles dames et de beaux messieurs qui me disent leur âge que je traduis tout aussitôt en heures, en minutes, puis en secondes et en tierces. Ceux-là, par exemple, me donnent quelques pièces de monnaie et m’appellent grand calculateur.
—Pourtant, m’a-t-on dit, vous ne savez ni lire ni écrire, ni surtout compter d’après les règles ordinaires.
—C’est vrai, je ne sais rien de tout cela. Je ne puis aller à l’école, car je souffre de rester enfermé toute une journée dans une classe; il me faut la liberté et l’air des champs; là du moins, je puis, tout à mon aise, m’exercer à calculer à l’aide de ces petits cailloux; je n’ai pas d’autre bonheur.
—Mon enfant, votre vie, à ce qu’il paraît, est peu régulière; quittez-la; vous êtes souvent plusieurs jours sans rentrer chez votre père, c’est mal, très-mal; voulez-vous aussi passer dans le pays pour un mauvais sujet?
—Monsieur, répliqua vivement le petit pâtre, je n’ai jamais fait de mal à personne. Quand je suis chez mon père, dont la cabane est là-bas, tout près de Mont-Louis, ma belle-mère m’accable de coups; alors je me sauve, et je vais me réfugier chez une pauvre folle qui me donne un peu de pain et de paille. Je sais bien que j’ai des torts; je ne remplis pas bien ma besogne, je surveille mal mon troupeau: est-ce ma faute? Ma tête est toujours tellement pleine de calculs, que j’oublie souvent ce que j’ai à faire.»
Henri Mondeux et M. Jacoby (c’est le nom de l’étranger qui n’était autre que le directeur de l’école primaire de Tours) continuèrent ainsi de s’entretenir quelque temps. A la fin, lorsqu’ils se séparèrent, contents l’un de l’autre, Henri venait de promettre à M. Jacoby de fréquenter assidûment son école. Il tint parole. A dater de ce moment, on le vit chaque soir sortir de la ferme, pieds nus, et souvent par des temps rigoureux, pour aller à Tours, situé à une lieue de là, écouter les cours de son maître.
Au bout de quelque temps, Mondeux perdit son emploi qui lui rapportait par an trois paires de sabots, du pain noir et un peu d’ail quelquefois, la saison de garder les troupeaux venant de finir.
M. Jacoby se décida alors à le recueillir chez lui, afin de diriger lui-même son éducation: noble désintéressement, qui assure à son auteur l’estime de tous les gens qui s’intéressent à la science. Sans maîtres et sans livres, Mondeux avait, en quelque sorte, deviné l’algèbre; il résolvait, sans le secours des chiffres, les problèmes les plus difficiles. Jugez des progrès immenses qu’il dut faire sous une direction habile. Doué de la mémoire la plus étendue et de l’esprit le plus perspicace, il allait toujours au-devant des explications: aussi la tâche de son maître était-elle facile. Les méthodes enseignées par nos plus savants mathématiciens ne lui suffisant plus, il en imagina de nouvelles; il se créa aussi des formules algébriques. Mais, chose surprenante! c’est que, s’il se montra aussi supérieur dans ses études mathématiques, il n’en fut pas de même pour les autres; il lui fallut dix-huit mois pour apprendre à lire couramment et à écrire d’une manière lisible. Ne serait-on pas tenté de croire que sa première faculté, sa plus grande, nuisait au développement des autres?
Enfin, au mois de novembre dernier, Henri Mondeux, accompagné de son généreux protecteur, quitta la Touraine et vint à Paris, où son arrivée fit grande sensation. Tous les savants se le disputèrent; ils le pressèrent en vain de questions en apparence les plus embarrassantes; il sortit toujours victorieux des épreuves. Le 14 novembre, il était présenté à l’Académie des sciences, et voici le problème qui lui fut proposé:
«Notre président a cinquante-deux années; combien a-t-il vécu de minutes?
—27,331,200 minutes et 1,639,872,000 secondes,» répondit le petit Tourangeau après une minute tout au plus, pendant laquelle il faisait, selon son habitude, son calcul à demi voix.
Au bout d’un quart d’heure seulement, et en opérant sur le papier, MM. Arago et Bouvard avaient pu reconnaître la justesse des chiffres.

Les soupes populaires.

| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Mangez toujours, mes enfants, c’est comme si je mangeais moi-même.» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
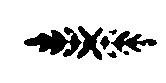
Il est chez le peuple des halles et des marchés de Paris un grand nombre d’établissements dont serait fière la plus haute philanthropie. Parmi ceux qui frappent l’imagination des observateurs moralistes, on remarque, et l’on ne peut s’empêcher d’admirer le débit qui se fait au Marché des Innocents, près de la fontaine, de soupes composées de rognures de viande que les bouchers vendent à bas prix, et de toute espèce de légumes que recèdent, pour une très-modique somme, les marchandes, après les heures de la vente. Aussi les entrepreneurs de cette nourriture populaire vous présentent-ils, pour la somme de trois sous, une écuelle de faïence remplie d’un potage au pain, dont l’odeur et le goût ne le cèdent en rien à ceux des consommés les plus succulents.
Tous les jours, de neuf heures à midi, on voit se grossir sur la Place des Innocents la foule des chalands de tout sexe et de tous âges qui viennent, moyennant quinze centimes, se réconforter, les uns jusqu’au repas du soir qu’ils pourront se procurer; les autres, hélas! pour vingt-quatre heures, n’ayant pas de quoi s’alimenter le reste de la journée. On les reconnaît aisément le lendemain matin à leur teint pâle, à leurs joues creuses, et surtout à l’avidité dévorante avec laquelle ils approchent de leurs lèvres desséchées l’aliment économique qui va leur rendre et la force et la vie.
Tantôt on voit arriver à cet établissement, si cher au peuple indigent, un vieillard appuyé sur le bras d’un pauvre enfant qui tient l’écuelle où l’octogénaire puise, d’une main tremblante, la seule nourriture qu’il puisse se procurer tantôt c’est une mère-nourrice, portant dans ses bras son nouveau-né, que lui donnera le pouvoir d’allaiter la soupe populaire dont elle va se rassasier; tantôt, enfin, ce sont de simples ouvriers, pères de famille, qui, pour économiser un repas à la cantine, dont le moindre prix serait d’un demi-franc, viennent, pour trois sous, se restaurer jusqu’au soir où ils retrouveront chez eux le petit souper du ménage, et sept sous d’économie.
Un hasard, dont je rendis grâce à la Providence, me conduisit un matin à cet établissement philanthropique, dont j’admirai l’ordre et l’économie. Sous deux grands parapluies de toile cirée sont établies, sur des fourneaux, plusieurs chaudières en cuivre, pouvant contenir chacune cinquante rations; et tout auprès s’élève un dressoir à plusieurs étages, portant environ deux douzaines d’écuelles en faïence, d’égale dimension; et derrière ce dressoir, tout près de la fontaine, se trouve un large baquet rempli d’eau limpide, dans laquelle on lave avec soin chaque vase qui vient de servir, ainsi que la cuillère d’étain, et qu’on essuie avec un linge blanc. Cinq entrepreneurs font le service de ce restaurant populaire; deux en dirigent la cuisson, un troisième remplit les vases, le quatrième les distribue aux nombreux chalands, et le cinquième les lave aussitôt qu’ils sont vides. Rien ne présente à la fois, aux yeux de l’amateur, plus d’harmonie, d’adresse et de propreté.
Je ne pus résister au désir de goûter moi-même à ce potage, et me glissant parmi les nombreux chalands, je payai mes trois sous et reçus ma portion. Je ne me disposais qu’à y porter les lèvres pour en connaître la qualité; mais ce potage, quoique fait en plein air, et composé d’une grande quantité de matières économiques, me sembla si suave à l’odorat, si délicieux au goût, que je le dévorai tout entier, et parus sans doute, aux nombreux convives qui m’entouraient, comme un indigent honteux qui se réconfortait pour vingt-quatre heures.
«Mais comment faites-vous, dis-je à l’un des entrepreneurs en lui remettant mon écuelle et ma cuillère, pour donner à si bas prix votre soupe populaire?—Nous sommes secondés bien souvent dans cette entreprise, me répondit cet excellent homme, par les chefs de cuisine des grandes maisons de la Capitale, qui nous gratifient d’une portion des restes d’un service somptueux: ce qui donne à nos potages ce parfum qui flatte le consommateur; et puis, je ne risque rien de vous le confier, Monsieur, à vous qui paraissez vous intéresser à notre entreprise, nous recevons parfois de la main de personnes respectables des bons sur des bouchers, des charcutiers, des boulangers: ce qui ne laisse pas que de nous être très-profitable. Aussi gagnons-nous à peu près le tiers sur le prix de chaque portion; et comme nous en débitons trois cents par jour, l’un dans l’autre, cela nous produit quinze francs de profit qui, partagés en cinq, nous fait trois francs pour chacun, et nous nous en contentons. Quelquefois cependant le renouvellement des écuelles qui se cassent et l’augmentation des denrées nous réduisent à trois centimes de gain; mais nous nous y soumettons sans peine, notre principal but étant de secourir les indigents qui, sans nous, expireraient de faim dans leurs greniers.—Merci de tous ces détails, brave et digne homme! lui dis-je en lui serrant la main; je reviendrai me régaler de vos soupes populaires.»
Plusieurs mois s’écoulèrent; et, bien que la fontaine des Innocents ne sortît pas de ma mémoire, plusieurs occupations importantes m’empêchèrent d’y retourner. Un hasard favorable m’en procura l’occasion. J’étais assis au boulevard de Gand, par un beau jour du mois de mai, tout auprès d’une dame dont le langage et les manières annonçaient une personne distinguée; elle était accompagnée de deux jeunes personnes de dix à douze ans, qui paraissaient d’une gaîté franche portée jusqu’à l’étourderie. Toutes les personnes qui passaient devant nous, surtout les femmes d’une élégante tournure, étaient critiquées et censurées avec une verve qui provoquait le rire, tout en blessant la raison. L’heureuse mère des deux jeunes folles ne pouvait elle-même s’empêcher de partager leur hilarité, et me parut habituée à les laisser exhaler ainsi tout ce qui leur venait à l’imagination.
Nous fûmes abordés par plusieurs mendiants qui nous demandaient l’aumône avec ce ton repoussant de l’habitude et cette importunité fatigante des paresseux désœuvrés: aussi mes deux jeunes voisines les renvoyaient-elles avec une dureté qui, bien que méritée, blessait l’oreille et attristait le cœur. Une jeune indigente tenant un enfant qu’elle allaitait, et traînant une petite fille accrochée à sa jupe, nous tendit la main d’un ton si pénétrant, que je m’empressai d’y déposer une pièce de monnaie. «Monsieur est bien bon, me dit la sœur aînée, d’écouter les doléances de tous ces gens du peuple qui empruntent le masque de la misère pour obtenir de la pitié trop crédule ce qu’ils pourraient gagner par un honnête travail.—Je conviens avec vous, mademoiselle, lui répondis-je, que la main qui trouve du bonheur à secourir l’infortune, place quelquefois mal ses bienfaits; mais il vaut encore mieux donner à l’intrigue et à la paresse que de refuser le malheur véritable.—Pour moi, dit à son tour la sœur cadette, je ne donne jamais aux mendiants des promenades publiques, même à ceux qui vous disent qu’ils n’ont rien mangé de la journée. Avec tous les bureaux de charité qui sont établis dans Paris, on ne saurait croire qu’aucun indigent soit exposé à souffrir de la faim.» Cette opinion, malheureusement erronée, et pénible à entendre de la bouche d’une jeune personne, reporta ma pensée aux soupes populaires; et, me rappelant les pauvres affamés qui s’étaient présentés à mes regards, je soutins, d’un accent assez prononcé, que souvent l’honnête et honteuse indigence se résignait à supporter la faim dans un grenier plutôt que d’aller tendre la main à des cœurs froids qui les repoussaient; et j’ajoutai, avec tout l’élan de la conviction, qu’il existait dans Paris un établissement où la véritable indigence venait apaiser les horreurs de la faim, et offrir à ceux qui nagent dans l’abondance le tableau fidèle des êtres souffrants; je fis aussitôt le récit de ce que j’avais vu et entendu à la fontaine des Innocents, et j’eus le bonheur d’intéresser la mère et ses deux filles, à ce point qu’elles me prièrent de les y conduire. Nous prîmes donc jour: j’offris à ces dames d’aller les prendre chez elles le matin, avant neuf heures, dans une voiture de place, et il fut convenu que nous serions tous les quatre à jeun pour nous régaler chacun d’une portion de soupe populaire, dont je vantai le parfum délicieux et surtout la propreté. Je prévins aussi ces dames d’être, ce jour-là, très-simplement vêtues, afin de pouvoir nous mêler plus facilement parmi le peuple, et d’observer plus à notre aise tout ce qui se passerait autour de nous. J’appris en ce moment, de la mère des deux jeunes personnes, qu’elle se nommait madame Allardin, femme d’un négociant de laine-mérinos, rue du Sentier, numéro 10; et sur l’énonciation que je lui fis à mon tour de mon nom, de ma demeure, ces trois dames me regardèrent avec un nouvel intérêt, et ne furent plus surprises qu’un écrivain moraliste prît avec chaleur la défense de l’humanité souffrante.
Je me rendis au jour convenu et à l’heure indiquée chez M. Allardin, qu’on me dit être un des négociants les mieux famés dans sa partie, et chez qui je remarquai sans peine tout ce qui annonçait l’opulence et la haute renommée. Il m’accueillit avec une gracieuse urbanité, me remercia de procurer à ses filles l’occasion de connaître le peuple, d’avoir une juste idée de ses souffrances, et de contribuer à les adoucir.
Nous nous transportâmes, ces trois dames et moi, vers huit heures et demie, au marché des Innocents, et nous n’y trouvâmes d’abord que peu de convives, l’heure du déjeuner des ouvriers n’étant pas encore venue. Nous pûmes, par ce moyen, déguster tout à notre aise ce potage populaire qui nous parut tout à fait digne de sa célébrité. Madame Allardin avouait tout haut qu’elle n’avait jamais rien goûté de plus succulent. Isabelle, sa fille aînée, prétendait que c’était le meilleur déjeuner qu’elle eût fait de sa vie; et sa sœur cadette, nommée Théonie, témoignait le désir que leur chef de cuisine vînt apprendre la recette d’un mets aussi exquis. «Il n’y parviendrait jamais, répondit un des chefs de l’entreprise; il faut pour cela réunir tout ce que nous procure la desserte des riches hôtels dont nous recevons chaque jour des secours bienfaisants.» Cette révélation parut frapper madame Allardin, ainsi que ses deux filles qui témoignèrent tout bas à leur mère le désir de contribuer à la confection des soupes populaires. «J’y pensais comme vous, mes enfants,» leur dit-elle en leur serrant la main: et je reçus, par cela même, la première récompense de mon œuvre philanthropique.
Mais neuf heures étaient sonnées, et déjà un grand nombre d’ouvriers arrivaient de tous côtés pour se réconforter, les uns jusqu’au dîner de deux heures, les autres jusqu’au repas du soir; et les plus pauvres jusqu’au lendemain matin, économisant par là de quoi nourrir, pendant le jour, leurs femmes, et leurs enfants. Rien n’était à la fois plus curieux et plus déchirant que ces figures pâles de besoin, qui venaient reprendre par degrés la couleur et la vie. On croyait entendre les premières cuillerées de potage, que dévoraient ces malheureux, tomber dans un gouffre profond. Là, c’était un ancien militaire infirme, partageant la portion avec une jeune fille qui soutenait ses pas chancelants; ici, c’était un gros limousin, compagnon maçon, qui, après avoir avalé, presque sans prendre haleine, une première portion de soupe, allait boire un coup d’eau limpide au bassin de la fontaine, et revenait aussitôt remplir son vaste estomac d’une seconde portion; après quoi il disait en souriant: «Me v’là r’crépi jusqu’à ce soir...» Mais ce qui frappa nos regards et nous causa la plus vive émotion, ce fut une femme d’environ trente ans, d’une figure expressive, mais dont les vêtements annonçaient une profonde misère, venir demander deux portions, dont elle paya le prix contenu dans une petite bourse de cuir, et les offrir ensuite à ses deux filles de huit à dix ans, avec cet empressement et cette joie d’une tendre mère qui calme la faim de ses enfants. Celles-ci, ne songeant d’abord qu’à satisfaire leur voracité, dévorent les premières cuillerées du mets succulent qu’on leur présente; puis, s’arrêtant tout à coup, l’aînée s’écrie: «Et toi, bonne mère! tu ne prends rien?—Oh! je n’ai pas si grand’ faim que vous, chères petites, et je puis attendre.—Cependant, lui répond la cadette, tu n’as mangé, comme nous, hier au soir, que deux pommes de terre. Tu dois avoir grand besoin.—Mangez toujours, mes enfants: c’est comme si je mangeais moi-même.—Partage au moins avec nous,» reprend l’aînée, en portant une cuillerée de soupe aux lèvres de sa mère, qui ne peut se défendre de l’avaler avec avidité. La cadette imita sa sœur, et la pauvre femme se trouva un peu restaurée malgré elle, en témoignant le regret de diminuer la nourriture de ses deux filles.... «Eh! pourquoi, lui dit madame Allardin, ne prenez-vous pas pour vous-même une troisième portion?—Hélas! ma bonne dame, c’est que je n’ai pas de quoi la payer!—Oh! permettez-moi de vous l’offrir.—Je n’ai pas la force de vous refuser, car j’ai bien faim.» Elle prend aussitôt la portion qu’on lui présente; et, après en avoir dévoré une partie, elle porte à son tour plusieurs cuillerées du potage à la bouche de chacune de ses filles, en leur disant: «Que je vous rende au moins, chères petites, ce dont vous vous étiez privées pour moi.»
Elle nous explique, à ces mots, la cause de la cruelle détresse où elle se trouve. Elle nous apprend qu’elle est la veuve d’un ouvrier du port Saint-Nicolas, disparu sous les eaux pour sauver un de ses camarades; et que depuis trois ans, restée mère de deux filles en bas âge, elle s’était occupée à carder de la laine avec ses enfants, dans la mansarde qu’elle habitait: ce qui leur produisait environ vingt sous par jour, en travaillant quinze heures de suite. Puis elle ajouta, du ton le plus touchant: «Nous payons régulièrement notre loyer tous les samedis; ce qui nous coûte trente-deux sous par semaine, ou quatre-vingts francs par an: impossible de se loger à moins.... Après avoir payé ce matin notre propriétaire, qui ne ferait pas crédit de vingt-quatre heures, je ne me suis trouvé que six sous, justement de quoi réconforter mes pauvres enfants; et sans vous, mes bonnes dames, j’aurais supporté la faim jusqu’à ce soir; ce qui m’eût fait un peu chanceler au travail et m’eût empêchée de carder toute la laine qui m’est confiée.—Ainsi donc, lui répond madame Allardin, avec trois sous, j’ai empêché une mère de famille de supporter les angoisses du besoin, et de voir autour d’elle ses deux filles manquer de pain.—Oh! cela nous arrive souvent, dit en baissant les yeux l’aînée des deux jeunes sœurs, mais nous nous sauvons avec les pommes de terre.—Et puis, ajoute la cadette, quand on s’est restaurée le matin d’une excellente soupe populaire, on gagne le soir sans trop de souffrances.—Mais, reprend madame Allardin, quand on n’a rien pris de la matinée....—Alors on est sans force, répond la bonne mère....—Et l’on tombe évanouie dans les bras de ses files, qui n’ont à lui offrir que leurs caresses pour la ranimer,» s’écria l’aînée en sanglotant; «c’est ce qui nous est encore arrivé la semaine dernière.»
Ces paroles pénétrèrent jusqu’au fond du cœur de madame Allardin, qui ne cessait de répéter: «Et l’on pourrait douter encore qu’il existe d’honnêtes indigents! Oh! je n’oublierai jamais que, pour trois sous, j’ai empêché une tendre mère de tomber anéantie dans les bras de ses enfants...—Et nous, dit tout bas à sa sœur, mademoiselle Allardin l’aînée; «et nous qui ne voulions pas croire qu’il y eût des malheureux dans Paris!»—«Il faut expier notre erreur,» lui répond à demi-voix la cadette; et tirant de son sac une jolie petite bourse à paillettes d’or, elle y prend une pièce de cent sous, qu’elle présente à la pauvre femme, en lui disant: «Tenez, bonne mère! voilà de quoi payer votre ration pendant un mois.»—«Voilà pour le second mois,» dit la jeune Isabelle en lui présentant de même une pièce de cinq francs.—«J’en ajoute dix à l’offrande de mes filles,» s’écrie madame Allardin, ravie de leur amende honorable. «Et moi pareille somme,» dis-je à mon tour, «cela vous défraiera pendant cent jours, vous et vos enfants, de chacune une soupe populaire... Comment vous nommez-vous, excellente femme?»—La veuve: «Crosnier».—«Votre demeure?»—«Rue de la Cossonnerie, ici tout près, nº 15, au fond de l’allée, au cinquième sur le derrière... Que Dieu vous donne à tous la récompense de ce que vous venez de faire pour nous! J’étais résignée à supporter la faim toute la journée, mais votre généreuse offrande me rend à la fois l’espérance et la vie.» En achevant ces mots, elle saisit, ainsi que ses deux filles, les mains de mesdemoiselles Allardin, les couvre des baisers de la reconnaissance, puis toutes les trois s’éloignent pour retourner à leur travail, en attachant sur nous des regards attendris, jusqu’à ce qu’elles se fussent dérobées à notre vue.
Madame Allardin et ses demoiselles me firent mille remercîments de leur avoir procuré l’occasion de faire une bonne œuvre; et je jouissais de l’aveu que faisaient les deux jeunes sœurs d’être détrompées sur la véritable indigence, et surtout de l’engagement solennel qu’elles prenaient de la secourir toutes les fois qu’elles en trouveraient l’occasion. Je les en félicitai, mais en même-temps, je les prévins qu’il ne fallait pas être dupe, et que la crainte d’alimenter le vice imposait une grande circonspection dans les dons qu’on répandait. «C’est pour cela, ajoutai-je, que j’ai demandé à cette infortunée sa demeure et son nom. Le vif intérêt quelle nous inspire doublerait, si tout ce qu’elle nous a dit était l’exacte vérité. Je vous propose donc d’aller ensemble demain, sur les trois heures, rue de la Cossonnerie, nº 15, afin d’inspecter nous-mêmes cet humble asile de l’indigence, à laquelle nous pourrions peut-être offrir des secours plus importants.» Ma proposition fut acceptée avec empressement; et, dès le lendemain, nous nous rendîmes au fond d’une longue allée; nous montâmes les cent vingt marches d’un escalier sombre et tortueux; enfin nous atteignîmes le palier de plusieurs mansardes, dont l’une était l’habitation de la famille Crosnier. Nous les trouvâmes occupées à carder de la laine, et à notre aspect, la mère et ses enfants vinrent se jeter à nos pieds. Dans un coin de ce taudis, était une paillasse posée sur le carreau, et recouverte d’un vieux matelas rapiécé; c’était le lit de la mère. Dans un autre coin, on apercevait un mauvais grabat où couchaient ses deux filles. Tout, dans cet asile de malheur, annonçait la détresse et le besoin. Toutefois le monceau de laine déjà cardée prouvait clairement qu’on était au travail depuis le lever du soleil; aussi la veuve Crosnier nous dit-elle avec un air de triomphe que, grâce aux soupes populaires dont elles s’étaient régalées, et surtout à la longueur du jour, leur gain de quinze heures de travail s’élevait à trente sous. «Eh bien! je viens vous proposer d’en gagner chacune vingt-cinq,» leur dit madame Allardin avec une vive émotion: «mon mari possède, dans un des faubourgs de Paris, une manufacture de laines mérinos, où il emploie un grand nombre d’ouvriers; dès demain, je vous fais admettre parmi eux. Vous aurez dans l’établissement une chambre et un cabinet pour vos enfants, et gagnant ensemble trois francs soixante-quinze centimes par jour, vous pourrez satisfaire aisément aux premiers besoins de la vie: mes filles et moi nous nous chargerons du reste.»
Il serait difficile de peindre la joie, le saisissement de la pauvre veuve et de ses deux filles. «Trois francs soixante-quinze centimes par jour et logées! répétait l’heureuse mère; mes chères petites, vous ne manquerez plus de rien!»—«Et toi, lui répondaient celles-ci, en la pressant dans leurs bras, tu n’endureras donc plus les tourments de la faim; tu ne te priveras plus de manger avec nous la soupe populaire.»—Oh! leur dit madame Allardin, les mains couvertes de leurs baisers et de leurs larmes, «c’est à ce précieux aliment du peuple que je dois la vive jouissance qui ne s’effacera jamais de mon souvenir,—et nous, s’écrièrent Isabelle et Théonie, cette conviction intime qu’il existe des êtres souffrants dignes de notre commisération, de tout notre intérêt.—Avouez, leur dis-je à mon tour, qu’en offrant aux indigents tous les secours qui sont en notre pouvoir, nous ne faisons que remplir un devoir sacré, qu’obéir à Dieu, qui ne nous a réunis sur la terre que pour nous entr’aider et partager la manne céleste dont il couvre les vastes champs du riche, à condition qu’il en rejaillira quelques parcelles dans la cabane du pauvre.»
Jeunes filles de tous les rangs de l’ordre social, vous surtout que l’opulence berce au sein des délices de la vie, puissiez-vous, en lisant ce récit fait d’après nature, éprouver le désir d’aller à votre tour apaiser la faim d’une pauvre mère de famille!... n’oubliez pas les soupes populaires!

J’avais une grand’mère excellente, dont la mémoire était on ne peut plus fertile en dictons et en proverbes; et de toutes ces vérités populaires, celle qui venait le plus souvent sur ses lèvres était l’adage que je prends pour titre.
Depuis longtemps je me promettais de lui demander ce que signifiaient ces paroles dont je ne comprenais pas bien encore toute la valeur, et un matin je lui adressai ma question:
«Pourquoi donc, grand’mère, dites-vous toujours à brebis tondue Dieu mesure le vent?
—Parce que rien n’est plus vrai, mon enfant, me répondit-elle. Ces gentilles brebis! vois, quand vient la saison de les tondre et de leur enlever la laine qui leur a tenu chaud l’hiver, vois comme l’air est doux et le soleil réchauffant; cet air et ce soleil de printemps, c’est Dieu qui les envoie à ces innocentes créatures, car, sans ces secours, elles mourraient de froid; de même, il ne nous donne jamais à porter un fardeau plus lourd que nous ne pouvons le soutenir. Si nous nous croyons un instant accablés par le malheur et la souffrance, espérons, prenons courage, et nous nous relèverons, ou bien Dieu aura pitié de notre faiblesse et mesurera nos douleurs à notre peu de force, comme à brebis tondue il mesure le vent.»
Après ces paroles, ma bonne grand’mère me raconta, et me répéta même cent fois depuis, une bien simple histoire que j’essaierai de redire ici:
Monsieur et madame Mérard, paysans aisés des environs de Tours, exploitaient la grande ferme de Belle-Assise qui leur rapportait de quoi vivre dans l’abondance, tout en faisant quelques économies. Jamais ils ne manquaient d’argent pour donner aux pauvres, et les malades étaient toujours sûrs de trouver chez eux, dans leur cuisine ou dans leur bourse, les secours les plus charitables et les plus prompts: aussi le ciel les avait-il récompensés de cette belle conduite en leur envoyant, pour fille, un petit ange de beauté et de bonté. Si le jour de la naissance de Marguerite fut une grande fête, les anniversaires ne furent pas célébrés avec moins de solennité; le septième surtout, début de la première année de raison de l’enfant, fut beau entre toutes ces journées de bonheur et de joie.
Les cadeaux, apportés de la ville, avaient été prodigués, après le dessert, à la gentille Marguerite, quand tout à coup elle poussa un cri de ravissement; elle venait de voir entrer le berger, un charmant agneau de quelques jours entre les bras.
«Tenez, mademoiselle Marguerite, lui dit-il après un long salut, voici une petite sœur que je vous prie d’accepter; c’est une jolie brebis qui est blanche comme vous, on le voit; et j’oserais promettre qu’elle sera bien tout aussi douce.
—Elle s’appellera Rosette, n’est-ce pas? dit Marguerite au comble du bonheur; ma brebis s’appellera Rosette.»
Le nom lui resta, et Rosette devint l’inséparable compagne de Marguerite. Rien n’était gracieux comme la brebis et la petite fille lorsqu’elles jouaient ensemble sur les tas embaumés du foin coupé nouvellement. Le visage frais et vermeil de Marguerite, couronné de cheveux blonds bouclés, était charmant à voir à côté du nez rose et transparent de Rosette, dont la tête blanche et soyeuse était frisée à ravir. Ces deux bonnes figures, à l’envi douces et naïves, aimaient à se sentir l’une près de l’autre: on aurait cru voir deux sœurs qui s’embrassaient, surtout quand Marguerite passait son bras rond potelé dans la toison du cou de Rosette qui, de son côté, appliquait, avec la familiarité d’une bonne camarade, ses deux pattes blanches sur chacune des épaules de sa petite maîtresse.
Gardez-vous bien de croire que Rosette eut une de ces vilaines toisons sales que vous voyez aux troupeaux qu’on mène paître; la robe de mérinos de la brebis, bien peignée, bien lissée chaque jour, était aussi blanche, mesdemoiselles, que celle que pourrait vous vendre le meilleur marchand de Paris: ajoutez, à cette parure naturelle, les ornements que Marguerite y mêlait avec goût.
Un jour, une dame de la ville lui ayant attaché sur les deux côtés de la tête, parmi les cheveux bouclés, au-dessus de ses joues fraîches et épanouies, un nœud de rubans bleus, Marguerite para, le soir même, les deux oreilles de Rosette de deux nœuds pareils; et, comme la petite fille portait, lorsqu’elle se mettait en toilette, une cravate de soie de la même couleur, elle ne voulut pas que sa chère brebis fût moins belle, et lui mit au cou un superbe ruban bleu-barbeau.
Vous voyez donc que Marguerite et Rosette faisaient, comme on dit, une paire d’amies, et la jolie petite bête s’était également attachée au père et à la mère de Marguerite. Partageant tous les sentiments de l’enfant, la brute avait acquis quelque chose de la tendresse de l’être doué d’intelligence, tant est grand le pouvoir de l’amitié, même sur les créatures sans raison.
Lorsque Marguerite entra dans sa huitième année, M. Mahou, le curé du pays, demanda à M. Mérard la permission de donner à leur fille les premiers éléments de l’instruction. Elle avait un si vif désir d’apprendre, que c’était un plaisir de lui montrer; aussi M. Mahou se trouvait-il heureux tant que duraient ses leçons, d’autant plus qu’il lui semblait, en s’y livrant, continuer l’exercice de ses fonctions saintes: car passer de l’adoration du Créateur au soin de ses créatures, au développement des âmes qu’il leur a données, c’est toujours rendre hommage à Dieu.
Il y avait encore une autre jolie créature qui venait, de temps à autre, tendre son nez rose vers le livre ouvert entre M. Mahou et Marguerite; mais Rosette ne prétendait pas y faire autre chose que lécher la main de sa compagne avec un gracieux bêlement de joie, puis elle s’échappait en bondissant pour revenir au bout de deux minutes.
Qui n’aurait aimé cette charmante petite bête? On comprendra donc bien quelle fut la terreur de Marguerite quand un jour, au sortir de son travail, durant lequel elle ne l’avait pas vue, elle ne trouva pas Rosette près d’elle.
«Rosette! Rosette!» s’écria-t-elle en courant çà et là comme une folle; d’une voix étouffée à demi, elle la demandait à son père, à sa mère, aux garçons de ferme, aux bergers, aux servantes de basse-cour, à tout le monde; personne ne l’avait vue. Alors Marguerite alla, toute éperdue, des étables aux bergeries, du fond des celliers jusqu’aux greniers; puis elle franchit, en sanglotant, la porte de la ruelle:
«Où es-tu, Rosette? où es-tu?» et elle pleurait à faire pitié aux passants. Enfin elle se décida à courir au bout du village, et là, dans un champ, qu’aperçut-elle? mademoiselle Rosette au milieu d’un troupeau, mademoiselle Rosette gambadant et jouant avec ses semblables; ses semblables! oh! non pas; car ces pauvres moutons n’avaient ni toisons blanches, ni rubans bleus. N’importe, Rosette était plus sage que bien des humains; elle ne méprisait pas ses frères, ses sœurs, parce qu’elle était la plus belle et la plus riche.
Marguerite reprit bien vite la fugitive, et, tout en la traitant de vilaine ingrate et d’enfant prodigue, elle lui pardonna, tant elle était heureuse de l’avoir retrouvée; mais, le lendemain même de son escapade, elle lui attacha, au ruban qu’elle portait en collier, une petite clochette d’un timbre charmant et assez clair pour qu’on l’entendît à une certaine distance. Dans cette mesure de précaution, Rosette ne vit qu’un jouet qu’on lui donnait, et elle s’amusa plus que jamais à gambader, à sauter, à danser au son de l’orchestre qu’elle portait toujours avec elle.
Jusqu’à sa dixième année accomplie, Marguerite n’avait connu d’autres chagrins que ceux que lui causaient les courtes absences de Rosette; mais, à cette époque, commencèrent pour notre chère petite fille de sérieuses et constantes afflictions: sa mère tomba gravement malade, et dès lors l’aimable enfant, instruite par l’inspiration d’un cœur tendre, devint une excellente garde. Tout le jour, et pendant que son père était occupé des travaux de sa ferme, elle se tenait près du chevet de sa mère, dont elle était la servante la plus dévouée et la plus affectueuse. C’est pendant les journées et les nuits ainsi passées qu’elle comprit la justesse de notre proverbe. Madame Mérard avait d’abord beaucoup souffert; mais elle s’affaiblissait de jour en jour, et ses douleurs devenaient d’autant plus vives, qu’elle avait moins de force pour les soutenir. Aussi, après avoir remercié Dieu de cette grâce: «Vois, disait-elle à sa fille, comme à brebis tondue Dieu mesure le vent.»
Telles furent les dernières paroles qu’une nuit, au milieu de toute sa famille et de tous ses serviteurs éplorés, madame Mérard prononça du ton de la plus pieuse résignation. Quelles furent, pendant l’agonie et après le soupir suprême, les larmes de Marguerite? il n’est pas besoin de le dire; j’écris pour des enfants pieux, au cœur bon, à l’âme aimante; ils comprendront ce que dut être la douleur de Marguerite, en songeant à ce que serait la leur, s’ils voyaient mourir leur mère.
La mort prématurée de madame Mérard avait eu des causes que Marguerite ne comprenait pas. Plusieurs années mauvaises s’étant succédé, la ferme était devenue de plus en plus onéreuse, et il était depuis longtemps question, dans la famille, de la nécessité de quitter Belle-Assise. Cette espèce d’exil allait s’accomplir, quand madame Mérard mourut.
M. Mérard n’était pas de ceux qui fuient les lieux consacrés par la vie et la mort d’un être chéri; ce devait donc être pour lui un bien vif chagrin que la seule pensée de quitter Belle-Assise; et cependant cet exil allait devenir indispensable, quand les voisins du malheureux fermier, pour le conserver parmi eux, vinrent à son secours; et M. Mahou fut le premier à lui prêter ses petites économies: pieux argent destiné aux pauvres. Dès ce moment, M. Mérard se livra au travail avec d’autant plus de courage, qu’il avait des dettes à acquitter, et Marguerite, le secondant de tout son pouvoir, dirigeait déjà la maison avec une intelligence remarquable. Le fermier de Belle-Assise avait déjà obtenu, au bout d’une année, quelques résultats, de bien heureux augure pour l’avenir, et l’espoir était rentré dans la famille.
Tout entier à ses travaux, il ne quittait jamais la ferme pour se rendre aux fêtes des villages environnants; Marguerite était assez raisonnable pour rester près de lui. Cependant un jour il força sa fille d’aller à la jolie fête d’un bourg voisin, où elle devait coucher chez une amie de sa mère.
Cette fête venait de se terminer, quand un horrible incendie éclata dans un petit bois qui entourait le hameau auquel donnait son nom la ferme de Belle-Assise. Un vent violent attisait le feu; l’eau était rare, et minuit venait de sonner.
Le tambour battit la générale, le tocsin retentit de toutes parts, et les habitants des pays d’alentour accoururent à cet appel sinistre; mais il était trop tard, et la malheureuse Marguerite n’arriva, ainsi que tous les villageois, que pour voir les débris fumants des granges, des écuries, des étables, et apprendre, ô comble de malheur! que son infortuné père avait péri dans les flammes.
Ainsi voilà Marguerite orpheline, sans appui, dans la douleur, dans la misère. Que va-t-elle faire à présent? La femme chez qui elle se trouvait la nuit de l’incendie, est trop pauvre et a trop de famille pour y ajouter la pauvre enfant. M. Mahou la recueille bien chez lui pour quelques jours; mais il est pauvre aussi, et puis il faut que Marguerite travaille dès à présent pour s’assurer un avenir. Il songe à l’adresser à une sœur qu’il a en Bretagne, et dont le fils est recteur d’une paroisse.
«Va chez ma sœur, lui dit-il en effet un jour, elle te recevra bien, ma chère Marguerite; et si tu la sers en bonne et douce fille, comme je t’ai toujours vue, je suis bien sûr qu’elle aura pour toi le cœur d’une mère.
—Le sœur d’une mère! ah! monsieur, je pars tout de suite pour la Bretagne.
—Bien, mon enfant; mais je ne puis te fournir les moyens de t’y rendre en voiture, et le chemin est bien long d’ici à Nantes.
—C’est égal; je marche bien: demain je me mettrai en route.»
Et, le lendemain, M. Mahou donna à Marguerite une lettre de recommandation pour sa sœur, qu’il avertissait en même temps par la poste. Il mit quelques pièces de monnaie, le seul argent dont il put disposer, dans la poche de la pauvre orpheline, et, après l’avoir conduite sur la grand’ route, il lui dit:
«Adieu, ma pauvre fille; va, aie du courage, aie foi dans la Providence: à brebis tondue Dieu mesure le vent.»
Et Rosette!—Nous n’avons point voulu mêler son nom au récit des afflictions qu’il nous a fallu raconter; mais elle n’existe pas moins, et la voila partie avec sa jeune maîtresse. Il leur fallut trois jours pour se rendre à Saumur, et jusques-là le voyage se fit assez bien. Marguerite avait emporté de son village un panier rempli de provisions qui suffit parfaitement à sa nourriture et à celle de sa brebis; mais, lorsqu’elles arrivèrent à Angers, notre pauvre voyageuse commença à se trouver dans un grand embarras; elle n’avait pas pu voyager de nuit, et les frais à payer dans chaque auberge pour la chambre et la nourriture, avaient tout à fait épuisé sa petite bourse, et elle n’avait pas même de quoi acheter un petit pain pour elle et Rosette, avant de sortir de la noire capitale de l’Anjou.
Pour comble de malheur, le temps, beau et doux jusqu’alors, subit une de ces variations si fréquentes au commencement du printemps: le ciel devint sombre et l’air très-piquant. Quand on a l’estomac creux, comme l’avait Marguerite, on est bien plus sensible aux rigueurs de l’atmosphère; et la malheureuse enfant, fatiguée par sa longue route, et mourante de faim, ne perdait cependant point courage, bien que la nuit fût à peu près complète.
«Viens, viens. Rosette, dit-elle à sa pauvre brebis; vois tu là-bas cette lumière? Je parie que nous allons trouver une auberge où l’on nous recevra pour cette nuit. Sois tranquille, car ma pauvre mère et M. le curé m’ont dit: A brebis tondue Dieu mesure le vent.»
Marguerite n’avait pas eu tort d’espérer. La lumière qu’elle avait aperçue de loin venait du village d’Oudon, que domine une tour si belle; et l’aubergiste, homme charitable, donna à l’orpheline un asile pour la nuit, un bon souper, et de quoi se nourrir toute la journée du lendemain dans les chemins de traverse qu’elle devait prendre pour aller trouver le recteur et la dame à qui elle était recommandée.
Marguerite remercia donc bien vivement son hôte et se remit en marche dès le point du jour. Elle suivit la bonne route jusqu’à deux heures après midi; mais le malheur voulut qu’alors elle arrivât à un carrefour formé par trois chemins. Elle hésita longtemps entre ces trois embranchements; et, mal inspirée celte fois, elle choisit le mauvais. Elle avait beau aller toujours devant elle, elle n’apercevait aucune habitation ni personne pour la diriger. Cependant la nuit était venue, nuit très-épaisse, sans lune, sans étoiles, dont le froid humide pénétrait jusqu’au fond des os. Il n’y avait plus qu’un parti à prendre, c’était de passer la nuit dans ce lieu même.
«Courage!... A brebis tondue Dieu mesure le vent.» Marguerite, en disant ces mots, se résigna; et, tapie de son mieux dans une touffe de genêts qui avaient à peine des feuilles, serrant le plus possible autour d’elle la cape de laine que lui avait donnée l’amie de sa mère, elle prit Rosette dans ses bras, en guise de manchon; et l’une et l’autre ne tardèrent pas à s’endormir. Elles étaient si lasses!
Lorsqu’elles rouvrirent les yeux, il faisait déjà grand jour, et le premier objet qui frappa les regards de Marguerite, ce fut une femme courbée en deux qui lui demandait la charité: à peine vêtue, elle était toute violette de froid et de besoin aussi sans doute. Marguerite avait connu ces souffrances; elle y compâtit d’autant plus; mais c’était une pitié stérile, car elle n’avait plus d’argent depuis la veille et son panier était à sec! et pourtant la vieille grelottait et semblait transie. Marguerite éprouvait tout ce qu’il y a de cruel à voir quelqu’un souffrir et à ne pouvoir le soulager, quand tout à coup son œil brilla comme si elle était au comble de la joie, et aussitôt elle avait ôté sa cape de laine pour en envelopper la tête et le cou de la vieille; mais ce n’était pas tout; elle n’avait pas un morceau de pain à donner à la pauvre femme affamée. Aussi de quelle voix suppliante elle s’adressa à un homme qui vint à passer dans une carriole chargée de diverses denrées et d’énormes paquets de laine:
«Oh! monsieur! pour l’amour du ciel, ayez pitié de cette pauvre femme, elle meurt de faim; donnez-lui un morceau du pain que vous avez dans votre charrette; donnez-lui quelque chose.
—Que me demandes-tu là, petite fille? lui répondit le marchand de laine d’une voix brusque. Tu peux bien lui faire la charité, toi, si cela te fait plaisir.
—Oh! cela me ferait tant de plaisir! Mais je ne le puis; je n’ai pas une miette de pain pour moi-même: je n’ai rien.
—Comment! rien?... Tu as ta brebis blanche, vends-la-moi, et ensuite tu pourras à ton gré faire l’aumône à cette femme.
—La vendre!... Te vendre, ma petite Rosette! pour qu’ils te tuent, pour qu’ils te mangent! oh! mon Dieu!» Et Marguerite embrassait sa brebis qui, promenant ses doux regards de sa maîtresse à la vieille mendiante et au marchand, semblait deviner qu’elle était l’objet de la conversation.
«Eh bien! reprit le marchand, tu peux au moins me vendre sa toison; je le paierai tout de suite.» En parlant ainsi, il faisait briller aux yeux de Marguerite quelques pièces d’argent que la bonne vieille contemplait aussi de ce regard avide que donne la faim.
«Allons, donne-moi la toison de ta brebis, petite; cela ne la tuera pas, et je te paierai sur-le-champ.»
La perspective de pouvoir tout aussitôt venir en aide à la pauvre mendiante décida enfin Marguerite; elle prit l’argent et l’un des pains que portait le marchand, partagea le tout avec la vieille; et pendant qu’elles soulageaient leur faim poignante, Rosette était entre les mains du marchand de laine qui la débarrassait lestement de sa toison.
Cette opération ne se fit pas sans bien des recommandations de Marguerite, sans bien des regards où se peignaient la tristesse, le regret peut-être; mais il lui suffisait de tourner ses yeux vers la mendiante, qui se ranimait visiblement, pour que la bonne fille se réjouit de son sacrifice.
Enfin la brebis était tout à fait dépouillée; et si Marguerite n’avait plus sa cape, Rosette n’avait plus sa toison; mais à brebis tondue Dieu mesure le vent. Tout à coup, comme par miracle, un bon soleil perça les nuages sombres et réchauffa les épaules de Marguerite: la bise s’apaisa, et devint un doux zéphir pour ménager le dos rouge et nu de la brebis.
Marguerite et sa petite compagne n’avaient plus froid. La vieille, reconnaissante, avait mis la jeune fille dans le bon chemin; mais, au bout de dix heures de marche, la mendiante, l’enfant, la brebis, toutes étaient de nouveau exténuées de fatigue; elles tombèrent de lassitude sur le bord d’un fossé, et prévoyaient avec épouvante la nécessité de passer encore une nuit à la belle étoile, quand une carriole parut sur la route et s’approcha d’elles. C’était la sœur de M. Mahou qui venait au-devant de la pauvre orpheline: elle la prit à côté d’elle, ainsi que Rosette et la vieille qui demeurait dans le village dont son fils était recteur.
M. Mahou avait eu bien raison de promettre à Marguerite que sa sœur aurait pour elle le cœur d’une mère. Au bout de quelques jours, elle fut dans la maison aussi chérie qu’un enfant qu’on a vu naître, et l’on aima Rosette presque autant qu’elle l’aimait.
«Eh bien! à présent, mon petit ami, ajouta ma grand’mère en terminant son récit, tu comprends bien tout ce qu’il y a de bon et de consolant dans mon proverbe? Dis donc toujours, à la fin de tes prières, cet acte de foi, d’espérance, de charité: A brebis tondue Dieu mesure le vent.»

Il existe, à Paris, un ancien joaillier fort célèbre dont la modestie et tout à la fois la reconnaissance pour les sabots, pourraient servir au besoin de leçon à quelques-uns de ces nouveaux riches dont l’orgueil ingrat se révolte contre l’origine de leur fortune.
Celui-ci du moins n’a pas honte des rudes épreuves auxquelles fut soumise sa jeunesse; il en chérit, il en conserve avec un soin religieux tous les souvenirs, il est fier de la lutte qu’il eut d’abord à soutenir contre l’adversité. Comme il est venu, lui aussi, en sabots, dans la capitale, il leur a voué une espèce de culte, il leur a dressé un piédestal où se perpétuera le souvenir de sa misère primitive.
Cette paire de lourds sabots est, à ses yeux, le plus bel ornement de son salon. Enfermée dans une cage de verre, supportée par une colonne en marbre de Sienne, elle est couronnée par le portrait du maître du logis. Il s’est fuit peindre par un de nos premiers artistes, non pas en un costume élégant, fashionable, avec sa croix d’honneur, mais dans le costume de son premier état. On y voit, le croiriez-vous, mes enfants? la simple veste de bure et le pantalon de toile, avec le bonnet de coton et l’invariable paire de sabots.
Le 1er avril de chaque année, jour anniversaire de son arrivée à Paris (il y a de cela près de cinquante ans), cet homme vénérable revêt, dès le matin, la veste de l’ouvrier, tire ses sabots de leur cage de verre, les met à ses pieds; puis il sort, tenant à la main un gros bâton, le même qu’il portait lors de son entrée dans la capitale. Il se promène dans les rues, sur les boulevards, partout enfin où il peut rencontrer des amis et des connaissances; il va visiter l’auberge du Faubourg Saint-Denis, où il reçut pour la première fois l’hospitalité sur la paille, et les différentes maisons où il travaillait comme ouvrier.
En un mot, toute sa journée est consacrée à ce qu’il nomme «son grand voyage au pays des souvenirs.» Ses repas du matin et du soir rappellent exactement la frugalité des repas de sa jeunesse; il va s’asseoir à la modeste table des ouvriers, et puis, quand il a terminé la répétition très-scrupuleuse de tout ce qu’il faisait il y a cinquante ans, il rentre chez lui, replace ses sabots au lieu accoutumé, après leur avoir fait subir une toilette convenable, et s’endort avec ses souvenirs pieux, pour se réveiller, le lendemain, dans l’opulence.
Mais ce n’est pas tout: il a deux fils, deux grands et beaux garçons, ma foi! qui continuent avec succès le brillant commerce de leur père, sous la surveillance de ce sage Mentor, dont les conseils et l’expérience les guident dans leurs affaires. Or, ces deux fils sont soumis, comme leur père, à l’épreuve des sabots; comme lui, ils prennent, une fois chaque année, cette lourde chaussure, mais sans être toutefois astreints à toutes les épreuves que nous venons de décrire, épreuves qui pourraient paraître trop dures à des jeunes gens qui ont reçu une brillante éducation. Une fois, chaque année, ils sont obligés de se rappeler l’origine et les causes de la fortune de leur père, et de rendre ainsi hommage à son activité laborieuse, à ses quarante ans de travail, d’économie et de probité. Ils ne sauraient ainsi jamais oublier de quel point est parti l’auteur de leurs jours pour arriver enfin à la considération et à la richesse: souvenir bien salutaire qui n’a que trop manqué au fils de ce fameux industriel anglais, Henri Hunt, qui laissait naguère en mourant un double et pompeux héritage: fortune et célébrité. Eh bien! demandez aujourd’hui, ces Angleterre, ce qu’est devenu le noble héritage, on vous dira: ces richesses immenses, elles ont été entièrement dissipées par un fils prodigue, et ce fils est dans la plus profonde misère. C’est que le malheureux avait complètement oublié que son père avait été le propre artisan de sa fortune, et que, malgré son luxe et ses richesses, il n’y avait pas, dans sa ferme, d’homme plus laborieux, de meilleur ouvrier que lui.—Mais revenons à notre petite anecdote.
Cette paire de sabots du joaillier devient donc, pour ses enfants, une garantie de sécurité pour l’avenir; si elle leur montre comment la persévérance et le travail peuvent conduire à l’aisance, à la richesse même, elle leur enseigne aussi le moyen de les conserver; elle parle économie et modestie bien plus haut que toutes les remontrances possibles; aussi, ce bon père a-t-il toujours été dispensé d’employer, à leur égard, le langage de la sévérité. Quand, par hasard, il surprenait dans leur conduite quelque petite velléité d’orgueil, ou sinon de paresse et de dissipation, oh! alors il lui suffisait de montrer ses sabots, et soudain tout rentrait dans l’ordre accoutumé.
L’homme vénérable dont nous vous parlons, mes enfants, est aujourd’hui plus qu’octogénaire; il occupe une haute position sociale, due à quarante années de travaux honorables; il jouit même d’une bonne santé, grâce à l’activité de son zèle philanthropique; il monte encore assez lestement les cinq étages de plus d’une pauvre maison, car il rend des visites très-assidues aux habitants des mansardes. Il y a quelques années, il lui a pris la fantaisie de faire son testament; mais tout ce qu’on sait du contenu de cet acte, c’est qu’il y a stipulé la conservation et la transmission de sa paire de sabots dans sa famille; il assure que c’est le legs le plus précieux qu’il puisse faire à ses enfants.

Le Deux Bouquet.
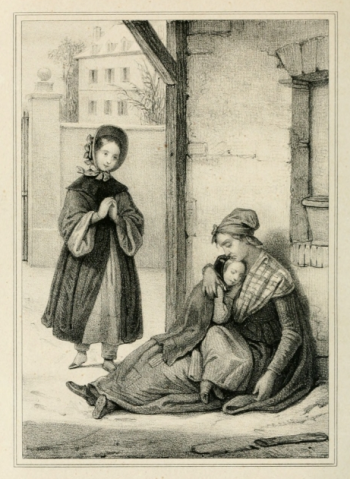
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «La neige qui entourait de toutes parts ce triste abri, prouvait assez ce qu’avaient du souffrir ces pauvres créatures.» | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
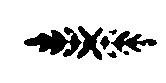
C’était au mois de décembre; la neige qui tombait depuis le matin avait converti les longues allées du bois de Boulogne en autant de nappes d’une blancheur éclatante.
Dans l’enceinte, dite de la Muette, s’élevait un grand bâtiment dont les murailles se confondaient avec les arbres du jardin, tout couverts de neige.
Il était environ quatre heures du soir; et, au milieu du silence qui régnait sur toute cette nature morte, on distinguait cependant un bruit confus de voix dans l’intérieur du pensionnat, du côté du réfectoire, qui prouvait assez à quel genre d’occupation se livraient, en ce moment, les jeunes écolières.
Puis une cloche sonore, accompagnée soudain de cris joyeux, annonça l’heure de la récréation qui suit d’ordinaire le repas du soir; toutes les jeunes filles, chaudement vêtues, s’élancèrent hardiment dans le jardin.
Toutes semblaient avoir une seule pensée, celle de se réunir pour partager les mêmes jeux; toutefois, une d’elles paraissait éviter de se mêler à ses compagnes, elle s’était écartée de leur troupe joyeuse. Etait-ce un sentiment de tristesse qui lui faisait ainsi rechercher la solitude? non, sans doute: Anna n’avait que douze ans, et à cet âge, on fuit volontiers la peine pour se livrer au plaisir. C’était un peu d’orgueil.
Anna avait des parents fort riches, tandis que la plupart de ses compagnes étaient simplement filles d’honnêtes artisans qui s’imposaient des privations pour donner à leurs enfants une éducation dont ils avaient peut-être été privés eux-mêmes.
La jeune fille sentait cette différence, et elle se croyait autorisée à s’en enorgueillir; à ce défaut, elle en joignait un bien plus funeste encore: elle avait un mauvais cœur.
Après avoir traversé le jardin, Anna s’approcha de la grille qui donnait sur l’entrée du bois, et aperçut une femme et une enfant pauvrement vêtues qui s’avançaient vers elle.
Il commençait à faire nuit, et, comme Anna se trouvait seule dans cette partie du jardin, elle eut peur et se recula vivement, sans penser que la grille la séparait encore de l’inconnue.
«Est-ce que nous vous causons de l’effroi, ma gentille demoiselle?» dit la femme en se rapprochant d’Anna.
Celle-ci ne répondit rien, et se disposait à se retirer.
«Par pitié, ne nous fuyez pas, reprit la pauvre femme d’un ton suppliant; tout le monde nous a repoussées; depuis ce matin je n’ai pu obtenir un morceau de pain; nous avons bien froid et ne savons où passer la nuit; la charité, s’il vous plaît?
—Vous n’avez pas d’argent? dit Anna d’un ton qui témoignait moins de compassion que de mépris; mais il faut en gagner en travaillant.
—En gagner? reprit la mendiante avec chagrin; mais comment? je n’ai pas d’ouvrage.
—Je n’y peux rien, répliqua la petite fille avec aigreur.
—Et pourtant, si vous nous refusez, ma chère demoiselle, ajouta en sanglotant l’infortunée, peut-être mourrons-nous cette nuit.»
En ce moment, Anna aperçut un homme qui passait, portant sur son dos une hotte remplie de fleurs: «Oh! les belles fleurs!...» s’écria-t-elle étourdiment.
L’homme s’approcha: «N’est-ce pas qu’elles sont bien jolies? reprit-il en cherchant à faire naître chez Anna le désir de les posséder; tenez, poursuivit-il, comme ça sent bon;» et il lui présentait alors un gros bouquet qu’il tenait à la main.
Les fleurs avaient totalement fait oublier à la jeune fille la pauvre mère qui était toujours là, attendant pour ainsi dire la vie ou la mort du caprice d’un enfant. Anna avait pris le bouquet; elle en admirait tour à tour les fleurs qui le composaient, et n’avait plus la force de s’en séparer.
«Combien voulez-vous de tout cela? dit-elle tout bas au marchand, par un sentiment intérieur de honte qui lui disait qu’elle faisait mal.
—Ah! dam! c’est cher! reprit cet homme; mais j’vous l’laisserai pour trois francs, parce que c’est vous.» Il avait prononcé ces mots à voix haute; la mendiante avait tout entendu.
«Ma bonne demoiselle, reprit celle-ci d’un ton suppliant, songez qu’avec cet argent-là, vous nous rendriez bien heureuses, et que, si vous rejetez ma prière, ma pauvre petite fille sera peut-être morte avant que ces fleurs soient fanées.»
Anna rougit et baissa les yeux. Quoique bien jeune, elle sentait bien qu’elle était coupable, mais elle n’avait pas la force de résister à son désir; aussi, après avoir lutté un instant contre elle-même, elle vida précipitamment toute sa petite bourse dans la main du marchand, et s’enfuit pour éviter de nouveaux reproches. Cependant, après avoir tourné l’allée qui faisait face à la grille, elle s’arrêta pour regarder derrière elle. Le marchand était parti enchanté de son aubaine, et la pauvre femme s’était assise tristement sur la terre, avec son enfant qu’elle cherchait à réchauffer dans ses bras; il sembla même à la jeune fille entendre ses sanglots...
Anna était restée à la même place, agitée et tremblante; enfin, elle se dirigea vers la maison, mais elle avait peur, car toutes ses compagnes étaient rentrées, et, à chaque pas, elle croyait voir, dans l’ombre projetée par les buissons, la pauvre mère et sa fille accroupies sur la neige; le vent lui-même, glissant avec un bruit plaintif à travers les branches, lui rappelait les sanglots qu’elle avait entendus un instant auparavant... Une sueur froide coulait sur son front, et, parvenue au bas du petit escalier de pierre qui conduisait au réfectoire, elle fut obligée de s’appuyer à la rampe.
Enfin, arrivée dans sa chambre, elle commença à reprendre un peu d’assurance, et la vue de ses jolies fleurs acheva de la distraire des terribles émotions qu’elle venait d’éprouver, et elle courut dans la classe, attendant avec impatience l’heure du coucher pour les revoir encore.
Cette heure sonne enfin; Anna avait caché ses fleurs avec soin; une fois seule, elle les met près de son lit, les caresse, s’enivre de leur parfum; elle ne se lasse pas de les admirer... Cependant le sommeil la gagne; elle veut le combattre; mais c’est en vain... jamais elle n’éprouva pareille lassitude... elle n’a plus la force de soutenir sa tête appesantie; ses paupières se ferment malgré elle; elle s’affaisse insensiblement sur son oreiller, et s’endort...
Trois ans se sont écoulés; le père d’Anna est mort du chagrin que lui a causé la perte de sa fortune, engloutie dans de fausses spéculations; et au moment où recommence cette histoire, Anna vit retirée, avec sa mère, dans une misérable chambre qu’elles vont pourtant être obligées d’abandonner, parce qu’elles n’en peuvent payer le loyer. La mère d’Anna prépare tristement le peu d’effets qu’il lui sera permis d’emporter; et la jeune fille, assise sur leur pauvre grabat, regarde sans paraître comprendre: sa tête est brisée; un voile épais semble jeté sur tout ce qui s’est passé; elle cherche en vain à recueillir ses souvenirs... Il semblerait même que sa raison l’a abandonnée, car elle ne pleure pas.
Enfin, sa mère a achevé ses apprêts, et, la prenant par la main, elle descend avec elle l’escalier tortueux qui conduisait à leur demeure; tous ont été sourds à ses prières; il faut partir...
Il y avait déjà quelque temps qu’elles marchaient au hasard, quand Anna se pencha vers sa mère. «J’ai faim, lui dit-elle tout bas, et comme craignant d’être entendue des passants.» Celle-ci la regarda en pleurant, et ne répondit rien.
Anna avait compris cependant, et cette douleur muette lui redonna du courage; elle se repentait d’avoir affligé celle qu’elle aimait, pourtant elle souffrait bien, car depuis la veille, ni elle ni sa mère n’avaient pris de nourriture; aussi, ses jambes fléchissaient-elles à chaque pas.
Sa mère, qui s’en aperçut, s’approcha timidement d’un homme qui passait à quelque distance pour implorer son secours, mais cet homme poursuivit sa route et ne se détourna pas; et bien d’autres encore qu’elle implorait et qui la regardaient avec mépris ou la repoussaient durement.
Tant d’humiliations avaient gonflé le cœur de la pauvre enfant, et ses sanglots l’étouffaient.
Cependant la nuit approchait, et personne n’avait eu pitié de leur misère; la neige tombait à gros flocons, et déjà les rues étaient désertes; les fenêtres des hôtels s’illuminaient, l’une après l’autre, comme des étoiles; c’était l’heure où, à Paris, chaque cuisine semble jeter un défi railleur au malheureux qui passe, et qui n’a pas même du pain. Toutes les portes s’étaient refermées, et il n’y en avait pas une, entre toutes, qui dût s’ouvrir devant elles pour les protéger contre les rigueurs de la nuit.
Insensiblement, elles étaient arrivées à un endroit solitaire, et la mère d’Anna chancelait à son tour, et, cette fois, c’était sa fille qui la soutenait.
«Je ne saurais aller plus loin, dit la pauvre femme en s’appuyant contre une borne.
—Du courage, mère, du courage; je vois là-bas une maison où, sans doute, on ne nous refusera pas l’hospitalité.
—Vain espoir! ma fille, le ciel nous a abandonnées.
—Oh! non, pas encore, car j’aperçois une charmante demoiselle à travers la grille; elle paraît bien joyeuse; elle ne nous repoussera pas.» Et Anna s’approcha.
La jeune inconnue chantait; mais en voyant tout à coup ces deux personnes, elle se tut et s’avança avec curiosité: «Que demandez-vous? dit-elle.
—L’hospitalité, pour cette nuit seulement.
—L’hospitalité! c’est impossible; n’entendez-vous pas les instruments? Il y a grande fête chez mon père; toute la maison est occupée.
—Mais alors que faire? que devenir?...
—Je ne sais.
—Oh! par pitié! fit Anna avec désespoir, secourez ma mère, il fait bien froid; si vous ne pouvez nous recevoir, du moins donnez-nous de quoi passer la nuit ailleurs.
—Vous n’avez donc pas d’argent?
—Hélas! non.
—Mais alors, il faut en gagner, répliqua-t-elle naïvement; moi, je n’en ai plus; tenez, voilà ce qui m’en reste.» Alors elle jeta par-dessus la grille un joli bouquet qui vint tomber aux pieds d’Anna, et s’enfuit en continuant sa chanson.
Anna était restée atterrée; tout le souvenir du passé se rattachait à ce bouquet; c’était comme un remords, un reproche d’une mauvaise action; et cependant, elle ne se rendait pas encore bien compte de tout ce qui se passait en elle.
En ce moment, elle se retourne, et aperçoit sa mère étendue sans mouvement sur la terre; à cette vue, Anna pousse un cri et se précipite sur le corps déjà glacé de sa pauvre mère; elle la couvre de ses baisers, cherche à la réchauffer par son haleine, mais c’est en vain, la vie semble éteinte en elle... alors... muette de douleur et d’effroi, après avoir couru comme une insensée de tous côtés, elle voit une corde qui pend en dehors de la grille, s’y cramponne avec toute la force du désespoir; soudain l’air retentit du bruit sonore d’une cloche, et. . . . . . . . . . . . . Anna s’éveille; des pleurs inondent ses joues animées d’une teinte fiévreuse; elle se dresse sur son séant, regarde autour d’elle avec des yeux hagards, et, persuadée alors que tout cela n’était qu’un rêve, des larmes de joie et de repentir viennent bientôt remplacer celles que la douleur avait fait couler.
Mais tout à coup la porte de sa petite chambre s’ouvrit et ses parents entrèrent: «Eh bien! petite dormeuse, lui dit sa mère avec bonté, tu n’entends donc pas la cloche? elle n’appelle pourtant pas à l’étude aujourd’hui; c’est jour de repos; mais que vois-je! pourquoi ces larmes?
—Oh! maman, je vous dirai tout; mais venez, venez vite, il est peut-être temps encore...» En un clin d’œil, Anna fut sur pied, et elle descendit précipitamment, suivie de son père et de sa mère au comble de l’étonnement.
Tous trois étant sortis du jardin, Anna regarde de tous côtés avec l’anxiété la plus vive; puis, poussant un cri de joie, elle s’élance vers un petit hangar... la pauvre mère et son enfant s’y étaient réfugiées, et la neige qui entourait de toutes parts ce triste abri, prouvait assez ce qu’avaient dû souffrir ces pauvres créatures; cependant elles dormaient, mais d’un sommeil qui eût pu devenir fatal, car toutes deux étaient presque évanouies.
M. et Mme N*** comprirent alors pourquoi leur fille les avait si précipitamment amenés de ce côté; or, n’écoutant que leur bon cœur, ils firent placer les deux pauvres mendiantes, à leur insu, dans le carrosse qui attendait Anna pour retourner à l’hôtel.
Quand elles se réveillèrent, ces infortunées étaient entourées des domestiques de la maison, qui leur prodiguaient tous les soins que réclamait leur état, et Anna, riant et pleurant à la fois, achevait à ses parents l’histoire de cette nuit, où elle avait tant souffert...
Dès ce jour, il y eut deux malheureux de moins; et Anna eut une vertu de plus.

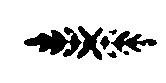
«Ainsi Nicolas partira demain?
—Oui! ma chère Marguerite, oui! demain nous nous séparerons d’un de nos enfants. Il le faut ainsi.
—Cependant il est si jeune encore!
—Nicolas compte maintenant douze années; il est temps qu’il songe sérieusement à apprendre un état qui le fasse vivre un jour.
—Mon ami, pourquoi ne pas le placer dans une ferme du village? il travaillera comme nous à la terre, ainsi du moins il sera toujours sous nos yeux.
—Non; Dieu a accordé à Nicolas de l’intelligence, de la facilité pour apprendre, et surtout une grande ardeur pour le travail. A la ville où je l’envoie, il pourra lire, étudier autant qu’il voudra; et qui sait? peut-être un jour deviendra-t-il un savant! Mais je l’aperçois qui s’avance avec ses frères et sœurs: laisse-moi seul afin que je lui fasse connaître mes intentions.»
Cette conversation se tenait par une claire soirée du mois de septembre de l’année 1775, entre deux personnes assises devant une chaumière du petit village de Saint-André d’Hébertot, situé au fond du Calvados. C’étaient deux époux, honnêtes et actifs ouvriers qui allaient d’ordinaire travailler à la journée chez les cultivateurs du pays, mais qui comptaient plus de mauvais jours que de bons, car leur salaire était modique et leur famille nombreuse.
«Nicolas, dit le père à son fils lorsque celui-ci se fut approché, prête-moi bien toute ton attention... Tu le sais, mes charges sont lourdes, tu as plusieurs frères et sœurs, et il nous faut travailler beaucoup, ta mère et moi, pour vous entretenir et vous nourrir. Tu viens d’atteindre ta douzième année, tu as de bons bras, de l’intelligence; sous mes yeux, tu as appris que l’homme est fait pour travailler, prépare-toi donc à nous quitter pour aller, à la ville, remplir un emploi.
—Mon père, je suis prêt à vous obéir, répondit Nicolas; dites, que faut-il que je fasse?
—Je viens de voir, dans le village, M. Moret, savant apothicaire de Rouen; il a besoin d’un jeune garçon pour l’aider dans ses préparations; je lui ai parlé de toi, il t’accepte, et demain je désire que tu partes avec lui dans sa voiture.
—Demain! demain! répéta plusieurs fois l’enfant presque effrayé de l’idée de quitter sitôt ses parents si bons, qu’il aimait tant et les lieux au milieu desquels s’était écoulée son enfance; mais il reprit bientôt joyeusement: «Merci, mon père; oh! vous me rendez bien heureux, vous me mettez à même de continuer mon éducation et d’apprendre des choses nouvelles; car là-bas j’aurai des livres, n’est-il pas vrai?»
—«Oui, certes, et de gros encore. Maintenant embrasse-moi, et va dire adieu à tous tes petits camarades.»
Quelques jours après, Nicolas Vauquelin (car c’était lui) était installé dans l’officine de maître Moret, riche apothicaire de la ville de Rouen. Celui qui devait un jour siéger à l’Académie, briller au premier rang parmi nos chimistes et nos naturalistes, dans ce temps-là couvert de vêtements grossiers, les pieds dans de lourds sabots, fut employé à ces travaux rebutants qui sont le partage des garçons de laboratoire. Maître Moret, quoique instruit, ne devina pas que, sous son enveloppe rude parce qu’elle était inculte, Nicolas cachait un esprit actif qui aspirait à la science et n’attendait qu’une bonne direction. Loin de là, il lui interdisait tous moyens d’étude, et quand il le surprenait dévorant, en cachette, les pages d’un livre de chimie ou d’histoire naturelle, c’était pour l’accabler de sarcasmes et souvent même de coups. Pourtant Nicolas ne se mettait à l’étude qu’après avoir rangé, nettoyé, accompli enfin tous ses devoirs de la journée. Pauvre Nicolas! ce n’est pas là ce qu’il avait rêvé!
Maître Moret avait ouvert chez lui un cours de chimie pour les jeunes étudiants rouennais; il entrait naturellement dans les fonctions de Nicolas d’assister à toutes les séances afin de servir son patron dans ses démonstrations. Ces jours-là étaient pour lui des jours de bonheur, car tout en soufflant le feu et en s’agitant dans la salle, il prêtait une oreille attentive à la parole du maître, et il entendait alors expliquer, avec méthode et clarté, des choses que son éducation incomplète ne lui permettait souvent pas de comprendre dans les livres. Un des assistants en fit la remarque, et, devinant que le pauvre garçon de laboratoire cherchait à profiter, lui aussi, des leçons du professeur, il lui proposa les cahiers qu’il rédigeait sur les notes prises au cours. Vauquelin accepta avec une vive reconnaissance. Cependant un obstacle se présentait: pour étudier ces cahiers et les copier, il n’avait que la nuit, temps pendant lequel, loin de l’œil de maître Moret, il était parfaitement libre. Son parti fut bientôt pris. Il déroba, ou plutôt, pour me servir, mes enfants, d’une de vos expressions familières, il chippa des bouts de chandelle, et, afin que la lumière, en se répandant dans sa chambre, ne le dénonçât pas, il s’imagina de placer sa chandelle sous un vase de nuit au côté duquel il avait pratiqué un petit trou. Le faible jet de lumière qui s’en échappait, éclairait seulement un petit espace de papier. Vauquelin n’en demandait pas davantage.
Une nuit que, selon son habitude, Nicolas travaillait avec ardeur à l’aide de son étrange lampe, il entendit frapper violemment à sa porte. Il ouvrit, mais sa frayeur fut grande en se trouvant en face de maître Moret, pâle, les yeux étincelants, la menace à la bouche.
«Petit malheureux! lui dit celui-ci, est-ce pour noircir du papier que je t’ai pris à mon service? Voyons, qu’écris-tu là? des notes sur mon cours; peux-tu en comprendre un seul mot, ignorant! (en même temps il déchira les cahiers); si je t’y reprends encore, je te chasse de chez moi.»
Ces procédés indignèrent l’enfant.
«Monsieur, s’empressa-t-il de lui dire, puisque c’est ainsi, je vous prends au mot, demain je quitterai votre maison.»
En effet, le lendemain, Nicolas Vauquelin, portant sous le bras son petit bagage, reprit à pied le chemin de Saint-André d’Hébertot. Quand, de loin, il aperçut le clocher pointu de son village, les hauts peupliers qui ombrageaient la maison où il était né, il s’arrêta, le cœur gonflé d’émotion, et, oubliant bien vite sa fatigue, il courut se jeter dans les bras de ses parents et de ses frères et sœurs. Sa joie fut de courte durée. Prévenu par l’apothicaire, son père lui fit un très-mauvais accueil, et refusa presque de l’entendre. Nicolas déclara alors qu’il irait à Paris pour y chercher fortune, mais ce fut bien autre chose: ses parents, les villageois, le traitèrent d’orgueilleux, même d’insensé, et lui tournèrent le dos. Tout cela était bien de nature à affliger Nicolas; cependant il ne perdit pas courage, car c’est le propre des âmes fortes et persévérantes de savoir résister aux coups de l’adversité; ils passent sur elles, sans jamais les froisser.
Madame Daguesseau, propriétaire du château voisin, avait souvent eu l’occasion d’apprécier la rare intelligence du jeune Bas-Normand. Lorsqu’elle apprit ce qui venait de lui arriver, elle le fit appeler, lui donna de sages conseils, et l’encouragea fortement à persévérer dans ses desseins. C’est alors seulement que la famille Vauquelin se décida à lever ses obstacles; Nicolas partit donc avec des habits neufs dans son sac et quelques écus dans sa poche; et telle était la confiance qu’il inspirait, que le curé du village n’hésita pas à le charger d’une somme de trois mille livres en or, pour le prieur de l’ordre des Prémontrés à Paris.
La route était longue et pénible, cependant Vauquelin ne dépensa, de son petit pécule, que trente sous seulement. Quel ordre et quelle économie déjà à cet âge!
En arrivant à Paris, sa première pensée fut pour son précieux dépôt; après avoir bien demandé, bien couru, il trouva l’abbaye des Prémontrés, et il remit, entre les mains du prieur, les trois mille livres qui lui étaient destinées. Ce n’est pas sans être grandement surpris que celui-ci reçut la somme des mains du jeune homme; aussi s’empressa-t-il de le questionner sur ses projets d’avenir et sur les motifs de son voyage à Paris. Nicolas répondit avec tant de simplicité et en même temps d’assurance, il montra un esprit naturel si charmant, que le prieur intéressé au plus haut point, le fit entrer tout de suite comme garçon chez un apothicaire de ses amis. Voilà Vauquelin placé, bien heureux de son sort; pourquoi faut-il qu’un mauvais génie s’attache encore à lui!
Au bout de quelques semaines, il tomba gravement malade, et on fut forcé de le transporter à l’Hôtel-Dieu. Pendant trois mois, il lutta avec courage contre le mal, et, pendant ces trois mois, il n’entendit pas une bouche amie lui murmurer à l’oreille quelques-unes de ces douces paroles qui vous soutiennent et vous consolent. Sa mère était au fond de son village, peut-être ignorante du mal de son fils, et le bon prieur lui-même venait de mourir.
Vauquelin recouvra la santé, mais ce fut pour tomber dans une affreuse perplexité; il se trouvait sans place, seul, perdu au milieu de la capitale. Dans ce moment critique, il lui fallut faire un appel à tout son courage. Enfin, après des démarches et des refus sans nombre, le pauvre petit Bas-Normand entra chez M. Chéradame, honnête et savant apothicaire. Dès ce jour, Vauquelin commença une vie nouvelle; ayant trouvé dans les personnes qui l’entouraient de l’amitié et de l’encouragement, il se livra tout entier à ses goûts pour les sciences naturelles. Afin de ne pas négliger les travaux de la pharmacie, il consacra une partie de ses nuits à ses études, et bien souvent le soleil levant le trouva penché sur ses livres. Il connaissait si bien le prix du temps que, dans ses courses pour son patron, il emportait les feuilles arrachées à un dictionnaire pour les apprendre par cœur en marchant.
Enfin, Vauquelin employa si bien les quelques années qu’il passa chez M. Chéradame, que le chimiste Fourcroy, qui l’avait pris en amitié, se l’attacha comme secrétaire, et l’admit même à partager ses travaux. Sous ce patronage illustre, il ne devait pas tarder à révéler son nom à l’Europe savante.
La Révolution de 89 arriva; quoique troublé dans ses succès et dans sa fortune, Vauquelin n’en continua pas moins ses travaux. Je ne puis me dispenser de vous citer ici un trait de courage qui honore infiniment l’homme dont je vous raconte aujourd’hui la vie. Un jour (c’était le 10 août 1792), le peuple s’était rué sur le château des Tuileries et massacrait les troupes suisses qui le défendaient. Un de ces malheureux soldats, couvert de blessures et poursuivi par la populace furieuse, se jette éperdu dans le laboratoire de Vauquelin. Celui-ci entrevoit l’échafaud qui le menace s’il sauve l’étranger, mais il n’hésite pas; aidé par mademoiselle Fourcroy qui se trouvait alors près de lui, il dépouille le soldat de ses vêtements, lui noircit le visage avec du charbon. Quand les assassins entrèrent, ils ne trouvèrent (dit un de ses biographes) qu’un charbonnier occupé à décharger un sac de braise, une femme qui travaillait paisiblement et un savant qui étudiait. A quelques mois de là, un des chefs de la Convention lui écrivit: «Pars, fais-nous du salpêtre, ou je t’envoie à la guillotine;» et Vauquelin partit pour l’armée en qualité de commissaire des poudres. Quand il revint, il fut nommé répétiteur du cours de chimie de l’École Polytechnique que Bonaparte venait d’instituer. Après la mort de son ami et émule Fourcroy, arrivée en 1810, il obtint la chaire de chimie de la Faculté de médecine, et (chose inouïe!) lors du concours, tous ses concurrents se retirèrent, en proclamant hautement sa supériorité et ses droits incontestables.
Mon intention n’est pas de suivre, pas à pas, Vauquelin au milieu de ses travaux immenses et de ses triomphes journaliers; qu’il me suffise de vous dire que, lorsqu’en 1831 la mort l’enleva à la science et aux lettres, il siégeait à l’Académie des lettres et à la Chambre des Députés, il occupait la chaire de chimie à la Faculté de médecine, et que, sur sa poitrine, brillaient plusieurs décorations françaises et étrangères.
Vous voyez, mes jeunes amis, quels peuvent être les résultats d’un travail soutenu, d’une volonté ferme et persévérante. Sorti de la classe modeste et peu éclairée des laboureurs, Vauquelin sut s’élever, par ses propres forces, jusqu’au premier rang parmi les savants. C’est ainsi que toujours la vie de l’homme qui travaille est remplie de joie, de bonheur et de prospérité; souvenez-vous au surplus de cette parole si juste de l’immortel Franklin: «La faim regarde à la porte de l’homme laborieux, mais elle n’ose pas y entrer.»
Le Morne aux Chacals.
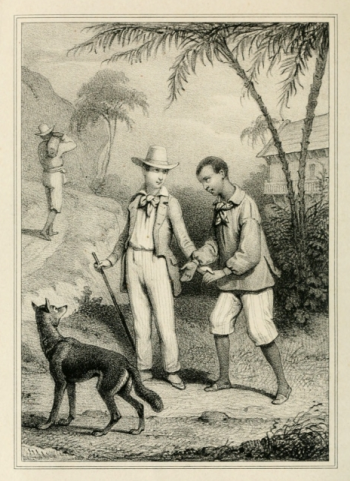
| Louis Lassalle del et lith. | Lith. de Cattier |
| «Voici mon bon compagnon Djaly, c’est un brave défenseur, un ami dévoué, je vous le donne maître»...... | |
Paris LOUIS JANET, Editeur du DIMANCHE des Enfants
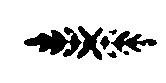
En 1819, il existait à Sainte-Rose, l’une des villes de la Guadeloupe, un riche planteur, dont les exploitations occupaient environ cent quatre-vingts esclaves. M. Norbert était un de ces maîtres chez qui l’indulgence et la compassion savent s’allier toujours à une juste sévérité. Qu’un nègre fût souffrant ou malheureux, la bienveillance du planteur lui était infailliblement acquise; mais qu’un esclave eût, en revanche, mérité une correction quelconque, avec M. Norbert, le châtiment suivait immédiatement la faute. Cette justice, loin d’être blâmée dans l’île, avait donné, à la famille de Sainte-Rose, une excellente réputation d’équité, qui la faisait chérir de toute la population noire.
Une bande nombreuse de nègres fugitifs, ayant été arrêtée dans les mornes de la Pointe-à-Pître, et vendue à l’encan, sur la place publique, M. Norbert y fit l’acquisition d’une négresse, d’une trentaine d’années, avec son petit négrillon d’environ cinq mois: circonstance qui servait merveilleusement ses projets, car un enfant lui était né depuis quelques jours; et cette femme, nommée Naya, ayant bon air et santé, allait servir de nourrice à son fils. Naya fut donc installée dans la maison du planteur.
Comparativement à l’existence vagabonde que la pauvre femme menait dans les mornes de l’île, cette vie tranquille et régulière lui sembla bien douce; aussi s’acquitta-t-elle de ses nouvelles fonctions, avec un soin, une probité, une sollicitude, dont elle n’eût pas été plus prodigue envers son propre enfant.
Pendant huit ans, cette excellente Naya vécut paisiblement au sein de l’honorable famille Norbert, partageant ses soins, avec une égale tendresse, entre Gaston, son jeune maître, et son fils qu’on avait baptisé sous le nom de Nicoli. Comme tous deux étaient, à cinq mois près, du même âge, ils se prirent, l’un pour l’autre, d’une amitié si grande que partout on les rencontrait ensemble. Un cœur droit, une franchise éprouvée, une profonde vénération pour leurs parents, avaient établi entre eux des sympathies qui resserraient chaque jour leur affection. Cette étroite intimité dura jusqu’à ce qu’ils eussent atteint l’âge de dix ans. C’est alors seulement que Gaston commença à comprendre qu’entre le blanc et le noir, il y avait la différence du maître à l’esclave. M. Norbert, commençant à craindre de voir naître, dans le cœur de son fils, cette fierté hautaine qui n’admet d’égalité nulle part, crut devoir témoigner au jeune Nicoli plus d’affection qu’il ne l’eût fait peut-être en toute autre circonstance. Au reste, l’excessive docilité du petit esclave, son extrême intelligence, la douceur inaltérable de son caractère, inspiraient en sa faveur un intérêt dont on ne pouvait se défendre; aussi qu’on donnât à Gaston un fruit, une friandise, qu’on lui accordât une grâce, ou qu’on lui fît une caresse, Nicoli n’était non plus jamais oublié. Ces deux enfants étaient traités sur le pied d’une égalité parfaite... Ce qui commença fort à déplaire au fils de la maison; et cette contrariété secrète ne fit que s’accroître par un autre concours de circonstances. Que Gaston vînt à renverser un meuble par maladresse, tout naturellement on lui citait, comme exemple, la manière délicate avec laquelle Nicoli nettoyait les porcelaines de la maison, sans jamais les briser; qu’il tachât, faute de précaution, ses jolis vêtements de drap fin, on lui montrait la petite veste de nankin de son frère de lait, qui toujours était d’une extrême propreté.
Ces comparaisons, dans lesquelles Nicoli avait un avantage incontestable, aussi bien sous le rapport de l’ordre que sous celui du caractère, finirent par révolter la vanité de notre jeune orgueilleux. Peu à peu il éprouva contre Nicoli une jalousie si profonde et si poignante, qu’il essaya, par tous les moyens possibles, de le faire chasser de l’habitation; mais Dieu, qui ne permet pas que l’injustice triomphe, en avait décidé tout autrement.
Lorsque les deux enfants eurent atteint l’âge de douze ans, on fit venir à l’habitation plusieurs professeurs, chargés du soin d’instruire Gaston; et, comme la protection qu’accordait M. Norbert à l’enfant de Naya, ne faisait que croître en proportion des mérites du petit nègre, il permit à Nicoli de prendre part aux leçons de son fils; ne soupçonnant pas d’ailleurs l’inimitié secrète de Gaston pour l’esclave, ce bon père croyait, en lui donnant un compagnon de travail, rendre ses études moins arides.
En peu de temps, Nicoli surpassa Gaston dans les devoirs qu’on donnait à tous deux; en même temps, les professeurs se plaignirent, à M. Norbert, du peu d’attention que son fils apportait à leurs leçons: ce qui affligea profondément cet homme respectable; mais, comme il lui sembla que les reproches et les menaces auraient beaucoup moins d’influence sur l’esprit de Gaston qu’une émulation adroitement excitée, il imagina de promettre une montre d’or à celui des deux écoliers qui aurait, au bout de deux mois, fait le plus de progrès dans ses études. Nos jeunes gens se mirent donc sérieusement au travail, mûs par l’espoir de cette précieuse récompense. Nicoli avait un si bon cœur et une si vive amitié pour Gaston, que souvent il lui offrait de terminer ses devoirs laissés à moitié, ou de faire, à sa place, les pensums qu’on lui avait infligés. Mais celui-ci, trop fier pour se résigner à devenir l’obligé de son esclave, refusait obstinément ses offres.
A l’heure des récréations, le fils du planteur passait la majeure partie de son temps dans les jardins de son père, ou dans la société des personnes que recevait madame Norbert. Nicoli, au contraire, allait herboriser sur le versant du Morne aux Chacals, gorge profonde resserrée entre deux monticules, où se réunissaient souvent, la nuit, des troupes de ces animaux féroces.
Un jour que le jeune nègre s’était hardiment aventuré dans une espèce de grotte, formée de blocs de granit éboulés, il fut tout saisi de surprise en apercevant là trois petits chacals; leurs grognements le remplirent d’abord d’effroi; mais, ayant observé peu à peu qu’ils étaient beaucoup trop jeunes pour lui faire le moindre mal, il en prit un, l’emporta dans ses bras, et, muni de ce singulier fardeau, il se mit en route pour l’habitation. M. Norbert lui permit d’élever cet animal qui bientôt grandit en force, en beauté; mais rien n’égalait l’attachement que Djaly (c’est le nom qui fut donné au chacal) témoignait au jeune esclave; Nicoli l’avait dressé à le suivre partout comme un chien, et à se laisser caresser par tout le monde, sans qu’on eût à craindre, de sa part, le moindre mouvement de colère ou de méchanceté. Gaston, dont la jalousie se trouva surexcitée par ce nouveau privilége accordé à son frère de lait, aurait bien voulu s’approprier le beau chacal; mais Nicoli s’y était si fort attaché, qu’il eût senti son cœur se briser de chagrin, s’il lui eût fallu se séparer de son animal chéri.
Cependant la dernière quinzaine du temps prescrit par M. Norbert pour le concours en question était à moitié expirée. Nicoli travaillait avec ardeur; quant à Gaston, il n’apportait guère plus d’application à ses devoirs que par le passé, certain qu’il était d’avoir plus d’esprit que le jeune esclave, et d’obtenir ainsi la montre, sans se donner la peine de la gagner. Les deux enfants se réjouissaient; car, après ce temps d’épreuve, une vacance de quinze jours leur avait été promise; et, tandis que Gaston se proposait d’aller voir sa grand’mère qui demeurait à quinze lieues de Sainte-Rose, Nicoli avait, lui, le projet d’apprendre la botanique, dont l’étude lui plaisait infiniment.
Toutefois, la veille du jour fatal, Gaston, voulant décidément savoir à quoi s’en tenir sur le résultat du concours, adressa quelques questions indirectes à son père; mais celui-ci, devinant son intention, lui reprocha, pour toute réponse, le peu de progrès qu’il avait faits depuis deux mois; puis, à l’heure de la leçon, son professeur de latin, qu’il essaya d’interroger à son tour, se mit à lui vanter le zèle et l’activité qu’avait apportés Nicoli dans ses études. Bref, notre petit paresseux comprit seulement alors que la montre d’or ne lui écherrait pas en partage. Cette conviction acheva de blesser son amour-propre et de bouleverser sa raison.
Naya, en cessant de nourrir l’enfant du planteur, avait déjà donné assez de preuves de dévouement et de probité pour mériter toute la bienveillance de M. et madame Norbert; aussi, depuis cette époque, était-elle devenue, d’ancienne nourrice, femme de charge et de confiance de la maison; en cette qualité, on avait mis à sa disposition une caisse pour les dépenses courantes de l’habitation, dont elle avait seule la clef; et jamais on n’avait eu lieu de concevoir le moindre soupçon sur sa délicatesse éprouvée.
Le matin même du jour où Nicoli devait recevoir la montre d’or, digne récompense de son travail assidu et de son application, Gaston forma secrètement l’affreux projet de perdre le pauvre nègre, en faisant peser, sur lui, l’accusation d’une action honteuse, infâme. Cette horrible pensée fermenta tout le jour dans son âme, ulcérée par la plus basse jalousie; et il y avait, dans cette vengeance, un calcul d’autant plus perfide, qu’il devait lui-même, dès le point du jour, être déjà loin de Sainte-Rose, quand l’infortuné Nicoli se trouverait accusé; en effet, il était convenu, avec son père, qu’il partirait, le lendemain matin, pour Orannes, petite ville située à quinze lieues environ, au bord de la mer; c’est là que demeurait son aïeule maternelle.
Une fois la nuit venue, et quand il se fut bien assuré que tout le monde dormait dans la maison, le malheureux se leva, ouvrit tout doucement la porte de la chambre où Naya couchait auprès de son fils, et s’achemina, à pas de loup, vers la négresse; ensuite s’emparant du trousseau de clefs, qu’elle déposait chaque soir sur sa table de nuit, il détacha soigneusement de ce trousseau la clef à trèfle, et bien reconnaissable au toucher, qui appartenait à la caisse; puis s’en alla immédiatement, toujours à pas de loup, à tâtons, cacher cette clef dans le gousset du pantalon de Nicoli qui dormait du plus profond sommeil. Ceci fait, il s’apprêtait à regagner sa chambre; déjà même il tenait le bouton de la porte, et la tirait sur lui, lorsqu’un sourd grognement se fit soudain entendre. Gaston tressaillit de frayeur: c’est Djaly, couché aux pieds de son maître, que ce léger bruit venait de réveiller, heureusement trop tard pour Gaston; car, épouvanté du danger qu’il venait de courir, et auquel il n’avait pas songé le moins du monde, celui-ci eut le temps de refermer bien vite la porte. Une seconde de plus, et l’animal furieux se jetait sur lui pour le dévorer, comme sur un malfaiteur... Et Dieu sait ce qu’il serait devenu sous la dent meurtrière du chacal, sans compter que toute la maison eût inévitablement été mise sur pied par suite de cet événement, et que le méchant eût alors été, à son éternelle confusion, pris, devant tout le monde, dans le piège honteux qu’il dressait au pauvre Nicoli. Mais enfin ce moment de terreur, tout passager qu’il avait été, puisque Djaly cessa presque aussitôt de grogner, n’en fut pas moins, pour le coupable, un avertissement providentiel qui éveilla incontinent le remords dans son âme. En effet, Gaston avait toujours été jusqu’alors bon et humain. Cette action, il se la reprochait donc comme une infamie; sa malheureuse jalousie lui avait donné le vertige; à deux ou trois reprises différentes, il fut près d’aller remettre la clef à sa place; mais, cette fois, le maudit chacal le dévorerait indubitablement sans miséricorde! Dans sa perplexité, il s’agenouilla au pied de son lit, demanda pardon à Dieu de sa faute; et, après avoir longtemps cherché dans sa tête à quelle décision il s’arrêterait, il résolut, sitôt arrivé à Orannes, d’écrire à son père, de se déclarer coupable du trait de jalousie et de méchanceté abominable qu’il venait de commettre, car il sentait qu’il n’aurait pas la force de soutenir les terribles reproches de son père, et de lui tout avouer lui-même, avant de partir; ceci décidé, il tâcha de s’endormir... Mais quel sommeil agité n’eut-il pas!
Le lendemain, à l’aube du jour, le voilà prêt à se mettre en route; il a les yeux rouges; il semble éviter les regards de Naya, de tout le monde; son père et sa mère, en l’embrassant, se méprennent tout naturellement sur cet air embarrassé; ils regardent la rougeur de Gaston comme un reste d’humiliation de sa défaite de la veille. Nicoli lui-même, dont le cœur est si bon, s’abuse mieux que personne sur la morne tristesse de son frère de lait; il le guette au passage, et, lui prenant la main avec amitié, il lui dit: «Pauvre maître! je suis, croyez-le, bien malheureux de vous voir partir en colère contre moi! Aussi, avant notre séparation, je veux vous donner un gage de ma tendresse et de mes regrets; voici mon bon compagnon Djaly, c’est un brave défenseur, un ami dévoué, un excellent animal, je vous le donne, maître, à condition que vous serez indulgent pour ses défauts, et que vous ne lui ferez jamais de mal. Adieu, Djaly, ajouta le petit nègre en essuyant une larme, adieu, mon bon animal, Nicoli ne t’oubliera jamais.»
Puis il se sauva, sans attendre la réponse de Gaston, qui, ému jusqu’au fond de l’âme, se préparait à lui sauter au cou, à lui tout avouer, à lui demander pardon; mais déjà Nicoli est bien loin, et une fausse honte reprend sur lui son empire.
Djaly, tout consterné, se laissa mettre une corde au cou; et, cinq minutes après, le fils du planteur était sur la grand’route pour se rendre chez sa grand’mère.
Le voyage fut bien pénible; les chemins hérissés, dans ce pays, de ravins et de précipices, se franchissent difficilement. Gaston avait le cœur dévoré d’inquiétude; l’horrible faute qu’il avait commise, passait et repassait incessamment dans sa mémoire; il s’accusait, se détestait, se frappait la tête, dès que le domestique qui l’accompagnait, le laissait seul un moment: «Oh! mon Dieu! se disait-il avec douleur, qu’une faute est donc lourde à porter, puisque la mienne m’écrase ainsi le cœur!»
Enfin, après dix-huit heures de marche, on arriva à Orannes chez la bonne grand’mère, qui fut bien heureuse de revoir son cher Gaston. Mais combien l’excellente femme eut le cœur navré quand l’enfant lui eut raconté ce qu’il avait fait! elle ne s’apaisa qu’en voyant couler les larmes d’amer repentir qui ruisselaient sur le visage de son petit-fils. Elle promit à Gaston d’écrire sur-le-champ à son père pour implorer son pardon. Mais, au moment où elle prenait la plume, une lettre et une petite boîte furent remises à Gaston. La boîte contenait une montre d’or, et la lettre était ainsi conçue:
«Mon enfant,
»Je t’envoie la montre que j’avais donnée à Nicoli, en récompense de sa bonne conduite. Une tentative de larcin dont le malheureux vient de se rendre coupable, ne me permet plus de laisser entre ses mains cette preuve de mon estime. Pour toi, mon fils, ce bijou n’est pas une récompense, car tu ne l’as pas méritée; je te le donne à titre d’encouragement pour l’avenir. Il me coûte beaucoup d’avoir à infliger une punition terrible à ton frère de lait; mais l’horreur que m’inspirent l’ingratitude et le manque de probité, me fait un devoir d’être sévère. Après-demain donc, au lever du jour, Nicoli recevra, dans le Morne aux Chacals, devant tous les esclaves assemblés, trente coups de lanière sur les épaules. Tu venais de partir, Gaston, lorsque Naya s’est aperçue de la soustraction de la clef de sa caisse; elle l’avait cherchée partout vainement; par le plus grands des hasards, je faisais alors, en présence de tous les nègres de l’habitation, au malheureux Nicoli, la remise solennelle de sa montre; je leur proposais cet enfant pour modèle. Je veux placer moi-même et le premier cette montre dans son gousset... Juge de ma stupéfaction... la clef qui avait disparu, s’y trouve cachée! Comprends-tu pareille infamie? Le misérable pâlit, balbutie, il s’étonne, proteste de son innocence... Naya, la pauvre Naya, toute en larmes, se jette à mes pieds, prend sa défense; puis tout à coup elle s’arrête comme saisie d’une pensée soudaine, et s’écrie: «Ah! ce n’était donc pas un rêve... Je l’ai vu... c’était lui;» et, après avoir proféré ces mots, elle garde dès ce moment un morne silence... Il était donc coupable, puisque sa mère elle-même...»
Gaston n’eut pas la force d’en lire davantage, il s’évanouit; et, dès qu’on lui eut fait reprendre connaissance, il supplia sa grand’mère de faire préparer un cheval, et voulut à toute force partir:
«Oh! mon Dieu! mon Dieu! s’écriait-il avec désespoir, le pauvre Nicoli va mourir sous les coups, tandis que c’est moi, moi... Oh! cela ne peut être ainsi, j’en mourrais de chagrin!...»
La grand’mère se désolait aussi, et cherchait vainement les moyens de sauver au malheureux esclave un châtiment qu’il n’avait pas mérité. Mais c’était le lendemain matin même que la correction devait être infligée... et quinze lieues de montagnes, de ravins, de précipices, les séparaient de Sainte-Rose... et point de cheval, de messager qui pût franchir cet énorme espace sans arriver trop tard... Et cependant, que faire, mon Dieu! que faire?
Le chacal, enchaîné dans un coin de l’appartement, semblait en ce moment jeter sur Gaston des regards féroces; la pauvre bête, depuis qu’elle avait changé de maître, refusait de prendre toute espèce de nourriture. Gaston le regardait avec compassion, quand tout à coup une pensée lui surgit comme un éclair; ah! cette pensée venait du ciel: «Vite, vite, du papier, de l’encre et un morceau de cuir!» s’écria-t-il avec exaspération.
Puis, ayant écrit ces mots: «Mon père, ne punissez pas Nicoli, il est innocent; c’est ma haine injuste, ma basse jalousie qui ont tout fait; c’est moi qui l’ai compromis ainsi pour le perdre; j’arriverai, sous deux jours, pour recevoir mon châtiment.»
Il plia le billet, l’enveloppa dans un sac de peau, l’attacha solidement au cou de Djaly, et conduisit le chacal aux portes de la ville; l’animal hésita quelques instants, puis flaira, dans le chemin, la trace qu’il devait suivre, et se mit à courir avec une telle vitesse qu’une flèche n’eût pas été plus rapide.
Il était sept heures, le lendemain, lorsque tous les esclaves de M. Norbert se rendirent au Morne aux Chacals, lieu habituel des punitions. Un poteau avait été dressé; c’est là qu’on devait attacher le malheureux Nicoli. M. Norbert; présent lui-même à l’exécution de la sentence, était assis sur un banc de gazon préparé pour lui. On amena le patient; il était pâle, défait, mais soutenu par la conscience de son innocence; Naya le suivait en pleurant et en s’arrachant les cheveux de désespoir; déjà l’esclave, chargé de la correction, levait le bras sur Nicoli, quand le chacal, haletant, couvert de sueur, s’élança sur son maître, le couvrit de caresses, et se dressa devant lui, de manière à ce que le sac de cuir fût en vue de tous les assistants. Le supplice fut suspendu; M. Norbert ouvrit précipitamment le sac, sans en expliquer le contenu; bientôt son front s’assombrit dune manière terrible. Mais tout à coup, proclamant l’innocence de l’accusé, il le fait ramener à l’habitation, porté en triomphe par les nègres qui devaient assister à son supplice. En homme juste, il devait une réhabilitation au pauvre Nicoli; aussi la lui accorda-t-il toute entière.
Cependant, au milieu de la joie qu’avait causée cet incident étrange, le planteur seul était soucieux et chagrin. Le soir même de cette journée, il partit pour Orannes, accompagné de sa femme, qui paraissait profondément affligée; le lendemain, ils arrivèrent dans la maison de leur mère. En les apercevant, Gaston courut au-devant d’eux, et se jeta à leurs genoux en leur demandant pardon. M. Norbert releva son fils avec une froideur pleine de dignité.
«Je ne vous ferai aucun reproche, monsieur, lui dit-il sans colère: après la faute vient la punition; c’est de toute justice; la vôtre sera donc de vous embarquer à bord de l’Alcyon, vaisseau qui part, dans trois jours, pour Cayenne, et d’y rester jusqu’à l’époque de son retour, qu’on suppose devoir être dans un an.
—Je suivrai, sans murmurer, les ordres de mon père, répondit humblement Gaston; j’ai eu l’infamie de commettre une faute; j’aurai le courage de me soumettre à l’expiation.»
Quelques jours après, un vaisseau quittait le port de la Pointe-à-Pitre; M. et madame Norbert pleuraient sur le rivage, tandis que leur fils agitait son mouchoir en signe d’adieu!...
Gaston ne revint que deux ans après; mais l’enfant coupable et jaloux était devenu, pendant ce trajet, un excellent ami et un jeune homme irréprochable.

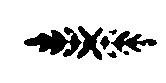
Lord Oswald et sa femme, lady Helena, prenaient le thé dans un riche salon de leur château de Northumberland, dont les fenêtres donnaient sur la terrasse fleurie du parc. C’était par un beau jour de printemps; là, une troupe d’enfants se livrait aux mille jeux de leur âge, et parmi eux leurs seigneuries suivaient surtout d’un regard caressant leur fils, jolie créature de huit ans, aux cheveux blonds bouclés en longs anneaux, aux fraîches couleurs, aux yeux d’un bleu pur et transparent; il leur semblait qu’aucun de ces enfants des nobles familles d’alentour ne pouvait être comparé à leur Arthur. Cette préférence était si naturelle chez lady Helena! Arthur avait donc été gâté par une aveugle prédilection; il s’était habitué à croire que toutes choses devaient aller selon sa volonté; il avait des caprices, des actes de colère; il prétendait exercer une certaine domination sur ses camarades: notre petit despote se jugeait fort au-dessus d’eux. Souvent, par orgueil, il refusait de les accompagner, de se mêler à leurs jeux. Une de ses manies, la plus funeste peut-être, c’était de réclamer la possession entière, et sans partage, de ce qu’on avait offert en même temps à lui et à ses jeunes amis, et de s’écrier aussitôt: Tout pour Arthur!
D’abord on avait donné le nom de gentillesse à cette preuve d’égoïsme; mais cette exclamation, trop souvent répétée, éveilla l’attention de mistriss Cowley, gouvernante de l’enfant: celle-ci s’entretint, à ce sujet, avec lord Oswald et milady. Il fut convenu qu’Arthur serait réprimandé; mais déjà le pli était pris, et les leçons de la gouvernante furent à peu près perdues.
Au moment où commence ce récit, lord Oswald attachait donc sur son fils un regard de satisfaction; il fut témoin d’une scène dont le sens ne lui échappa point. Le jardinier, pour se rendre agréable à son jeune maître, s’avança, un énorme bouquet de fleurs à la main, et l’offrit à Arthur; celui-ci le remercia d’un air assez dédaigneux, et se disposa à rentrer au château: ses camarades lui ayant demandé chacun une part de roses, de pensées et d’œillets, il les repoussa en leur signifiant que tout lui appartenait. Alors les enfants se fâchèrent; il y eut une querelle, et par suite une courte lutte dans laquelle Arthur devait avoir le dessous. Entouré, assailli, il laissa tomber le bouquet, qui fut à l’instant même divisé aux cris de joie des vainqueurs. La vigilante mistriss Cowley s’était élancée, au premier bruit, vers le champ de bataille. Elle n’arriva que pour assister à l’humiliation d’Arthur, et l’entendre dire à travers ses sanglots: «Ils m’ont battu, ma bonne; ils m’ont pris mes fleurs.» Mais, loin de chercher à le consoler, celle-ci lui répondit: «Eh bien! monsieur, vous n’avez que ce que vous méritez.—Moi!—Oui, vous qui oubliez constamment les autres, pour ne songer qu’à vous. Aviez-vous besoin de tant de fleurs?... Où les eussiez-vous mises?—Dans ma chambre.—Où elles se fussent bientôt fanées. Allez, monsieur, vous vous ferez détester de vos camarades; ils resteront chez leurs parents, et alors vous resterez tout seul!»
Arthur, se redressant avec orgueil, répondit: «Je serai seul!... Eh bien! peu m’importe.
—Ah! vous serez seul! peu vous importe. Vous ne savez donc pas qu’il n’est rien de plus triste que la solitude.
—Ah! tu crois que j’ai besoin de petits camarades pour m’amuser... point du tout... je serai seul... je veux être seul... Ils seront bien attrapés.»
La gouvernante ne prolongea pas cet entretien; mais elle alla rendre compte à lord Oswald de tout ce qui s’était passé. Au bout d’une heure, elle sortit du salon: à son air animé, il était aisé de pressentir qu’une prompte résolution venait enfin d’être prise par les parents d’Arthur.
Le lendemain, Arthur, en s’éveillant, fut bien surpris de se trouver dans une chambre qu’il ne connaissait pas, de voir pendre du baldaquin de son lit des rideaux de perse lilas au lieu des rideaux blancs qui d’ordinaire protégeaient son sommeil: des jouets nouveaux garnissaient les meubles. Tout offrait à l’enfant des sujets d’étonnement; il ne savait plus où il était et s’il ne rêvait pas. Dans son angoisse, il appela; un domestique entra.
«Ah! c’est vous, Jack!... Dites-moi donc si on n’a pas emporté ma chambre?
—Monsieur Arthur, mylord est parti hier pour Londres.
—Pour Londres... Et il m’a laissé ici!...
—Il a dit que vous aimiez autant rester seul, et a donné des ordres pour que vous ne manquiez de rien.
—Et maman?
—Partie aussi.
—Sans embrasser son enfant!...
—Elle reviendra bientôt.
—A la bonne heure... Aide-moi à m’habiller, Jack; il faut que je rejoigne mes camarades.
—C’est inutile, monsieur Arthur; ils ne reviendront plus.
—O mon Dieu!
—Non; vos parents ont voulu les punir de vous avoir maltraité. Désormais tout sera pour vous sans partage.
—Eh bien! tant mieux... Puisqu’ils sont méchants, ils resteront chez eux à s’ennuyer... et moi je m’amuserai tout à mon aise... Mais, tu ne m’as pas dit où je suis?
—Dans le grand pavillon chinois. Mylord a ordonné que désormais il vous servit de demeure. On a meublé avec soin ce pavillon, et on vous y a transporté pendant votre sommeil, afin de vous ménager une surprise agréable. Tout ce qui est ici vous appartient.
—Et ma gouvernante?
—Elle vous attend dans la salle à manger.
—Allons la retrouver.»
Mistriss Cowley reçut son jeune élève avec dignité, et lui indiqua un siège, tandis qu’elle restait debout. Comme il en exprimait son étonnement, elle répondit que désormais il prendrait tout seul ses repas. Mylord avait commandé qu’il en fût ainsi pour faire plaisir à son fils.
Arthur ne répliqua rien, et déjeuna assez tristement, bien qu’il affectât de la gaîté, de l’insouciance; ensuite il rentra dans sa chambre et se mit à examiner les objets nouveaux dont il était entouré, en répétant machinalement, par habitude: «Tout pour Arthur!» Il poussa quelques cris d’allégresse à la vue de jouets magnifiques; mais, après avoir tourné et retourné ces élégantes babioles, considéré de tous côtés ces figures de carton, ces maisons de bois, et disposé avec une savante tactique ses soldats de plomb, il sentit venir la satiété. Ce qui l’avait amusé d’abord, lui parut monotone. Il sema sur le parquet de la chambre les jouets à moitié brisés, en les suivant dans leur chute d’un regard distrait. Qu’il eut été heureux, en ce moment, d’entendre un petit camarade lui dire, sur le ton de la convoitise: «Oh! que tu as de jolies choses!» Mais il était seul... seul!
Pour échapper à l’ennui qui le dominait, Arthur se coiffa de sa casquette de velours, ouvrit la porte et descendit, en courant, dans le parc. Le temps était superbe; un léger souffle agitait le feuillage avec de doux murmures; l’herbe, humectée par la rosée, avait une senteur exquise: aussi l’enfant ressentit d’abord une impression délicieuse du spectacle que lui offrait la nature. Jamais peut-être il n’avait apprécié si bien le panorama de ces allées ombreuses à l’extrémité desquelles apparaît la lumière, le bleu du ciel. Descendant en lui-même, il se reprochait de n’avoir pas été jusqu’à ce jour assez reconnaissant envers un Dieu qui prodigue tant de trésors à l’homme. Mais son défaut favori ne tarda pas à lui inspirer de nouveau ces paroles empreintes d’orgueil: «Tout cela sera pour Arthur!»
Cependant, à force de se promener, il commença à trouver les allées un peu longues. S’il avait eu avec lui quelques-uns de ses petits camarades, quelle jolie partie de barres il eût pu faire!... Aussi, sans regarder davantage les ravissants objets qui l’entouraient, il se mit à marcher au hasard. Comme il approchait d’une des grilles du parc, un bruit de voix attira son attention; il leva la tête et aperçut deux jeunes garçons, dont l’un, âgé de treize à quatorze ans, s’était assis sur le rebord du mur d’enceinte et avait déposé à ses pieds un gros paquet, tandis que le second, enfant de dix ans au plus, s’ébattait sur l’herbe et poussait des cris joyeux. L’aîné salua poliment le petit gentilhomme, et lui dit: «Est-ce à vous, monsieur, ce jardin-là?
—Ce parc, s’il vous plaît.
—Un parc... un jardin... ça revient au même; des arbres, du gazon, un peu plus, un peu moins...
—Oui; mais remarque cette étendue; quelle vaste pelouse!...
—Ah bah! regardez de ce côté, il y en a bien davantage. Votre parc danserait dans la forêt voisine.»
Arthur sentit la rougeur lui monter au front, et s’écria d’une voix émue: «Est-ce que tu t’es placé là pour m’insulter?»
Le jeune villageois, le considérant avec étonnement, prit son paquet en silence et se disposait à s’éloigner, quand le fils de lord Oswald s’avança et le retint, en lui disant: «Faisons la paix et reste ici... C’est, sans doute ton frère qui joue sur le gazon?
—Oui, monsieur.
—Et où sont tes parents?
—Des parents, répéta tristement l’enfant du peuple, nous n’en avons plus.
—Déjà!... Pauvre garçon!
—Ah! que c’est pénible d’être orphelin! Priez Dieu pour qu’il vous conserve votre père et votre mère... Des parcs comme celui-ci, dont vous êtes si fier, on peut en avoir tant qu’on en veut pour son argent; mais des parents qu’on chérit, ça ne se donne pas deux fois... et quand on ne les voit plus qu’en souvenir, on pleure souvent, allez!»
Et tirant son mouchoir, John Osburn essuya quelques larmes; mais il réprima ce mouvement d’émotion en voyant que son frère le regardait d’un œil inquiet. Affectant même une expression de gaîté, il ajouta: «C’est égal, Dieu nous a bénis, et ni mon frère ni moi ne manquons de rien.»
Arthur, qu’intéressait vivement celte conversation, examina plus attentivement son interlocuteur, et remarqua, en effet, que celui-ci avait une veste et un pantalon neufs, des souliers solides, et que l’autre enfant était proprement vêtu. Il ne put s’empêcher de témoigner son étonnement: «Si vos parents ne vous ont pas laissé de fortune, comment pouvez-vous exister?... Est-ce qu’on travaille à votre âge?—Si l’on travaille! s’écria John; c’est bon pour des mylords comme vous de se promener; mais, moi, je suis occupé toute la journée, et lorsque le soir je me mets au lit, je l’ai bien gagné.—Pourquoi ne vous reposez-vous pas?—Me reposer! en ai-je donc le temps? obligé de faire subsister mes deux frères, celui-ci et un autre plus petit qui va à l’école... Quand notre maman fut près de nous quitter, elle m’appela, et dit: «John, mon ami, tu es déjà grand et fort, tu n’as jamais été paresseux, deviens le protecteur de ta famille, élève et nourris Philips et Richard; songe qu’ils n’auront que toi au monde pour les aimer, puisque je n’y serai plus...» O monsieur! je lui promis d’exécuter ses volontés, et j’ai tenu mon serment. A la fabrique où je travaille, on me paie bien, et mes frères sont heureux.—Quoi! tu leur apportes tout ce que tu gagnes?—Tout, c’est le mot. J’achète tantôt à l’un une veste, tantôt à l’autre une casquette.—Et pour toi?—Pour moi... s’il en reste.—Ainsi tu ne gardes rien?—Est-ce que je ne jouis pas de tout ce que peuvent avoir Philips et Richard?—Allons, tu es un brave garçon, et je parlerai de toi à papa...—Laissez donc, mon jeune monsieur, votre père n’a pas le loisir de penser à moi; et vous-même, avant cinq minutes, vous m’aurez oublié... Mais il est déjà tard. Viens, Philips, partons.»
Puis, rejetant son paquet sur l’épaule et prenant la main de son frère, il s’éloigna d’un pas rapide, après avoir adressé, de la tête et du regard, un salut à Arthur.
Celui-ci revint tout pensif à son pavillon; il n’y entra qu’avec répugnance, certain de n’y rencontrer aucun visage ami. Déjà une métamorphose s’était opérée en lui. Ainsi, au lieu de se soustraire désormais aux graves leçons de mistriss Cowley, il alla la trouver, et la pria de causer avec lui. Mistriss Cowley ne parut pas s’apercevoir de ce changement, et elle ne mit aucune affectation à vanter la conduite du petit paysan, lorsqu’Arthur lui eut appris la rencontre qu’il venait de faire. L’enfant s’animait au contraire de plus en plus, et disait: «Quoi! ma bonne, vous n’admirez pas ce pauvre John qui nourrit ses deux frères!—C’est son devoir, puisqu’il est le plus grand, le plus fort. Est-ce que vous n’auriez pas été capable d’un pareil dévouement?»
Arthur rougit et balbutia. La gouvernante reprit: «Comment admirez-vous le courage de ce John, vous qui n’êtes pas reconnaissant de l’amitié que vous portent vos camarades? Comment approuvez-vous les sacrifices de cet enfant et les privations qu’il s’impose, vous qui désirez tout posséder, tout garder? Vous comprenez donc enfin, mon ami, qu’il y a du bonheur à vivre pour les autres?»
Le fils de lord Oswald répondit d’un ton enjoué: «Méchante! vous me grondez; mais je veux me corriger.—Vous corriger!... Déjà vous l’avez promis.—Je tiendrai ma promesse.—C’est ce qu’il faudra voir.—Certainement... Et, d’abord, je vais ordonner à Jack d’aller chercher mes camarades... Ils passeront ici le reste de la journée, et lorsqu’ils s’en iront, je leur donnerai tous mes beaux jouets.—C’est inutile.—Pourquoi donc?—Ils sont fâchés, et ils ne reviendront plus...—Quoi! je serai toujours seul, et ils joueront sans moi?—Oui, parce que vous avez été égoïste avec eux.»
En entendant ces paroles, Arthur ne put contraindre son chagrin; des larmes abondantes coulèrent de ses yeux: cependant, par un reste de cette fierté mal placée qui formait le fond de son caractère, l’enfant se leva et courut se réfugier dans sa chambre. Mistriss Cowley jugea nécessaire de le laisser livré à ses réflexions; mais elle recommanda à Jack de veiller attentivement sur son jeune maître, et de pourvoir à tous ses besoins.
Plusieurs jours s’écoulèrent. Arthur demandait sans cesse à sa gouvernante si ses parents seraient bientôt de retour. Sa promenade favorite était le côté du parc où il avait rencontré John. Mais en vain cherchait-il du regard le petit ouvrier; celui-ci était trop occupé pour prendre l’air des champs. Indifférent à tous les jeux, Arthur se mit donc à étudier sans relâche, afin do surprendre agréablement son père.
Enfin un matin, à son réveil, il fut fort étonné de se retrouver transporté, comme par magie, dans son ancienne chambre. Ses parents étaient là qui le contemplaient. Il jeta un cri de joie et tendit les bras, en disant, avec une profonde émotion:
«Oh! vous voilà enfin!... Je ne serai plus seul!
—Mais il me semble, répondit lord Oswald, que tu te plaisais à vivre ainsi, et que nos conseils ne te profitaient guère.
—C’est vrai, je l’avoue; à présent je suis changé... Grondez-moi, punissez-moi quand je serai coupable, je ne me plaindrai pas.
—Mais si tu éloignes encore tes camarades par ton orgueil...
—Qu’ils reviennent... je serai bien heureux. N’est-ce pas, ma bonne mistriss Cowley, qu’il faut qu’on me pardonne?
—Certainement, dit la gouvernante... Il a promis solennellement de ne plus recommencer à mécontenter ses excellents parents, à tyranniser ses amis; et, d’abord, il ne répétera plus comme autrefois: «Tout pour Arthur!»
—Non, excepté si ceux qui m’aiment devaient souffrir.»
Lord et lady Oswald embrassèrent leur fils avec effusion.
—————
Douze ans après, un jeune et brillant lieutenant de vaisseau, qui s’était distingué dans un combat naval, rentrait au même château; il montrait avec une noble joie à ses parents un brevet de capitaine, et il leur disait: «Si j’ai obtenu cette récompense, dont vous êtes fiers, c’est qu’au moment de l’abordage, payant de ma personne, et insensible aux dangers qui m’entouraient, pourvu que je sauvasse mon équipage, je me suis écrié intérieurement: Tout pour Arthur!»
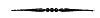
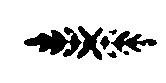
Le soleil, qui commençait à s’élever à l’horizon, lançait ses rayons dorés sur les vertes prairies d’un délicieux village de la Picardie; de légers nuages parcouraient le ciel sous mille formes gracieuses; la journée promettait d’être pure et belle... et cependant toutes les chaumières du village étaient tristes et silencieuses; un air de vague inquiétude et quelquefois d’anxiété profonde se peignait sur tous les visages. Eh! pourquoi cette morne tristesse? pourquoi ces larmes maternelles? c’est que, la veille, un long roulement de tambour avait retenti au cœur de tous les pauvres habitants consternés; c’est qu’à ce rappel de sinistre augure les jeunes gens du village s’étaient rassemblés sur la grand’place, et que dans quelques jours un grand nombre d’entre eux allait partir à l’armée pour donner à Napoléon de jeunes et braves soldats. Ils allaient donc partir, peut-être, hélas! pour ne plus revenir au foyer où tant de fois ils s’étaient assis dans l’insouciance et la joie. Toutes ces existences, remplies d’avenir et de bonheur, n’appartenaient plus à leurs familles. Pauvres mères!...
Dans une des plus misérables chaumières de ce village, un vieillard infirme et malade était couché sur un lit de douleur. Une paralysie cruelle l’avait, depuis de longues années, condamné à la souffrance; et pourtant, jusqu’à ce jour, il s’était soumis avec résignation à cette triste existence: il avait traversé toutes les épreuves d’une longue vie rude et pénible sans plaintes ni murmures. Sa femme et son fils savaient le consoler, le soutenir par leurs travaux au milieu de ses infortunes; il se trouvait encore heureux quand le soir les réunissait tous trois autour de leur triste foyer. Mais maintenant le malheureux vieillard ressentait toute l’horreur de sa position; son visage était inondé de larmes, car son fils bien-aimé, leur unique appui, allait partir, les quitter à jamais. Quant à la pauvre mère, elle cherchait à cacher ses angoisses pour ne pas affliger son enfant; mais elle le couvrait de caresses, elle le pressait sur son cœur en attendant avec effroi le moment fatal qui les devait séparer.
Hélas! ce signal redouté ne se fit pas attendre. Alors le bon vieillard attira vers lui son cher enfant, et lui dit d’une voix entrecoupée par les sanglots:
«Mon fils, tu vas partir; te voilà forcé d’abandonner ton vieux père que tu ne retrouveras plus au retour; pense souvent à lui, à ta bonne mère! que leur image te fasse au moins supporter la douleur d’une séparation si affreuse. Sois pieux, sois brave; souviens-toi que, si tu es vertueux, la Providence ne t’abandonnera jamais; n’oublie pas que tu laisses au village un père infirme, une tendre mère qui prieront Dieu pour toi.»
Puis étendant ses mains sur son fils, le vieillard lui donna sa bénédiction.
L’heure du départ avait sonné. Pierre, le cœur gros de chagrin, les yeux baignés de larmes, embrassa son vieux père qui lui disait adieu; puis, après avoir jeté un dernier regard à tout ce qu’il aimait dans la chaumière, il quitta le village, et sa pauvre mère le suivit jusqu’au bord du chemin. Là, elle lui dit adieu à son tour, s’arracha de ses bras; car le malade avait grand besoin aussi de la revoir et d’être consolé.
«Que Dieu te bénisse du haut du ciel comme je te bénis sur la terre, mon fils; qu’il veille sur toi, afin qu’un jour tu reviennes embrasser les vieux habitants de la chaumière!»
Pierre, pour une dernière fois, embrassa sa mère, puis il prit sa course devant lui, d’un pas précipité et sans se retourner; en effet de grosses larmes mouillaient ses yeux.
Cette pauvre mère! elle resta longtemps à la place même que venait de quitter son fils; toujours elle attendait un dernier regard... mais Pierre ne se retourna pas.
Les jours, les mois s’écoulèrent, jours et mois d’affliction, de tristesse, de poignante misère, et jamais un mot, un seul ne vint consoler la mère du jeune conscrit. Ses journées se passaient dans les larmes; ses nuits étaient sans sommeil. La mort lui avait récemment enlevé celui que, depuis tant d’années, elle entourait de sollicitude et d’amour; il reposait sous la croix noire du cimetière. Il ne lui restait donc plus, dans sa détresse, d’autre espoir de consolation et de salut que dans le retour de son fils, de son Pierre bien-aimé; et cependant pouvait-elle espérer qu’il fût encore de ce monde? En partant, ne lui avait-il pas dit: «Bonne mère! ne crains rien pour moi, je t’écrirai, je t’écrirai... sois-en bien sûre.» Et, depuis son départ, nulle lettre de Pierre n’était venue au village.
Quand la triste veuve apprenait que les armées de Napoléon avaient remporté une victoire nouvelle, à la suite de sanglants combats, combien son cœur était saisi d’effroi! que de cruelles tortures déchiraient son cœur!... Dans l’égarement de son désespoir, elle ne cessait de répéter:
«O mon fils! mon pauvre Pierre, ils t’auront tué; tu es loin de moi, je ne te reverrai plus. Mon Dieu! mon Dieu! puisque vous avez rappelé mon fils à vous, je n’ai plus qu’à mourir.»
Un jour, de grands cris retentirent au village; les jeunes gens se pressaient, avec une joie bruyante, autour de deux soldats qui revenaient en chantant au toit paternel; tous ils demandèrent ce qu’étaient devenus leurs amis, leurs camarades; puis accoururent les mères aussi... Celle de Pierre, épuisée de souffrances, vint à son tour, et presque mourante, se précipiter au milieu de la foule pour demander son fils. Hélas! il était mort, bien mort. Le morne silence qui succéda à ses questions, ne lui apprit que trop que le malheureux Pierre avait été rejoindre son père.
«Oh mon Dieu! s’écria-t-elle alors en tombant à deux genoux et tendant vers le ciel ses mains amaigries et tremblantes, ne m’abandonnez pas; cette dernière épreuve est au-dessus de mes forces... Pierre!... mon fils!... mort!... mort!... ô mon Dieu!...»
Elle achevait à peine ces mots que l’infortunée tomba soudain la face contre terre; et quand on s’empressa autour d’elle pour la relever, elle n’était plus. L’une de ses mains serrait encore avec force un petit médaillon où se trouvait renfermée une mèche de cheveux noirs: c’étaient ceux du pauvre Pierre.
FIN DU VOLUME.
Note de Transcription
Les mots mal orthographiés et les erreurs d’impression ont été corrigées. Lorsque plusieurs orthographes se produisent, l’utilisation de la majorité a été employé.
Ponctuation a été maintenue sauf si évidente erreurs d’impression se produisent.
Certaines illustrations ont été déplacées pour faciliter la mise en page.
Une couverture a été créée pour ce livre électronique et est placée dans le domaine public.
[The end of Le Dimanche des Enfants-Tome 04 by Various]