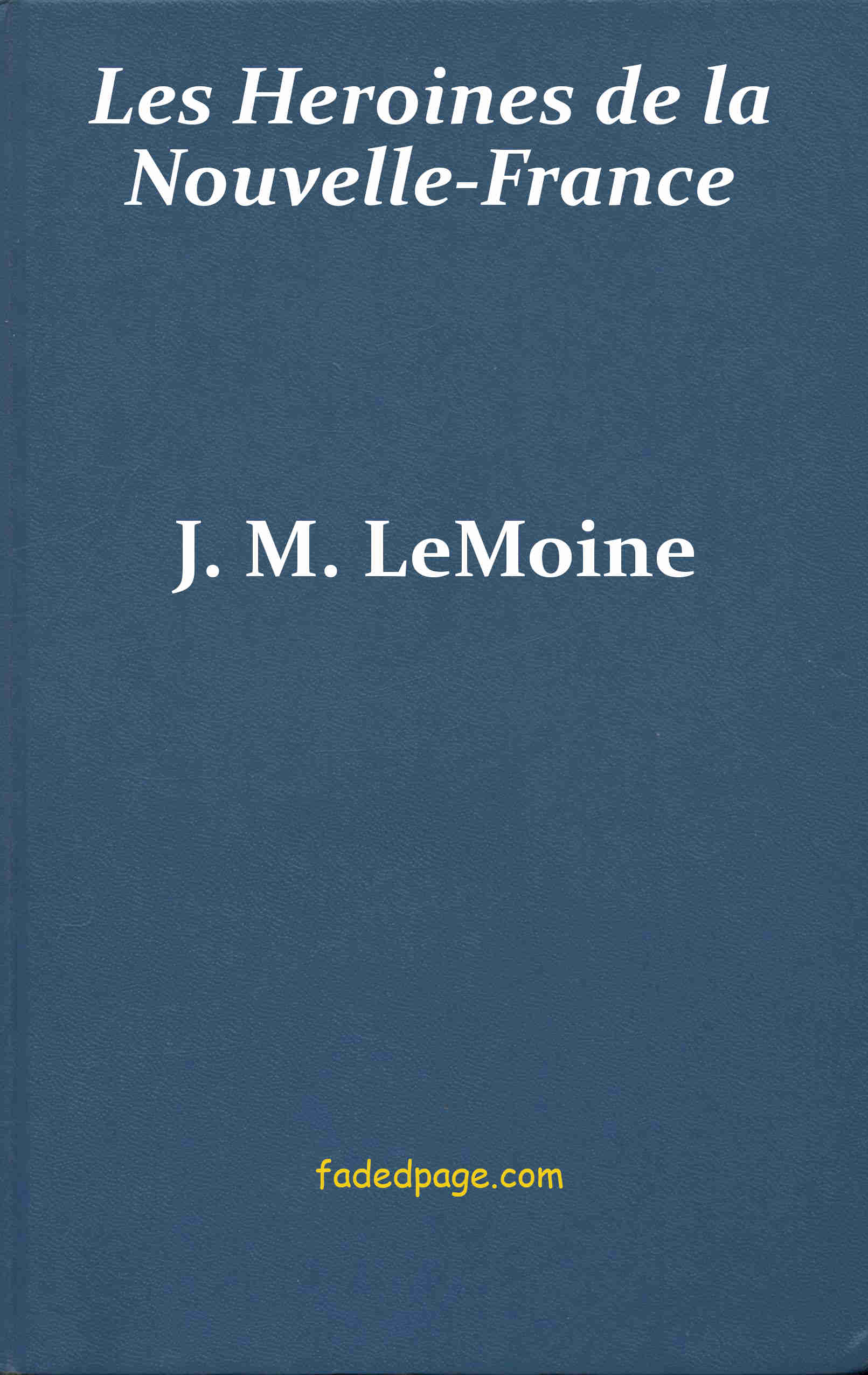
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: Les Heroines de la Nouvelle-France
Date of first publication: 1888
Author: J. M. (James MacPherson) LeMoine (1825-1912)
Date first posted: Jan. 22, 2023
Date last updated: Jan. 22, 2023
Faded Page eBook #20230135
This eBook was produced by: John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
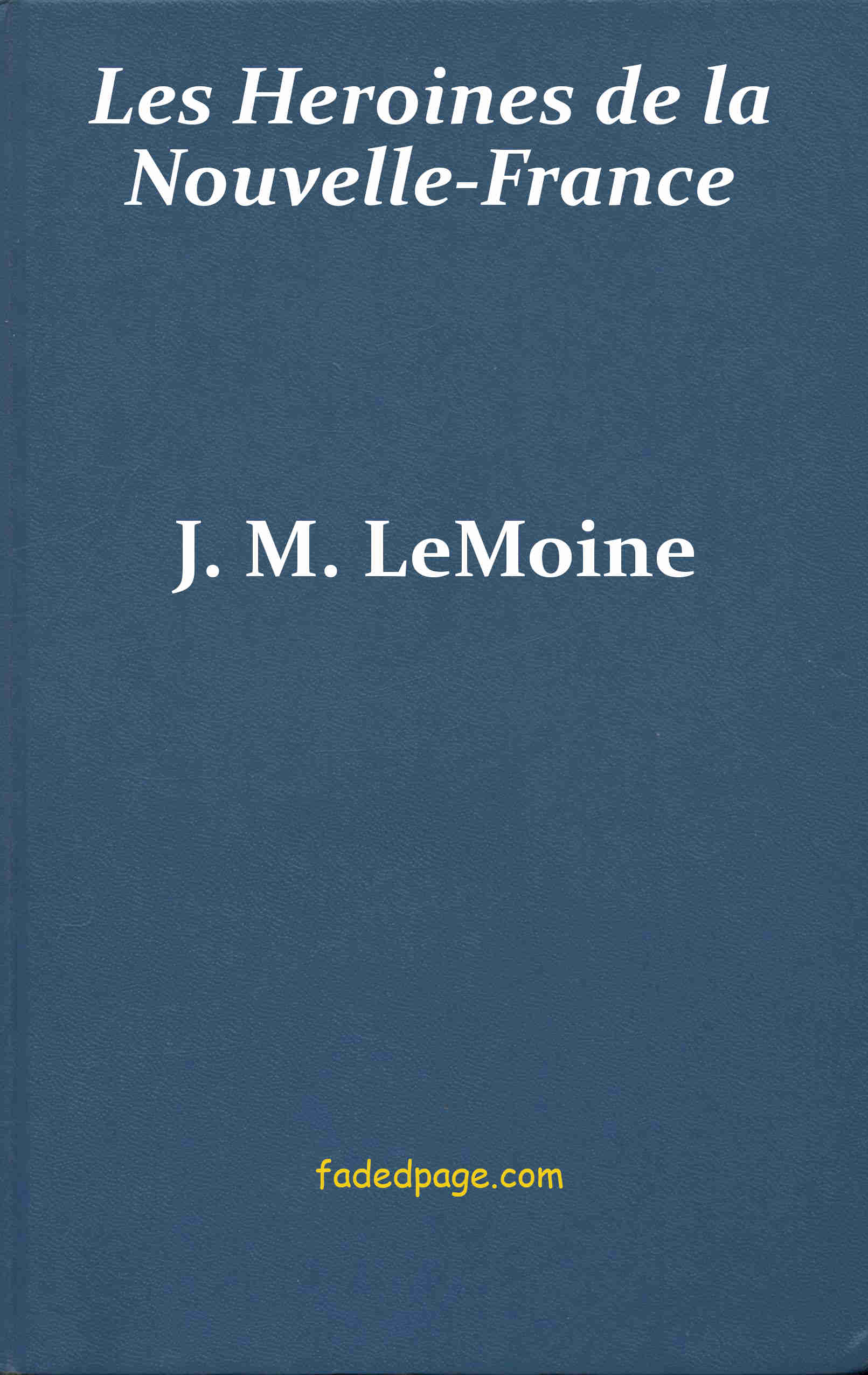
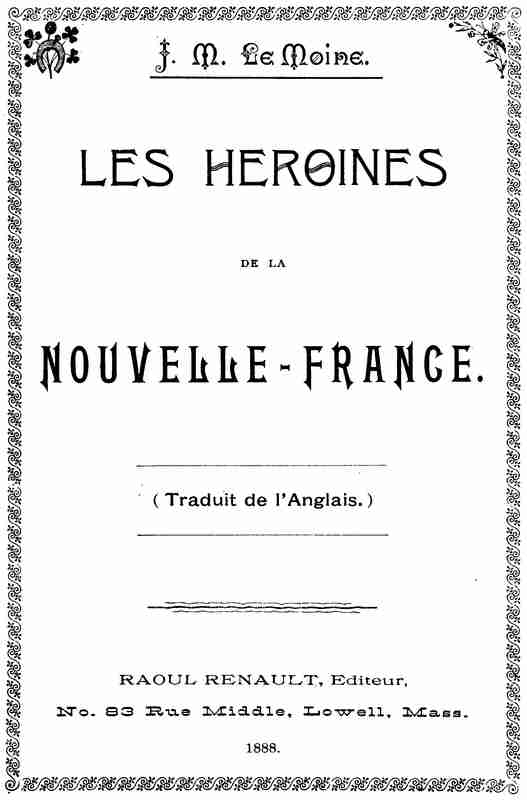

Nous présentons à nos compatriotes du Canada et des Etats-Unis, la traduction d’un intéressant travail de M. James McPherson LeMoine, de Québec: “Les Héroïnes de la Nouvelle-France.”
Il nous est inutile de faire ici l’éloge de M. LeMoine. Ses productions littéraires et historiques parlent d’elles-mêmes. Grâces à ses incessantes recherches, plusieurs points ignorés de notre glorieuse histoire ont été élucidés.
Nous espérons que l’accueil que nos compatriotes feront à cet opuscule, ne decevra pas nos espérances.

Lowell, Mass., Décembre, 1888.
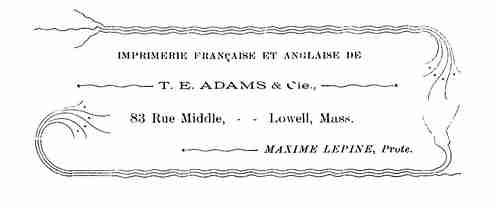
Les Héroïnes de la Nouvelle-France
Si j’avais à vous entretenir sur le patriotisme de De Longueil; sur les actions valeureuses de ses dignes frères, d’Iberville et de Ste. Helene; sur le dévouement surhumain de Dollard des Ormeaux et de sa spartiate bande de héros; si j’avais à vous faire admirer le zèle évangélisateur des Pères Jogues, de Brebœuf et Lallemand; l’héroïsme du vieux comte de Frontenac répondant à l’amiral Phipps par la bouche de ses canons, aussi bien que d’autres preux dont les carrières constituent, suivant l’heureuse expression d’un de nos estimés gouverneurs, Lord Elgin, “l’ère héroïque du Canada,” ma tâche serait facile et les matériaux nombreux.
Le fécond mais silencieux passé est rempli de grandes figures qui illustrent notre drame historique; il fourmille d’hommes qui se sont distingués pendant leur vie et sont morts dans la gloire.
Mais mon but n’est pas de vous raconter les prouesses des hommes que nous trouvons burinées dans les premières pages de notre histoire. Je veux simplement vous relater quelques épisodes mettant en lumière trois des plus pures, des plus braves et des plus dévouées femmes qui aient illustré la première période de nos annales historiques.
Nous avons chez nous, de même qu’il s’en trouve chez d’autres peuples, de ces femmes qui ont laissé l’empreinte de leur pied sur le sable des temps.[2]
|
Cette conférence a été publié: dans les canadian leaves, recueil des lectures données devant le Canadian Club, en janvier 1887, et compilées par M. Geo. M. Fairchild, Jr., de New-York. |
|
Who have left their footprints on the sand of time. |
Une des premières qui apparaît dans nos glorieuses annales est la compagne de l’intrépide fondateur de Québec, Hélène Boulle, la jeune femme à laquelle Champlain fut uni, et qui vint, en 1620 égayer les habitants de la solitaire et sauvage Nouvelle-France.
C’est le 5 décembre 1610 que Champlain épousa mademoiselle Boullé, dont le père Nicolas Boullé, était secrétaire de la maison du roi. Elle n’était alors que dans sa douzième année, et avait été élevée dans les croyances calvinistes, la religion de son père. Sa mère, Marguerite Alice, d’abord catholique, avait épousé les croyances de son mari. Mais nous verrons plus tard que la jeune Hélène ne tarda pas à embrasser le catholicisme et devint un modèle de piété.
Dame Rumeur insinuait dans le temps que l’audacieux fondateur de Québec n’avait pas seulement obtenu la main d’une belle et noble française mais aussi le cœur d’une héritière. Quatre mille cinq cents livres de sa dot de six mille furent immédiatement mises à la disposition de l’époux pour l’armement de ses vaisseaux.
Cependant, il appert qu’avant son arrivée à Québec, la jeune femme ne vit que très peu son mari, qui était constamment absent; soit qu’il naviguât dans des mers éloignées, soit qu’il fût en explorations ou qu’il combattît contre les Indiens.
Champlain passa deux années en France, et s’étant défait de tout ce qu’il possédait, il engagea sa femme, qui avait alors atteint sa vingt-deuxième année, à l’accompagner au Canada. Ce à quoi elle consentit gaîment, en amenant avec elle trois dames de compagnie.
Grande fut la joie de la petite colonie au retour de leur brave gouverneur, de leur puissant protecteur; immense fut l’admiration qu’inspirât l’aimable et toujours souriante femme qui l’accompagnait.
La première femme qui ait foulé le sol du Canada comprit bientôt ce que c’était que vivre à Québec en 1620.
C’était alors pour les colons une vie d’alarmes incessantes, accompagnée de scorbut et de famines périodiques; de scènes de gloutonnerie et de débauches de la part des sales et grotesques sauvages campés aux environs du fort.
Deux ans après l’arrivée de Champlain dans la colonie, une nombreuse bande d’Iroquois fit son apparition aux alentours de Québec. La crainte salutaire du mousquet de Champlain, dont ils avaient encore souvenance, les empêchait seule de faire incursion dans la ville.
Un jour que Champlain et la plupart de ses hommes étaient absents, le cri de guerre fut lancé; les femmes et les enfants s’enfermèrent dans le fort; le couvent des Récollets, sur les bords de la rivière St. Charles fut attaqué.
Jugez de la stupeur de la gentille femme de Champlain, laissée seule dans le fort avec ses compagnes.
Pendant quatre hivers consécutifs, les colons eurent à subir les horreurs des tempêtes et le voisinage immédiat des sauvages, et néanmoins Madame de Champlain resta toujours ferme au poste du devoir.
Une de ses occupations favorites était de pourvoir aux besoins spirituels et temporels des enfants sauvages et de les visiter dans leurs wigwams.[1] Bientôt elle devint presqu’un dieu aux yeux naïfs et reconnaissants des sauvages, et ils étaient portés à lui vouer une espèce de culte.
L’histoire fait mention des charmes de sa personne et de sa bonté affectueuse.
Dans ces courses à travers la forêt, elle portait ordinairement un article de toilette qui n’est plus de mode de nos jours: un petit miroir pendu au côté. Les sauvages prenaient un vif plaisir à regarder leur figure basannée se réfléchir dans la glace magique. L’effet de réflexion produit par le petit miroir leur faisait dire tout naïvement: “Une femme aussi belle, qui prend soin de nous pendant nos maladies, et qui nous aime tant qu’elle porte notre image tout près de son cœur doit être plus qu’une créature humaine.” Les bénédictions et les présents l’attendaient chaque fois qu’elle rendait visite aux aborigènes.
La candide figure de la première dame canadienne rayonnant, sans faste, au sein des solitudes du St. Laurent, il y a plus de deux siècles, et y répandant une atmosphère radieuse, n’est-ce pas là un tableau digne d’un grand peintre, et que la poésie devrait immortaliser comme modèle de vertu, de pureté, d’abnégation?
Les alarmes quotidiennes, la solitude, l’isolement commencèrent à désenchanter la solitaire châtelaine. Quatre années d’existence dans cette morne solitude étaient trop pour la noble dame habituée aux charmes des salons parisiens. Elle avait hâte de retourner à Paris.
Dans ces rêves, elle entrevoyait une autre solitude: la mystique solitude du cloître où loin des agitations du monde, elle pourrait adresser ses prières au Tout-Puissant pour son mari absent.
Par une belle matinée du mois d’août 1624, (le 15,) tout Québec regardait à regret s’éloigner la barque à la blanche carène emportant dans ses flancs, vers des pays moins monotones, la captive mise en liberté.
Dix-neuf ans après la mort de son époux, Madame de Champlain fondait à Meaux, en France, un couvent des sœurs de Ste. Ursule où elle se retira.
Le 20 décembre 1654, elle laissa ce monde pour aller rejoindre là-haut, espérons-le, celui qui avait été son compagnon sur cette terre. Elle avait alors cinquante-six ans.
|
Wigwams, cabane ou hutte où logent les sauvages. |
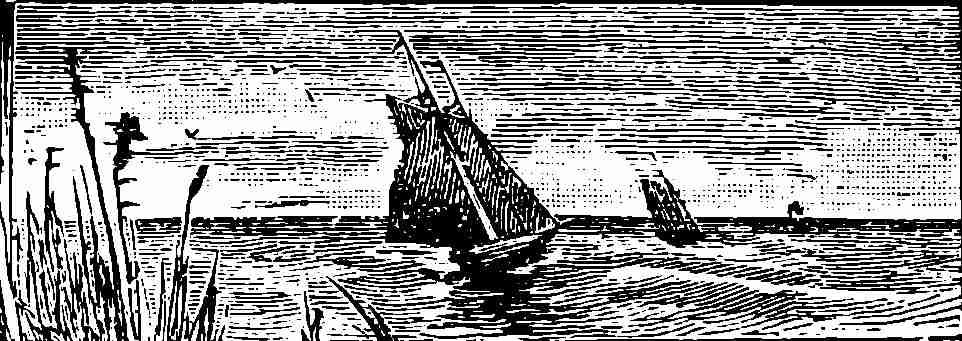
Transportons-nous des hauteurs de Stadacona à la sauvage mais fertile terre à laquelle Longfellow a donné un charme impérissable: l’Acadie, maintenant la Nouvelle-Ecosse.
Deux cents ans avant que les champs de blés dorés de Grand Pré émurent le cœur du poête Américain, vécut, aima et mourut sur les rives historiques de la rivière St Jean, au fort St Louis, une dame française accomplie, connue dans l’histoire sous le nom de Madame de La Tour.
Claude de St Etienne, sieur de La Tour, était allié à la noble maison de Bouillon, mais il avait perdu la majeure partie de ses biens dans les guerres civiles. Il vint en Acadie vers 1609 avec son fils, Charles, alors âgé de quinze ans.
Charles, après la destruction de Port-Royal par Argall, devint l’ami intime de Biencourt et vécut avec lui, menant tous deux une vie libre et inconsciente.
Biencourt réclamait des droits importants dans Port-Royal. A sa mort, il légua ses droits au jeune Huguenot, Charles de La Tour et le nomma son lieutenant et successeur dans le gouvernement de la colonie. Il ne pouvait pas choisir un plus intrépide et entreprenant chef.
En 1625 ou vers ce temps-là, Charles de La Tour épousa la jeune femme dont je veux vous exquisser la carrière.
Peu de temps après son mariage, il établit ses quartiers à un fort qu’il avait érigé près du cap Sable. Il avait nommé ce refuge fort St Louis, et il avait l’intention d’en faire un dépôt sûr et convenable pour la traite avec les sauvages.
Vers cette époque, les colons Français effrayés de leur petit nombre et de leur faiblesse en cas d’agression étrangère, envoyèrent en France Claude de La Tour, père de Charles, pour représenter au gouvernement l’état de leur force et demander du renfort. Comme celui-ci s’en revenait avec des munitions destinées à Québec et à Port-Royal, son escadre et la flotte de Roquemont furent capturées, en 1628, par sir David Kirk, et Claude de La Tour fut fait prisonnier et envoyé en Angleterre.
Loin de perdre courage, il semble avoir utilisé sa captivité à poursuivre ses fins.
Huguenot marquant, il fut très-bien vu par les huguenots Français qui, exilés de leur propre pays, avaient cherché un refuge à Londres. Le monarque anglais les considéraient comme d’utiles alliés.
Claude de la Tour fut présenté à la cour, s’éprit d’une dame d’honneur de la reine Henriette Marie,[1] l’épousa et fut fait chevalier de l’Acadie.
On lui octroya ainsi qu’à son fils qui commandait alors l’Acadie, une concession de 4,500 milles de terre dans la nouvelle colonie acadienne devant être fondée par sir William Alexander, à condition que Claude de la Tour amena son fils à livrer son fort aux représentants du roi d’Angleterre.
Le père peu scrupuleux, en faisant connaître à son jeune et noble fils ce que coûteraient ces flatteuses distinctions et ces émoluments, s’aperçut bientôt qu’il y avait quelque chose de plus précieux que toutes ces concessions et ces octrois, et que cet avoir, cet héritage qui paraissait si cher à son fils Charles, n’était ni plus ni moins que l’honneur. Charles de la Tour accueillit avec mépris et indignation les offres de son père.
Charles fut en butte à bien des contrariétés lorsque d’Aulnay Charnisay, le lieutenant de Razely, vint en Acadie commander une autre colonie. Charnisay était insatiable, prétentieux, vindicatif.
“L’Acadie était trop petite pour deux hommes aussi ambitieux.”
De suite Charnisay se mit à l’œuvre auprès de la cour de France pour supplanter son rival, ce à quoi il réussit avec l’aide de puissants amis. Les odieuses calomnies eurent un plein succès. La commission de lieutenant du roi de Charles de La Tour fut révoquée en 1641 et un vaisseau fut envoyé de France pour le ramener.
Conseillé par sa courageuse femme, Charles refusa de courber la tête sous l’affront, convaincu qu’il était qu’on avait dû surprendre la bonne foi de Louis XIII. Il fortifia son fort, demanda de l’aide à Boston et envoya un représentant aux huguenots de La Rochelle en lutte avec leur mortel ennemi, Richelieu. Pendant ce temps, Charnisay traversa en France pour poursuivre ses odieux plans de vengeance contre de La Tour. Une fois de l’autre côté, il apprit que Mme. de La Tour, qu’il redoutait avec raison, l’avait précédé. Il fit immédiatement émaner contre elle un mandat d’arrestation dans lequel il l’accusait de complicité dans la trahison de son époux.
Elle s’enfuit en Angleterre et ayant réussi à fréter un navire, elle le chargea de provisions et de munitions de guerre pour venir en aide à son mari au fort La Tour.
Le capitaine Anglais, au lieu de filer tout droit au fort, passa plusieurs mois à faire le commerce côtier. Pendant ce temps Charnisay n’était pas resté oisif. A son retour, il épia et réussit à arrêter le vaisseau; le capitaine fut obligé de cacher dans sa cale son intrépide passager, Mme. de La Tour, et de faire croire qu’il faisait voile vers Boston. Charnisay lui donna alors un message pour les autorités de Boston où il arriva quelques jours plus tard.
Ce changement d’itinéraire ajouté au fâcheux retard qui lui était déjà arrivé, fut un grave contre-temps pour Mme. de La Tour et elle résolut de s’en faire dédommager.
A Boston elle intenta une action en dommages de deux mille louis au capitaine anglais, réclamation qui lui fut accordée par le tribunal bostonnais. Elle fit saisir la cargaison et loua trois autres vaisseaux pour transporter ses munitions au fort La Tour, où elle arriva en 1644 après une absence de plus de douze mois.
Charnisay, après avoir réprimandé le gouverneur Endicot et les autorités bostonnaises pour les secours qu’ils avaient donnés à Mme. de La Tour, résolut de prendre avantage de la faiblesse du fort et de l’absence de son chef pour en faire immédiatement l’attaque.
La garnison était peu nombreuse, il est vrai, mais elle avait à sa tête une chevaleresque amazone, qui valait à elle seule tout un régiment: Mme. de La Tour.
Au moment de l’assaut, elle se plaça sur le bastion, commandant elle-même la canonade et communiquant à ses guerriers son propre courage héroïque. Elle eut bientôt la satisfaction de voir le vaisseau de Charnisay obligé de s’atterrir sur une pointe, pour ne pas sombrer, et de contempler en vainqueur vingt des assiégeants étendus morts et treize de blessés. Ce fut en février 1645 que Charnisay essuya ce premier échec.
Le dernier siège du fort de La Tour, par d’Aulnay Charnisay eut lieu le 13 avril 1645, et l’attaque fut dirigée de terre. Malheureusement, le fort n’était pas dans de meilleures conditions que la première fois, et Charles de La Tour, qui était à Boston, fut incapable d’arriver au fort, car la baie Française (baie de Fundy aujourd’hui) était bloquée par les croiseurs de Charnisay.
Mme. de La Tour, quoique désespérant de pouvoir résister avec succès, se décida cependant à défendre le fort jusqu’au dernier moment.[2]
Pendant trois jours et trois nuits consécutifs, assiégés et assiégeants échangèrent un feu vif; mais la défense était si bien conduite que les assiégeants, ne gagnant pas de terrain, furent obligés de se retirer après avoir perdu plusieurs des leurs.
La trahison, cependant, acheva ce que la force n’avait pu faire. Charnisay réussit à corrompre une sentinelle suisse qui formait partie de la garnison, et le quatrième jour qui était le saint jour de Pâques, alors que tout le monde était en prières, le traître laissa l’ennemi s’approcher sans en donner l’alarme. Les assiégeants escaladèrent les murailles sans que les défenseurs du fort en eurent connaissance.
Mme. de La Tour se rua sur l’ennemi à la tête de ses soldats et se battit avec tant de courage, que Charnisay ayant déjà perdu douze de ses hommes à part plusieurs blessés, désespéra du succès de son attaque. Il offrit aux assiégeants de capituler, leur promettant la liberté et la vie s’ils se rendaient.
Mme. de La Tour persuadée qu’il n’y avait pas de résistance possible et désireuse de sauver la vie de ceux qu’elle avait sous ses ordres, accepta les offres de Charnisay et le laissa entrer dans le fort.
Ce fut là que Charnisay révéla toute la bassesse de sa nature, en faisant pendre toute la garnison à l’exception d’un seul homme; et celui qu’il épargna fut forcé d’être le bourreau de ses compagnons d’armes.
Le massacre de ces pauvres soldats ne parut pourtant pas satisfaire sa soif du sang. S’il l’avait osé, il aurait très-certainement fait assassiner Mme. de La Tour; mais il craignait que la cour de France malgré sa vénalité, ne tolérât un tel acte de barbarie. Il fit cependant quelque chose d’aussi vil, d’aussi méprisable.
La femme héroïque fut obligée d’assister, une corde au cou, comme une condamnée, à l’exécution de ses vaillants soldats.
Mme. de La Tour s’inquiétait peu des plans de vengeance de son implacable rival. Rien ne pouvait plus l’émouvoir; son grand cœur était brisé.
Elle était loin de son mari à qui elle avait été si fidèle; elle n’osait plus espérer le revoir de nouveau, sinon captif comme elle.
Sa tâche dans la vie touchait désormais à sa fin et elle se sentait née pour la captivité.
Elle s’affaiblit de jour en jour jusqu’au moment où son âme héroïque et pure quitta cette vallée de larmes.
Trois semaines après le siège du fort, elle fut inhumée sur les vertes rives de la rivière St. Jean qu’elle avait tant aimée et où elle avait vécu plusieurs années, “laissant un nom aussi fièrement enchâsé dans l’histoire acadienne, (dit un historien) que celui de n’importe quelle reine régnante dans l’histoire européenne.”
|
Henriette de France, fille de Henri IV et de Marie de Médécis. |
|
La carrière de Mme. de La Tour a servi de canevas au plus beau poème que John Greenleaf Whitier ait fait: Saint John, 1647, tel en est le titre. La noble conduite de son mari refusant aux sollicitations de son père de rendre le fort qu’il commandait au roi d’Angleterre, fut immortalisée par Gérin-Lajoie dans un drame intitulé: Le Jeune La Tour. |

Retraçons maintenant un des plus énergiques caractères qui ait illustré une des plus belles époques de l’histoire canadienne: l’ère de Frontenac.
Vous avez tous entendu parler du brillant régiment de Carignan, que le grand monarque, Louis XIV, avait donné comme escorte en 1664 à son altier vice-roy, le marquis de Tracy. Ce régiment de soixante à soixante dix officiers, dont plusieurs de la noblesse était commandé par le colonel de Salières. Quatre compagnies, six cents hommes environ, qui furent divisées en escouades peu de temps après leur arrivée.
Les officiers et les soldats avaient été induits par des octrois de terres et de bétail, à se marier dans la Nouvelle-France.
Plusieurs d’entre eux le firent et devinrent les chefs respectés de plusieurs des premières familles canadiennes-françaises. Parmi ces derniers on remarque De Chambly, * Sorel, * Du Gué, la Valtrie, * Verchères, * Berthier, * Grandville, Contrecœur, * De Méloises, Tarieu de la Pérade, * Saint-Ours, * De la Fouille, Maximin, Lobeau, Petit, Rougemont, Traversy, De la Nouette, Lacombe et plusieurs autres, dignes compagnons d’armes de De Longueil, * de d’Iberville * et de De Ste. Hélène. * [1]
L’un d’eux, M. de Verchères, obtint en 1672, sur les rives du St. Laurent, près de Montréal, un octroi de trois milles carrés de terre que le roi augmenta en étendue l’année suivante.
Dans ces temps de troubles, une maison de seigneur c’était un petit fort pour empêcher les agressions des sauvages.
“Ces forts, dit l’historien Charlevoix, étaient de grands enclos, entourés de palissades et de redoutes. L’église et la maison du seigneur était en dedans des palissades, et le fort était assez grand pour mettre en sûreté en cas d’attaques les femmes, les enfants et les bestiaux. Une ou deux sentinelles montaient la garde jour et nuit. Avec quelques petites pièces de canons ils tenaient en respect l’ennemi scalpeur, avertissaient les colons de se tenir sur leurs gardes et les appelaient au secours du fort. Ces précautions étaient suffisantes pour se mettre en garde contre les incursions,” mais pas dans tous les cas, comme nous le verrons par la suite.
Prenant avantage de l’absence de M. de Verchères, les Iroquois, toujours aux aguets, cernèrent un jour à la sourdine le petit fort et se mirent à escalader les palissades.
En apprenant cette incursion, Marie-Madeleine de Verchères, la jeune fille du seigneur, saisit un mousquet et fit feu. Les maraudeurs alarmés s’esquivèrent; mais, lorsqu’ils s’aperçurent qu’ils n’étaient pas poursuivis, ils rôdèrent pendant trois jours comme des loups aux alentours du fort sans cependant oser approcher, car de temps à autre un balle abattait celui qui se risquait à tenter l’escalade.
Ce qui augmenta leur surprise c’est qu’ils ne virent en dedans du fort aucun être vivant autre qu’une femme; mais cette femme était si active, si intrépide, si ubiquiste, qu’elle semblait se prodiguer partout en même temps. Et son feu mortel ne cessait pas tant qu’il y avait un ennemi en vue. Cette belliqueuse gardienne du fort était Mademoiselle de Verchères, alors dans la douzième année de son âge. Cela avait lieu en 1690.
Deux ans plus tard, les Iroquois revinrent en plus grand nombre fondre sournoisement sur le fort pendant que les colons étaient occupés à défricher le sol.
Mademoiselle de Verchères, alors âgée de quatorze ans, se promenait lentement sur le bord de la rivière, lorsqu’elle s’aperçut qu’un de ces féroces Iroquois la couchait en joue.
L’Indien était un fort coureur, mais la terreur donnait des ailes à la jeune fille. Le tomahawk à la main, le sauvage la gagnait graduellement et allait la rejoindre sous les palissades du fort comme la jeune fille allait y entrer. Faisant un dernier effort l’Indien fit un bond et arrêta Mademoiselle de Verchères par le mouchoir qu’elle avait autour du cou. Aussi rapide que la pensée, pendant que le barbare levait son arme pour frapper le coup fatal, elle défit le nœud qui retenait le mouchoir et entra dans le fort dont elle ferma lestement la porte, laissant derrière elle l’Iroquois ébahi.
—Aux armes! Aux armes!
Sans s’occuper des cris de douleur des pauvres femmes voyant leurs maris faits prisonniers par les sauvages, elle courut au bastion, où était l’unique sentinelle, saisit un mousquet et un képi et ordonna une grande décharge afin de faire croire aux sauvages que le fort était bien défendu. Elle chargea ensuite une petite pièce de campagne et, à défaut de bourre, elle y fourra une touaille ou serviette qu’elle déchargea sur l’ennemi.
Cette résistance inattendue remplit les maraudeurs de terreur.
Ainsi armée, et avec l’aide d’un seul soldat, elle continua le feu.
L’alarme se propagea vite dans les environs de Montréal, et un intrépide officier, le chevalier de Crisasi, frère du marquis de Crisasi alors gouverneur de Trois-Rivières, vint au secours du fort Verchères à la tête d’une escouade d’élite; mais les sauvages avaient fait leur retraite avec trois prisonniers. Après trois jours de poursuite, de Crisasi les trouva fortement retranchés sur les bords du lac Champlain. L’officier français les mit en complète déroute et les tailla en pièces.
Les prisonniers furent relâchés et toute la Nouvelle-France retentit de l’exploit de Mlle. de Verchères, qui mérite bien le titre d’héroïne.
Un autre exemple d’héroïsme de sa part qui lui valut la réputation de son mâle courage.
Un commandant français, M. de La Naudière de la Pérade, poursuivait les Iroquois dans les environs de la rivière Richelieu, selon les uns ou dans le voisinage de la rivière Ste. Anne d’après les autres, lorsque tout à coup sortit des buissons un véritable essaim de féroces Iroquois.
Pris par surprise, M. de la Pérade allait tomber victime de cette ambuscade lorsque Mlle. de Verchères s’emparant d’un mousquet, se précipita sur l’ennemi à la tête de quelques hommes résolus et réussit à sauver le commandant du tomahawk indien.
Elle acheva la conquête ou pour mieux dire elle devint la conquise de celui auquel elle avait sauvé la vie. A partir de cette époque, l’héroïne de Verchères porte dans l’histoire le nom d’un seigneur influent: Madame de La Naudière de la Pérade.
Le renom de cette héroïne fit écho sur les bords de la Seine, et Louis XIV ordonna à son vice-roy, en la Nouvelle-France, de la faire demander et d’avoir sa propre version de ses hauts faits. Le simple compte-rendu qu’il en fit plût beaucoup au monarque français.
L’héroïne de Verchères mourut à Ste. Anne de la Pérade le 7 août 1737.
Pour faire suite aux trois héroïnes de la Nouvelle-France mentionnées dans la conférence de M. J. M. LeMoine je m’empresse de vous offrir la primeur d’un important document que j’ai eu le bonheur d’obtenir d’un antiquaire érudit, l’honorable juge Baby, au sujet de Madame de la Pérade, l’héroïne de Verchères.
Ce mémoire, en dehors de sa valeur historique, contient d’intéressantes données sur la vie seigneuriale de cette époque-là, c’est pourquoi je puise de longs extraits dans cette relique de famille.[2]
“Plusieurs années après son mariage avec Tarieu de La Naudière,—dit le mémoire que je cite textuellement,—Mlle. Jaret de Verchères sauva la vie à son mari pour la seconde fois. Les Iroquois, qui ne pardonnent rien, leur avaient juré une grande haine à raison des affronts que l’un et l’autre leur avaient infligés. Aussi, ne laissaient-ils jamais, chaque fois qu’ils passaient à Ste. Anne de la Pérade, que de leur donner quelques marques de leur ressentiment. Un jour, croyant sans doute que M. de La Naudière était absent ou qu’elle pourrait tomber à l’improviste, une forte bande de ces cruels sauvages se présente au manoir seigneurial au coucher du soleil, dans le mois de septembre, avec l’intention évidente de faire un mauvais parti à ses habitants.
“Située à une faible distance des bords du St. Laurent, cette résidence se trouvait assez éloignée des autres habitations et les grands arbres séculaires qui l’environnaient en rendait l’isolement encore plus complet. M. de La Naudière retenu au lit par un mal aigü et dangereux, un vieillard de quatre-vingts ans, une jeune servante de seize printemps à peine et la dame de céans en étaient les seuls occupants dans le moment. Tous les canots cachés dans les joncs, le chef et trois de ses sanguinaires compagnons se dirigent en courant vers la maison tandis que les autres s’empressent de se tapir derrière les arbres attendant sournoisement le dénouement de leur trame.
“Madelon de Verchères, bien heureusement, vit venir ces misérables et connaissant parfaitement leurs roueries, s’empressa de fermer la porte du logis, de la barricader du mieux possible, pendant que la jeune fille sur ses ordres lui apporta et plaça à ses côtés les deux seuls fusils à leur disposition, les serviteurs absents ayant emportés les autres.
“Ainsi préparée elle attend de pied ferme, bien décidée à ne pas les laisser entrer dans la place, s’il est possible.
“A peine le chef et les siens étaient-ils parvenus au haut du large perron qui ornait la devanture de la maison, que, sans attendre aucune interpellation de leur part, elle leur demanda, dans leur langue qu’elle connaissait passablement bien, ce qu’ils voulaient.
“Le chef, un peu surpris de se voir apostropher de la sorte par une femme, de lui répondre doucereusement qu’il avait affaire à M. de La Naudière, et devait lui communiquer des choses de grande importance, ajoutant de plus que lui et ses compagnons avaient faim et soif et qu’ils savaient M. de La Naudière assez généreux pour les recevoir et surtout leur faire distribuer un peu “d’eau de feu”.
“D’une voix ferme qui ne traduisait en rien la crainte, de suite elle répond que son mari est trop occupé, dans le moment pour les recevoir, et qu’ils font bien mieux de porter leurs pas ailleurs. Convaincu alors qu’ils n’avait affaire qu’à une femme, ce rusé sauvage, après avoir échangé quelques paroles à voix basse avec les autres auprès de lui, élevant tout-à-coup le ton lui dit avec insolence d’avoir à lui ouvrir immédiatement, sans quoi il allait se frayer un passage lui-même, ajoutant:
“—Nous sommes les maîtres ici, puisque ton mari n’y est pas.
“Cette femme courageuse savait, à n’en pas douter, le sort terrible qui leur était réservé à tous dans les cas où ces barbares effectueraient leur entrée. Son mari, témoin auriculaire de ce qui se passe ne peut pas cependant lui venir en aide. Que faire? Elle implore Dieu, remonte son courage et leur fait savoir on ne peut plus énergiquement que la porte allait leur rester fermée au nez, et que s’ils ne déguerpissaient pas au plus vite, elle prendrait les moyens à l’instant même de les faire éconduire.
“Pleins de colère et sentant qu’ils ne pourraient réussir dans leur affreux dessein qu’en employant l’astuce pour la force, ils se mirent en voie d’y avoir recours. Tout d’abord ils tentèrent d’enfoncer la porte, mais ne parvinrent qu’à l’ébranler quelque peu seulement. Rébutés ici, ils descendent précipitamment le perron en poussant des cris terribles et s’élancent vers une des fenêtres par laquelle ils comptent bien pénétrer à l’intérieur, sans doute. Tous ensemble ils y déchargent leur fusils dans la maison. Les carreaux volent en éclats et les balles et le plomb vont se loger dans les soliveaux et les cloisons. Ne donnant pas le temps à ses assaillants de s’assurer de leur feu, prompte comme l’éclair, armée de ses deux fusils, Madame de La Naudière se jette dans l’embrasure de la croisée et les tire successivement sur les deux sauvages qui surpris de voir rendre leur feu d’une manière si imprévue, crurent qu’en effet ils allaient avoir à rencontrer forte partie; ils hésitent, puis lâchent pied emportant un des leurs légèrement blessé à la jambe.
“Notre héroïne témoin de ce mouvement, recharge prestement son arme et en vide le contenu sur ces barbares qu’elle a l’indiscible plaisir de voir disparaître à ses regards en pleine déroute, dans les ombres du soir. Ceux qui étaient restés en arrière entendant le bruit de la fusillade, sentirent d’instinct qu’il devait y avoir résistance au Manoir dont les maîtres étaient si bien connus et ce qu’ils avaient de mieux à faire était de retraiter sans perdre de temps.
“En effet, ce fut un sauve qui peut général vers les embarcations où ils furent tout aussitôt rejoint par leur chef et son escorte, et tous s’éloignent précipitamment du rivage sous l’impression que M. de La Naudière et les siens sont à leurs trousses; c’est une véritable panique. Mais les épreuves de Madame de La Naudière n’étaient pas encore finies. A peine les Iroquois s’étaient-ils enfuis que la jeune domestique accourut auprès de sa maîtresse et lui annonce avec effroi que la toiture est en feu. Ce sont deux sauvages qui l’y ont mis en lançant plusieurs flèches enflammées avant de se retirer. Nouveau sujet de crainte et d’inquiétude pour cette épouse dévouée, au sujet de son mari.
“Avait-il échappé aux Iroquois pour devenir la proie des flammes? D’ailleurs ces rusés et méchants hommes n’étaient que cachés dans le bois tout auprès pour revenir saisir leur proie du moment que l’incendie serait dans toute sa violence. Elle ignorait qu’ils étaient eux-mêmes dans le moment sous le coup d’une grande frayeur et se sauvaient dans le moment de toute la vitesse de leurs canots devant un ennemi imaginaire.
“Cependant, sans hésitation aucune, elle s’élança à l’intérieur et d’un coup d’œil elle mesure l’étendue du danger qui les menace. Déjà les flammes montent tranquillement sur le toit à-pic de l’édifice et sont même sur le point de s’attaquer aux grosses pièces du comble.
“Il fait calme plat heureusement. Avec l’aide de la jeune fille et les faibles efforts du vieillard dont j’ai parlé ci-dessus, une échelle est immédiatement appuyé sur le mur. On y est monté avec un peu d’eau. Mais que peuvent ces deux femmes contre l’élément dévorant déjà entièrement hors de leur contrôle. Mme. de La Naudière voyait le feu gagner peu à peu du terrain malgré ses efforts surhumains pour ainsi dire, pour en arrêter les progrès, et il était déjà à l’intérieur lorsque soudain elle se rappelle que son mari cloué sur un lit de douleur pouvait être exposé à un danger éminent. Elle se jette à terre pour ainsi dire et rentre. Déjà une épaisse fumée remplissait la maison, le craquement des poutres en partie embrasées et le pétillement des flammes se faisaient entendre. Elle se précipita dans la chambre où elle a laissé son mari quelques instants auparavant, appelant avec des cris de douleurs celui que son intrépidité avait fait échapper à la fureur des barbares, mais qui va périr maintenant peut-être dans un brasier ardent. D’un bond elle arrive auprès de lui et constate qu’il réalise parfaitement la position extrêmement critique dans laquelle il se trouve. Elle l’implore de vouloir bien faire un suprême effort afin de se soustraire à une mort presqu’inévitable, en se sauvant en dehors avec elle.
“—Non, je ne le puis pas, dit-il, car mes forces physiques m’ont complètement abandonné; mon sacrifice est fait, ajouta-t-il, et je suis prêt à me soumettre à la volonté de Dieu, qui après m’avoir sauvé du tomahawk, grâce à ton héroïsme, semble avoir décrété tout de même que ce jour sera le dernier de ma vie. Adieu, laisse-moi ici à mon propre sort.
“Elle le voyait là devant elle, calme et résigné, attendant l’instant suprême. Alors, cette femme réellement extraordinaire, puisant dans son amour le courage voulu et trouvant une force qu’elle ne s’était jamais connue, enlève son mari dans ses bras, le traîne en quelque sorte au dehors et le dépose sur l’herbe à quelques pas de la porte où épuisée physiquement aussi bien que moralement, elle s’évanouit à ses côtés. Au même instant, une pluie qui menaçait déjà depuis quelques heures, éclate avec force et bientôt les flammes qui, le calme aidant, n’avaient pas trop fait de progrès, commencèrent à s’éteindre.
“Les censitaires attirés par la réverbération de l’incendie accourent en toute hâte et bientôt sous les généreux efforts de leurs bras vigoureux les flammes sont tout à fait éteintes. Madame de La Naudière, qui avait bientôt repris ses sens, s’empresse auprès de son mari qui est rapporté soigneusement sur son lit. Quelques semaines plus tard, il reprenait son train de vie ordinaire.”
C’est ainsi,—dit M. Baby,—que cette femme d’une bravoure éprouvée, et d’une force morale au-dessus de tout éloges sauva son mari deux fois dans la même année d’une mort qui semblait inévitable assurément. L’intention bien arrêtée des Iroquois était d’assassiner M. de La Naudière et son épouse aussi. Des sauvages amis leur en donnèrent l’assurance peu de temps après, et leur dévoilèrent tous les détails du complot. D’un autre côté, si M. de La Naudière n’eût pas été transporté en dehors il aurait été tout probablement asphyxié.
Ce simple récit,—ajoute encore M. Baby,—m’a été fait par Mlle. Marguerite de La Naudière, petite-fille de Mlle. de Verchères. Cette demoiselle avait beaucoup de sa grand’mère; elle en tenait par maints côtés. La bravoure, la force de caractère, la franchise étaient des traits distinctifs chez elle, sans compter l’esprit servi par d’amples connaissances humaines.
A mon tour, j’ajouterai que ce manuscrit inédit consigne des faits qui ne sont pas racontés dans la relation de Mlle. Marie Jaret de Verchères, ni aucune part dans les ouvrages sur l’histoire de la Nouvelle-France.[3]
|
Les noms de ceux qui sont suivis d’un astérisque (*) ont laissé leur nom à quelques villes ou paroisses. |
|
Ce récit ajoute le juge Baby, je le tiens de ma vieille tante, Mlle. de La Naudière, petite-fille de l’héroïne, morte à Québec le 17 novembre 1856, à l’âge patriarcal de 81 ans. La vénérable Mlle. de La Naudière fut pendant plusieurs années à Québec, la borne, la limite vivantes entre le passé et le présent; sa mémoire, sa conversation agréable et ses réparties la faisaient rechercher par les plus hauts placés dans l’aristocratie. Ses manières dignes et courtoises nous faisaient penser à l’ancienne école, à l’ancienne noblesse française. Elle fut plus d’une fois l’hôtesse des gouverneurs-généraux et de leurs familles. Parmi ceux-là étaient Lord Elgin, Sir Edmund Walker Head, Lord Monck. Après son départ, Lord Elgin entretint une correspondance amicale avec elle jusqu’à sa mort. |
|

Ces remarquables données ne sont-elles pas autant de leçons pour nous?
Dans Madame de Champlain, nous voyons une femme noble, belle et jeune; une vie pure et douce, une bonté surhumaine.
Madame de La Tour déploie un caractère indomptable, prête en tout temps à affronter la guerre et l’adversité dans toutes ses formes immédiates; et un modèle de dévouement envers son mari.
Dans Mlle. de Verchères, il nous faut admirer une brave jeune fille d’un courage qu’on ne rencontre qu’à l’âge mûr; une intrépidité mâle battant dans un cœur de quatorze printemps et augmentant avec les années.
Voilà, aimables lectrices, trois de vos sœurs dont vous n’aurez pas à rougir.
La traduction, toute mauvaise qu’elle soit, ne vous fera pas moins admirer ces caractères d’élite qu’on ne rencontre qu’à de rares intervalles dans ce siècle de faiblesse et de sensualité.
M. LeMoine a eu l’excellente idée de donner sous forme de conférence, les traits distinctifs de ces trois grandes figures du passé, qui jettent sur quelques pages de notre histoire immaculée comme une odeur de noblesse, de bravoure, de dévouement et de zèle religieux; de peindre ces trois héroïnes qui semblent nous apparaître dans la nuit des temps comme autant d’étoiles, de flambeaux conducteurs destinés à nous piloter à travers les sinueux sentiers de notre existence, comme autant de patrones pour nos jeunes canadiennes, comme autant de modèles de fidélité conjugale.
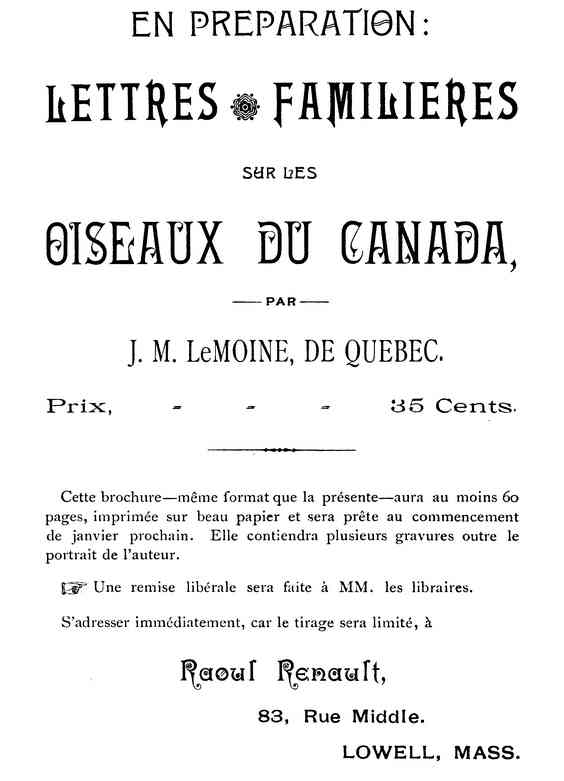
Les mots mal orthographiés et les erreurs d’impression ont été corrigés. Lorsque plusieurs orthographes multiples, l’usage majoritaire a été utilisé.
La ponctuation a été respectée, sauf en cas d’erreurs d’impression évidentes.
Une couverture a été créée pour cet ebook qui est placé dans le domaine public.
[Fin de Les Heroines de la Nouvelle-France par J. M. (James MacPherson) LeMoine]