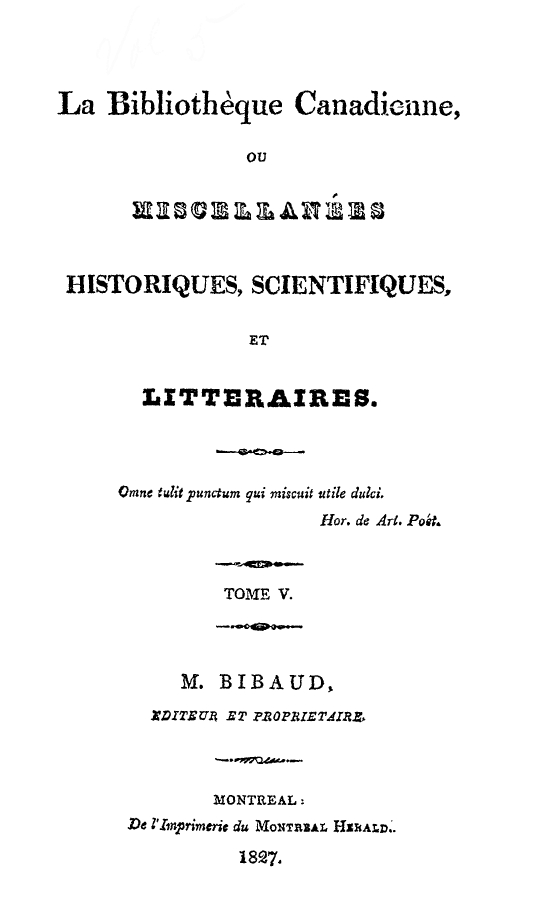
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La bibliothèque canadienne Tome V, Numero 4, Sep. 1827.
Date of first publication: 1827
Author: Michel Bibaud (1782-1857) (editor)
Date first posted: Sep. 28, 2022
Date last updated: Sep. 28, 2022
Faded Page eBook #20220964
This eBook was produced by: Marcia Brooks, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
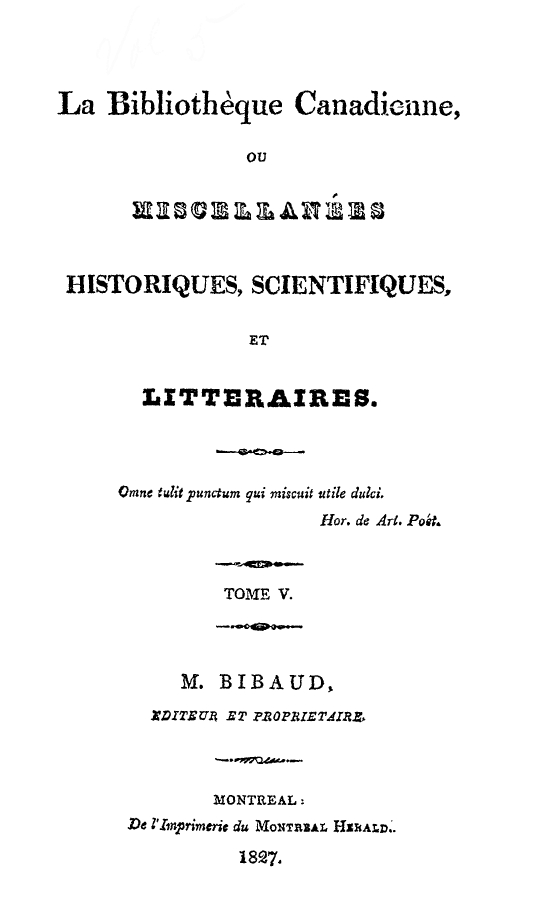
La Bibliothèque Canadienne
| Tome V. | SEPTEMBRE 1827. | Numéro IV. |
Le marquis de Dénonville ne déclara pas la guerre aux Iroquois, ou plutôt ne s’était pas déclaré leur ennemi, de la manière que nous venons de le voir, avant d’avoir pris toutes ses mesures. Dès l’année précédente, le chevalier de Tonti s’étant trouvé à Montréal, au mois de Juillet, avait eu ordre de repartir incontinent, pour le pays des Illinois, afin de leur annoncer que la guerre était déclarée; d’assembler le plus qu’il pourrait de ces sauvages, et de les conduire, au mois de Juin de cette année, dans le voisinage des Tsonnonthouans, du côté de l’Ohio; d’envoyer ensuite de petits partis pour donner l’alarme aux ennemis, et couper à leurs femmes et à leurs enfans la retraite, qu’on jugeait ne pouvoir se faire avec sureté pour eux que par cet endroit.—Le nommé Boisguillot et Nicholas Perrot, qui étaient en traite vers le Mississipi, avaient été avertis de se trouver à Michillimakinac, au temps qui leur fut marqué, avec tous les Français ou Canadiens qui se trouveraient avec eux ou dans les environs, à la réserve de ceux qu’il leur serait nécessaire de laisser à la garde de leurs effets.—Les sauvages des environs de la Baie avaient été priés de se joindre à M. Duluth, à qui il avait été ordonné de se retrancher à la tête du Détroit, du côté du Lac Huron, poste regardé comme important pour la réunion et la sureté de tous les partis qui devaient venir de tous les quartiers du Canada au rendez-vous général de l’armée.—Enfin, M. de la Durantaye, qui commandait toujours à Michillimakinac, et qui s’était acquis l’estime et l’affection de tous les sauvages établis à ce poste, avait eu ordre de réunir ces divers corps de troupes, et de les conduire à Niagara; d’y bien reconnaître le pays, et d’y harceler les ennemis, eu attendant l’armée, s’il arrivait avant elle; mais de distinguer les Onnontagués des autres Iroquois, et de se contenter de faire sur eux des prisonniers de guerre.
Ce ne fut pas néanmoins sans beaucoup de peines que MM. de la Durantaye et Duluth purent faire consentir les Outaouais et les Hurons à prendre de nouveau les armes; et sans les grands efforts, les grandes promesses, peut-être, de ces deux officiers, et les pressantes exhortations de leurs missionnaires, ces sauvages seraient très probablement restés dans l’inaction, s’ils ne s’étaient pas joints aux Iroquois. D’un autre côté, M. de Tonti ne put se joindre que quatre-vingts Illinois, de six à sept cents sur lesquels il avait compté, parce qu’ils curent avis que les Tsonnonthouans étaient en marche pour venir fondre sur leurs villages, qu’ils ne voulurent pas laisser sans défense; de sorte que, ne pouvant pas exécuter tout ce que M. Dénonville lui avait ordonné, il prit le parti d’aller joindre M. Duluth, à l’entrée du Détroit.
Tous ces arrangemens avaient été pris et en partie exécutés, sans que les Iroquois se fussent apperçus de ce qui se tramait contre eux: les premiers avis qu’ils en reçurent par le colonel Dongan ne produisirent même d’autre effet que de les rendre un peu plus attentifs aux démarches des Français. Le départ du P. Lamberville le jeune, qui avait été coloré u’un prétexte plausible, ne leur avait pas décillé les yeux; et la présence de l’aîné, qui était fort tranquille, et qui, en effet, pouvait bien ne se douter de rien, ne contribuait pas peu à les rassurer. Mais enfin, le gouverneur de la Nouvelle York ayant su que les Français et leurs alliés étaient sur le point de se mettre en marche, il en avait fait avertir les Iroquois, qui avaient commencé à entrer tout de bon en méfiance: ce qui pourtant ne les avait pas empêchés d’envoyer leurs chefs à Catarocouy, comme nous l’avons vu plus haut; soit qu’ils se flatassent d’intimider par là M. de Dénonville, ou de l’engager dans quelque négociation qui leur donnât le temps de se mettre en état de l’attendre de pied ferme, ou même de le prévenir.
Mais l’armée française était déjà campée dans la petite île Ste. Hélène, vis-à-vis de Montréal. M. de Champigny Noroy, qui, l’année précédente, avait succédé à M. de Meules, dans l’intendance de la Nouvelle France, s’y rendit, le 7 Juin, avec le chevalier de Vaudreuil, qui était arrivé depuis peu, dans la colonie, avec la qualité de commandant des troupes.—Cette armée était composée de huit cent trente-deux hommes de troupes, d’environ mille Canadiens, et de trois cents sauvages. Elle se mit en marche, le 11, sur deux cents bateaux et autant de canots d’écorce. M. de Champigny l’accompagna pendant trois jours, au bout desquels il prit le devant, afin de préparer tout ce dont les troupes pourraient avoir besoin à Catarocouy; mais la vigilance et l’activité de Mr. d’Orvilliers y avaient pourvu; et l’intendant ne trouva presque rien à faire.
En arrivant à Catarocouy, M. de Dénonville reçut une lettre du colonel Dongan, écrite à peu près sur le même ton que ce gouverneur avait accoutumé de prendre, lorsqu’il s’agissait des Iroquois; c’est à-dire qu’il se plaignait hautement de ce que le gouverneur du Canada faisait la guerre à des peuples qui étaient sujets de sa Majesté britannique. Il ajoutait que M. de la Barre n’avait pas cru devoir s’engager dans une pareille expédition, sans lui en avoir auparavant donné avis.
M. de Dénonville lui fit réponse qu’ils étaient loin de compte, s’il regardait les Iroquois comme sujets du roi d’Angleterre; et que quant à la démarche de son prédécesseur, il lui déclarait que ce n’était pas pour lui un exemple à suivre. Le gouverneur du Canada parlait avec d’autant plus d’assurance qu’il croyait être en droit d’accuser de mauvaise foi celui de la Nouvelle York. Il venait d’apprendre par le sieur de la Forêt, que M. de la Durantaye avait rencontré, sur le lac Huron, soixante Anglais, escortés par des Tsonnonthouans, et conduits par un Français, que Charlevoix qualifie de déserteur, quoiqu’il ne dise pas qu’il eût été soldat, avec des marchandises pour faire la traite à Michillimakinac. Cette démarche était une contravention aux conventions faites entre les deux couronnes: mais si le colonel Dongan ne pouvait pas ignorer le droit, comme Charlevoix le remarque, il pouvait bien ignorer le fait de ces traitans anglais, et conséquemment n’être pas coupable de mauvaise foi, non plus que d’infraction aux traités. Quoiqu’il en soit, tous ceux qui conduisaient le convoi furent faits prisonniers, et leurs marchandises distribuées aux sauvages. Le Français qui leur avait servi de guide, fut ensuite fusillé, par ordre du gouverneur général: châtiment sur lequel Lahontan s’écrie à l’injustice, par la raison qu’il y avait paix alors entre l’Angleterre et la France: que Charlevoix approuve, en prétendant, à tort, que ce Français combattait contre le service de son prince; et que, pour tenir un juste milieu, nous nous permettrons de qualifier de sévère et disproportionné à l’offense.
Après cet exploit, M. de la Durantaye alla joindre MM. Duluth et de Tonti à l’entrée du Détroit, et se rendit avec eux à Niagara. Ils y étaient à peine arrivés, que M. de la Forêt leur apporta un ordre du gouverneur général de se rendre sans délai à la rivière des Sables, en deçà de la baie des Tsonnonthouans, du côté de Catarocouy. M. de Dénonville s’y transporta lui-même avec toute son armée; et par un hazard dont les sauvages ne manquèrent pas de tirer un heureux présage, ils y entrèrent tous en même temps. On travailla aussitôt à faire sur le bord du lac, un peu au-dessus de la rivière, un retranchement de palissades, pour y mettre les magazins. Ce retranchement, auquel on donna le nom de Fort des Sables, fut achevé en deux jours. M. d’Orvilliers y fut laissé avec quatre cents hommes, pour le garder, et assurer les derrières de l’armée.
Du fort des Sables, l’armée prit son chemin parles terres, et après avoir passé deux défilés très dangereux, elle arriva à un troisième, où elle fut vigoureusement attaquée par huit cents Iroquois. Deux cents de ces saurages, après avoir fait leur décharge, se détachèrent pour prendre l’armée française en queue, tandis que le reste continuait à charger en tête. On n’était qu’à une portée de fusil du premier village des Tsonnonthouans, d’où l’on craignait qu’il ne sortît de nouvelles troupes; et cette crainte, jointe à la surprise dans un lieu désavantageux, causa d’abord quelque désordre. Mais les sauvages, ou du moins une partie d’entr’eux, plus accoutumés que les Français à combattre dans les bois, tinrent ferme, et donnèrent au reste de l’armée le temps de se reconnaître. Alors, les ennemis furent repoussés de toutes parts, et voyant la partie trop inégale, ils se débandèrent pour fuir plus aisément.
Il y eut du côté des Français cinq ou six hommes de tués, et une vingtaine de blessés, du nombre desquels fut le P. Anjelran, jésuite. La perte des Iroquois fut de quarante-cinq hommes tués sur la place, et d’une soixantaine de blessés. Les corps des premiers furent mis en pièces et mangés par les Outaouais, qui firent beaucoup mieux la guerre aux morts, comme le dit M. de Dénonville, dans une lettre à M. de Seignelay, qu’ils ne l’avaient faite aux vivants. Les Hurons qui étaient venus avec eux, se battirent bien, et ceux de Lorette, ainsi que les Iroquois de la Montagne et du Sault St. Louis, encore mieux. Les Canadiens se conduisirent avec leur bravoure accoutumée; mais, comme on s’y était attendu, les soldats se firent peu d’honneur dans toute cette campagne. “Que peut-on faire avec de tels gens?” disait M. de Dénonville au même ministre, dans une autre lettre.
Le lendemain du combat, l’armée alla camper dans un des quatre grands villages dont se composait le canton des Tsonnonthouans, et qui était éloigné de sept ou huit lieues du fort des Sables. Il ne s’y trouva personne, et il fut brulé. Ensuite les Français pénétrèrent dans le pays, et pendant dix jours qu’ils mirent à le parcourir, ils ne rencontrèrent pas une âme. Tous les habitans s’étaient retirés, les uns à la Nouvelle York, les autres chez les Goyogouins. On brula des cabanes et quatre cent mille minots de bled-d’inde, et l’on tua une immense quantité de cochons. Ce furent là, après le combat dont nous venons de parler, tous les exploits de cette campagne; car l’armée étant rendue de fatigue, et déjà pleine de malades et de gens qui mouraient en chemin, et les sauvages menaçant sans cesse de se retirer, le général jugea à propos de se rapprocher de la rivière de Niagara, après avoir pris possession du pays qu’il venait de conquérir à peu de frais, mais inutilement, puisque les Tsonnonthouans purent y entrer, et y entrèrent en effet, dès que l’armée française s’en fut retirée. Leur humiliation fut le seul fruit de cette brillante et couteuse expédition.
M. de Dénonville avait toujours extrêmement à cœur de bâtir un fort à Niagara, et l’occasion d’exécuter ce dessein était trop belle pour qu’il la manquât. Le fort fut construit, et le chevalier de Troye y fut laissé avec cent hommes, pour le garder. Les sauvages alliés de la colonie en témoignèrent beaucoup de joie; mais quelque temps après, la maladie s’étant mise dans la garnison, qui périt toute entière avec son commandant, on attribua cet évènement à l’air du pays, bien qu’on n’eût dû s’en prendre qu’à la mauvaise qualité des vivres, et le fort fut abandonné.
Les provinces méridionales du Canada continuaient à être exposées aux incursions, et, suivant les historiens français, aux empiètemens des habitans de la Nouvelle Angleterre. M. de Meules avait fait la visite de ces provinces, sur la fin de l’année 1685, et à son retour à Québec, il avait écrit au ministre des colonies, que le plus utile établissement que l’on pouvait faire était celui de l’Acadie. Il mandait en même temps au roi, que pour rendre cet établissement stable, il était nécessaire, avant tout, de peupler et de fortifier le Port-Royal, et de construire un bon fort à Pantagoët, pour servir de barrière contre les Anglais. Il ajoutait, que si avec cela, on pouvait faire quelque dépense au port de la Hêve, dans l’île du Cap Breton et dans l’Ile Percée, et fortifier Plaisance en Terre-Neuve, où le sieur Parat, qui y commandait, était trop faible pour se défendre, s’il était attaqué, rien n’empêcherait que la France ne fût seule maîtresse des pêches de la morue; objet pour le moins aussi important que le commerce, même exclusif, des pelleteries. Il disait, en finissant, qu’ayant fait le dénombrement de tout ce qui dépendait du gouvernement de l’Acadie, il n’y avait pas trouvé neuf cents personnes.
Les Anglais du Massachusetts, connaissant l’état de dénuement où ces provinces étaient laissées, manquaient rarement de s’en prévaloir pour attaquer les postes qui se trouvaient hors d’état de leur résister. Quelques années avant l’époque dont nous parlons, le fort de Pantagoët avait été de nouveau attaqué, pris et démoli. Le baron de St. Castin, ancien capitaine dans le régiment de Carignan, vint ensuite se loger dans ce fort, et le répara un peu. Mais, sommé d’en sortir, quelque temps après, par le gouverneur de la Nouvelle Angleterre, qui prétendait que tout le pays, jusqu’à l’île de Ste. Croix, était de son gouvernement, il écrivit à M. de Dénonville, que s’il n’était pas promptement secouru, il serait forcé de se rendre; et le secours n’étant pas venu à temps, il se rendit en effet.
Cependant, le gouverneur de la Nouvelle York suivait toujours son plan, qui était d’accaparer tout le commerce du Canada, de détacher les Hurons et les Outaouais de l’alliance des Français, et de leur rendre les Iroquois irréconciliables. Il fit déclarer aux Cantons qu’il ne voulait plus qu’ils allassent à Catarocouy, ni qu’ils eussent d’autres missionnaires que de son choix; et il fit dire de nouveau aux Iroquois du Sault St. Louis et de la Montagne, qu’il leur donnerait des terrains beaucoup plus avantageux que ceux qu’ils occupaient. Enfin il manda au marquis de Dénonville, que s’il continuait à molester les Iroquois, il ne pourrait se dispenser de les secourir à force ouverte. Ce général se mocqua des menaces du colonel Dongan; mais, quoiqu’il parlât d’une nouvelle campagne contre les Iroquois, pour le printemps suivant, ne voyant que peu d’apparence de pouvoir réduire ces peuples par la force, il mit toute son application à les diviser. Il n’avait pu encore savoir en quelle disposition était le canton des Agniers: un chef du Sault St. Louis, qui était de cette tribu, et qu’on appellait, dans la colonie, le Grand Agnier, s’offrit d’y aller, lui sixième, et d’en rapporter des nouvelles certaines. Son offre fut acceptée; et comme il traversait le lac Champlain, il rencontra un parti de soixante Agniers, qui avaient été envoyés pour faire des prisonniers. Il les aborda sans crainte; leur déclara qu’Ononthio ne songeait pas à leur faire la guerre, et réussit à leur persuader de s’en retourner chez eux. Il envoya ensuite son neveu aux cantons d’Onneyouth et d’Onnontagué, pour leur donner les mêmes assurances qu’il avait données à ses compatriotes; et le grand crédit que son mérite lui avait acquis, joint aux bons offices de Garakonthié, et peut-être aussi à la crainte d’un traitement semblable à celui que venait d’éprouver le canton de Tsonnonthouan, fut, pendant quelque temps, une puissante digue que tous les efforts du gouverneur de la Nouvelle York ne purent forcer.
Mais le plus grand embarras du gouverneur général de la Nouvelle France venait des ordres qu’il recevait de sa cour, de ne donner aucun sujet de plainte aux Anglais. Les gouverneurs de la Nouvelle Angleterre et de la Nouvelle York avaient reçu des ordres semblables de la cour de Londres, par rapport aux colonies françaises; mais il paraît qu’ils ne s’y conformaient pas scrupuleusement; d’où Charlevoix infère que le marquis de Dénonville aurait pu agir de la même manière, par voie de représailles. “Ce n’est point désobéir au souverain, dit-il, que d’interpréter ses volontés, et de faire ce qu’il ferait lui-même, s’il était instruit de l’état présent des choses. Cela est surtout vrai dans une colonie éloignée, où un gouverneur général peut supposer que son maître n’exige pas de lui une déférence aveugle, et où il doit savoir que c’est à lui à concilier l’intérêt de l’état et la gloire du prince avec les instructions qu’il reçoit. D’ailleurs, ajoute-t-il, il ne s’était pas assez mis par lui-même au fait des affaires du pays; on plutôt, parmi ceux qu’il consultait, pour s’en instruire, tous ne méritaient pas la confiance qu’il avait en eux. Plusieurs même en abusèrent pour lui faire suivre leurs idées particulières, ou pour aller à leurs f.... Sous un chef déclaré pour la vertu, et qui ne se défie pas assez de ceux qui l’environnent, il n’eu coute à l’intérêt, à l’ambition et aux autres passions, que de prendre un masque; la chose du monde la plus facile à quiconque ne suit pas pour guides la conscience et l’honneur.”
Ces réflexions de notre historien nous ont paru judicieuses, et nous voulons bien l’en croire, quand il nous dit que le marquis de Dénonville “n’avait en vue que l’utilité de la colonie et l’avancement de la religion, et qu’il embrassait avec zèle tout ce qu’on lui proposait pour rendre l’une et l’autre florissantes;” mais nous ne pouvons nous empêcher de penser qu’il exagère un peu, quand il dit que ce général “possédait, au souverain de gré, tout ce qui peut faire le parfait honnête homme au yeux de Dieu et aux yeux des hommes.” Pour ne rien dire de sa sévérité, nous dirions presque de sa créauté à l’égard du prétendu transfuge français, fusillé au lac Huron, sa conduite à l’égard des chefs iroquois arrêtés à Catarocouy, semblerait indiquer qu’il était peu scrupuleux sur les moyens de réussir dans ses projets; outre qu’il nous semble avoir usé de plus de voies détournées, de subterfuges et de faux-fuyants, dans sa correspondance et ses négociations avec les sauvages et les Anglais, qu’aucun de ceux qui l’avaient précédé dans le gouvernement du Canada. Mais il sut maintenir la tranquillité, et faire régner le contentement dans l’intérieur de la colonie, “et l’on n’a guère vu que de son temps, dit encore Charlevoix, les trois têtes qui y partageaient l’autorité, se gouverner avec cette bonne intelligence si nécessaire pour le bonheur des peuples et pour le bien du service.”
Pour revenir aux Iroquois, tandis qu’on se reposait un peu trop sur la crainte où ils avaient paru être d’une nouvelle irruption dans leur pays, sur le résultat des démarches du Grand Agnier et de son neveu, et peut-être aussi sur de nouveaux ordres, qu’avait reçus le colonel Dongan, de travailler à la paix entre les Français et les Cantons, avec de très expresses défenses de leur fournir des armes, ni aucune sorte de munitions, le Fort de Chambly fut tout à coup assiégé par un gros parti d’Agniers et de Mahingans. Il est vrai que la résistance qu’ils y trouvèrent les obligea de décamper dès le lendemain; mais ce ne fut qu’après avoir brulé quelques habitations écartées, et fait plusieurs prisonniers. Le mauvais succès de cette expédition, et l’avis que reçut le gouverneur de la Nouvelle York, qu’on était informé de la part qu’il y avait eue, lui firent craindre une représaille: l’alarme fut même si grande à Orange que les habituas de la campagne y envoyèrent tous ce qu’ils avaient de plus précieux, et qu’un corps de douze cents sauvages passa tout l’hiver dans le voisinage de cette ville, pour la couvrir.
(A continuer.)

Nous aurions pu, en publiant ces extraits, les faire précéder d’un bout de préface, accompagnée d’une courte introduction, suivie elle-même d’un mot d’avant-propos; mais tout cela est du vieux style,et nous n’en ferons rien. Nous aurions pu, de même, y joindre quelques commentaires, faire quelques parallèles,—pointer certains rapprochemens, &c.—nous n’en ferons rien encore; laissant à nos lecteurs tout le mérite et tout le plaisir des petites applications auxquelles ces extraits peuvent prêter.
Abbadié (d’). Très honnête homme, qui parle peu, et dont personne ne parle. Il n’aurait jamais rien fait sans ses guerres de la Vendée. Nous ne craignons pas d’affirmer que ses cicatrices sont plus éloquentes que ses discours.
Aboville (d’). Ses frères d’armes assurent qu’il est éloquent à la tête d’un régiment.
Aiguillon. Honnête négociant de Toulon; peut-être possède-t-il un grand talent comme législateur: s’il monte quelque jour à la tribune, nous en dirons un mot, dans une nouvelle édition.
Aigle (le Comte d’). Ne doit pas plus fixer le soleil que l’attention.
Andigné de Mayneuf (le Comte d’). Du corps législatif, où il ne disait rien, ce député passa à la Chambre, où il parla beaucoup. M. de Villele le fit taire en le nommant premier président de la Cour royale d’Angers. Il n’a parlé depuis que pour défendre l’infortuné 3 pour 0 | 0.
Andigné de Restau (d’). Gentilhomme manceau, député par la grâce du ministère.
Anthes (le Baron d’). Ce député ne parle pas; mais en revanche il crie beaucoup: c’est le plus infatigable clôturier de la Chambre. On dit que les ministres se moquent de lui: ce serait pousser l’ingratitude envers un homme dont les honorables poumons jouent un si grand rôle.
Auberjon (le Marquis d’). Longtemps en état d’hostilité avec le ministère, ce député est maintenant l’un des plus intrépides défenseurs de M. de Villele. Mais aussi comment résister à un homme qui vous fait marquis, préfet, chevalier de la Légion-d’bonneur, et qui donne des places à tous vos parens jusqu’au quatrième degré inclusivement? il faudrait avoir un cœur de roche, et, grâces au ciel, les préfets n’ont pas de ces cœurs-la!....
Augier du Chzaud. Député depuis 1815, il n’a pas cesse de voter avec la majorité, quels qu’en aient été les chefs: il appelle cela de la constance.
Avoyne-Chantereyne. C’est un honnête bas-normand qui a trouvé le moyen d’être plus ministériel que les ministres. D’abord avocat, il commença à faire son chemin pendant la révolution; les commotions politiques qui se succédèrent ne purent l’arrêter, et il est arrivé sans encombre à la Cour de cassation et à la Chambre élective. Envoyé par les contribuables pour défendre leurs intérêts, il se plaint, souvent du peu d’élévation du budget; à son avis, les ministres n’en demandent jamais assez. Aussi ces derniers se montrent-ils reconnaissans. On assure que ce loyal mandataire a déjà obtenu 71 nominations pour lui, ses parens et amis: espérons qu’il n’en restera pas là.
Aymard (d’). Député tout nouveau; élu à grands coups de circulaires.
Bacot de Romans (le Baron). Préfet et député en 1815, il se contentait d’assister en temps en temps aux séances de la Chambre. La perte de sa préfecture lui a fait retrouver la parole: c’est maintenant un des plus redoutables adversaires de M. de Villele. En lui ôtant sa place, M. Decaze a rendu service à la France.
Bailly (le Marquis de). Royaliste indépendant. Fort heureusement pour le ministère, ce député n’est pas orateur.
Barlier. Il bâille en entrant à la Chambre, s’endort pendant la séance, et ne se réveille que pour crier: La clôture! Il ira loin, si Dieu prête vie au ministère.
Baron (le Baron). Ce député est directeur du grand bureau des mystifications, autrement dit Mont-de-Piété: on le dit libéral; c’est une mauvaise plaisanterie: un homme qui prête de l’argent à 20 pour cent!....
Basterreche. Membre de cette opposition à la fois si peu nombreuse et si brillante, ce député se montra en plusieurs circonstances l’émule de MM. Casimir-Perrier et Lafitte. Ses discours, dans les discussions financières, sont fort remarquables.
Baudel-Martinet. Voyez Bausset, c’est tout ce qu’on peut dire de lui.
Bausset (le Marquis de). Voyez Baudel-Martinet.
Bazire. Fils d’un boucher, frère d’une tripière, et d’abord avocat, ce personnage, grâces à une riche veuve dont il lit sa femme, devint député et conseiller à la Cour royale. Ses commettans l’accusent de crier en même temps: Vive le roi! vive la ligue! C’est une calomnie: nous pouvons affirmer qu’il n’a jamais fait entendre qu’un de ces cris à la fois.
Beaumont (le Vicomte de). Royaliste par conviction, antiministériel par systême, il a souvent porté de fortes bottes à M. de Villèle, et il sait mieux que personne combien la cuirasse d’un premier ministre est difficile à entamer.
Beaurepàire (le Marquis de). Il possède de grandes connaissances en chevaux.
Becays de la Caussade. Convive assidu de l’hôtel de Rivoli: il a peu de bien, beaucoup d’enfans, et sa devise est: “il faut que tout le monde vive.”
Bellissen (le Marquis de). On assure que ce députe royaliste a résisté à toutes les séductions du ministère; est-ce qu’il voudrait tâter du porte-feuille?
Benjamin Constant. Une profonde érudition, de vastes connaissances, beaucoup d’esprit, un jugement sain, telles sont les qualités qui font de ce député un des hommes les plus célèbres de notre époque. Elevé en Allemagne, il vint à Paris en 1795, et commença sa carrière politique par la publication d’une brochure fort remarquable. Proscrit par Napoleon, dont il ne pouvait souffrir le despotisme, il parcourut l’Allemagne et l’Angleterre, et l’amitié de la célèbre Madame de Stael adoucit beaucoup alors les rigueurs de son exil. Rentré en France avec les Bourbons, il fut un des rédacteurs du Nain Jaune. Napoléon étant revenu à Paris, Benjamin Constant songea à en sortir; mais voyant tous les francs républicains se réunir à l’empereur, il suivit leur exemple, et pensa que sa présence pouvait être encore utile à la liberté de son pays; il voulut tenter, selon les expressions d’un jeune écrivain, de lier les mains à l’empereur, en donnant, des armes au soldat. Pendant les Cent-Jours, il publia un livre qui renferme une critique amère de l’acte additionnel, dont ses ennemis l’accusent d’être l’auteur. Devenu député, il n’a jamais cessé de défendre les intérêts du peuple, et les amis d’une sage liberté n’oublieront jamais cette phrase qu’il prononça à la tribune:—“Si j’avais été en France en 1793, ni Fouquier-Tainville au parquet, ni Marat à la tribune, ne m’auraient effrayé; j’aurais voté jusqu’au bout contre les Jacobins de la république, comme je voterai jusqu’au bout contre les Jacobins de la royauté.”
Béraud des Rondards. Après s’être fatigué pour les ministres, il s’est lassé des ministres. Ce député menace de devenir indépendant.
(A continuer.)

Mr. Bibaud,—Les extraits que je vous envoie sont copiés de ce MS. même, dont je suis en possession. Ils contiennent principalement une anecdote historique relative à la disette des vivres, à Montréal, en 1757 et 1758: le souvenir ne s’en était jamais perdu, mais les détails, conservés dans ce MS. avaient pu s’effacer en partie. Mr. Smith, dont je crois avoir déjà prouvé l’inexactitude comme historien, ne dit absolument rien des suites qu’eut, à Montréal, sur le peuple et les troupes, cette disette, fruit de la coupable avidité des principaux administrateurs de la Colonie, ni de la distribution que l’on fit alors, dans les boucheries du Roi, de la chair de cheval au lieu d’autre viande, pour la nourriture surtout des troupes. Il eût dû, ce semble, recueillir au moins ce que la tradition avait conservé de ce fait. Une telle omission de la part de ce compilateur, jointe à son ortographe toute particulière des noms de plusieurs officiers du temps, à l’infidélité de son récit sur le Règne Militaire, et à cent autres incorrections qu’on peut lui reprocher, (voir, par exemple, les “Observations d’un Catholique, &c.”) donnent la juste mesure de l’exactitude de cet écrivain, et prouvent combien il a rempli, dans la publication de son étrange “History of Canada,” les promesses de son épigraphe:—
Ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat.
J’ai commencé, je n’ai pas fini; je reviendrai à la charge.
Suit un Sommaire des extraits que je vous envoie pour la Bibliothèque Canadienne.
| Montréal, Août, 1827. | S. R. |
(Sommaire.—1756 à 1758.)—Arrivée, en Canada, de quelques Régimens français, et d’Officiers supérieurs.—Expédition préméditée contre le Fort George.—Disette; ses suites à Montréal.—On veut distribuer de la viande de cheval, en place d’autres vivres, aux habitans et aux troupes, qui s’y refusent.—Mutinerie qui s’ensuit parmi les soldats, et Emeute de femmes.—Conduite ferme de Mr. le Chevalier de Lévis et de Mr. le Marquis de Vaudreuil, dans cette occasion.—Les soldats rentrent dans leurs devoirs; mais les femmes continuent dans leurs mauvaises dispositions.—Le Jour-des-Rois.—Mouvemens séditieux dans la garnison de Carillon, réprimés.
1755.—“Le Roi ayant résolu d’envoyer de nouveaux secours en Canada, et de remplacer les Officiers supérieurs qu’il y avait fait passer l’année dernière, fit choix du Marquis de Montcalm, du Chevalier de Lévis,[1] et de Mr. de Bourlamaque,[2] qui furent pourvus des grades,—le premier de Maréchal-de-Camp, le second de Brigadier, et le troisième de Colonel. Les bataillons de la Sarre et de Royal-Roussillon furent destinés pour ce secours, avec quelques Officiers d’Artillerie et des Ingénieurs. Le tout fut rassemblé à Brest, au commencement de Mars 1756, et arriva heureusement en Canada, sur la fin de Mai.”
1756 à 1757.—“On avait formé, au commencement de l’hiver (1756 à 1757) le projet d’enlever le Fort George par escalade, avec an détachement d’environ 1500 hommes, soldats des troupes de terre, de la marine, Canadiens et Sauvages, aux ordres de Mr. de Rigaud, Gouverneur de Montréal, et de Mr. de Ponlariez, Capitaine de grenadiers au régiment de Royal-Roussillon, qui devait se mettre en marche, dans le mois de Janvier; mais une maladie considérable, survenue à Mr. le Marquis de Vaudreuil,[3] en différa le départ, qui ne fut que le 25 Février. (1757), et de Carillon le 15. Après avoir pris les échelles nécessaires dans cette expédition, on brula deux ou trois barques, qui étaient auprès du Fort, et un hangard rempli de vivres. De retour à Carillon, on laissa partie des troupes de terre pour en renforcer la garnison; le reste revint à Montréal.
“Cette expédition conta beaucoup. Il fallut équiper; cela dévasta les magazins, et fit une consommation de vivres très considérable.”
1757.—“A peine avions-nous des vivres pour tenir un mois, mais comptant sur les secours de France, on forma les préparatifs pour faire le siège du fort George: les matériaux furent mis eu mouvement à bonne heure.
“Mr. le Marquis de Vaudreuil, le 28 Septembre, donna des ordres à Mr. le Chevalier de Lévis, pour réduire la ration des quatre bataillons qui étaient à St. Jean et à Chambly, et commencer du 1er Octobre, à une livre de pain, un quart de pois et un quart de lard. Mr. le Ch. de Lévis fit passer à cet égard les ordres de Mr. le Marq. de Vaudreuil aux commandans des bataillons, et leur exposa la nécessité qu’il y avait à se soumettre à cette réduction de vivres. Elle fut mise en exécution le 1er Octobre. Les soldats s’y prêtèrent de bonne grâce.
“La même réduction fut ordonnée pour les garnisons de Montréal et de Québec, que Mr. le Marq. de Montcalm fit mettre à exécution au Régiment de Berry.
“Mr. le Chev. de Lévis reçut (le 1er Novembre) des ordres de Mr. le Marq. de Vaudreuil et de Mr. de Montcalm, pour réduire encore la ration des soldats de la garnison de Montréal à une demie livre de pain, un quart de morue, et un quart de pois, avec une demie livre de pain payée en argent, à commencer du 1er Nov. On avait réduit celle de Québec au même taux; ce qu’elle avait exécuté sans difficulté.
“Mr. le Chev. de Lévis parla lui-même aux soldats de Bearn, et leur représenta la nécessité indispensable qu’il y avait de se soumettre à cette réduction des vivres. En conséquence, le Régiment de Bearn prit les vivres à 9 heures du matin, de bonne grâce, sans témoigner le moindre mécontentement. Les troupes de la marine, qui devaient les prendre à la même heure, refusèrent de les recevoir et de se soumettre à la réduction, et se retirèrent du lieu où l’on faisait la distribution; leurs officiers ne parent les contenir.
“Mr. le Chev. de Lévis dit à Mr. Duplessis, qu’il était de grande conséquence et de nécessité absolue, de forcer les soldats à prendre les vivres. Mr. Duplessis lui dit qu’il avait grondé les officiers qui s’étaient trouvés à la distribution, et qu’il avait ordonné que les troupes de la marine se trouvassent à une heure après-midi, avec les officiers, dans la cour de l’Intendance, pour y passer la revue du Commissaire, et qu’il parlerait aux soldats pour leur faire prendre les vivres, de même qu’avaient fait les troupes de terre.
“Après le dîner, Mr. Duplessis sortit pour se rendre à l’Intendance. Mr. le Chev. de Lévis lui dit, que si les soldats de la marine persistaient à refuser les vivres, il eût à le faire avertir, et qu’il s’y rendrait sur le champ pour les forcer à les prendre.
“Une heure après que Mr. Duplessis fut sorti de chez Mr. le Chev. de Lévis, il lui envoya le Sergent-major des troupes de la marine, pour le prier de se rendre à l’Intendance, parce que les soldats de la marine persistaient dans leurs mutineries et dans le refus des vivres.
“Mr. le Chev. de Lévis s’y rendit sur le champ, avec quelques officiers des troupes de terre, qui avaient dîné chez lui. En arrivant, il trouva les soldats de la marine en foule dans la cour, et sans ordre, tenant de mauvais propos; il leur imposa silence, et leur fît prendre les armes; leur représenta la nécessité qu’il y avait de se soumettre à la réduction des vivres; leur dit que les troupes de terre s’y étaient soumises sans difficulté; qu’il fallait qu’ils en fissent de même, et qu’il ferait pendre sur le champ le premier qui hésiterait à prendre les vivres; et en conséquence il ordonna à la première compagnie de les prendre, ce qu’elle fit, de même que le reste des troupes de la marine, sans murmurer davantage. Ils firent même des excuses à Mr. le Chev. de Lévis, en disant que Messieurs leurs officiers ne leur avaient pas bien expliqué les motifs de la réduction, et que désormais ils seraient soumis à toutes les volontés de leurs supérieurs. Mr. le Chev. de Lévis leur assura aussi qu’il tiendrait la main pour qu’il ne leur fût fait aucun tort, mais qu’il punirait, sans miséricorde, tous les mutins—s’il s’en trouvait encore.
“Mr. le Chev. de Lévis dit à Mr. Duplessis, en présence de tous les soldats de la marine, que le refus des vivres n’était venu que par la faute que Messieurs les Officiers avaient eue de ne point expliquer les intentions de Mr. le Général, et que c’était le cas de pardonner aux soldats le refus qu’ils avaient fait de prendre les vivres, parce qu’ils ignoraient sur quel pied la réduction avait été faite.
“Après que la revue eut été faite, et que les vivres eurent été pris, en envoya les soldats de la Colonie dans leurs quartiers, où ils retournèrent sans murmurer, avec satisfaction, et se louant de Mr. le Chev. de Lévis. On fut obligé, malgré la mauvaise saison, d’envoyer chercher à Carillon 200 quarts de farine: la ville en manquant entièrement.
“Mr. le Marq. de Vaudreuil laissa Québec pour Montréal, le 10 Novembre.
“Le 20, à 8 heures du soir, Mr. de Malartic, Major de Bearn, vint avertir Mr. le Chev. de Lévis que plusieurs sergents venaient de lui rendre compte, de même qu’à Mr. Dalquier, Commandant de ce Régiment, que les soldats de la marine et quelques habitans fomentaient les soldats du Régt. de Bearn à se révolter, et à refuser les vivres, et que l’on avait fait courir des billets.
“Mr. le Chev. de Lévis ordonna à Mr. de Malartic de mettre les sergents et les soldats les plus affidés en campagne, pour tâcher d’arrêter les soldats de la marine ou habitans qui seraient porteurs des billets ou qui tiendraient des propos qui pourraient tendre à une sédition. Il lui ordonna en même temps de se trouver à la distribution, le lendemain, avec le Capitaine et le Lieutenant qui étaient commandés ordinairement, et que s’ils s’appercevaient que les soldats fissent la moindre difficulté de prendre les vivres, il envoyât sur le champ un sergent l’avertir; qu’il se rendrait, dans le moment, au lieu de la distribution, pour y mettre ordre.
“Mr. le Chev. de Lévis fit prier Mr. Dalquier de lui amener chez lui quatre grenadiers, pour qu’il pût leur dire ses intentions.
“Mr. le Chev. de Lévis dit aux quatre grenadiers: qu’il était informé que les soldats de la marine et même les habitans sollicitaient le Régiment de Bearn à une sédition et à refuser de prendre les vivres; qu’il était persuadé que les soldats de Bearn connaissaient trop bien leurs devoirs pour écouter de pareils propos, et qu’ils arrêteraient ceux qui pourraient les tenir, et que c’était dans tous les cas, aux troupes de terre à montrer le bon exemple; que le Roi les avait envoyés pour défendre cette Colonie, non seulement par les armes, mais encore pour supporter toutes les misères que toutes les circonstances demandaient; qu’il fallait nous regarder comme dans une ville assiégée, privés de tous secours; qu’ils n’ignoraient pas que c’était aux grenadiers à montrer l’exemple, à être le plus soumis et à tenir les meilleurs propos; que s’il arrivait quelque mutinerie, il s’en prendrait aux grenadiers de Bearn; que ce serait sur eux qu’il ferait tomber le premier exemple; qu’il les en avertissait; que c’était à eux à se conduire de façon qu’il n’eût aucun reproche à leur faire à cet égard; que d’ailleurs il tiendrait la main pour qu’il ne leur fût fait aucun tort, et qu’il leur rendrait tous les services qui dépendraient de lui. Les grenadiers l’assurèrent qu’ils se conduiraient bien, et qu’il n’aurait aucun reproche à leur faire.
“Mr. le Chev. de Lévis fut rendre compte à Mr. le Marq. de Vaudreuil de tout ce qui se passait et des arrangemens qu’il avait pris pour qu’il n’arrivât point de désordre parmi les troupes de terre. Mr. de Vaudreuil les approva, et lui dit qu’il allait prendre les mêmes arrangemens pour celles de la marine.
“Les troupes de terre furent à leur ordinaire, le 21, à la distribution, où les grenadiers tinrent de bons propos, et tout se passa bien. Mr. de Malartic, après qu’elle fut faite, se rendit chez Mr. le Chev. de Lévis, qui en fut rendre compte à Mr. le Marq. de Vaudreuil, où il trouva tous les Officiers de la marine, qui y étaient assemblés. Les soldats de ce corps se rendirent, à 11 heures, à la distribution, qui se passa de même en règle.
“Le 1er du mois de Décembre, l’on ôta entièrement le pain que l’on distribuait. A la place, on voulut donner moitié bœuf et moitié cheval, dont la livre de l’un et de l’autre ne serait payée que six sols; mais le peuple témoigna de la répugnance pour le cheval, et refusa d’en prendre.
“L’après-midi, il y eut une émeute de femmes. Elles s’assemblèrent devant la porte de Mr. le Marq. de Vaudreuil. Il en fit entrer quatre chez lui. Il leur demanda quel était le sujet de cette émeute. Elles répondirent qu’elles venaient pour lui demander du pain. Mr. le Marq. de Vaudreuil dit qu’il n’en avait point à leur faire donner; qu’il n’en avait pas même pour les troupes, auxquelles on avait été obligé de diminuer la ration; que le Roi n’était pas obligé de fournir du pain au peuple, et que c’était à lui à s’en pourvoir; que cependant il avait fait tuer des bœufs et des chevaux pour assister les pauvres dans le temps de disette; que ceux qui en voulaient prendre en pouvaient aller chercher à la boucherie du Roi, à six sols la livre. Les femmes répondirent à Mr. de Vaudreuil, qu’elles avaient de la répugnance à manger du cheval; qu’il était l’ami des hommes; que la religion défendait de les tuer, et qu’elles aimeraient mieux mourir que d’en manger. Mr. de Vaudreuil dit que c’était une chimère et une imagination de leur part; que de tous les temps l’on en avait mangé; qu’il était bon, et qu’il avait ordonné qu’il fût tué avec soin et de la même manière que le bœuf; que c’était le seul soulagement qu’il pût donner au peuple.
“Mr. le Marq. de Vaudreuil congédia ces femmes, et leur dit: que la première fois qu’il leur arriverait de faire une émeute, il les ferait toutes mettre en prison, et qu’il en ferait pendre la moitié. Il ordonna à MM. de Martel, Commissaire de la marine, et de Monrepos, Juge de Police, de mener ces femmes à la boucherie, pour leur faire voir que le cheval et le bœuf étaient de bonne espèce; elles en convinrent, mais elles dirent qu’elles n’en prendraient pas, ni personne—pas même les troupes: après quoi, elles se dissipèrent, et se retirèrent chez elles, en tenant des propos séditieux. MM. de Martel et de Monrepos auraient dû en faire arrêter quelques unes; ce qu’ils ne firent pas.
“Mr. le Marq. de Vaudreuil dit à Mr. le Chev. de Lévis, le 4 Décembre, qu’il venait de recevoir une lettre de Mr. l’Intendant; qu’il lui marquait la nécessité qu’il y avait que les troupes en garnison à Québec et à Montréal, mangeassent du cheval. En conséquence, la ration fut réglée à une demie livre de pain, demie livre de bœuf, demie livre de cheval, un quart de pois, et une demie livre de pain payée en argent.
“Le 8, il fut ordonné que l’on prendrait les vivres, le 9, sur le pied de ce dernier arrangement. En conséquence, Mr. le Chev. de Lévis ordonna au Régiment de Bearn d’aller à la distribution, à l’heure ordinaire. Il dit à MM. Dalquier et Malartic de s’y trouver, avec les Officiers qui étaient commandés ordinairement, parce que le peuple fomentait les soldats à ne pas prendre du cheval. Mr. le Chev. de Lévis recommanda à Mr. de Malartic, s’il s’appercevait que les soldats fissent la moindre difficulté à en prendre, de l’envoyer avertir, et qu’il se rendrait lui-même au lieu de la distribution.
“A 8 heures et demie, Mr. de Malartic vint dire à Mr. le Chev. de Lévis, que les soldats ne voulaient pas prendre du cheval; que la plus grande partie s’était retirée de la distribution. Mr. le Chev. de Lévis s’y rendit sur le champ. Il gronda en arrivant Messieurs les Officiers, de ce qu’ils n’avaient pas contenu leurs soldats, et de ce qu’ils les avaient laissé disperser. Ils s’excusèrent sur ce qu’il faisait très froid, et que les bouchers n’avaient pas encore préparé les viandes. Mr. le Ch. de Lévis ordonna à Mr. de Malartic de faire rassembler les soldats pour se rendre au lieu de la distribution. Dès que toutes les Compagnies furent assemblées, Mr. le Chev. de Lévis fit couper du cheval pour lui, et le fit prendre pur un de ses domestiques. Il ordonna en même temps aux grenadiers d’en prendre. Ils voulurent lui faire quelque représentation qu’il ne voulut point écouter, disant aux grenadiers d’obéir; que le premier qui ferait difficulté d’en prendre, il le ferait arrêter et le ferait pendre; que si on avait quelques représentations à faire. il les écouterait après que la distribution serait faite et finie. Les grenadiers ne répliquèrent point, et prirent du cheval, et les autres compagnies firent de même, sans faire aucune difficulté.
“Après que la distribution fut faite, Mr. le Chev. de Lévis dit aux Grenadiers que s’ils avaient quelques représentations à lui faire, il les écouterait volontiers. Ils lui dirent qu’ils se plaignaient de ce qu’on les avait obligés de prendre du cheval; que le peuple avait rejetté et refusé d’en prendre; qu’ils pensaient que la Colonie n’était point réduite au point de faire manger du cheval aux troupes et au peuple; que l’on pouvait en juger par la grande quantité de bœufs que les habitans apportaient tous les jours au marché; que de plus ils avaient une grande difficulté à vivre, attendu qu’ils étaient logés chez les habitans, et que l’on ne voulait pas leur permettre de se rassembler pour faire ordinaire de sept en sept, et que la ration étant réduite au point où elle était, il n’était pas possible qu’un homme pût vivre en mangeant seul; que le Régiment de la Reine, qui était à Québec, avait l’avantage d’être cazerné et de pouvoir faire ordinaire, et qu’ils voyaient avec douleur que la réduction des vivres ne regardait que les troupes: que les habitans ne se réduisaient sur rien, pas même leurs Nègres et leurs Panis—qui veut dire Esclaves sauvages; qu’ils n’ignoraient point que, dans les cas forcés, les troupes étaient faites pour se soumettre à toutes les réductions, et se contenter de tout ce qu’on pourrait leur donner pour vivre, sur le pied de la plus petite ration, mais que cela devait être égal au moins avec les habitans.
“Mr. le Chev. de Lévis répondit à leurs représentations:—que le cheval qu’il leur avait fait donner était de bonne qualité; que le peuple avait la faiblesse et le préjugé de ne vouloir pas en manger; que les soldats devaient penser différemment; qu’ils n’ignoraient point que les troupes en avaient mangé à Prague et dans d’autres places assiégées, et que l’on devait se regarder en Canada dans le même cas, puisque le secours de vivres que le Roi avait envoyé avait été pris par les Anglais; qu’il aurait attention qu’on leur délivrât du cheval de la bonne qualité, et qu’à cet effet il en faisait porter et servir sur sa table, et qu’il en mangeait tous les jours; qu’ils étaient mal informés de la situation et de l’état de la Colonie; qu’elle se trouvait dans la plus grande de disette; qu’il y avait longtemps que le peuple à Québec ne mangeait point de pain; qu’il y avait 2000 Acadiens qui n’avaient pour toute nourriture que de la morue et du cheval; que tous les Officiers de Québec et de Montréal étaient réduits à un quarteron de pain par jour; que le Gouvernement de Montréal était mieux fourni que les autres, et que par conséquent les troupes qui y étaient avaient moins à souffrir que celles qui étaient à Québec.
“A l’égard du bœuf qu’ils voyaient tous les jours apporter au marché, que c’était le temps où les habitons tuaient les bestiaux qu’ils n’étaient point en état de nourrir pendant l’hiver, et que les glaces permettaient qu’on les conservât pendant une grande partie de l’hiver; que les soldats avaient la même liberté d’en acheter au marché et d’en faire leurs provisions; que s’ils n’avaient point d’argent, il ordonnerait à Mr. de Malartic de leur en avancer sur leur décompte, ce qui pourrait leur faciliter les moyens de faire leurs provisions pour leur hiver, tant en bled qu’en viande; qu’à l’égard des inconvéniens où ils étaient de ne pouvoir faire ordinaire plusieurs ensemble, il ferait son possible pour leur procurer cet avantage; qu’au surplus les troupes devaient être persuadées que les Généraux étaient occupés de procurer le plus de bien-être qu’il serait possible, et à conserver la Colonie au Roi; que c’était aux troupes de terre à montrer l’exemple; qu’il comptait que désormais le Régiment de Bearn ne ferait plus aucune représentation sur rien; qu’ils devaient être persuadés qu’il tiendrait la main pour qu’il ne leur fût fait aucun tort et qu’il leur rendrait tous les services qui pourraient dépendre de lui, comme aussi il ferait punir très sévèrement tous ceux qui seraient mutins, et qui ne se porteraient pas à tout ce qui serait jugé nécessaire au bien du service; que de plus il leur recommandait de n’avoir aucune querelle avec les soldats de la Colonie, ni avec les habitans, et de faire leurs services avec la plus grande exactitude.
“Les Grenadiers et les soldats répondirent à Mr. le Chev. de Lévis qu’ils étaient très satisfaits de ce qu’il leur avait dit; qu’ils se conduiraient de façon qu’il n’aurait aucun reproche à leur faire; qu’ils avaient toute confiance eu lui, et qu’il connaissait leurs besoins.
“Les troupes de la marine prirent de même les vivres, après-midi, sans faire de difficulté, Il n’y à plus eu aucune représentation sur la réduction des vivres.
“Mr. le Chev. de Lévis obtint de Mr. l’Intendant que l’on donnerait huit livres par mois par chaque chambrée de sept hommes, pour dédommager les habitans chez qui les soldats faisaient ordinaire.
1758—“Le Jour-des-Rois, huit grenadiers du Régt. de Bearn, apportèrent à Mr. le Chev. de Lévis un plat de cheval accommodé à leur façon, qui se trouva très bon. Mr. le Chev. de Lévis fit déjeuner ces grenadiers et leur fit donner du vin et deux plats de cheval accommodé par ses cuisiniers, qui ne se trouva pas si bon que le leur. Il leur donna de plus quatre louis, pour que la Compagnie fît les Rois et bût à sa santé.
1758.—“Dans le mois de Janvier, Mr. d’Hébecourt écrivit à Mr. le Chev. de Lévis qu’il y avait eu une espèce de sédition dans la garnison de Carillon; ce qui pouvait devenir de grande conséquence, à cause du mécontentement que cette garnison avait déjà fait paraître dans le mois de Novembre, au sujet du manque d’équipement. Ces raisons firent prendre à Mr. le Chev. de Lévis le parti de proposer à Mr. le Marq. de Vaudreuil d’envoyer 8 sergents et 8 caporaux, gens intelligents et sûrs, pour contenir cette garnison dans le devoir, et lui donner bon exemple. Le détachement partit à la fin de Février, sous prétexte de servir d’escorte à Mr. Pénissant, munitionnaire.—Moyennant ce secours, la garnison de Carillon est restée dans l’obéissance et dans le devoir.”
|
Smith et quelques autres écrivent Levi; ce n’est pas correct. |
|
Un correspondant de la Bib. Can. pp. 95 et 96 du Tome III., a écrit Bourglamarque, et Smith a quelquefois écrit Bourlemaque, mais plus souvent Bourlamaque. Il faut suivre l’orthographic du Journal de M. de Lévis. |
|
M. le Marquis de Vaudreuil de Cavagnal avait remplacé M. le Marquis Du Quesne de Menneville, comme Gouverneur-général du Canada, le 10 Juillet, 1755. |

L’Assomption, 30 Juillet, 1827.
Mr. Bibaud,—Il me semble qu’un Journal de la nature du vôtre, répandu comme il l’est par tout le pays et dans toutes les classes de la société, devrait nous mettre un peu plus au fait des découvertes qui se font, chez nos voisins et en Europe, dans les arts et les métiers: il ne faudrait pour cela qu’en publier quelques-unes de tems en tems. Ce serait, suivant moi, d’un bien incalculable pour nos artisans, à qui, vous le savez comme moi, il ne faut que montrer, pour qu’ils fassent. Ils ont de l’aptitude, de l’intelligence, beaucoup d’industrie; mais ils sont Casaniers, et manquent par cela même de moyens de comparaison, pour faire aussi bien, et peut-être mieux, que les artisans d’outre-mer, ou d’au-delà de la ligne de 45°.—Au moyen des petites publications que je suggère, étant au moins au niveau des progrès que les arts et les métiers qu’ils suivent font ailleurs, et qu’un voisin, ami de son pays, leur lirait sans doute et leur expliquerait, on les verrait étendre peu-à-peu la sphère de leurs connaissances, désirer ensuite de l’aggrandir encore, méditer, raisonner, et, peut-être enfin, produire à leur tour: les moins capables finiraient, au moins, par copier, et ce serait autant de gagné pour eux et pour le pays. Vous ajouteriez donc au bien que fait votre Journal sons d’autres rapports, et peut-être aussi en augmenteriez-vous la circulation.
C’est dans cette vue que lisant, l’autre jour, l’article suivant, dans les “Archives des Découvertes et des Inventions nouvelles, faites en 1824, dans les Sciences, les Arts et les Manufactures, tant en France que dans les Pays étrangers,” je l’ai copié de suite pour votre Bibliothèque Canadienne, persuadé qu’il pourrait être utile à plusieurs de nos Tanneurs; le style me paraissant devoir en être à la portée de la généralité de ces utiles et industrieux artisans. Si vous êtes de mon opinion, Mr. Bibaud, donnez-lui donc insertion dans votre prochain ordinaire.
Je suis, Monsieur, votre &c. R.
Les cuirs, après avoir subi les préparations usitées, devront être examinés avec soin pour s’assurer s’il y a des trous; ceux-ci seront cousus et bouchés avec du fil très fort, afin que l’eau n’y puisse passer; ensuite on dispose trois cadres ou châssis d’égale dimension, sur l’un desquels la peau est fortement tendue par ses bords; on applique dessus un second châssis pour que la peau soit maintenue et pressée entre les deux châssis; une seconde peau est ensuite placée sur la surface extérieur du second châssis, de la même manière que la première; elle est retenue par un troisième châssis qu’on pose par-dessus. Les trois châssis portant les deux peaux sont ensuite réunis, au moyen de boulons[1] à écrous, et placés debout; on introduit alors dans l’espace ménagé entre les deux peaux la liqueur tannante, contenue dans un réservoir supérieur, en la faisant couler par un tuyau. L’air renfermé entre les peaux s’échappe par un robinet qu’on ferme lorsque cette espèce d’outre est pleine; mais on maintient la communication avec le réservoir supérieur, ce qui permet à la liqueur tannante d’agir par son poids sur celle contenue dans l’outre. II résulte de cette pression hydrostatique que la liqueur, dont on peut augmenter ou diminuer la quantité selon le besoin, est forcée de pénétrer dans les pores du cuir, et de passer au travers; elle se trouve ainsi complètement absorbée.
L’auteur assure que la préparation de ses peaux se fait en huit à neuf jours, et que des cuirs, forts de trois huitièmes de pouce d’épaisseur, qui ne pouvaient être tannés en moins d’un an par les procédés ordinaires, sont convertis par les siens, dans le cours de six semaines seulement, en cuirs parfaits à tous égards.
Quand les peaux sont tannées, on en retire la liqueur; alors les écrous sont dévissés, les châssis désassemblés et les peaux enlevées; on rogne les bords jusqu’aux endroits où les boulons ont passé; puis on les fait sécher et on les finit à la manière ordinaire.
(Bulletin de la Soc. d’Entour. février, 1824.)
|
Grosses chevilles de fer. |

Rockaway, 16 Août, 1819.
Dans une de nos promenades de ces jours derniers, nous nous trouvions accompagnés d’un Monsieur européen, avec qui nous avions fait connaissance à New-York, et pour qui j’avais une lettre de recommandation. Il est venu passer ici une couple de jours avec nous. Il est de la Belgique. Il y possédait des terres. Nous avons été nous promener ensemble dans notre voiture, jusqu’à near-Rockaway et comme les hayes vives sont un objet extrêmement intéressant à mes yeux, parce que rien ne serait, suivant moi, plus avantageux pour le Bas-Canada que d’y en introduire l’usage, j’ai fait tomber la conversation sur cet objet, en appercevant celles qui bordent le chemin en plusieurs endroits. Il m’a dit qu’elles ne se font pas ainsi dans les Pays-Bas. Suivant lui, quand on veut faire une haye vive, on commence par creuser un fossé le long de la ligne dans laquelle on veut la planter; et l’on jete les terres du côté où on se propose de l’avoir. Alors on sème des grains ou noyaux d’épines sur cette élévation, et on laisse croître les petits arbres pendant trois ou quatre ans, ayant le soin de n’en jamais laisser approcher les animaux qui, très friants des feuilles, surtout quand elles sont jeunes et tendres, feraient périr les arbres en les broutant.
A mesure qu’ils croissent, on entrelasse les branches qui peuvent se croiser, et on coupe celles qui s’écartent de la direction que l’on a donnée à la haye. Au bout de huit à dix ans, on a une clôture solide, à travers laquelle les petits animaux ne sauraient passer, et qui n’exige plus désormais que quelques journées de travail, chaque printemps, pour la tailler, et couper les branches superflues, sans aucun autre frais, ni dépense, pour l’entretenir. Mais il observait en même temps, que cette espèce de haye demande un excellent terrain ou de l’engrais, au moins pendant les premières années.
Je suis entré dans quelques détails à ce sujet, parce que dans un pays où le bois commence à devenir aussi rare qu’il l’est déjà en plusieurs endroits du Bas-Canada, et où la consommation en doit nécessairement être aussi considérable à raison de la dureté du climat, il me semble qu’il serait du plus grand avantage pour les propriétaires de terres d’avoir recours à ce moyen économique de les enclore. Tu diras peut-être que tout ce que j’écris sous la dictée de ce Belge n’est pas nouveau; que c’est du rebattu que l’on retrouve dans tous les livres d’Agriculture, et que l’on peut apprendre de tous ceux qui ont voyagé en Europe. Tout cela est vrai, et je ne crois pas en avoir de moins bonnes raisons de l’écrire. Si jamais ces lettres sont lues par quelques amis, ce que j’en ai dit leur rappellera ce qu’ils ont déjà lu ou entendu dire à ce sujet. Ils en causeront peut-être ensuite. Il n’en faut pas davantage peut-être pour faite naître à quelqu’un l’idée de tenter l’expérience. Cet exemple une fois donné pourrait, comme beaucoup d’autres, être imité. On ne fait pas assez d’attention à tout le bien que l’on peut faire par des moyens de cette espèce. Le peuple ne lit point, ou ne lit guère, chez nous. Il agit et raisonne d’après ce qu’il voit de ses propres yeux.—Combien de nouvelles méthodes de culture se sont ainsi propagées, depuis une trentaine d’années, parmi nous! J’ai connu le curé d’une paroisse dont les habitans, non plus que ceux des paroisses voisines, ne connaissaient point encore, lors de son arrivée parmi eux, la culture des plantes légumineuses: surtout celle des pommes de terre, que nous appellons patates, en Canada. Il leur parla des avantages qu’ils pourraient en retirer, leur donna à ce sujet toutes les explications nécessaires, et entra dans les détails les plus propres à leur persuader d’y donner leurs soins. Il aurait prêché et prêcherait encore inutilement jusqu’à ce jour, si tant il avait vécu. Il aurait, comme tant d’autres, perdu son temps et ses peines. Heureusement, il y avait une petite terre attachée à la cure. Il prit le parti d’y faire planter des patates, avec soin, en recueillit de grandes quantités, qu’il employa d’une manière très profitable chez lui, tant pour la table que pour la nourriture des animaux de ses fermes et des siens propres. Il n’en fallut pas plus pour exciter l’attention de ses voisins, jusque là sourds à tous ses avis.
Ils avaient accueilli ses leçons et les belles idées philanthropiques dont il assaisonnait ses discours, avec la plus parfaite indifférence: mais le sentiment de l’intérêt les ont bientôt tirés de cet engourdissement, quand ils purent se convaincre qu’il y avait un profit à tirer de ces patates, qu’ils avaient d’abord regardées avec un souverain mépris. Leurs champs en furent bientôt couverts à leur tour. Ils ne manquèrent pas non plus d’imiter la méthode que le fermier du curé employait, et qui d’après les avis de son maître en avait une excellente pour les cultiver.—De proche en proche, ce genre de culture s’est étendu dans la paroisse et dans les paroisses voisines; c’est peut-être de toute la province la contrée où il est porté au plus haut point de perfection.
Mais en voilà assez sur cet article: je toucherai peut-être encore quelques autres objets d’agriculture, dans les lettres qui suivront celle-ci. Il ne se présente guère d’autres sujets d’observations ici. J’ai pour principe qu’il faut toujours s’efforcer de tirer de sa situation le meilleur parti possible. Ici, il n’y a point de choix à faire.—Adieu.
Les fils et les tissus du lin et du chanvre, dont les toiles sont fabriquées, doivent être considérées comme composés de fibres blanches, unies à une certaine quantité de matière colorante. L’opération du blanchiment ou du blanchissage des toiles consiste à détruire cette matière. Dans les grands ateliers, on parvient à ce but, en fesant tremper les toiles dans de l’eau pendant quelques jours, en les lessivant à plusieurs reprises, en les plongeant après chaque lessive dans une solution d’acide muriatique oxigéné, en les traitant ensuite par l’acide sulfurique très-faible, en les lavant à grande eau après chaque opération, et en les exposant au contact de L’air et de la lumière. Dans d’autres ateliers, on parvient au même but en fesant usage de la potasse et de quelques autres substances que les différents cultivateurs ne pourraient se procurer que difficilement et à des prix assez considérables. Le procédé que l’on vu décrire est un peu plus long et moins parfait, mais il a du moins l’avantage d’être peu dispendieux, et de pouvoir être pratiqué dans toutes les maisons de la campagne. Voici en quoi il consiste.
On commence par faire tremper les toiles, pendant deux ou trois jours, dans des cuves pleines d’eau tiède; il s’établit une fermentation qui détruit la colle dont les tisserands enduisent les fils de la chaîne, pour faciliter le jeu du peigne ou rot[1]. Cette opération est plus ou moins longue selon la température. Lorsque l’on n’a point collé les toiles en les fabriquant, il est bon de mêler un peu de son dans l’eau, afin d’exciter la fermentation dont on vient de parler. On ne doit faire usage que d’eau très limpide et légère dans le blanchiment des toiles.
Quelque temps après que l’on a laissé tremper la toile dans l’eau tiède, le liquide entre en fermentation, il s’élève des bulles d’air, il se forme une pellicule sur la surface de l’eau, la toile s’enfle, et s’élève quand elle n’est pas retenue par un couvercle. L’écume commence alors à tomber au fond. C’est à ce moment qu’il faut tirer la toile de la cuve.
Il faut la laver ensuite à grande eau et à plusieurs reprises, afin d’enlever la crasse que la fermentation en a détachée. Si l’on a une machine à fouler, on peut s’en servir à faire ce lavage. On étend ensuite la toile sur un pré pour la faire sécher.
Quand elle est parfaitement sèche, il faut la lessiver. Pour cela, on la place dans une grande cuve par rangées, et on a l’attention de mettre dessus les toiles qui exigent une lessive plus forte. On recouvre le tout d’une toile grossière mais serrée; on forme sur cette toile une couche de cendre. Ces cendres doivent être tamisées avec soin, et n’étoyées de tous corps étrangers; il en est de même de toutes les cendres que l’on emploie à faire les lessives dont on fait usage dans le blanchiment des toiles. On recouvre cette couche de cendre d’une autre grosse toile, puis on y jette quelques seaux d’eau chaude, et bientôt après, de la lessive bouillante. Cette lessive serait préférable si elle était formée avec des cendres obtenues de la combinaison des côtes et des tiges de tabac.
La lessive pénètre toute la masse et s’écoule par une bonde qui est pratiquée au fond de la cuve. On la reçoit dans un vase, et après l’avoir fait chantier de nouveau, on la reverse continuellement sur la cuve. Ces coulées durent l’après-midi et toute la nuit, sans aucune interruption.
Le matin, au point du jour, les toiles sont portées et étendues sur le pré; on les arrose de tems en tems, jusque vers les dix heures. Vers midi, on les reporte dans la cuve pour leur donner une seconde lessive, et l’on répète ces opérations ou manœuvres alternatives d’exposition sur le pré et de lessivage pendant au moins 15 jours. Il est bon d’augmenter graduellement la force de la lessive pendant les trois premiers, et de la diminuer par degrés les derniers jours du lessivage.
Quand on juge que les toiles ont assez de lessive, on les fait tremper, pendant au moins 24 heures, dans du lait sûr (du petit lait aigri.) On peut ajouter au-petit lait, du lait de beurre, on du lait écrémé. Si l’on n’a point assez de petit-lait, on peut ajouter de l’eau tiède, dans laquelle on a mis du son fermenter. La farine et le son de seigle seraient préférables.
On savonne ensuite les toiles à la main ou dans des machines à fouler.
Après chaque savonnage, on les reporte au pré, d’où on les retire pour les passer au lait. On répète ces opérations cinq à six fois, jusqu’à ce que la toile ait acquis la blancheur convenable.
A défaut de petit-lait aigri, on pourrait faire fermenter les toiles dans de l’eau tiède mêlée de son. Il serait bon de faire aigrir cette eau d’avance. Les dernières de ces opérations doivent se faire dans un petit-lait aigri, pour donner plus de douceur aux toiles.
Lorsque l’on juge que les toiles ont la blancheur convenable, on les savonne avec soin, et on les lave dans de l’eau claire pour la dernière fois.
Pour donner du lustre aux toiles, on les passe dans une cuve d’eau tenant de l’amidon, ou de l’empois, en dissolution, et on les cylindre à demi-sèches. Cette opération consiste à faire passer les toiles entre deux rouleaux de bois dur et poli, ou même de métal. Les rouleaux de bois sont traversés, chacun, par un axe de fer, dont les deux extrémités servent de tourillons, et sont placés l’un au-dessus de l’autre sur deux montans solides. Les tourillons du rouleau supérieur sont engagés dans une rainure pratiquée dans les montans; ils n’y sont point fixés, de sorte que ce cylindre peut s’élever librement et peser sur l’autre de tout son poids. Si sa pesanteur n’est pas assez considérable pour presser fortement la toile, on peut empêcher les deux tourillons de s’élever en les arrêtant, par-dessus, par deux coins, ou clefs de bois dur, que l’on prend en mortaise dans les deux montans, et que l’on enfonce plus ou moins, selon le degré de pression que l’on désire. La longueur des cylindres est d’environ 4 pieds, et se détermine par la largeur de la toile.
Quand on veut faire usage de cette machine, on engage un des bouts de la pièce de toile entre les deux cylindres, et on enfonce les deux coins, dont on vient de parler, plus ou moins selon la grosseur de la toile. On fait tourner, en sens contraire, la manivelle que porte l’un des tourillons dans chacun des deux cylindres. Ces deux manivelles sont en dehors des montans, l’une à droite et l’autre à gauche. La toile coule rapidement entre les deux rouleaux, s’unit et se glace par la pression qu’elle éprouve.
Il faut avoir l’attention de l’étendre bien uniformement dans sa largeur, à mesure qu’elle s’engage entre les deux rouleaux, afin qu’il ne s’y forme aucun pli.
Il est bon d’observer que, pour donner une certaine blancheur aux toiles, il faut absolument que le lin ou le chanvre qui ont procuré les filasses dont on les a fabriquées, aient été rouis dans l’eau.
|
Cette colle ou eau d’empois se fait avec de l’amidon; elle doit être très-alaire: on l’applique à mesure que l’ouvrage avance. |

Vulcain était le dieu tutélaire de ce mois. Ses statues le représentent presque nu, ayant seulement sur l’épaule une espèce de marteau. Ausone lui fait tenir un lézard qui se démène, et place auprès de lui des cuves et autres vases préparés pour la vendange. Les modernes le peignent le visage riant, couronné de pampres, vêtu de pourpre, à raison de ses magnifiques présens; tenant d’une main le signe de la balance, parce que l’équinoxe d’automne ramène, dans ce mois, l’égale partage des heures entre le jour et la nuit, et de l’autre, une corne d’Amalthée, pleine de raisins, de pêches, de poires, &c. Un enfant qui foule le raisin, et une treille, désignent la principale richesse de ce mois. Cl. Audran, pour le caractériser, a représenté Vulcain assis sur une enclume, sous un pavillon soutenu de deux colonnes chargées des instrumens de sa forge. Plus bas, est la salamandre, et des Cyclopes forgent la foudre de Jupiter. Les casques, cuirasses, bombes, mortiers, &c. sont les attributs.

Une mine d’or extrêmement riche a été découverte dans l’île d’Aruba, dépendance de la colonie hollandaise de Curaçao.
Ce furent les Indiens auxquels le hazard fit faite cette découverte entre les montagnes, au mois de mars, 1824; ils vendirent à des Juifs les morceaux d’or qu’ils trouvèrent. Cet évènement fut tenu quelque temps secret, parce que peu de personnes encore connaissaient les endroits où l’on pouvait trouver de l’or; mais la nouvelle s’en étant peu-à-peu répandue, l’on vit accourir de toutes parts vers les montagnes, pour y recueillir ce métal. Le commandant de l’île en ayant en avis, défendit toute recherche ultérieure. L’or trouvé depuis le mois de mars est de la plus grande pureté; les morceaux sont de diverse grandeurs; ou en a trouvé qui pesaient 32 livres, d’autres 14 et 16 livres.—On en a déjà reçu à Curaçao pour une valeur de plus de 150,000 dollars (750,000 fr.)—Constitutionnel du 28 Sept. 1824.
Nous ne savons quel degré de foi nous devons ajouter à ce qui nous a été dit dernièrement, savoir, que l’on a appris qu’une mine d’argent a été découverte dans le Haut-Canada, et exploitée par quatre individus, pendant ces deux dernières années, avec un profit considérable. On dit que la cause de cette découverte est provenue d’une querelle entre les exploiteurs, dont trois étaient Américains, et le quatrième Anglais. Les premiers ayant voulu, dit-on, interdire au dernier toute participation ultérieure dans leurs opérations, le ressentiment lui a fait divulguer le secret. La personne qui nous a fait ce rapport ajoute, qu’il a été envoyé avis de la chose au gouvernement, à Québec.
Pap. de Montréal, du 15.

LE PERE MOURANT ET SES DEUX FILS.—FABLE.
Un bon père, et de plus homme de très grand sens,
Touchait à son heure dernière;
Il jouissait des pleurs de ses enfans,
Et gardait à tous deux une tendresse entière.
En tête cependant il avait un projet.
Il écarte l’aîné, fait venir son cadet:
Mon fils, nous sommes seuls; prends cette clef secrète,
J’ai caché dans ce coin une riche cassette,
Où tu trouveras du comptant:
Garçon d’esprit, je te dois ce présent.
Le cadet étonné:—Que voulez-vous, mon père?
Mon cœur me le défend; un tel tort à mon frère!
Ah! reprit le vieillard, emporte et ne dis mot.
De ton frère je sais quel deviendra le lot.
Va, ce n’est pas pour lui que je crains la misère;
Il réussira: c’est un sut.
Mercier.
DÉBUT D’UN POEME SUR LE BONHEUR; PAR M. BERCHOUX.
Plus d’un poëte, hélas! sur le bonheur
A composé de malheureuses rimes;
Sur ce sujet maints prosateurs sublimes
Ont échoué, tant il porte malheur!
Helvétius, avant lui Fontenelle,
M’ont ennuyé, voulant me rendre heureux.
Maudite soit la muse criminelle
Qui fait bâiller avec l’aide des dieux!
Puisse la mienne avoir le bien suprême
De n’être point trop coupable à vos yeux!
Il est affreux d’ennuyer ce qu’on aime;
Mais vous m’aimez, et les vers d’un ami.
Tant durs soient-ils, ne blessent point l’oreille.
Si quelquefois on en est endormi,
C’est doucement; on n’y dort qu’à demi.
Pour applaudir, l’amitié se réveille.
Sur votre cœur il est doux de compter;
Je ne peins point un bonheur chimérique,
Un homme heureux est un sujet unique:
Je suis cet homme, et je vais me chanter.
PROLOGUE,
Récité par une jeune Demoiselle, aux exercices de l’Ecole de
Mademoiselle Forrence, à Montréal, le 12 Février 1825.
Parens, de nos jeux l’ornement
Ne blâmez pas légèrement
Notre prudente institutrice,
Si pour un instant sous vos jeux
Votre fille devient actrice:
Le théâtre est trop dangereux
Pour y former un cœur novice;
Il est un but plus important
Qu’on n’atteint que par l’exercice.
Et qu’il faut atteindre pourtant
Ce but où nous aspirons tant,
C’est le grand art de la parole.
Pour la vertu, sous peu de temps,
Nous retournerons, bons parens,
L’étudier à votre école.
N.

Mon premier pas dans les affaires publiques fut d’être nommé, en 1736, secrétaire de l’assemblée générale. Ce choix eut lieu cette année sans opposition; mais, la suivante, lorsque je fus proposé de nouveau, (le choix des secrétaires étant annuel comme celui des membres;) un nouveau membre de l’assemblée lit un long discours contre moi, pour favoriser un autre candidat. Je fus pourtant choisi, ce qui me fut d’autant plus agréable qu’indépendamment des appointemens attribués au secrétaire, cette place me fournissait l’occasion d’intéresser en ma faveur les membres de l’assemblée, ce qui m’assurait l’impression des opinions, des lois, du papier monnaie, et autres ouvrages officiels de circonstance; ce qui, en total, m’était fort profitable. Je ne fus donc pas fort charmé de l’opposition de ce nouveau membre, homme jouissant d’une belle fortune, ayant reçu une bonne éducation, et doué de talens qui paraissaient devoir, avec le temps, lui procurer dans la chambre une influence qu’il y obtint effectivement par la suite. Je ne cherchai cependant point à gagner ses bonnes grâces, en lui témoignant de serviles égards; mais, au bout d’un certain temps, j’usai d’une autre méthode. Ayant appris qu’il possédait dans sa bibliothèque un certain livre rare et curieux, je lui écrivis un billet pour lui exprimer le désir de m’en servir, et pour le prier de me faire le plaisir de me le prêter pour quelques jours. Il me l’envoya sur-le-champ; et moi, au bout d’une semaine, je le lui renvoyai accompagné d’un nouveau billet, avec les plus vifs remercîmens pour sa complaisance. La première fois que nous nous rencontrâmes dans la Chambre, il m’adressa la parole, ce qu’il n’avait jamais fait auparavant, et me témoigna beaucoup de civilités; et, depuis ce temps, il s’est toujours montre disposé à m’être utile en toute occasion; si bien que nous sommes devenus grands amis, et que notre amitié a duré jusqu’à sa mort.
C’est un nouvel exemple de la vérité d’une vielle maxime que j’avais apprise, et qui dit:—Celui qui vous a une fois rendu service, sera plus disposé à vous en rendre un autre, que celui que vous avez obligé vous-même. On voit aussi, par là, combien il est plus profitable d’écarter avec prudence les occasions d’inimitié, que de les saisir en s’y montrant trop sensible, que d’y répondre par de l’aigreur, que de les perpétuer par des procédés désobligeants.
Supposez un pays X, avec trois manufactures, par exemple: de drap, de soie, de fer, ayant l’approvisionnement de trois autres pays A, B, C, mais, désirant augmenter la vente et élever le prix du drap, en faveur des seuls fabricans de drap.
En conséquence, on prohibe les draps venant de A.
A, par représailles, prohibe les soieries de X.
Il suit de là que les fabricans de soieries se plaignent de la diminution du commerce.
Cependant X, pour les satisfaire, prohibe les soieries de B.
B, par représailles, prohibe les fers forgés de X.
Il suit de là que les maîtres de forges se plaignent de la diminution du commerce.
Alors, X prohibe les fers provenant de C.
C, par représailles, prohibe les draps de X.
Qu’est-il résulté de toutes ces prohibitions?
Réponse.—Chacun des quatre pays a éprouvé une diminution dans la masse commune des jouissances et des commodités de la vie.
Dans mon opinion, il n’y a jamais eu ni bonne guerre, ni mauvaise paix. De quelles immenses améliorations pour les agrémens et les commodités de la vie, se serait enrichie l’espèce humaine, si l’argent dépensé pour la guerre avait été employé à des ouvrages d’utilité publique? Quelle extension l’agriculture n’aurait-elle pas reçue, même jusqu’au sommet de nos montagnes! Combien de rivières rendues navigables, ou réunies par des canaux! Que de ponts, d’aqueducs, de nouvelles routes; que d’autres ouvrages publics, que d’édifices et d’améliorations qui auraient fait de l’Angleterre un vrai paradis terrestre! Voilà ce que l’on aurait obtenu, si l’on avait consacré à faire le bien tant de millions consommés pour faire le mal, pour porter la misère dans plusieurs milliers de familles, et pour ôter la vie à tant de milliers d’êtres laborieux, dont le travail pouvait être utile.
Mon cher Monsieur,—J’ai reçu votre lettre du 15 du courant (Avril,) et le mémoire qui y était joint. Le tableau que vous me faites de votre situation m’afflige. Je vous envoie, ci-inclus, un billet de dix louis. Je ne prétends pas vous donner cette somme; je ne fais que vous la prêter. Lorsque vous retournerez dans votre patrie, avec une bonne réputation, vous ne pourrez manquer de prendre un intérêt dans quelque affaire qui vous mettra en état de payer toutes vos dettes; dans ce cas, si vous rencontrez un honnête homme qui se trouve dans une détresse semblable à celle que vous éprouvez en ce moment, vous me payerez en lui prêtant cette somme, et vous lui enjoindrez d’acquitter sa dette par une semblable opération, dès qu’il sera en état de le faire, et qu’il en trouvera une occasion du même genre.—J’espère que les dix louis passeront de la sorte par beaucoup de mains, avant de tomber dans celles d’un malhonnête homme qui veuille en arrêter la marche. C’est un artifice que j’emploie pour faire beaucoup de bien avec peu d’argent. Je ne suis pas assez riche pour en consacrer beaucoup à de bonnes œuvres, et je suis obligé d’user d’adresse, afin de faire le plus possible avec peu. C’est en vous offrant tous mes vœux pour le succès de votre mémoire et pour votre prospérité future, que j’ai l’honneur d’être, mon cher Mr., votre, &c.
La dernière fois que je vis votre père (Mr. Mather,) ce fut au commencement de 1724, à Boston, après mon premier voyage en Pensylvanie. Il me reçut dans sa bibliothèque, et, quand je pris congé de lui, il me montra un chemin plus court pour sortir de la maison, par un passage étroit, qui était traversé par une poutre à hauteur de tête. Nous causions encore, lorsque je me retirais, lui me suivant, et moi me retournant à moitié de son côté, quand il me cria vivement: baissez-vous! baissez-vous! Je ne compris ce qu’il voulait me dire, que lorsque je sentis ma tête frapper contre la poutre. C’était un homme qui ne manquait jamais une occasion de donner une leçon utile, et il me dit dans celle-ci:—“Vous êtes jeune, et vous allez entrer dans le monde; baisses-vous pour le traverser, et vous éviterez plus d’une rude atteinte.” Ce conseil, imprimé de la sorte dans ma tête, m’a été fréquemment utile, et j’y pense souvent quand je vois l’orgueil humilié et les malheurs qu’éprouvent ceux qui portent la tête trop haute.

Si les merveilles de la nature qui ont le mérite particulier d’une extrême rareté doivent de préférence trouver place dans cet ouvrage, la Forêt souterraine qui a été découverte en 1808, en Angleterre, ne saurait être oubliée. Ce fut à la suite d’une très haute marée, qu’une brèche s’étant faite dans une des digues de la Tamise, les marais de Dagenham et de Havering, dans le comté d’Essex, furent entièrement inondés. La force de l’eau fut même si grande, qu’elle y creusa un canal dont la largeur est de près de trois cents pieds, et la profondeur de vingt. Cette inondation qui, de temps immémorial, n’avait pas en sa pareille, frappa d’étonnement tous les habitans du pays; mais une surprise bien plus grande leur était réservée; car, lorsque les eaux furent retirées, ils apperçurent dans le canal, nouvellement creusé, un grand nombre d’arbres qui y étaient enterrés depuis plusieurs siècles. Tous, à l’exception d’un gros chêne, qui avait la plus grande partie de son écorce, de sa tête et de sa racine, dans l’état le plus parfait, étaient des aunes. Ils étaient devenus noirs, durs, coriaces, et tout prouvait qu’ils avaient vicilli dans ce sol marécageux, où ils venaient d’être trouvés, et sur la surface duquel ils s’élevaient horizontalement. Une couche épaisse de terreau les avait jusqu’alors tenus cachés.
Cette première découverte ayant excité la curiosité générale, tout le monde se mit a suivre le cours du canal, et l’on vit une continuité de ces troncs et de ces arbres souterrains, dans la même position où ils avaient été plantés ou semés. Les racines et les branches de la plupart d’entr’eux offraient tous les signes qui se manifestent dans les arbres naissants. Il restait à examiner si l’époque à laquelle on pouvait raisonablement faire monter leur disparation datait du déluge, ou de quelque grande inondation de la Tamise. Nul doute qu’elle ne fût très ancienne.—Dans l’incertitude où les savans étaient de fixer leur opinion à cet égard, l’apparition d’un lit de coquilles au-dessus duquel un ruisseau, qui a une communication directe avec la Tamise, coule à la profondeur perpendiculaire de vingt pieds, et à la distance d’environ deux cents dans la plaine, fut pour eux un trait de lumière, et leur démontra que, puisque ce lit de coquilles avait été déposé dans cette place, il fallait nécessairement qu’il y eût été amené par une inondation précédente de la Tamise, qui, ayant couvert une grande étendue de terrain, y avait enseveli tous les arbres qu’elle avait trouvés sur son passage.
Ce jeu de la nature peut s’expliquer par la qualité du sol, qui étant spongieux, clair, marécageux, et rempli de racines et de roseaux, a reçu, malgré la couche de terreau dont il était recouvert, assez d’air pour conserver la végétation aux plantes souterraines qu’une inondation extraordinaire avait fait disparaître.

Celui-ci est presque tout de notre temps. On en trouve à peine quelque trace en France dans les siècles passés. Il semble que l’homme soit condamné, par la faiblesse de son esprit, à d’éternelles erreurs, puisqu’on ne sort d’un préjugé que pour retomber dans un autre. On a reproché aux nobles, qu’ils se glorifiaient sottement de leurs ancêtres: on leur a dit, avec raison, que le petit-fils de Bayard, de Turenne et de Rolland pouvait bien n’être qu’un homme ordinaire. Eh bien! ce vain orgueil, fondé sur des préjugés vulgaires; ce ridicule que les philosophes ont si bien rejette sur la noblesse, ils s’en couvrent maintenant, sans s’en appercevoir.
On nous dit, tous les jours, que les descendans de Corneille, de Racine, de Lafontaine, sont dans l’obscurité; que les œuvres de leurs grands-pères ont fait la gloire de la France, et font aujourd’hui la fortune des comédiens et des libraires; que la nation doit embellir le sort des descendans d’un grand homme, &c.: cependant, on n’applaudirait pas un acte du gouvernement qui enrichirait la postérité d’un grand général, parce que ce serait la postérité d’un grand général.
Que me fait le descendant d’un homme de génie, s’il n’a pas le génie de son ayeul? Un fils de noble peut-être un lâche; un fils de poëte peut-être un sot. Si Racine a honoré notre littérature, Turenne a honoré nos armes. Si on paie aux descendans de Racine la rente des tragédies de leur père, on doit donner aux petits-fils de Turenne des rentes sur les provinces que leur ayeul a soumises, et alors il n’y aura plus de propriété nationale.
On fait cas d’un coursier, qui, fier et plein de cœur,
Fait paraître, en courant, sa bouillante vigueur;
Qui jamais ne se lasse, et qui dans la carrière,
S’est couvert mille fois d’une noble poussière:
Mais la postérité d’Alfane et de Bayard,
Quand ce n’est qu’une rosse, est vendue au hazard,
Sans respect des ayeux dont elle est descendue,
Et va porter la malle ou tirer la charrue
Pourquoi voulez-vous donc que, par un sot abus,
Chacun respecte en vous un honneur qui n’est plus?
Boileau, Satire V.
Si le fils de Corneille a du génie, qu’il vive de ses travaux, comme son père a vécu de ses veilles. Si ce n’est qu’un lourdaud, qu’il soit cordonnier, et qu’on ne nous montre pas la branche dégénérée d’une souche honorable.
Ceux qui demandent que les pièces dramatiques soient une propriété perpétuelle dans la famille de l’auteur, songent pins à leur intérêt qu’à la gloire nationale,.... Nos auteurs n’ont cependant pas à se plaindre de l’état des choses, et c’est maintenant une bonne fortune pour eux qu’une comédie médiocre....
Je crois que les traits suivants tiennent un peu d’un fanatisme littéraire. Un homme de robe apporta à Malherbe de méchants vers qu’il avait faits pour sa femme, Malherbe, après les avoir lus, lui demanda s’il avait été condamné à être pendu, ou à faire ces vers-là?....
Boileau disait, un jour: “A moins que le roi m’ordonne de trouver bons les vers de Chapelain, je soutiens que celui qui en fait de pareils mérite d’être pendu....” Moliere a saisi ce trait de ridicule, et l’a placé dans son Misanthrope.
Hors qu’un commandement exprès du roi me vienne,
De trouver bons les vers dont on se met en peine,
Je soutiendrai toujours, morbleu! qu’ils sont mauvais,
Et qu’un homme est pendable après les avoir faits.
Dictionnaire de la Folie et de la Raison.

Doyen n’étoit pas un excellent peintre, mais c’étoit un artiste dans toute la force de la qualification honorable attachée à ce nom. Libre par goût et par caractère, ennemi de ces vanités puériles qui charment les hommes médiocres; jaloux des droits que sembloit devoir lui assurer sa position au milieu des courtisans vendus à toutes les volontés du maître, Doyen alloit souvent à Versailles. Le roi le recevoit très bien; il aimoit son talent, bien que Pierre fût alors premier peintre: il estimoit sa personne, parce qu’il trouvoit en lui une grande indépendance d’idées et d’expressions, qualité-phénomène, que le monarque auroit en vain cherchée dans la cour où régnait madame Dubarry.
Louis XV avoit alors un jeune favori. Ce familier en titre s’étoit habitué à prendre avec toutes les personnes qui approchoient du monarque des privautés qui accusoient sa mauvaise éducation. Les plaisanteries du plus mauvais goût, les plus sottes espiègleries étoient les passe-temps ordinaires de ce domestique à parchemins.
Un jour, le roi avoit convoqué ses ministres; les affaires étoient pressantes. Les secrétaires d’état étoient arrivés au château, dans un salon de l’Œil de bœuf; ils attendoient le moment du travail.... Le favori, que le roi regardoit sans doute comme un animal sans conséquence (c’étoit ainsi du moins qu’aux petits appartements, on regardoit madame Duhausset, confidente de madame la marquise Poisson,) le favori étoit là. On s’ennuyoit, on médisoit: les affaires du monde, et les nouvelles de l’Opéra étaient en jeu; on préludoit aux discussions qui alloient s’agiter au cabinet du prince, en parlant de la nymphe en crédit au Vauxhall de Thoré....Il prit au favori du roi la fantaisie de porter aux jambes de leurs excellences de ces coups de mouchoirs roulés qu’on appelle du nom d’anguilles. Nos seigneurs n’osoient se plaindre de la licence de cet insolent, et chacun à son tour essuyoit la bordée qu’une risée impudente accompagnoit.
Doyen étoit présent, attendant l’audience de Louis XV.—Quand le favori eut exercé son adresse sur toutes ses complaisantes victimes, il se retourna du côté de Doyen, et le frappa comme il avoit fait le chancelier, le contrôleur des finances, le ministre de la guerre, l’intendant de police, et cet intendant des postes qui livroit gaiement au souverain le secret des lettres et l’honneur des familles. Doyen ne put esquiver l’anguille, mais s’élançant avec rapidité, il saisit le favori, et, lui appliquant un vigoureux soufflet, lui dit: Faquin, me prends-tu pour un Ministre?
Ce soufflet retentit à l’Œil de bœuf; on en rit beaucoup, parce qu’il humilioit les esclaves en dignité. Le roi apprit l’anecdote, qui le divertit fort. Doyen eut une audience où Louis XV témoigna que cette hardiesse envers son favori ne lui déplaisoit pas; et quand il sortit du cabinet de sa majesté, il fut salué profondément par tous les grands seigneurs, comme l’avoit été, au siècle précédent, le bon-homme Jean Bart, quand il eut corrigé les courtisans de Louis XIV, dans la galerie de Versailles.

En remuant, dernièrement, mes paperasses, j’y ai trouvé une feuille de papier contenant le morceau suivant, que je me rappelle d’avoir extrait, autrefois, en substance, du volume de l’Histoire Ancienne de Rollin où il est traité des Sciences et des Arts.—N’ayant pas ce volume sous la main, dans le moment, je regrette de n’avoir pas fait mon extrait un peu plus ample; mais je pense que, tel qu’il est, son insertion dans le Bibliothèque Canadienne peut-être de quelque utilité, ne serait-ce qu’en donnant à quelques uns des lecteurs de ce journal, le désir d’acquérir au moins des connaissances élémentaires dans le bel art de l’architecture. M.
Il y a cinq ordres d’architecture, le Dorique, l’Ionique, le Corinthien, le Toscan et le Composite, auxquels on peut ajouter la Gothique. Les trois premiers ont été inventés par les Grecs; les deux suivants par les Romains, et le dernier, par les peuples du nord de l’Europe. L’ordre dorique, à cause de sa solidité, convient aux grands édifices, aux portes de villes, aux dehors des temples, aux places publiques, et autres lieux semblables. L’ordre ionique, plus délié que le précédent, convient aux bâtimens plus délicats, aux dedans des églises, aux portes des maisons, des jardins, &c. L’ordre corinthien, qui ne différé de l’ordre ionique que par le chapiteau, qui est plus orné, est propre aux mêmes constructions: c’est le plus parfait de tous les ordres d’architecture. Le toscan est de tous les ordres le plus simple et plus dépourvu d’ornemens; on ne l’emploie guère que dans la construction des amphithéâtres et autres bâtimens semblables, où il n’est besoin que d’un seul ordre. Le composite participe de l’ionique et du corinthien: il est même plus orné que ce dernier. L’ordre gothique, ou plutôt l’architecture gothique, est celle qui s’éloigne des proportions antiques, et est chargée d’ornemens superflus. On la distingue en vieille et nouvelle. La vieille était grossière et pesante; la nouvelle est plus délicate, plus déliée, et d’une hardiesse à causer de la surprise.
Chez les Grecs, les ordres étaient composés de colonnes et d’un entablement; les Romains ont posé des piédestaux sous les .colonnes, pour leur donner plus de hauteur. La colonne est un pillier rond destiné à soutenir ou à orner un bâtiment. Toute colonne est composée d’une base, d’un fut et d’un chapiteau. La base est la partie de la colonne qui est au-dessous du fut, et qui pose sur le piédestal. Elle a une plinthe qui est une pièce plate, et des moulures, qui représentent les anneaux dont ou liai le bas des pilliers, pour les empêcher de se fendre. Ces anneaux se nomment tores, quand ils sont grands, et astragales, quand ils sont petits. Les tores laissent ordinairement entr’eux des intervalles creusés en rond, que l’on nomme scoties ou trochiles. Le fut est la partie de la colonne, ronde et unie, qui s’étend depuis la base jusqu’au chapiteau: elle doit être plus étroite par le haut que par le bas. Le chapiteau est la partie supérieure de la colonne, et qui pose immédiatement sur le fut.
L’entablement est la partie de l’ordre qui est au-dessus des colonnes: il comprend l’architrave, la frise et la corniche.—L’architrave représente une poutre et porte immédiatement sur les chapiteaux des colonnes. On la nomme en grec épistyle. La frise est l’intervalle qui se trouve entre l’architrave et la corniche: elle représente le plancher du bâtiment. La corniche est le couronnement de l’ordre entier: elle est composée de plusieurs moulures, qui saillent les unes sur les autres.
Le piédestal est le partie le plus basse de l’ordre: c’est un corps quarré qui renferme trois parties; le socle, qui porte sur l’aire ou le pavé; le dé, qui est sur le socle, et la cymaise, qui est la corniche du piédestal, et sur laquelle la colonne est assise.
Sur 19 parties égales, on en donne ordinairement 4 au piédestal, 12 à la colonne avec le basent le chapiteau, et 3 à l’entablement. Une colonne peut avoir pour hauteur, 8, 9, 10, &c., de ses diamètres.
La différence qui se trouve entre le rapport des hauteurs des colonnes avec leurs diamètres; entre leurs bases, leurs chapiteaux et leurs entablemens, forme la différence des cinq ordres d’archicture: mais c’est principalement par leurs chapiteaux qu’on peut les distinguer. Les colonnes doriques et toscanes n’ont à leurs chapiteaux que des moulures en forme d’anneaux, et par-dessus une pièce plate, que l’on nomme tailloir. Le dorique est distingué du toscan par la frise; dans l’ordre toscan, le frise est unie; tandis que dans le dorique elle est ornée de triglijes, qui sont des bossages oblongs, imitant les bouts de plusieurs poutres, qui porteraient sur l’architrave pour former un plancher. Cet ornement est propre à l’ordre dorique.
Le chapiteau ionique se reconnaît par ses volutes, qui sont des enroulemens spiraux sortant de dessous le tailloir.—Le chapiteau corinthien est orné de deux rangs de huit feuilles, chacun, et de huit petites volutes, qui sortent d’entre les feuilles. Le chapiteau composite est formé du chapiteau corinthien et de l’ionique: il y a deux rangs de huit feuilles, et quatre grandes volutes, qui paraissent sortir de dessous le tailloir.

Hedelin, abbé d’Aubignac, fit une tragédie en prose, qu’il intitula Zénobie; et il prétendait qu’elle était conforme en tout aux règles d’Aristote. Cette pièce n’eut aucun succès; ce qui fit dire au grand Condé. “Je sais bon gré à l’abbé d’Aubignac devoir suivi les règles d’Aristote; mais je ne pardonne pas aux règles d’Aristote d’avoir fait faire à l’abbé d’Aubignac une si mauvaise tragédie.”
Lulli, un des plus célèbres musiciens qui aient paru en Europe, obtint de Louis XIV d’être reçu secrétaire à la chancellerie, malgré l’opposition de tous les membres de cette compagnie. Comme M. De Louvois lui reprochait sa témérité, de briguer une place dans un corps dont il était membre, lui qui n’avait d’autre recommandation que le talent de faire rire: “Eh! tête bleue, répondit Lulli, vous en feriez bien autant, si vous le pouviez.”
Le comte de Maurepas, disgracié et exilé, s’en allait dans une de ses terres: chemin faisant, un homme qui ignorait sa disgrâce, s’approcha de lui, pour lui parler d’affaires. “Permettez, monseigneur,” lui dit-il, “que quoique vous soyez en route,” “....Ah! monsieur, dites en déroute,” répondit l’ex-ministre.
Un plaisant se trouvant un jour à la table d’un lord, ce seigneur fit servir à la fin du repas, un très petit flacon devin, dont il ne cesait de vanter les qualités, et surtout l’âge; “Qu’en pensez-vous,” lui dit le lord? “Ma foi, milord,” répondit-il, “il est bien petit pour son âge.”
Le maréchal de Saxe faisait, dans son camp, l’éloge d’un officier absent: un militaire dit: “Oui, mais Chevert est un officier de fortune.” M. de Saxe, qui le savait, feignit de Fignoler, et répliqua brusquement: “Vous me l’apprenez; je n’avais pour lui que de l’estime; je vois que je lui dois encore du respect.”
Louis XV passant devant les grenadiers à cheval, dit au lord Stanley, qui se trouvait à portée: “Milord, vous voyez-là les plus braves gens de mon royaume; il n’y en a pas un qui ne soit couvert de blessures,” Le lord lui répondit: “Sire, que doit penser votre majesté de ceux qui les ont blessés? Ils sont morts,” répartit un vieux grenadier.
Un homme de lettres répondit, un jour, à quelqu’un, qui lui disait que Vigée était le premier de nos poëtes négligés:
Ah! mon ami, tu l’as bien mal jugé:
Ne sois donc plus dupe d’un vain prestige.
Non, ce n’est point un auteur négligé;
C’est seulement un auteur qu’on néglige.
Une dame voyant, dans une compagnie, un homme qui éclatait de rire à tout propos, et sans paraître même en avoir envie, dit tout bas à quelqu’un qui était à côté d’elle: “Cet homme rit toujours de toutes ses forces, et jamais de tout son cœur.”
Un politique disait d’un grand prince qui a négocié toute sa vie: “Ce prince doit faire grande chère; car il traite toujours.”
On étouffait, un jour, au parterre de l’opéra: c’était précisément dans le temps que les arrêts du conseil venaient de paraître au sujet de la réduction des effets royaux. Un plaisant s’écria: “Ah! où est notre cher abbé Terray? Que n’est-il ici pour nous réduire à moitié!”
Un médecin était au chevet d’un malade: “que sentez-vous?” lui disait il.—“Je sens....un ignorant,” reprit le malade.
Le régent de France demandait, un jour, à Fontenelle quel jugement il fallait porter des ouvrages en vers.—“Monseigneur, répondit celui-ci, dites toujours qu’ils sont mauvais; sur cent fois, vous ne vous tromperez pas deux.”
Le plaisir de la conversation mêlé à celui de la bonne chère, est un préservatif contre l’intempérance. Piron disait à ce sujet; “Les morceaux caquetés se digèrent plus aisément.”
Le grand Frederic a dit fort plaisamment au sujet des courtisans, “qu’un souverain était presque toujours l’homme de ses états, qui par bienséance, voyait la plus mauvaise compagnie.”
Avez-vous des bons à vendre, disait, un jour, un spéculateur à quelqu’un qui passait au Perron? “Avez-vous des bons à vendre?” “Du tout,” lui répondit ce particulier; “nous n’en avons déjà pas de trop.”

Un fait bien remarquable a eu lieu, ces jours derniers, dans la paroisse Saint-Ambroise, à environ neuf milles de Québec. Deux enfans, l’un âgé de sept ans, l’autre de cinq, s’amusaient dans un champ à faire les petits moissonneurs, pendant que leurs parens étaient allés dîner à la maison. Un aigle apparaît soudain, planant au-dessus d’eux, et visant le plus grand des enfans, il fond dessus, et le manque. Sans être déconcerté, il se pose à terre à quelque distance, et revient un instant après à la charge. L’enfant courageux se met en défense, avec la faucille qu’il avait fort heureusement à la main. Comme son féroce antagoniste arrivait sur lui pour le saisir, il le frappa sous l’aile gauche avec sa faucille, dont le fer pénétra entre les côtes, et traversant le foie, causa la mort presque instantanée de l’oiseau. L’enfant n’a pas eu seulement une égratignure. L’aigle a été acheté par M. Chasseur, qui l’a empaillé et placé dans son musée, où on peut le voir maintenant. C’est un de ceux qu’on appelle aigles de Russie; il a plus de six pieds d’envergure et les serres extrêmement fortes; les ongles dont ses pieds sont armés ont un pouce et demi de longueur; il avait l’estomac vide, et c’est peut-être en partie à cette circonstance que l’enfant a dû sa victoire. Beaucoup de ces oiseaux font leurs aires dans les falaises autour du cap Tourmente, en bas de Saint-Joachim. L’automne, ils se nourrissent principalement d’oiseaux de mer et des poissons qu’ils trouvent sur les rivages. L’été, ils font beaucoup de dégât parmi les oiseaux le basse-cour, enlevant les oies, les dindons, etc. C’est la première fois, à notre connaissance, qu’ils aient attaqué les enfans dans ce pays.—Gazette de Québec.
Notre zélé et laborieux compatriote, Mr. le Dr. Labrie, de St. Eustache, a annoncé la publication prochaine d’un ouvrage qui sera intitulé: Les premiers Rudiment de la Constitution Britannique, traduits de l’anglais de Mr. Brooks, précédés d’un Précis historique, et suivis d’Observations sur la Constitution du Bas-Canada, &c. ouvrage utile à toutes sortes de personnes, et principalement destiné à l’instruction politique de la jeunesse canadienne. Cet ouvrage sera imprimé aussitôt qu’il y aura un nombre suffisant de souscripteurs pour subvenir aux frais de l’impression, et formera un pamphlet de 72 à 80 pages in 8vo. Le prix sera de 2s, 6d. payable à livraison.

Le 10, à Laprairie, Mr. E. H. Barbeau, Marchand, à Demoiselle Sophie Bourassa.
Le même jour, à Blairfindie, Mr. J. A. Sabatté, instituteur, à Dame Ephrosine Poudret, veuve Rogers.
Le 11 à Varennes, Mr. E. N. Duchesnois, à Demoiselle Françoise Ainse.
Le 18, à Québec, Phil. Chatloup, écr., Avocat, à Demoiselle Emilie Jouvin.
Le même jour, au même lieu, Mr. A. Paré, Marchand, à Demoiselle Henriette Tessier.
Le 24, aux Trois-Rivières, Mr. J. Dupuis, âgé de 29 ans, à Dame Marguerite Doucet, veuve Boivin, âgée, dit-on, de 74 ans.
A Ste. Geneviève, le 6, à l’âge de 85 ans, Dame Charlotte Lagassé, veuve de J. B. P. L. De Champlain.
A St. Jean, île d’Orléans, le 8, Messire Gemest, prêtre.
A Québec, le 19, Dame Marguerite Vallieres de St. Real, épouse de Mr. A. Cayet, et sœur de J. R. V. de St. Real, écuyer.
A Bellevue, Près Montréal, le 20, presque subitement, Dame Marie Julie Fortier, épouse de S. H. Durocher, écuyer.
A Beauport, le 24, Mr. Charles Deblois, âgé de 33 ans.
A St. Charles, Rivière Boyer, le 26, l’honorable Louis Turgeon, membre du Conseil législatif et Colonel de milice.
A Ste. Anne de la Pocatière, le 27, Benoit Roy, écr. ancien Major de milice.
Dans le dernier Numéro:
Page 95, ligne 34e, article Biographie Canadienne, pour—et sa propre satisfaction, lisez, et sa propre sanctification.
Page 105, ligne 14e, lisez ainsi:
Luttant contre le sort ou contre les bourreaux.
Page 120, ligne 22e au lieu de Gamalogie, lisez Gamologie.
Dans le présent Numéro:
Page 139, ligne 27e, au lieu de Penissant, lisez Penissaut, ou plutôt Penisseau.
Printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Mis-spelled words and punctuation have been maintained except where obvious printer errors occur.
[Fin de La bibliothèque canadienne Tome V, Numero 4, Sep. 1827. par Michel Bibaud]