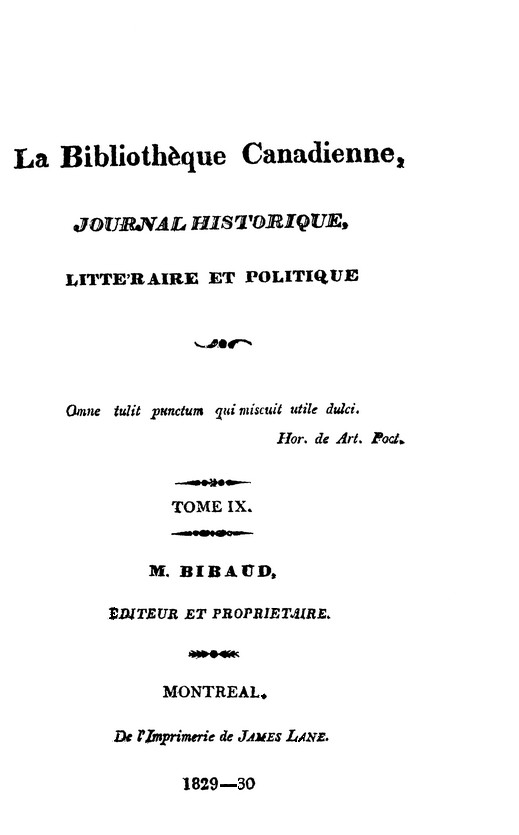
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque Canadienne, Tome IX, Numero 15, Fevrier 1830.
Date of first publication: 1830
Author: Michel Bibaud (1782-1857) (editor)
Date first posted: Jan. 29, 2022
Date last updated: Jan. 29, 2022
Faded Page eBook #20220147
This eBook was produced by: Marcia Brooks, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
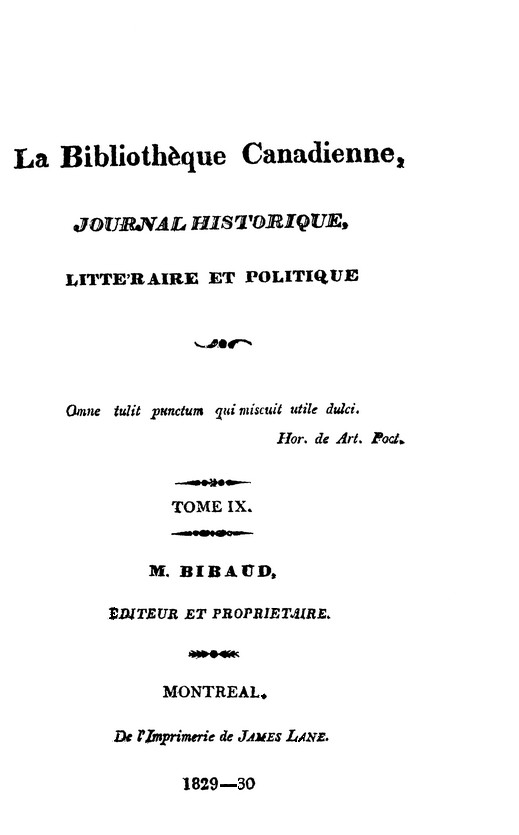
La Bibliothèque Canadienne
| Tome IX. | 1er. FEVRIER, 1830. | Numero XV. |
La prise du fort de Frontenac et celle du fort Duquesne, ne permirent plus au marquis de Vaudreuil de douter que le but du gouvernement anglais ne fût l’annéantissement de la puissance française sur le continent américain. Pour se mieux préparer à défendre le pays de l’invasion à laquelle il s’attendait pour le printemps suivant, il adressa aux capitaines de milice une circulaire où il leur indiquait la conduite qu’ils devaient tenir: il y dit, entre autres choses, que malgré les grands avantages qui avaient été obtenus, le Canada se trouvait dans un état très critique; que le dessein qu’avaient formé les Anglais de l’attaquer par terre et par mer, dans la prochaine campagne, démontrait la nécessité de prendre les mesures les plus efficaces, pour être prêts à repousser l’invasion, dès le commencement de l’été; et qu’il n’y avait aucun temps à perdre pour faire les préparatifs d’où dépendait la sureté de la colonie. Il ordonne ensuite que toute la population, mâle, depuis l’âge de seize ans jusqu’à soixante, soit enrôlée dans la milice, et soit prête à marcher au premier avis.
Les capitaines de milice exécutèrent de point en point les ordres du gouverneur général. Mais il était moins difficile de trouver des soldats que des vivres pour les nourrir; et les enrôlemens et les devoirs militaires auxquels les cultivateurs étaient assujétis, augmentèrent encore la disette, qui se faisait sentir depuis l’automne de 1757, où l’on avait été obligé de réduire la ration de pain et de viande des troupes du roi et de la colonie, et où il y avait eu à Québec, une espèce d’émeute, surtout parmi les femmes, en conséquence de l’extrême rareté du pain et des vaindes de boucherie.[1] La récolte de 1758 avait été très médiocre, et les requisitions de grains que faisait le gouvernement, avait rendu le bled extrêment rare, et l’avait porté à un prix exhorbitant. Quoique l’intendant en eût fixé le prix à douze francs le minot, on ne pouvait s’en procurer à moins de trente-six ou quarante francs. Ce n’était qu’avec beaucoup de difficulté que le gouvernement en pouvait obtenir pour les troupes, quelque peu qu’il leur en fallût, depuis la diminution de la ration, à laquelle elles ne s’étaient soumises qu’après une espèce de mutinerie, qui aurait pu avoir des suites fâcheuses, mais qui fut appaisée, dès le principe, par la prudence et la fermeté du chevalier de Lévis. Aussi fut-on obligé, dans l’hiver de 1758 à 1759, d’augmenter la paie des officiers, et de mettre une partie des soldats et sous-officiers en quartier chez les habitans des campagnes.
Dans le mois de Janvier, on fit le recensement de toute la population, dans les trois gouvernemens de la colonie. Le nombre des hommes en état de porter les armes, de l’âge de seize ans à celui de soixante, se trouva de sept mille cinq cent onze, dans le gouvernement de Québec; de six mille quatre cent cinq, dans celui de Montréal, et de treize cent treize, dans celui des Trois-Rivières; faisant un total de quinze mille deux cent vingt-neuf miliciens.
Le marquis de Montcalm, convaincu de la nécessité de mettre les garnisons de la colonie dans le meilleur état de défense possible, employa à leurs réparations et leur approvisionnement une grande partie des troupes et des milices, et fit en outre construire trois vaisseaux de guerre, pour avoir le commandement sur le lac Champlain. Le capitaine Pouchot, du régiment de Bearn, homme de talens et excellent ingénieur, fut aussi envoyé à Niagara, pour commander dans ce fort et le mettre en état de soutenir un siège.
Tandis qu’on faisait ces arrangemens, le gouverneur reçut, par le colonel de Bougainville[2], qui arriva à Québec le 14 Mai 1759, la confirmation de l’avis qu’il avait déjà reçu, que le dessein du gouvernement anglais était d’attaquer le Canada, par mer et par terre. Il lui était ordonné de faire les meilleures dispositions possibles pour la défense de la colonie, à défaut des secours qu’on ne pouvait pas lui envoyer.
Le 20 Mai, M. de Vaudreuil émana une circulaire, ou plutôt une proclamation, où, après avoir enjoint aux capitaines de milice de tenir leurs compagnies prêtes à se mettre en campagne au premier ordre, il disait aux habitans en général:
“Cette campagne fournira aux Canadiens l’occasion de se signaler: sa majesté connaît la confiance que j’ai en eux, et je n’ai pas manqué de l’informer des services qu’ils ont rendus. Sa majesté ne doute pas qu’ils ne fassent tous les efforts qu’on peut attendre de sujets fidèles, d’autant plus qu’ils ont à mettre leur religion, leurs femmes et leurs biens à l’abri du cruel traitement qu’ils éprouveraient de la part des Anglais.
“Quant à moi, j’ai résolu de ne consentir à aucune capitulation, dans l’espérance que cette résolution sera suivie des conséquences les plus ruineuses pour les ennemis. Il est indubitable qu’il serait plus avantageux aux habitans, à leurs femmes et à leurs enfans, d’être ensevelis sous les ruines de la colonie, que de tomber entre les mains des Anglais.
“Comme il est nécessaire de prendre les précautions les plus prudentes, afin de prévenir une surprise, j’ai fait placer de poste en poste, sur la rive du sud, au-dessous de la Pointe Lévy, des fanaux, qu’on allumera dès que l’ennemi sera apperçu.
“Nous promettons de donner aux habitans, à leurs femmes, à leurs enfans, et à leurs propriétés, toute la protection nécessaire pour qu’ils ne tombent pas entre les mains des anglais, qui leur feraient souffrir les mêmes maux et les mêmes mauvais traitemens qu’ont éprouvés les Acadiens. Nous avons pour témoignage de la mauvaise conduite qu’ils ont tenue dernièrement, la manière dont ils en ont agi à l’égard des habitans du Cap Breton et de l’île St. Jean, nonobstant la capitulation.
“Leur haine pour tout ce qui est canadien est telle, qu’ils les rendent même responsables des cruautés de quelques sauvages, oubliant les mesures que nous avons prises pour empêcher le renouvellement de ces actions, et le bon traitement que la nation a toujours fait à ceux d’entr’eux qui ont été nos prisonniers.
“Nous éprouvons une vraie satisfaction de pouvoir déclarer que nous n’appréhendons nullement pour la sureté de la colonie; cependant nous prendrons les mesures les plus efficaces pour mettre les biens et les droits des habitans en sureté.”[3]
Quelques jours après, la milice de Kamouraska reçut l’ordre de descendre à la Pointe Lévy: on fit passer celle de l’Ile d’Orléans sur la rive du nord, et celles d’au-dessus de Québec eurent ordre de descendre, par compagnies, avec des vivres pour un mois. Il fut aussi assigné dans les bois, des endroits particuliers, où les vieillards, les femmes et les enfans devaient se retirer, avec les bestiaux, à la première nouvelle de l’approche de la flotte anglaise. Afin que l’approche de l’ennemi fût connue aussitôt que possible, il fut établi trois postes à signaux, sous la direction de trois officiers de confiance. Le premier poste, établi à l’Ile du Portage, fut assigné à Mr. De Léry; le second, établi sur une hauteur à Kamouraska, était sous la direction de Mr. de Montesson, et le troisième, sur l’Ile d’Orléans, sous celle de Mr. de Lanaudière.
Outre ces arrangemens, il fut tenu à Montréal un grand conseil de guerre, pour aviser aux moyens de défendre efficacement la colonie, dans le cas où les Anglais l’attaqueraient simultanément sur différents points. Ces dispositions devenaient d’autant plus nécessaires, qu’on avait eu avis qu’une armée de vingt mille hommes, sans le général Wolfe, devait remonter le fleuve pour attaquer Québec; qu’une armée de trente mille hommes, aux ordres du général Amherst, devait venir par le lac Champlain; et une autre, de six mille, par la voie d’Oswego. Après s’être réuni plusieurs fois sans rien conclure, le conseil en vint à ces résolutions: Qu’un corps de troupes, sous le marquis de Montcalm et deux autres officiers généraux, MM. de Lévis et de Sennezergues, seraient postés à Québec; que M. de Bourlamaque se rendrait à Carillon; avec ordre de détruire les fortifications, et de descendre le lac, dans le cas de l’approche des Anglais, pour s’établir à l’Ile aux Noix, et y faire face à l’ennemi, afin de l’empêcher de pénétrer dans le pays; que les petits forts de la Pointe au Baril et de la Présentation seraient abandonnés, comme incapables de défense; mais qu’un corps de troupes serait posté à la tête des Rapides, et y éleverait de forts retranchemens. Le chevalier de La Corne fut choisi pour ce dernier service, et prit avec lui huit cents hommes, tant troupes réglées que miliciens.
Ces résolutions furent aussitôt mises: à exécution: à son arrivée à Québec, le marquis de Montcalm ordonna que les troupes et les milices fussent employées à élever des retranchemens à Beauport. Il ne négligea rien pour mettre la capitale dans le meilleur état de défense possible: il assura la communication de la basse-ville à la haute, vis-à-vis de l’évéché, par une forte palissade, et y fit élever une plate-forme, sur laquelle furent placés des canons pour enfiler la rue. La batterie érigée derrière l’évéché fut étendue de chaque côté, et jointe par une forte palissade, qui s’étendait sur le penchant de la colline presque jusqu’au palais de l’intendant. Il fut érigé plusieurs batteries pour la défense de la basse-ville, et toutes les communications avec le fleuve furent barricadées. St. Roch et le palais de l’intendant furent entourrés d’une palissade et protégés par de petites batteries. On établit une batterie de gros canon sur deux vaisseaux qui furent calés dans la rivière St. Charles, vis-à-vis du palais, et l’on érigea une redoute, près du gué, où l’on avait construit un pont de bateaux. Il fut construit une batterie flottante de dix-huit canons, et plusieurs brûlots, pour harrasser et tenter d’incendier la flotte anglaise; et toutes les bouées et autres marques pour la navigation du fleuve furent enlevées. La garde des batteries de la basse-ville fut confiée à un détachement de troupes de la colonie, sous les ordres de M. de Vaudain, lieutenant de marine; il fut formé un petit corps de cavalerie, dont le commandement fut donné à M. de la Roche Beaucourt, aide-de-camp du marquis de Montcalm; enfin, la milice de Québec fut formée en compagnies, et eut ordre de se tenir prête à agir au premier avis.
(A continuer.)
|
La chose est ainsi rapportée en substance dans les Mémoires du chevalier de Lévis: «L’après-midi (du 1er Déc. 1757,) il y eut une émeute de femmes. Elles s’assemblèrent devant la porte de M. de Vaudreuil. Il en fit entrer quatre chez lui, et leur demanda quel était le sujet de leur rassemblement. Elles répondirent qu’elles venaient pour lui demander du pain. Il leur dit qu’il n’en avait pas à leur donner; que le roi n’était pas obligé de nourrir le peuple; que cependant il avait fait tuer des bœufs et des chevaux pour assister les pauvres, et qu’ils en pouvaient aller chercher aux boucheries du roi, à six sols la livre. Les femmes répondirent au gouverneur, qu’elles aimeraient mieux mourir que de manger de la chair de cheval. M. de Vaudreuil leur repartit, que de tout temps, on en avait mangé; qu’il était bon, et qu’il avait ordonné qu’il fût tué de la même manière que le bœuf. En congédiant ces femmes, le marquis de Vaudreuil leur dit, que la première fois qu’il leur arriverait de faire une émeute, il les ferait toutes mettre en prison, et qu’il en ferait pendre la moitié. Il ordonna néanmoins à M. Martel, commissaire de la marine, et à M. de Monrepos, juge de police, de les mener à la boucherie du roi, pour leur faire voir que le cheval et le bœuf étaient de bonne espèce. Elles en convinrent; mais elles dirent qu’elles n’en prendraient pas, ni personne, pas même les troupes; après quoi, elles se dispersèrent, et se retirèrent chez elles, en tenant des propos séditieux.» |
|
M. de Bougainville était porteur des nouvelles promotions pour les principaux officiers de la colonie: M. de Vaudreuil était nommé grand-croix de l’ordre de St. Louis; le marquis de Montcalm, commandeur du même ordre et lieutenant-général; le chevalier de Lévis, maréchal de camp; MM. de Bourlamaque et de Sennezergues, brigadiers, et M. Dumas, major-général et inspecteur général des troupes de la marine. |
|
Nous devons avertir que nous ne donnons pas ici la copie d’un document original, mais une retraduction de la traduction de Mr. Smith. |

Mr. L’Editeur de la Bibliothèque Canadienne est prié d’insérer ce qui suit dans son intéressant journal.
S. P. Q. R.
On a parlé dernièrement d’une députation en Angleterre de deux Chefs du Sault St. Louis (Thomas Sonatsiowane et Thomas Sawennowane) pour revendiquer une partie de leur Seigneurie, enclavée dans celle de la Prairie, appartenant ci-devant à l’Ordre des Jésuites. Comme on pourrait croire que le voyage a été entrepris légèrement et sans motifs suffisans, on ne sera pas fâché de voir ici le résumé des preuves sur lesquelles ils appuyent leurs reclamations.

Résumé des preuves en faveur des Sauvages du Sault St. Louis, reclament le Moulin du Sault, et le Lopin de Terre, de trente et quelques arpens de front sur deux lieues de profondeur, sur lequel il est construit.
1º. On peut donner pour première preuve les reclamations constantes que les Sauvages ont faites de ce morceau de terre, comme faisant partie de leur Seigneurie, auprès de presque tous les Gouverneurs de la Province, depuis et même avant la conquête; ce qu’ils n’auraient pas fait, si de père en fils et de succession en succession de Chefs, ils n’eussent pas été convaincus qu’il leur appartient de droit.
2º. Dans les titres de la concession du Sault, donnés à Fontaine-bleau, par Louis XIV, en 1680, il est dit: “En montant le long du Lac sur pareille profondeur, avec deux isles, ilets et batures qui se trouvent au-devant.” Or ces isles, islets et batures, avec la portion du continent vis-à-vis duquel ils se trouvent, ne sont point entre les mains des Sauvages, comme ils devraient l’être d’après leurs titres, puisqu’ils font partie du morceau reclamé.
3º. Il est dit dans les mêmes titres; “Joignant aux terres de la Prairie de la Magdeleine.” N’est-ce pas dire que la ligne entre la Prairie et le Sault doit être mitoyenne. Or cependant il se trouve entre ces deux lignes un espace d’une trentaine d’arpens qui ne sont pas mentionnés sur les titres de la Prairie ni sur aucuns autres titres que sur ceux des Sauvages.
4º. La tradition constante de tous les Sauvages et des habitans de la Prairie est que, lorsque les Iroquois ont quitté la Prairie de la Magdeleine pour venir s’établir sur la nouvelle concession appelée du Sault, ils ont planté leur village sur la rive Est de la rivière du Portage, et qu’ils sont restes là au moins une quinzaine d’années, après y avoir bâti une église en bois. Il reste encore une vieille croix plantée sur le terrain de l’ancien village et quelques décombres en terre.
5º. La seconde station du village, d’après la même tradition, a été quelques arpens plus haut, dans un endroit que l’on appelle à présent chez Catho, encore sur le morceau reclamé. Ils n’ont été là que six à sept ans.
6º. La troisième station, d’après la même tradition, a été sur la rivière Susanne, une demi-lieue au-dessus de rapide. Ils sont demeurés là une quinzaine d’années, après quoi ils sont venus se fixer ici pour toujours.
7º. Le nom de Caughnawaga, en sauvage Kahnasake, qui veut dire au Sault, au Rapide, dénote que le village a été autrefois vis-à-vis d’un sault, ou d’un rapide. Il n’aurait pas été ainsi nommé s’il eût été bâti dès le principe à une demi-lieue au-dessus du Sault (3ème. station), ou à plus d’une lieue d’icelui, où il est maintenant. Les sauvages dans les différentes stations de leur village, en ont conservé le nom primitif.
8º. Le Père Charlevoix en son journal historique qui fait partie de l’Histoire du Canada, dit dans une lettre datée du Sault St. Louis même, 1721: “Cette bourgade fut d’abord placée à la Prairie de la Magdeleine, environ une lieue plus bas que le sault (ou le rapide) St. Louis, du côté du sud. Les terres ne s’y étant pas trouvées propres à la culture du Maïs, on la transporta vis-à-vis le Sault même, d’où elle a pris son nom, qu’elle porte encore, quoiqu’elle ait été transférée il y a peu d’années, une autre lieue plus haut.” Donc, d’après Charlevoix, le terrain qui est vis-à-vis le rapide, et où a été bâti le premier village, doit appartenir à la concession du Sault, qui doit être toute entière aux sauvages.
9º. En partant de 1680, temps où les Sauvages ont laissé la Prairie pour venir au Rapide, où est maintenant la Croix, et additionnant les années des différentes stations du village, savoir: 15 ans au Rapide; 7 ans chez Catho, et 15 ans sur la Rivière-Susanne, on a 37 ans; lesquelles ajoutées à 1680, font 1717. Or le père Charlevoix écrit en 1721, qu’il y avait peu d’années que le village avait été transféré où il est maintenant; ce qui s’accorde parfaitement avec les traditions sauvages.
10º. La réponse de l’Intendant aux sauvages du Sault St. Louis, avant la conquête[1], on doit y remarquer les mots: “Pour que vous jouissiez ensemble des avantages que Cette Terre doit produire, &c.” et ces autres: “Vous devez tous jouir de cette terre, &c. et ces autres: Les Pères Jésuites prédécesseurs de ceux-ci ont concédé quelque terres de cette Seigneurie, &c.” et plus bas: “Les Révérends Pères ni vous ne pouvez vendre aucune partion de cette terre, &c.” Les Sauvages reclamaient alors ce qu’ils reclament aujourd’hui: l’Intendant ne leur dit pas que le morceau revendiqué ne leur appartient pas; il ne le sépare pas du reste de la Concession; cette terre, cette seigneurie, &c. il accorde donc le droit; mais il oblige les Sauvages à le laisser entre les mains des Jésuites, comme leurs agens, parce que, dit-il, dans son allocution; “Ils (les Jésuites) doivent avoir la direction de la Seigneurie que vous n’êtes pas capables de gouverner.” Donc c’est par erreur que l’on a confondu ce morceau de terre avec les propriétés des Jésuites.
11º. Le Procès Verbal de Jean Peladeau, Arpenteur,[2] Il y est dit dans la première partie “y planter les bornes pour séparer la dite Seigneurie de la Prairie de la Magdeleine, de la Seigneurie du Sault St. Louis.........en présence de mon dit Sieur Claus et des Sauvages, &c.,” Or ces bornes furent plantées près de la Rivière de la Tortue, comme le dit le même Procès Verbal, précisément là où finit la Seigneurie de la Prairie. Donc là doit commencer la Seigneurie du Sault.
Les Sauvages ne veulent pas admettre la seconde partie de ce Procès Verbal, où l’on voit que le même Jean Peladeau vint dans l’automne de la même année (1762) avec des Miliciens et entièrement à l’inscu des Sauvages, reprendre les bornes qu’il avait plantées à la Tortue, et les reporter trente et quelques arpens plus haut, au-dessus du Moulin du Sault, parce que disent-ils, étant les plus intéressés dans cette affaire, nous aurions du y être appelés des premiers; Ils regardent donc comme nul ce qui a été fait sans eux.
12º. La promesse du Général Carleton aux Sauvages, rassemblés à Montréal, dans la Maison du Gouvernement, de leur rendre ce morceau de terre, à la mort du dernier Jésuite. Cette promesse, il est vrai, n’a été que verbale, les Sauvages ne connaissant pas alors la conséquence d’un écrit; mais il reste encore dans le Village du Sault un vieux Iroquois octogénaire qui était présent alors; tous les autres sont morts.
13º. La triple promesse de Sir George Prévost aux mêmes Sauvages:—1º. à Montréal; 2º. à Chateaugay aux Fourches; 3º. à Kingston, de leur rendre à la fin de la guerre le morceau de terre qu’ils reclamaient, lorsqu’ils l’auraient défendu avec le reste du pays contre l’ennemi.[3]
14º. Par leurs Titres de Concession de 1680, les Sauvages doivent avoir trois lieues et demie de front, sur deux de profondeur; or par le fait, ils n’ont pas trois lieues. Donc ils ont été frustrés de plus d’une demi-lieue.
15º. Lorsque les Jésuites avaient la jouissance du Moulin du Sault, et qu’ils percevaient les Rentes des Concessions qu’ils avaient faites sur le morceau de terre reclamé, les Sauvages n’étaient chargés d’aucune redevance envers eux ni envers l’Eglise. Ils vivaient de ces revenus, et portaient exclusivement les frais d’entretien et de réparations nécessaires à l’Eglise et au Presbytère, comme le font à peu près les Messieurs de St. Sulpice au Lac des deux Montagnes. C’était à eux de plus que s’adressaient les Sauvages pour leurs pauvres et leurs malades. Lorsque le Gouvernement s’est emparé de ce fond, comme fesant partie des biens des Jésuites, il n’en a pas moins fallu que les Sauvages trouvassent dans le reste de leur Seigneurie de quoi subvenir à toutes ces dépenses, sans quoi ils n’auraient plus eu de Missionnaire. Aussi ne leur reste-t-il pas un denier à la reddition de leurs comptes annuels, les trois lieues qu’ils ont entre les mains, étant beaucoup moins lucratives que la demi-lieue revendiquée par eux, vu quelles ne sont ni ne peuvent être toutes concédées, étant presque toutes en Culture et en Prairies et en Sucreries, départies entre chaque famille, pour sa propre subsistance.
SAULT St. LOUIS, 1829.
|
Pièce originale, entre les mains des Sauvages. |
|
Autre pièce authentique entre les mains des Sauvages. |
|
Les témoins auriculaires ont donné des certificats de ces différentes promesses, signés de leurs mains. |

Lorsque Publius Dolabella était proconsul en Asie, on poursuivit criminellement devant lui une femme qu’on accusait d’avoir empoisonné son mari et un fils qu’elle en avait eu, parce qu’ils avaient tué un autre fils qu’elle avait eu du premier lit: Dolabella se trouvant embarrassé, et ne pouvant absondre la criminelle, qui était duement convaincue, ni la condamner, parce qu’elle y avait été poussée par l’assassinat commis en la personne de son fils innocent, renvoya la connaissance de cette affaire à l’aréopage: ce sénat, ayant murument examiné les raisons de part et d’autre, ordonna que l’accusateur et l’accusé comparaitraient dans cent ans.
Du temps de Théodoric, roi des Goths, une femme refusa de reconnaître son fils, qui avait été longtems esclave chez les ennemis. Elle agissait ainsi par les conseils d’un débauche, avec qui elle entretenait un commerce criminel. Théodoric, instruit de ces circonstances, ordonna à cette femme d’épouser celui qu’elle reniait pour son fils, puisqu’elle soutenait qu’il ne l’était pas. Mais l’horreur qu’elle eut d’un tel mariage la contraignit d’avouer son injustice.
Alphonse le Grand, roi d’Aragon, élevé sur le trône a l’âgé de dix-neuf ans, signala le commencement de son règne par un jugement semblable à celui de Salomon. Une esclave soutenait devant lui que son maître était le père d’un enfant qu’elle avait mis au monde, et demandait qu’il la mît en liberté, suivant une loi d’Espagne. La maître nia le fait. Alphonse ordonna qu’on vendît l’enfant au plus offrant. Le maître ne put voir son fils en la puissance d’un étranger: il le reconnut, et mit l’esclave en liberté.
Un sultan, persuadé qu’une grâce accordée à un criminel est une injustice envers le public, s’est immortalisé par un trait sublime. Un Arabe était venu se jetter à ses genoux, pour se plaindre des violences que des inconnus exerçaient dans sa maison. Le sultan s’y transporte aussitôt, et après avoir fait éteindre les lumières, saisir les criminels et envelopper leurs têtes d’un manteau, il commande qu’on les poignarde. L’exécution faite, le sultan fait rallumer les flambeaux, considère les corps de ces criminels, lève les mains et rend grâces à Dieu. Quelle faveur, lui dit son visir, avez-vous donc reçue du ciel? Visir, répond le sultan, j’ai cru un de mes fils auteur de ces violences; c’est pourquoi j’ai voulu qu’on éteignît les flambeaux et qu’on couvrît d’un manteau la tête de ces malheureux; j’ai craint que la tendresse paternelle ne me fît manquer à la justice que je dois à mes sujets. Juge si je dois remercier le ciel, maintenant que je me trouve juste sans être parricide.
(Mes Souvenirs.)

M. Duval, qui a été bibliothécaire de l’empereur François I, a rendu compte de la manière dont un pur instinct, dans son enfance, lui donna les premières idées d’astronomie. Il contemplait la lune, qui, en s’abaissant vers le couchant, semblait toucher aux derniers arbres d’un bois: il ne douta pas qu’il ne la trouvât derrière ces arbres; il y courut, et fut étonné de la voir au bout de l’horizon.
Les jours suivants, la curiosité le força de suivre le cours de cet astre, et il fut encore plus surpris de le voir se lever et se coucher à des heures différentes, Les formes diverses qu’il prenait de semaine en semaine, sa disparition totale durant quelques nuits, augmentèrent son attention. Tout ce que pouvait faire un enfant était d’observer et d’admirer: c’était beaucoup; il n’y en a pas un sur dix mille qui ait cette curiosité et cette persévérance.
Il étudia comme il put pendant une année entière, sans autre livre que le ciel et sans autre maître que ses yeux. Il s’apperçut que les étoiles ne changeaient point entr’elles de position. Mais le brillant de l’étoile de Vénus fixant ses regards, elle lui parut avoir un cours particulier, à peu près comme la lune; il l’observa toutes les nuits: elle disparut longtemps à ses yeux, et il la revit enfin devenue l’étoile du matin au lieu de l’étoile du soir.
La route du soleil, qui de mois en mois, se levait et se couchait dans des endroits du ciel différents, ne lui échappa point; il marqua les solstices avec deux piquets, sans savoir ce que c’était que les solstices.
Il me semble que l’on pourrait profiter de cet exemple pour enseigner l’astronomie à un enfant de dix à douze ans, beaucoup plus facilement que cet enfant extraordinaire dont je parle n’en apprit par lui-même les premiers élémens. C’est d’abord un spectacle très attachant pour un esprit bien disposé par la nature, de voir que les différentes phases de la lune ne sont autre chose que celle d’une boule autour de laquelle on fait tourner un flambeau, qui tantôt en laisse voir un quart, tantôt une moitié, et qui la laisse invisible quand on met un corps opaque entre elle et le flambeau. C’est ainsi qu’en usa Galliée, lorsqu’il expliqua les véritables principes de l’astronomie, devant le doge et les sénateurs de Venise, sur la tour de St. Marc: il démontra tout aux yeux.
En effet, non seulement un enfant, mais un homme mûr, qui n’a vu les constellations que sur des cartes, a beaucoup de peine à les reconnaître quand il les cherche dans le ciel. L’enfant concevra très bien en peu de temps les causes de la course apparente du soleil et de la révolution journalière des étoiles fixes.
Les systèmes de Ptolomée et de Ticho Brahé ne méritent pas qu’on lui en parle, puisqu’ils sont faux: ils ne peuvent jamais servir qu’a expliquer quelques passages des anciens auteurs qui ont rapport aux erreurs de l’antiquité: par exemple, dans le second livre des Métamorphoses d’Ovide, le Soleil dit à Phaéton:
Adde guôd assiduá rapitur veitigine cœlum,
Nitor in adversum, nec me, qui cœtera vincit
Impetus, et rapido contrarius evehor orbi.
Un mouvement rapide emporte l’empirée;
Je résiste, moi seul, moi seul je suis vainqueur,
Je marche contre lui dans ma course assurée.
Cette idée d’un premier mobile qui ferait tourner un prétendu firmament en vingt-quatre heures, d’un mouvement impossible, et du soleil, qui, entraîné par ce premier mobile, s’avançait pourtant insensiblement d’occident en orient, par un mouvement propre qui n’a aucune cause, ne ferait qu’embarrasser un jeune commençant, Il suffit qu’il sache que, soit que la terre tourne sur elle-même et autour du soleil, soit que le soleil achève sa révolution en une année, les apparences sont à peu près les mêmes, et qu’en astronomie, on est obligé de juger par ses yeux avant que d’examiner les choses en physicien. Il connaîtra bien vite la cause des éclipses de lune, et pourquoi il n’y en a pas tous les mois. Il lui semblera d’abord que le soleil se trouvant, chaque mois, en opposition ou en conjonction avec la lune, nous devrions avoir chaque mois une éclipse de lune et une de soleil. Mais dès qu’il saura que ces deux astres ne se meuvent point dans un même plan, et sont rarement sur la même ligne avec la terre, il ne sera plus surpris.
On lui fera aisément comprendre comment on a pu prédiré les éclipses en connaissant la ligne circulaire dans laquelle s’accomplissent le mouvement apparent du soleil et le mouvement réel de la lune. On lui dira que les observateurs ont su, par l’expérience et par le calcul, combien de fois ces deux astres se sont rencontrés précisément dans la même ligne avec la terre, en dix-neuf années et quelques heures; après quoi, ces astres paraissent recommencer le même cours: de sorte qu’en faisant les corrections nécessaires aux petites inégalités qui arrivaient dans ces dix-neuf années, on prédisait au juste quel jour, quelle minute, il y aurait une éclipse de lune ou de soleil. Ces premiers élémens entrent aisément dans la tête d’un enfant qui a quelque conception.
La précession des équinoxes même ne l’effraiera pas. On se contentera de lui dire que le soleil a pu avancer continuellement dans sa course annuelle, d’un degré en soixante-douze ans, vers l’orient, et que c’est ce que voulait Ovide par ce vers que nous avons cité:
.......................Contrarius evehor orbi:
Ma carrière est contraire au mouvement des cieux.

M. Bretonneau, médecin de Tours, parait avoir découvert un remède efficace pour la maladie appellée la grippe, en soufflant dans la gorge de l’enfant de l’alun par le moyen d’un instrument inventé pour cet objet. Dans bien des cas, 2 ou 3 répétitions de ce traitement suffisent; dans d’autres, il en faut cinq ou six. M. Bretonneau a guéri par ce procédé un grand nombre d’enfans qui allaient succomber à cette maladie cruelle.
Beaucoup de personnes instruites, des médecins même, révoquent en doute le réalité des combustions humaines spontanées, malgré l’évidence de plusieurs faits qui ne sauraient être contestés; à leur appui, voici un nouvel exemple d’une combustion de cette espèce: A Auriol (département du Var,) demeurait Marie Daignau, veuve Feraud, habitant seule à un second étage; depuis longtemps elle était adonnée aux boissons spiritueuses. Dans la nuit du 24 Octobre, on sentit dans cette maison et dans les environs une odeur empyreumatique désagréable, mais on n’aperçut aucun signe d’incendie: on n’entendit aucun cri, aucune plainte. Le 24 au matin, le corps de cette femme fut trouvé en ignition et aux trois quarts consumé, quoique la chaise sur laquelle elle était assise ne fût brûlée qu’en partie. On a trouvé un chandelier près de la chaise. De là, M. Aubanel, médecin très instruit de cette commune, a tiré la conséquence naturelle et évidente que la chandelle à dû enflammer le gaz hydrogène.

On ne trouve dans un livre qu’autant d’esprit qu’on en a soi-même.
C’est dans l’esprit qu’est le véritable courage, et le plus rare est celui qui surmonte, non pas la mort, non pas un danger momentané, mais une longue suite de revers ou d’infirmités.
Penser est un art que l’on apprend comme tous les autres; mais il est peut-être le plus difficile de tous. Un sot peut réfléchir quelquefois; mais c’est toujours après la sottise.
C’est une chose bien commode que la critique; car, où l’on attaque avec un mot, il faut des pages pour se défendre. Il en est de même de la calomnie.
Le penser des âmes fortes, les sensations d’une personne profondement émue, leur donnent un idiôme particulier. Les âmes communes n’ont pas la grammaire de cette langue.
Les cœurs qu’échauffe un feu céleste; les génies livrés à une grande conception; les hommes dévorés d’une grande passion, trouvent dans leurs propres sentimens une jouissance qu’il faut avoir éprouvée pour la bien peindre.
Un cœur malade ne peut guère écouter la raison que par l’organe du sentiment.
L’homme du monde est tout entier dans son masque; il est toujours mal à son aise, quand il est forcé de rentrer eu lui-même: ce qu’il est n’est rien, et ce qu’il paraît est tout pour lui.
C’est dans les appartemens dorés qu’on va prendre les airs du monde; mais le sage en apprend les mystères dans la chaumière du pauvre.
Les orientaux, quoique voluptueux, sont en général logés et meublés simplement: ils regardent la vie comme un voyage, et leur maison comme une hôtellerie.
Les âmes d’une certaine trempe transforment, pour ainsi dire, les autres en elles-mêmes; elles ont une sphère d’activité à laquelle rien ne résiste. On ne peut les connaître sans vouloir les imiter; et de leur sublime élévation elles attirent à elles tout ce qui les environne.
Il n’y a que des âmes de feu qui sachent combattre et vaincre; tous les grands effets, toutes les actions sublimes sont leur ouvrage: la froide raison n’a jamais rien fait d’illustre, et l’on ne triomphe des passions qu’en les opposant l’une à l’autre.
Si l’on est plus attaché à sa vie qu’à ses devoirs, on ne peut être solidement vertueux.
Les mauvaises maximes sont pires que les mauvaises actions; elles corrompent la raison même, et ne laissent plus de ressource pour revenir au bien.
L’esprit se rétrécit à mesure que l’âme se corrompt.
La conscience du juste lui tient lieu des louanges de l’univers.

Don Pablo Ochou, qui a été pendant plusieurs années surintendant d’une pêche, et qui était lui-même un habile plongeur, m’a donné le détail suivant d’une de ses aventures submarines.
On supposait que le rocher de la Piedra negada, près Loretto, recelait autour de lui une quantité de très grandes huitres à perles; supposition qui fut confirmée par la difficulté qu’on eut de retrouver ce rocher caché. Cependant Don Pablo réussit à le sonder, et plongea auprès, à onze brasses d’eau, pour y chercher les coquilles les plus vieilles et les plus grosses. Le rocher n’a pas plus de cent cinquante à deux cents verges de circonférence, et notre aventurier en fit le tour et l’examina dans tous les sens, mais sans rien trouver qui l’induisit à rester plus longtems sous l’eau. Etant donc convaincu qu’il n’y avait pas d’huitres à perles autour de ce rocher, il songea à remonter à la surface de l’eau; mais auparavant, il regarda au-dessus de lui, comme font tous les plongeurs, pour éviter la gueule affamée d’un monstre. Si l’eau est claire et libre d’objets étrangers, ils peuvent s’élever sans crainte.
Mais en regardant en haut, Don Pablo s’apperçut qu’un tinterero s’était posté à trois ou quatre verges au-dessus de lui, et le guettait probablement depuis qu’il était sous l’eau. Un bâton à deux pointes est une arme inutile contre un tinterero, sa gueule étant si énormément grande qu’il pourrait avaler homme et bâton à la fois. Il se trouva donc assez en peine, vu que la retraite lui devenait impossible. Mais sous l’eau, le temps est un objet trop précieux pour être perdu en réflexions; il se mit donc à gagner à la nage une autre partie du rocher, espérant éviter par ce moyen la vigilance de son ennemi. Quel ne fut pas son découragement, lorsque jettant les yeux en haut, il vit son opiniâtre ennemi nageant encore au-dessus de lui, comme un épervier plane au-dessus d’un faible oiseau. Il le peignait comme avant de grands yeux ronds, enflammés et semblant prêts à sortir de leurs orbites, et une gueule (au souvenir de laquelle il frissonnait encore) qui s’ouvrait et je fermait continuellement, comme si le monstre eut déjà dévoré sa victime, en imagination, ou du moins comme si la vue de sa proie lui eût donné un avant-goût du régal qu’il se promettait.
Il ne restait plus que deux alternatives dans l’esprit de Don Pablo, celle de se laisser noyer, ou celle d’être mangé. Il y avait déjà si longtemps qu’il était sous l’eau, qu’il ne lui était presque plus possible de retenir son baleine, et il fut sur le point de s’abandonner à son sort, avec toute la philosophie dont il était doué. Mais qu’y a-t-il de plus cher que la vie? L’invention de l’homme est rarement en défaut, quand il s’agit de trouver des expédiens pour sa préservation, dans les cas d’extrême nécessité. Il se rappella tout à coup que sur un des côtés du rocher, il y avait un endroit sablonneux, et il y nagea avec une vitesse incroyable, son attentif ennemi continuant a épier ses mouvemens, et le suivant à pas mesurés, si l’on peut ainsi parler.
Dès que Don Pablo fut parvenu à l’endroit, il se mit à remuer le sable, avec son bâton pointu, de manière que les parties déliées s’élevèrent à la surface de l’eau, et la rendirent toute trouble; et qu’il ne put plus voir le monstre, ni le monstre le voir. A la faveur du nuage interposé entre lui et le tinterero, il nagea loin de l’endroit, dans une direction transverticale, et atteignit la surface sans accident, quoiqu’entièrement épuisé. Heureusement, il reparut tout près d’une des chaloupes, et ceux qui étaient dedans le voyant dans cet état, et sachant qu’un ennemi l’avait poursuivi, et qu’il n’avait pu se sauver-que par quelque artifice, sautèrent à l’eau, suivant leur coutume, pour effrayer le poisson, en s’y débattant violemment. Don Pablo fut mis dans la chaloupe plus mort que vif.
(Hardy’s Travels in Mexico.)

Un jeune Américain qui, depuis longtems, avait mérité l’approbation du général Washington par son activité et par sa valeur, reçut du congrès une commission de capitaine. Sa femme voulut le suivre et partager avec lui les fatigues et les dangers de la campagne de 1778. Poursuivant un jour un détachement de royalistes, le chef de ce parti le tua d’un coup de fusil, un moment avant d’être investi. Il eut là générosité, en expirant, d’ordonner que sa mort ne serait point vengée, et que les prisonniers seraient conduits au quartier général. Quelle fut la douleur de sa femme, lorsqu’elle vit le corps de son mari pâle et sanglant, rapporté par ses soldats! Elle ont encore un autre sujet de la plus vive douleur: dans celui des prisonniers qu’on lui dit l’avoir tué elle reconnut un frère qu’elle aimait tendrement, mais qui, malgré ses exhortations, avait suivi le parti des Anglais. Pénétré d’horreur et de désespoir, cet homme voulut se tuer; mais l’amour fraternel, balancant pour un instant tous les autres sentimens, cette épouse infortunée calma le désespoir de ce frère; elle pardonna même au meurtrier involontaire de son mari et à l’ennemi de sa patrie, à condition toutefois qu’il quitterait le service de la métropole. Il changea de parti en effet, et cette jeune veuve alla passer de tristes jours dans une campagne isolée, consacrant tous ses instans à l’éducation du seul enfant qu’elle avait eu de l’époux qu’elle ne cessa jamais de regretter.
Au milieu des horreurs de la guerre civile, les plus proches parens sont souvent armés contre les objets qu’ils chérissaient le plus. L’anecdote que nous venons de rapporter nous rappelle ces vers de la Henriade:
Enfin, le vieux d’Ailly, par un coup malheureux,
Fait tomber à ses pieds ce guerrier généreux.
Ses yeux sont pour jamais fermés à la lumière;
Son casque, auprès de lui, roule sur la poussière;
D’Ailly voit son visage: ô désespoir, ô cris!
Il le voit, il l’embrasse: hélas! c’était son fils.
Le père infortuné, les yeux baignés de larmes,
Tournait contre son sein ses parricides armes;
On l’arrête, on s’oppose à sa juste fureur.
Il s’arrache en tremblant, de ce lieu plein d’horreur:
Il déteste à jamais sa coupable victoire;
Il renonce à la cour, aux humains, à la gloire,
Et se fuyant lui-même, au milieu des déserts,
Il va cacher sa peine au bout de l’univers.
Du héros expirant la jeune et tendre amante,
Par la terreur conduite, incertaine, tremblante,
Vient d’un pied chancelant sur ces funestes bords:
Elle cherche, elle voit dans la foule des morts,
Elle voit son époux, elle tombe éperdue;
Le voile de la mort se répand sur sa vue:
Est-ce toi, cher amant? Ces mots interrompus
Ces cris demi-formés né sont point entendus.
Elle rouvre les yeux, sa bouche presse encore
Par ses derniers baisers la bouche qu’elle adore;
Elle tient dans ses bras ce corps pâle et sanglant,
Le regarde, soupire, et meurt en l’embrassant.

—On lit l’article suivant dans le Bulletin des sciences et des arts du mois d’Octobre dernier.
“Nous avons sous les yeux une nouvelle invention qui nous paraît utile, non seulement pour le roulage et pour les diligences, mais aussi pour toutes les voitures en général, voire même les brouettes et les charrues, ainsi que pour toutes les surfaces planes auxquelles on veut imprimer un mouvement de rotation. Ce sont des rondelles à galets, que l’inventeur breveté, M. Charbonneaux, libraire de Versailles, se propose de livrer au public. Pour les roues de voitures, elles s’interposent aux deux bouts du moyen, entre deux rondelles plates, et facilitent le mouvement des roues. La société d’encouragement pour l’industrie nationale a approuvé ce procédé, et en a témoigné sa satisfaction à l’auteur, en délibérant qu’il serait décrit et figuré dans son bulletin, et communiqué au ministre de la guerre, afin qu’il puisse être appliqué au matériel de l’armée.”

—L’éloge, de M. Guernon de Ranville est dans toutes les feuilles congréganistes; on réimprime ses mercuriales, on vante à l’avance son éloquence parlementaire, on fait de lui le glaive et le bouclier du ministère. On parle de son génie politique et de ses talens administratifs, on va même jusqu’à dire que Mgr. est très lettré, et qu’il a tous les mérites classiques que doit avoir un successeur de Rollin. Nous nous étions un peu défiés de toutes ces louanges; nous avouons que nous n’avons plus de raison de douter maintenant du talent de son excellence. Ce que lès discours prononcés par M. Guernon de Ranville devant la cour royale de Lyon n’avaient pu faire, une chanson, une simple chanson l’a fait. Et quelle est cette chanson? D’où vient-elle? Elle fut composée en 1815, et chantée par son auteur, aux volontaires qu’il commandait. Le Figaro, qui a toujours soin de donner à ses abonnés des choses rares et curieuses, a publié hier la chanson de M. de Ranville. Nous en citerons un couplet qui nous paraît admirable: le voici:
Bonaparte est en cage
Et son règne est fini:
Qu’il en crève de rage.
Il ne tenait qu’à lui
De servir les Bourbons
Sous le prince d’Aumont.
Ces vers sont délicieux assurément: mais c’est surtout par la pensée que cette strophe est sublime! Bonaparte qui pouvait servir sous M. le duc d’Aumont, et qui a préféré régner, pour finir par crever de rage dans une cage! M. Guernon de Ranville est bien mieux avisé; il a servi sous le prince d’Aumont, et le voilà ministre de l’instruction publique. Et quand on pense qu’il ne tenait qu’à Napoléon d’en être là! Il ne dépendra pas de nous que la gloire de M. Guernon ne soit immense comme elle doit être; voilà pourquoi nous publions ce joli échantillon du talent poétique de M. le ministre de l’instruction publique.—Le Constitutionnel.

On en est venu à un mépris pour l’histoire qui fait peur. C’est une des conséquences de l’ennui qui nous frappe. On ne veut plus d’histoire: du drame ou de roman, à la bonne heure. Walter Scott ou M. de Fongerai passe encore. Voici l’histoire de la Conquête de Grenade: un récit sérieux, animé, vif, plein d’intérêt: vous croyez avoir lu une histoire véritable. Détrompez vous! véritable comme l’histoire véritable du Chevalier de la Manche. C’est une bonne et charmante mystification, malheureusement détruite à la première page par un monsieur nommé Jean Cohen.
M. Jean Cohen est un littérateur de l’école de M. de Faucompret. Il a traduit, tant bien que mal l’Histoire de Grenade. Mais au lieu d’abandonner le lecteur à lui-même, et de lui laisser croire qu’il vient de lire en effet une vieille et vénérable chronique du bon temps, il nous avertit dans un avant-propos très stupide, que M. Irving n’a fait qu’un frivole roman. A cela ou demande de quel droit M. Jean Cohen traduit M. Washington? Je charge mon laquais de porter une lettre à la poste, il la décacheta en chemin, à l’encontre du cabinet noir: que faire? On n’est pas littérateur comme M. Jean Cohen, à moins qu’on ne soit faiseur de vaudeville ou de roman.
Ce qui n’empêche pas que cette Histoire de Grenade ne soit une excellente plaisanterie, pleine de goût, de simplicité et d’intérêt. C’est bien l’éclat de Grenade, un éclat africain, par un beau soleil, et de grands arceaux d’architecture mauresque, et des chevaliers tant qu’on en veut; partout des noms propres, des physionomies animées; une histoire, en effet, malgré la note de M. Jean Cohen! Que me fait, à moi, M. Jean Cohen? Tout cela est de l’histoire! Il faut absolument que ce soit de l’histoire; autrement aurais-je lu deux volumes in-8o au plus fort de l’inquiétude du ministère Labourdonnaye?
Voyez quels progrès depuis M. de Florian. Gonzalve de Cordoue est aussi l’histoire de Grenade. On ne se souvient guère de Gonzalve de Cordoue, non plus que des Incas, et de toute notre poésie en prose. Ne l’eut-on pas oubliée, voici un auteur américain qui viendrait de New-York nous en faire rougir, nous Français des bords de la Seine. Il usurpe lé champ de bataille de M. de Florian, sans songer que M. de Florian y a campé; et quand il a fait mouvoir le même peuple simplement et franchement, comme dans un conte écrit à loisir dans une auberge voisine de Hurl’ Gate, il met en titre Histoire de Grenade, par respect pour ses compatriotes qui ne sont pas encore aussi avancés que nous dans le dédain des faits réguliers.
M. Washington Irving, qu’il faut connaître, est un compatriote de Cooper, un écrivain plus élégant et plus correct que l’auteur de l’Espion, ayant surtout une bonne odeur d’université d’Oxford, avec un bel amour de patrie et de liberté. La réputation de M. Irving a commencé en Angleterre dans les revues, dont nos voisins sont fiers à tant de titres et que nous aurons beaucoup de peine à égaler. Plusieurs ouvrages du même auteur ont déjà réussi parmi nous. Ses Contes d’un voyageur, son Histoire d’Amérique, le Château de Brucebridge, ont révélé un talent pur et neuf, une variété puissante de style et d’émotions.
M. Washington Irving a été nommé depuis six mois secrétaire du congrès américain, de sorte que, Dieu aidant, nous aurons des contes politiques avec des hommes politiques, car un conte est un besoin de cœur pour M. Irving. Nouveau Jovial, il dira au moindre événement: Je ferai un conte là-dessus, et ce sera tant mieux.
Il n’y a pas jusqu’à l’Histoire de Grenade qui ne soit une bonne fortune pour les heureux de ce monde qui ont un jour à perdre, même malgré la traduction et la préface de M. Jean Cohen.—Le Messager des Chambres.

Hier soir (19), à une assemblée de la Société Littéraire et Historique, tenue au Vieux Château, il a été lu un écrit sur quelques arbres et arbustes remarquables trouvés dans cette province, avec des remarques sur leur physionomie et leurs usages. A la première assemblée de la Société, tenue cet hiver, il avait été lu un mémoire intéressant du même auteur, sur les arbres de haute futaie. Il y a été exhibé un modèle en bronze d’un substitut pour les roues de vaisseaux à vapeur. Dans cette machine, l’essieu seul de la roue se meut circulairement, et au moyen de leviers à jointures, deux pelles, ou larges rames, sont continuellement en opération, et dans une position perpendiculaire.—Star.

Montréal, 20 Janvier 1830.
L’assemblée annuelle de la Société d’Agriculture pour le District de Montréal, a eu lieu aujourd’hui, au palais de justice, conformément à l’avis qui en avait été donné.
Joseph Perrault, écuyer, M. P. Président de la Société, ayant été appelle au fauteuil, a exposé que l’objet de l’assemblée était l’élection d’un Comité directeur pour l’année suivante, conformément aux règles et règlemens de l’institution; après quoi, les Messieurs et-dessous nommés ont été élus unanimement:
Joseph Perrault, George Gregory, Thomas Porteous, James Leslie, Austin Cuvillier, Charles Penner, James Sommerville, Hugh Brodie, Arch. Ogilvie, Paschal Lachapelle, père, John Molson, James Logan, John Boston, John Clark, Charles Bowman, V. Roy Lapensée, Étienne Guy, P. Lachapelle, fils, J. Bte. Bourbonnière, Henry Headly, et William Evans.
Le Comité a alors procédé à l’élection de ses officiers pour la présente année, et a élus Jos. Perrault, Président, Chs. Penner et Jas. Logan, Vice-président, et Wm. Evans, Secrétaire.
Après que le Président a eu laissé le fauteuil, Mr. Penner y a été appelle, et il a été voté des remercimens à Joseph Perrault, écuyer, pour sa conduite comme président de l’assemblée.
| Par ordre, | Wm. Evans, Secrétaire. |

Mariés:—A Ste Rose, le 12 de Janvier dernier, par Messire Belair, Louis Bastien, écuyer, de Terrebonne, à Dlle Julie Plessis-Belair;
A Québec, le 16, par le revd. G. J. Mountain, R. I. Routh, écuyer, Commissaire général pour le Canada, à Dlle Marie Louise, fille aînée de l’honorable J. T. Taschereau;
A Montréal, le 18, M. L. L. Durocher, Marchand, à Dlle Sophie Dezery;
Au même lieu, le même jour, Mr. Ives Tessier, Peintre d’histoire et de portraits, à Dlle Marie Anne Tulloch;
Le même jour, à Vaudreuil, Mr. Octave Bastien, à Dlle Charlotte Lefebvre, fille de feu J. Bte. Lefebvre, écuyer:
A Montréal, le 19, T. Bouthillier, écuyer, à Dlle Françoise Beaubien, fille unique de Benjamin Beaubien, écuyer.
Décédés:—A Beaumont, le 15 du mois dernier, Mr. F. L. Turgeon, âgé de 90 ans;
A Montréal, le 18, Madame Veuve Leheuf, dite Latulippe, âgée de 88 ans;
A Varennes, le 19, Mr. Augustin Gauthier, âgé de 73 ans et 9 mois.
Commissionné:—Frédéric D’Estimauville, écuyer, Trésorier des Chemins, pour la ville et banlieue de Québec.
Printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Mis-spelled words and punctuation have been maintained except where obvious printer errors occur.
[La fin de La Bibliothèque Canadienne, Tome IX, Numero 15, Fevrier 1830. par Michel Bibaud]