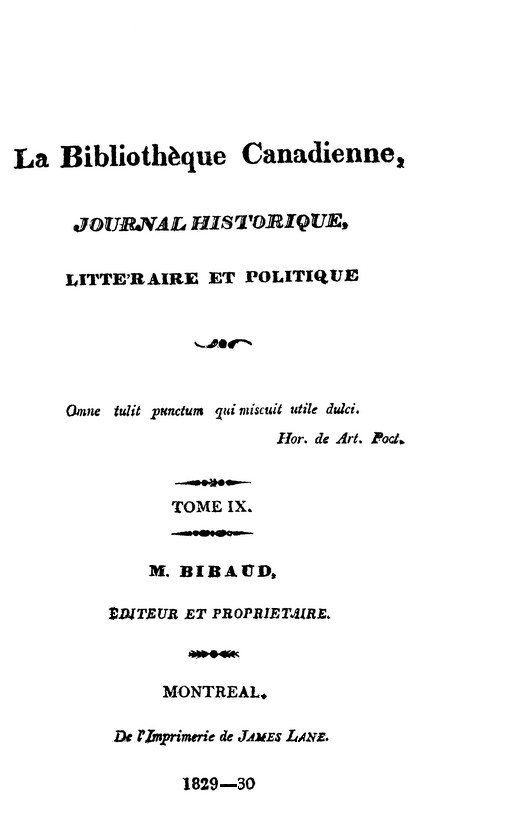
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque Canadienne, Tome IX, Numero 5, Septembre 1829.
Date of first publication: 1829
Author: Michel Bibaud (1782-1857) (editor)
Date first posted: Dec. 24, 2021
Date last updated: Dec. 24, 2021
Faded Page eBook #20211256
This eBook was produced by: Marcia Brooks, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
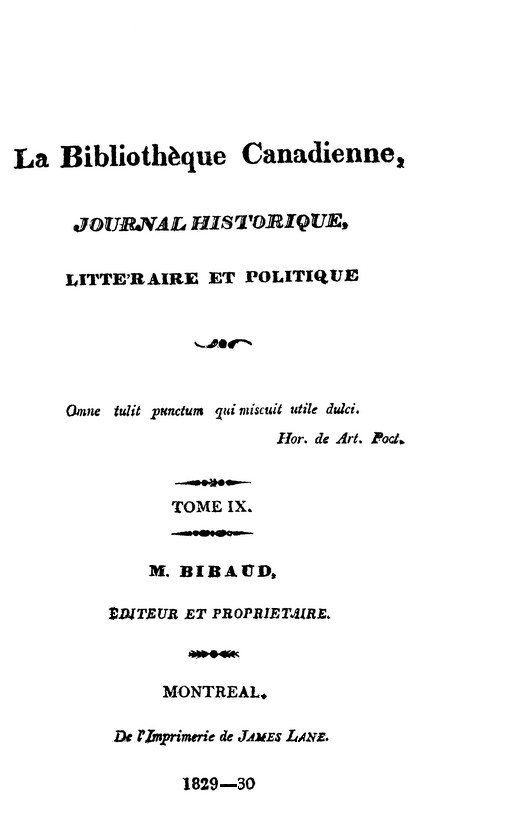
La Bibliothèque Canadienne
| Tome IX. | 1er. SEPTEMBRE, 1829. | Numero V. |
Dès l’année 1703, il avait été émané un édit royal, par lequel il était défendu aux communautés religieuses d’acquérir des biens fonds au-de là d’une certaine valeur: par un édit subséquent, toute acquisition de ce genre fut interdite aux gens de main-morte, à moins qu’ils n’en eussent préalablement demandé et obtenu la permission par écrit. Enfin, en 1743, il fut émané un troisième édit royal, prohibant strictement tout achat, mutation, et aliénation en main-morte, sans une autorisation du roi ou de la justice.
Il fut aussi émané, la même année, un ordre du conseil supérieur, défendant aux curés de marier les mineurs sans permission, et leur enjoignant de se conformer en tout aux règles canoniques concernant la publication des bans de mariage.
L’année suivante, le roi de France, persuadé à juste titre, que toute les lois et ordonnances du royaume n’étaient pas convenables aux colonies, écrivit au gouverneur et à l’intendant de la Nouvelle France, une lettre portant que sa majesté entendait qu’à l’avenir les ordonnances et édits royaux auxquels elle voulait que ses sujets du Canada obéissent fussent enrégistrés au conseil supérieur de Québec; et que conséquemment, aucun édit, arrêt, déclaration, lettres-patentes, &c. ne fussent enrégistrés au dit conseil, sans un ordre exprès de sa part, signifié par le ministre de la marine et des colonies.
La même année 1744, en conséquence d’une lettre écrite à l’évêque de Québec par M. de Maurepas, d’après des représentations envoyées en France par les autorités civiles de la colonie, ce prélat supprima ou abolit plusieurs des fêtes qui se célébraient dans son diocèse. Ce sont celles dont la solennité est présentement remise au dimanche suivant.
Une ordonnance datée du 28 Avril 1715, nous paraît mériter d’être rapportée à peu près en entier, d’autant plus que nous croyons qu’elle n’a pas été annullée, et qu’il y est contrevenu présentement, d’une manière préjudiciable au bien du pays sous plus d’un rapport. Cette ordonnance porte:
Que sa majesté étant informée que l’établissement des terres en Canada n’a pas fait les progrès qu’elle avait lieu d’attendre de la protection et des facilités qu’elle veut bien accorder aux habitans; que cette colonie n’a pas même fourni, pendant quelques années, les vivres nécessaires pour la subsistance de ses propres habitans; que la principale cause de ce ralentissement vient de ce que la plupart des habitans se bornent à cultiver les portions des terres qui leur sont échues par le partage des biens de leurs pères, et qui le plus souvent se trouvent réduites à une si petite étendue, que les dits habitans ne peuvent y recueillir de quoi subsister; et que ces mêmes habitans pourraient cependant faire d’autres établissemens plus utiles pour eux et leurs familles, et plus avantageux pour le bien général de la colonie.
Sa majesté fait défense à tous ses sujets de la Nouvelle France qui ont des terres à cens, de bâtir dorenavant aucune maison ou étable en pierres ou en bois, sur les terres ou portions de terres, à moins qu’elles ne soient d’un arpent et demi de front sur trente à quarante de profondeur, à peine de cent livres (tournois) d’amende, et de démolition des dites maisons et étables. Les propriétaires pourront seulement y faire construire, s’ils le jugent à propos, des granges en bois, pour y serrer les grains, foins, et autres denrées qui seront recuilles sur les dites terres.
Pour procurer aux citoyens des villes une abondance de menues denrées, sa majesté permet aux habitans des environs des dites villes, de faire tels établissemens, et dans telle étendue de terrain qu’ils jugeront à propos, dans les fauxbourgs et banlieues des dites villes, en se conformant aux règlemens et aux usages ordinaires de la voierie et de la police.
Les dispositions portées au précédent article auront lieu pour les bourgs et villages déjà établis, ou qui le seront par la suite, et suivant qu’il sera estimé nécessaire par le gouverneur-général et l’intendant de la colonie, à l’effet de quoi, ils détermineront les limites des dits bourgs et villages, au-dela desquelles il ne sera permis aux habitans de faire d’autres établissement sur leurs terres en censive, que conformément à ce qui a été réglé au premier article de la présente ordonnance.
Le premier exemple de désobéissance à un règlement si salutaire fut donné dans l’ile d’Orléans: cinq des habitans de cette île ayant bâti des maisons sur des portions de terres moins étendues qu’il n’était requis par l’ordonnance royale, ils furent poursuivis et condamnés à payer chacun l’amende de cent livres, et les bâtimens qu’ils avaient érigés en contravention à la loi furent démolis.
L’année 1745 est célèbre dans les annales du Canada par le siège de Louisbourg, et la reddition de cette place aux Anglais, ou plutôt aux colons de la Nouvelle Angleterre. La guerre avait été déclarée entre la France et l’Angleterre, au commencement de l’année précédente 1744. M. Duvivier, qui commandait à Louisbourg, n’eut pas plutôt été informé de ce nouvel état de choses, qu’il arma quelques vaisseaux de guerre qu’il y avait dans le port, y fit embarquer environ neuf cents hommes, tant troupes réglées que milices, et gagna le poste de Camceaux, dans l’Acadie, dont il se rendit maître sans coup férir. Après en avoir transporté la garnison et les habitans à Louisbourg, M. Duvivier retourna sur les côtes de l’Acadie, et tint le Port Royal bloqué pendant plusieurs semaines. Mais ayant appris qu’il y venait du secours de la Nouvelle Angleterre, il se retira aux Mines, autre poste de l’Acadie, peuplé de Français, dont il prit possession, mais qu’il abandonna ensuite comme intenable, pour retourner à Louisbourg, où sa présence était devenue nécessaire.
Le 5 Février 1745, il fut résolu dans l’assemblée générale du Massachusetts, à la majorité d’une voix, qu’il convenait de faire une tentative contre Louisbourg, afin d’oter aux Français, par la réduction de cette forteresse, les moyens faciles qu’elle leur fournissait d’incommoder la Nouvelle Angleterre et de faire des excursions dans la Nouvelle Ecosse. M. Shirley, homme habile et entreprenant, qui était alors gouverneur de la Nouvelle Angleterre, entra avec ardeur dans les vues de l’assemblée générale: les enrôlemens commencèrent aussitôt, et au bout d’un mois, le nombre des volontaires fut de plus de 4000.
Ces troupes furent mises sous les ordres de M. Pepperel, commandant en chef des milices, et embarquées sur une escadre commandée par le commodore Warren. Cette escadre se rendit d’abord à Camceaux, où elle resta trois semaines, pour attendre que les rivages de l’Ile Royale fussent débarrassés des glaces qui les rendaient inabordables. Elle remit à la voile le 10 Mai, et jetta l’ancre, le lendemain, dans la baie de Gabori ou Gaborouse, un peu au sud de Louisbourg.
Les Français voulurent s’y opposer au débarquement des troupes de terre; mais ils furent repoussés avec la perte de huit hommes tués et d’une vingtaine de prisonniers. Le même jour un détachement des troupes débarquées brula l’établissement français de St. Pierre. Le lendemain, elles érigèrent une batterie de petits canons et de quelques mastiers sur la Colline verte, à 750 toises environ du bastion du Roi appelle la Citadelle.
Le 13, 4000 hommes marchèrent, à l’abri des hauteurs, au havre du Nord-Est, et y brulèrent les magazins, &c.; sur que les troupes françaises qui étaient stationnées à la grande batterie enclouèrent leurs canons, au nombre de trente, de 36 et 42 livres de balles, et se retirèrent dans la ville, pour en renforcer la garnison. Ces canons furent presque aussitôt décloués et tournés contre la place. Les assiégeans furent obligés d’amener les plus gros des leurs sur des espèces de traineaux par des marais impénétrables pour les bœufs et les chevaux. Ils ne firent point d’approches régulières par des tranchées en parallèles et en zigzags, mais se contentèrent de battre et de bombarder la ville au hazard; ce qui ne laissa pas de causer beaucoup de dommages aux murs et aux bâtimens intérieurs, mais sans qu’il en résultât aucune brèche praticable.
Le 18, il fut érigé une batterie à 425 toises distance, et la ville fut sommée de se rendre. Le lendemain, les assiégés firent une sortie qui n’aboutit à rien d’important; mais un détachement de sauvages tua un assez grand nombre de traineurs anglais.
Dans la nuit du 27, cent hommes de la garnison débarquèrent près de la pointe du Phare, dans l’intention de surprendre ceux des assiégeans qui y érigeaient une batterie, pour la faire jouer sur celle de l’île; mais ils furent découverts à temps, et poursuivis jusque dans le bois, où ils furent joints par des sauvages, et escarmouchèrent pendant quelque temps avec les avant-postes des assiégeans. Le 28, il fut érigé une batterie à 250 verges seulement de la porte de l’Ouest. Le 30, la Vigilante, vaisseau français de 64 canons, chargé de troupes et de provisions pour Louisbourg, fut pris par le commodore Warren, qui couvrait le siège par mer avec son escadre. Le 31, il fut érigé une nouvelle batterie de cinq canons de 42 livres, pour jouer sur la batterie circulaire de la ville et le magazin du roi.
Le 5 Juin, 500 hommes dans des bateaux firent une tentative contre la batterie française de l’île, forte de trente canons de 28 et gardée par 150 hommes; mais ils furent repoussés avec la perte de soixante hommes tués ou blessés, et cent vingts faits prisonniers.
Le 23, l’escadre anglaise se trouvant composée d’un vaisseau de 64 canons, de trois de 60, d’un de 50 et de quatre de 40, il fut résolu que le lendemain, on donnerait l’assaut à la ville par mer, tandis que les troupes du camp feraient une attaque du côté de terre, par voie de diversion.
Quoique les murs de Louisbourg fussent de quatre-vingts pieds de hauteur, que le fossé en eût autant de largeur; qu’il y eût 64 canons de gros calibre en batterie dans la ville, sans compter ceux de l’île, dont il a été parlé plus haut, et que la place fût abondamment pourvue de vivres et de munitions, la garnison, forte de 900 hommes, fut effrayée des préparatifs des assiégeans, et le commandant se détermina, peut-être trop tôt, à capituler. Comme les échelles se trouvèrent trop courtes de dix pieds, il est assez probable que l’assaut n’aurait pas réussi, et que les assiégeans auraient été découragés par le manque de succès. Quoi qu’il en soit, il fut convenu que la garnison sortirait de la place avec les honneurs de la guerre, et serait transportée en France aux frais de l’Angleterre, à la condition de ne point servir contre cette puissance durant l’espace d’une année. La perte des assiégeans ne fut pas de plus de 150 hommes tués: celle des assiégés n’est pas mentionnée par l’auteur qui nous sert de guide; mais elle ne dut pas être bien considérable.
La reddition de Louisbourg et du Cap-Breton ne fut pas plutôt connue en France, que le gouvernement fit préparer un armement considérable dans le port de la Rochelle. La flotte fut prête à mettre en mer dès le commencement de Mai 1746; mais elle fut retenue par les vents contraires jusqu’au 22 Juin, qu’elle mit à la voile, sous les ordres du due d’Anville, officier de mer dans le courage et l’habileté duquel on avait la plus grande confiance. Elle consistait alors en onze vaisseaux de ligne, trente vaisseaux de dix à trente canons et bâtimens de transport, avec trois mille hommes de débarquement, sous le commandement de M. de Pommeril, brigadier-général. Cette flotte devait être renforcée par quatre vaisseaux des Antilles sous les ordres de M. de Conflans, et l’on s’attendait que l’armement serait joint par les Acadiens, ou habitans français de l’Acadie, où M. de Ramsay s’était rendu, avec dix-sept cents Canadiens et sauvages, pour attendre l’arrivée de la flotte.
C’en était bien autant qu’il fallait pour reprendre le Cap-Breton et enlever l’Acadie aux Anglais, sans l’espèce de fatalité qui sembla s’attacher alors comme plus tard aux entreprises des Français en Amérique. Il n’y avait que quelques jours que la flotte était en mer, lorsqu’elle fut accueillie par une tempête qui sépara les vaisseaux les uns des autres; de sorte qu’il n’en arriva que quelques’uns, avec celui de l’amiral, à Chébouctou, le 12 Septembre, c’est-à-dire plus de deux mois et demi après le départ de la Rochelle. Pour comble d’infortune, le duc tomba malade le jour même de son arrivée à Chébouctou, mourut quatre jours après.
Le surlendemain 18, il fut assemblé un conseil de guerre: le vice-amiral y proposa de retourner en France, attendu qu’il ne restait plus que sept vaisseaux, et que la plus grande partie des troupes se trouvait sur ceux qui manquaient. M. de la Jonquière, qui le 15 Mars précédent, avait été nommé gouverneur du Canada, en remplacement de M. de Beauharnois, s’opposa à la proposition du vice-amiral: d’autres proposèrent d’attaquer les établissemens anglais de l’Acadie, et particulièrement le Port Royal, ajoutant que si l’on ne réussissait pas à le prendre, on pourrait du moins hiverner en sûreté dans la baie de Casco, ou s’en retourner en France plus tard, si la chose devenait nécessaire. Le vice-amiral, qui était depuis quelque temps indisposé, voyant que son avis ne prévalait pas, tomba dans une espèce de délire, et se passa son épée au travers du corps.
Par sa mort, le commandement échut à M. de la Jonquière, qui, quoiqu’âgé de plus de soixante ans, se montra plus actif et plus résolu que son prédécesseur, et releva par là le courage de la flotte et de l’armée. Mais tandis que les Français se préparaient à attaquer le Port Royal, Une chaloupe que M. Shirley envoyait à Louisbourg, avec la nouvelle du départ de l’amiral Lestock pour l’Amérique, fut prise par un croiseur français, et conduite à Chébouctou. Sur cet avis, M. de la Jonquière n’eut rien de plus pressé que de mettre à la voile: une tempête qui l’assaillit près du Cap de Sable, dispersa encore le peu de vaisseaux qu’il avait sous son commandement; et il s’en retourna en France, sans avoir rempli aucune des vues que son gouvernement s’était proposées, en faisant cet armement.
(A Continuer.)

Les fumiers en ce pays, sont, pour ainsi dire, le seul engrais dont les cultivateurs se servent pour améliorer leurs terres épuisées. Encore plusieurs ont-ils la coupable négligence de les laisser perdre à la porte de leurs étables et de leurs granges, sans en retirer l’avantage de l’engrais, qui serait pour eux une source de richesses et d’opulence, ou au moins qui les soutiendrait dans leur fortune et les empêcherait de tomber dans l’indigence et la misère.
Il est vrai que ce malheureux nombre n’est pas le plus grand; mais il est toujours trop fort, à cause des pertes qui en résultent et de la ruine des individus négligents, qui méprisent cette manière d’améliorer leurs antiques propriétés; rien ne démontra plus la négligence et la décadence d’un cultivateur, que de voir à l’en tour de ses étables et de ses granges, des fumiers épars ça et là, près desquels et sur lesquels croissent des mauvaises herbes de toutes les espèces, et qui lui font une nuisance journalière. Un homme, pour peu qu’il ait de cœur et de sentiment, devrait rougir de honte de garder près de sa maison, des marques évidentes et certaines de sa nonchalance, et de la plus grande indifférence en fait de culture.
Que doit penser le voyageur de la capacité et du courage d’un cultivateur, lorsqu’il voit des quantités prodigieuses de fumiers, accumulés ça et là près de ses bâtimens? sans doute qu’il se forme une idée bien petite d’un homme qui néglige ainsi la partie la plus nécessaire et la plus essentielle de ses travaux.
Au contraire, quel plaisir et quelle satisfaction n’éprouve pas le passant, lorsqu’il voit une ferme dont les étables et les granges ont une apparence de propreté et de diligence, et auprès desquelles on ne voit aucun fumier ni immondices, qui démontrent de la négligence et de l’indifférence. On a aussitôt la meilleure opinion d’un propriétaire qui paraît si soigneux et si travaillant: on admire son courage et son industrie, et l’on s’entretient de la beauté de ses dépendances. Chacun lui donne de justes louanges; on publie son industrie et sa propreté, et on exalte son travail et sa judicieuse vigilance. On ne saurait donc trop blâmer les uns et rendre assez de justice aux autres; mais parmi ceux qui sont soigneux et vigilants, il se glisse souvent beaucoup de défauts dans la manière d’employer le fumier de leurs animaux, et qui par là même les empêchent de retirer tout l’avantage possible de cette espèce d’engrais, qui mal employé et à contre-tems, est moins favorable à la végétation. La manière d’avoir du fumier qui soit de la meilleure qualité n’est pas ou n’est que peu connue des cultivateurs du pays; il faut des soins et beaucoup de précautions. Il est nécessaire d’avoir des étables qui aient de bons planchers bien serrés, afin d’empêcher les urines de s’écouler dans la terre et de se perdre; car elles ajoutent au fumier une force qu’on ne saurait trop apprécier: elles lui donnent une vertu humide et nutritive qui augmente beaucoup sa force et son pouvoir. Ceux qui ont de grandes quantités de fourrage, et plus que leurs animaux n’en peuvent consommer, doivent mettre d’épaisses litières sous leurs animaux, afin de retenir les urines, et de donner à ces sortes de pailles une vertu nutritive qu’elles n’auraient point sans cela. Ceux qui ne font point de plancher dans leurs étables, et qui laissent coucher leurs animaux sur la terre, avec la malpropreté qui règne ordinairement dans ces étables, perdent une partie notable d’un excellent engrais, ou plutôt ils diminuent volontairement la valeur de leurs fumiers, qui ne leur donneront qu’un engrais médiocre et peu durable. Les fumiers doivent être mis en tas auprès des étables, afin que les pailles et foins qui s’y trouvent mêlés se décomposent et se pourrissent plus vite, et qu’il ne fassent qu’un seul tout avec le fumier. Dès que les beaux jours du printems commencent à paraître, et que le soleil nous favorise de ses premières faveurs, on doit alors mettre dans les fumiers, toutes les pailles, pesas, et autres choses de cette espèce, qui restent dans les granges; et jetter dessus une couche de fumier, assez épaisse pour qu’ils se pourrissent et corrompent promptement et à l’égal du fumier. Après trois semaines ou un mois de soleil, et lorsqu’on est certain que les fumiers sont parfaitement dégelés, et qu’ils commencent à chauffer, il faut avoir le soin de les couvrir (quoique les cultivateurs Canadiens ne le fassent jamais) afin d’empêcher les pluies qui tombent quelquefois, avec une grande abondance dans cette saison, de les pénétrer, et d’en tirer en peu de tems par de continuels lavemens la meilleure partie, qui est la vertu nutritive et végétative, qu’ils peuvent contenir.
Le soleil n’est pas moins dangereux que la pluie: il n’y a aucun doute que par la force de son insatiable attraction, il n’enlève continuellement une partie notable des substances grasses que contient la superficie du fumier. Ainsi il est de la plus grande nécessité de mettre le fumier à l’abri du soleil et des pluies: ses qualités seront généralement meilleures; il possédera une plus grande force; et sera en état de couvrir une plus grande étendue de terrain.
Les Canadiens ont pour habitude, et c’est encore un vice dans leur système actuel de culture, de charroyer leurs fumiers aussitôt après leurs semences faites, afin de se débarasser de ce pénible ouvrage et de nétoyer les devantures de leurs granges et de leurs étables. En cela ils ont certainement raison, et j’avoue que c’est bien pour eux le tems le plus propice et le plus favorable pour faire cet ouvrage; mais si c’est le tems le plus convenable, il faut qu’il soit fait dans des circonstances fort heureuses, qu’on ne peut pas toujours prévoir.
Encore ces circonstances heureuses, qui sont des pluies de quelques jours qui suivent immédiatement le charroyage des fumiers, ne font qu’empêcher une plus grande perte, en donnant aussitôt à la terre, les vertus humides et nutritives des fumiers, qu’un soleil ardent attirerait promptement par son avide et continuelle attraction. Car dès que les fumiers sont charroyés et étendus, s’il vient une pluie de quelques jours, elle les pénètre et les lave, et donne immédiatement à la terre toutes les substances nutritives qu’ils contiennent. Alors on voit l’herbe croître considérablement: elle devient plus verte et plus forte: elle jouit, contre les vœux du laboureur, des premiers avantages que donne le fumier à la terre, et profite des premières et plus fines substances de cet engrais, qui ne devrait servir qu’au seul froment. Ce qui reste de graisse ou vertu nutritive dans la terre après que l’herbe en a eu les premiers avantages, a moins de force et de vigueur, et par conséquent est moins favorable à la
Mais ce qui est encore le plus à craindre et le plus dangereux, c’est un tems sec et chaud, pendant plusieurs jours, après que le fumier a été charroyé et étendu. Le soleil attire avec une grande avidité toutes les substances humides et nutritives que contient le fumier: il devient sec et aride, et les vents emportent dans les airs un suc nourricier et végétatif qui était, destiné à restaurer la terre épuisée. Le fumier le plus gras est alors privé de toute sa valeur et sa force, et il ne lui reste plus que la propriété de retenir l’humidité que contient la terre, et de l’empêcher de s’exhaler dans l’air par des évaporations qui seraient sans le secours du fumier plus communes et plus faciles. Le fumier ainsi détérioré par les ardeurs du soleil, ou lavé par l’abondance des pluies, cause une perte considérable au cultivateur, qui attend de cet engrais, des avantages dont l’herbe a profité à son préjudice, ou que le soleil et le vent ont naturellement dissippé dans les airs. Il est certain que le tems le plus propice pour charroyer le fumier, et pour en avoir un ample profit, serait avant de faire les labourages, l’automne ou le printems. Car il serait aussitôt couvert par la terre, et serait moins détérioré par les ardeurs du soleil, ou par des pluies continuelles et abondantes.
Le grain que l’on confierait à cette terre profiterait seul de sa force et de sa valeur, et deviendrait beaucoup plus beau que s’il eût été semé dans une terre engraissée dans le tems ordinaire. Mais afin que le fumier que l’on charroyerait à cette saison ne fût pas nuisible, il faudrait qu’il fût bien pourri; car s’il était trop vert, il empêcherait l’action de la charrue, ou au moins rendrait la terre très difficile à labourer; ce qui causerait une perte de tems considérable pour le laboureur. On peut aussi étendre du fumier sur les terres ensemencées; mais il faut éviter de le charroyer avec des chevaux ou des bœufs; car ils perdraient beaucoup de grains par leurs pieds.
Le grain viendrait tout à fait beau et bon sur un terrain, ainsi engraissé, surtout si une pluie favorable et bienfaisante venait à tomber aussitôt après cet ouvrage terminé. Le grain profiterait alors seul de toute la force du fumier.

Dans les habitations situées sur les bords de la Delaware, une jeune fille d’une beauté parfaite, nommée Molly, aimait le jeune Seymours, et en était tendrement aimée. Harvey, père de la belle Molly, possédait de grandes richesses; il avait des champs fertiles et de nombreux troupeaux. Seymours était pauvre; Harvey ne pouvait se résoudre à lui donner sa fille, Seymours accablé de chagrin, partit pour la Caroline avec une troupe de volontaires. Jaloux d’apporter des lauriers aux pieds de sa maîtresse, et d’acquérir un grade qui puisse lui faire obtenir sa main, il se distingue à la défense du fort Sullivan, et le commandement d’une compagnie devient bientôt la récompense de sa valeur.
Après avoir donné de nouvelles preuves de son courage, il joignit l’armée de Washington; et se trouvant peu éloigné de sa maîtresse, il désira jouir du bonheur de la revoir; il demanda et obtint un congé de trois jours. Le père de Molly le voyant capitaine, lui fit un accueil favorable, et ne crut pas devoir refuser pour gendre un homme utile à sa patrie. Le temps pressait; il fallait que Seymours retournât dans les camps: le mariage se fit dès le lendemain. Après la cérémonie, les parens des jeunes époux se rassemblèrent sous des arbres environnés de treillages, à deux cents pas de la maison d’Harvey. Ils y faisaient un repas champêtre qu’assaisonnait une douce joie, lorsque les soldats de l’infanterie légère du général Howe, qui parcouraient le pays pour chercher des vivres, traversèrent l’habitation. Seymours et les témoins de son bonheur étaient dans la plus grande sécurité: l’armée anglaise était loin de là, et le pays était couvert par les détachemens de Washington, qui tenaient la campagne. Cependant deux soldats appercevant de loin, à travers les arbres, un uniforme américain, s’avancèrent en appellant leurs camarades. Ils surprennent Seymours au milieu de la joie et dans l’ivresse du plaisir; ils veulent l’emmener prisonnier. Il n’avait point ses armes, mais le courage et l’amour ajoutant à sa force, il saisit un des aggresseurs, s’empare de son fusil, et le renverse d’un coup de bayonnette. L’autre soldat prend la fuite: Seymours le poursuit, et lâche son coup après lui. Fier de sa victoire, il revole vers ses parens et ses amis; mais il n’entend que des cris et des gémissemens: il frémit, il approche: la balle a frappé son amante, il la trouve expirante et baignée dans son sang.
Ne pouvant supporter ce spectacle douloureux et terrible, ni la voix d’Harvey qui lui demande sa fille, Seymours retourne éperdu dans le camp, pour se livrer tout entier à la fureur et au désespoir. Il ne tarda pas à trouver dans les combats la mort qu’il désirait, et à suivre au tombeau celle qu’il avait tant aimée, et qu’une affreuse destinée fit périr de sa main, au moment qu’il allait être l’époux et l’amant lé plus fortuné.
(Beautés de l’Histoire des Etats-Unis.)

Un peu de fumée sur le penchant du Vésuve suffit pour faire pâlir l’habitant de Portici, et l’orangiste d’Irlande se croit perdu s’il entend murmurer: tolérance, liberté, révolution surtout. A ces terribles paroles, fussent-elles prononcées au hazard, son corps s’agite, son visage se décompose, et son trouble donne le secret de sa faiblesse. En voici un exemple récent. Un de nos compatriotes, le duc dé Montébello, assitait au meeting de Ballinasloe: flattés d’avoir un pair de France pour témoin de leurs énergiques réclamations, les catholiques du Connaught lui ont adressé des remercîmens, auxquels il a répondu en faisant des vœux pour le succès de leur cause. C’est ce qui arrive tous les jours en Angleterre. Eh bien, en Irlande, cette circonstance si simple est tout à coup devenue une affaire d’état. Les catholiques s’en sont réjouis comme d’un événement de la plus haute importance, et le gouvernement a eu la folie de s’en effrayer. Plus d’un conseil privé s’est rassemblé a Dublin pour délibérer sur les dangers de la patrie; des meetings protestants ont eu lieu, où l’on a parlé de trahison, de donjon, et même de potence. Pendant ce temps, les journaux ne restaient point en arrière: l’un dénonçait à l’exécration publique “le fils de l’un des chefs de cette horde sanguinaire que la France, aux jours de son athéisme, a vomie sur l’Europe;” l’autre en faisait l’émissaire des jésuites de Rome, et invoquait contre lui l’alien-bill, qui n’existe plus. Le grave Courrier voyait dans le discours du due de Montébello le pied fourchu de l’invasion étrangère; et le John Bull, avec une délicatesse toute aristocratique, lui reprochait surtout de n’avoir pas deux cent mille livres de rente, armant ainsi un préjugé contre l’autre. Tous enfin ont rêvé l’Irlande en feu, et le Times lui-même, le sage Times, a sérieusement envoyé Sa Grâce (His Grace) conspirer avec M. Shiel, contre la religion protestante et la maison de Hanovre. Dans cette puissante Grande-Bretagne, c’étaient enfin toutes les petites craintes, tous les misérables soupçons, toutes les honteuses angoisses du gouvernement lombardo-autrichien. juste châtiment de l’intolérance et de la persécution! C’est pour les opprimés un commencement de vengeance.
Quel était donc ce discours à la fois jésuitique et séditieux, diplomatique et incendiaire, ce discours qui a ébranlé l’empiré britannique et fait trembler sur sa base la glorieuse, pieuse et immortelle statue du grand roi Guillaume? En voici la traduction:
“Si j’étais Irlandais, je me rendrais digne de l’honneur que vous venez de m’accorder, en défendant votre cause. Mais, etranger, que puis je? si ce n’est faire les vœux les plus ardents pour votre délivrance. On est heureux de trouver des hommes pour qui les mots de tolérance et de justice ne sont point de vains sons. Ces hommes sont nombreux en France. Et comment serions-nous insensibles à vos souffrances, nous qui, libres depuis si peu de temps, n’avons point encore oublié le temps où nous luttions pour le devenir? Enfin nous avons conquis la liberté civile et religieuse; nous l’avons conquise par cette glorieuse révolution, si mal connue de ceux qui ne voient que ses excès; et quoique catholiques pour la plupart, si demain le protestantisme était blessé dans ses droits, nous nous lèverions contre les empiètemens du catholicisme comme vous vous levez aujourd’hui contre ceux l’église dominante. Permettez-moi donc au nom de la France libérale, de vous souhaiter une prompte et complète émancipation. En persistant dans vos efforts vous ne pouvez manquer de l’obtenir, et je ne puis croire que l’admirable constitution anglaise reste toujours déshonorée par l’ilotisme politique de six millions d’hommes.”
De tels sentimens n’ont rien que de noble et de généreux: exprimés au nord de l’Angleterre, on les eût trouvés parfaitement innocents; le Courrier n’en eût rien dit, et le Times les eût loués; mais l’Irlande les avait applaudis, et, dès qu’il est question de l’Irlande, les Anglais perdent la tête. Quand les plus sages en parlent, c’est avec un orgueil de conquérant, avec une naïveté de dominateur, qui reportent aux siècles de Henri II et de Cromwell. A leurs yeux, il ne s’agit point de droits, mais de faveurs. Ce sont de hauts et puissants seigneurs qui daignent consentir à émanciper leurs esclaves. Lettres sur la situation de l’Irlande. Paris, 1826.

La nature bienfaisante a souvent placé le remède, à côté de mal: c’est ainsi que, dans l’Amérique du Sud, le guaco, espèce de lierre qui s’accroche avec ses vrilles aux branches des arbres, annonce la présence des serpens de la plus dangereuse espèce; car il passe pour certain que cette plante, antidote infaillible de leurs poisons, abonde dans les lieux qu’ils habitent. La racine et les branches du guaco, qui ressemblent à la vigne dépourvue de ses feuilles, sont également efficaces contre leur morsure. Si je n’avais, dit M. Thompson, entendu raconter les effets de ce contre-poison par des personnes dignes de foi qui les avaient éprouves elles-mêmes, je n’aurais pu y croire, tant on les représente comme instantannés et en quelque sorte miraculeux morsure de quelques-uns des serpens de ce pays est si venimeuse, que l’on en meurt en moins de vingt minutes; mais si la personne blessée peut mâcher un morceau de guaco pendant quelques heures, en appliquant sur la plaie une partie de la salive qui résulte de cette mastication et avalant le reste, elle n’a plus à redouter aucun mauvais effet du venin, quelque puissant qu’il soit.
Ce merveilleux remède ne pourrait-il pas être employé dans le cas d’hydrophobie? Sans parler de son utilité contre les fièvres d’accès, la dysenterie, et généralement toutes maladies qui appartiennent aux contrées où il est répandu avec abondance, je puis, poursuit M. Thompson, me citer comme exemple de ses qualités bienfaisantes. A l’exemple des autres Anglais, pour éviter les maladies pendant que je résidais à Sansonate et dans les autres villes dont le climat est considéré comme funeste aux Européens, j’en pris tous les jours, et ma santé y fut constamment parfaite.

On trouve dans un journal de province la découverte suivante, qui est de nature à intéresser l’agriculture:
Un propriétaire avait mis des branches de sureau, garnies de leurs feuilles et de leurs fleurs, dans un grenier où se trouvait du blé que les charançons avaient attaqué; l’odeur de ces branches, ou plutôt celle de la fleur, a suffi pour éloigner ces insectes. L’expérience a été recommencée dans d’autres greniers, et chaque fois elle a donné le même résultat.
M. Patey vient d’inventer un système qui fixe les mots entiers aussi rapidement que la sténographie trace les seules syllabes, et qui permet d’écrire en une heure ce que le plus habile expéditionnaire écrirait à peine en un jour.
Un nouveau système qui a pour but de faciliter d’une manière extraordinaire l’enseignement de l’arithmétique, vient d’être inventé par M. Lahaye, chef de bataillon et ancien ingénieur. Au moyen de cette découverte, dite Arithmétique physico-instrumentale, 10,000 personnes pourraient en moins de 15 jours, apprendre à calculer, alors même qu’elles ne sauraient ni lire ni écrire.
Sucre de Foin.—Tandis que l’Europe occidentale s’applique avec succès à substituer le sucre de betteraves au sucre de cannes, un malfaiteur détenu dans la maison de correction de Vienne, en Autriche, vient, dit-on, de découvrir un procédé pour faire du sucre avec du foin. On sait qu’il en existe toujours plus ou moins dans tous les végétaux; mais cet homme assure que la matière saccharine est surtout en très-grande abondance dans le foin, et qu’on peut tirer une livre de sucre de six livres de cette plante, au moyen du procédé dont il est l’inventeur. Il paraît que le gouvernement autrichien ne considère pas ce projet comme chimérique, et qu’il est disposé à en favoriser l’exécution.

M. Julia Fontenelle communique, dans une lettre adressées à l’Académie, des faits très importants observés par M. Portal, et qui confirment ce qu’avaient avancé MM. les commissaires chargés de rendre compte du mémoire de M. Leroy d’Etoiles sur l’innocuité de l’insufflation de l’air chez les nouveau-nés, et les avantages qu’on peut en retirer.
On avait apporté à M. Portal un enfant né asphyxié; il était déjà depuis quelque tems dans son amphithéâtre lorsqu’il se mit en devoir d’en faire la dissection. Mais, au moment d’opérer, il eut l’heureuse idée de lui souffler pendant quelques instans dans la bouche; au bout de deux ou trois minutes, la chaleur revient, la circulation commence à se rétablir, le cœur bat, et bientôt ce cadavre est un enfant plein de vie qu’il renvoie à ses parens.
Un semblable événement arriva à un anatomiste de Lyon, qui le communiqua dans le tems à M. Portal.
M. Julia Fontenelle fait remarquer combien ces deux importantes observations sont concluantes en faveur des avantages qu’on peut retirer de l’insufflation chez les enfans nouveau-nés, pourvu toutefois que l’air soit poussé dans la poitrine avec ménagement.

Mr. Bibaud.—Les journaux de Montréal et de Québec, en publiant que ce vieillard était mort à Ste. Rose, le 15 Mai dernier, ont ajouté qu’il était né à Québec en 1705, et conséquemment décédé à l’âge avancé de 124 ans. Voici quelques petits détails qui, tout en prouvant que la conséquence est inexacte, parce que la majeure est fausse, vont vous rajeunir mon homme de 34 ans seulement! Notez bien.
J’avais entendu parler, dès avant 1825; de cet homme extraordinaire par son âge. Il vivait alors à St. Martin, dans l’Ile Jésus, au petit village, près du passage. Il y était connu sous le nom de Bon-homme Cent-ans. J’y vais exprès en 1827, et j’entre de suite en conversation: “Eh bien, Père, quel âge a-t-on?—Cent vingt-deux ans, Monsieur.—Bien; et en quelle année est-on né?—En 1705.—A merveille. Quel est votre nom?—François Forgue ou Mourougeau.—Les noms de vos père et mère?—Pierre Mourougeau et Marie Boissel.—Se rappelle-t-on du parrain et de la marraine?—Oh oui; ce sont mon grand-père Boissel et ma tante Turgeon.—Mais, on ne peut mieux, Père....et se souvient-on du prêtre qui nous a baptisé?—Eh mais, ce n’est pas le même, je crois, ...hé hé hé hé; celui qui m’a baptisé, moi, c’est le bon Monsieur Chasle, curé de Beaumont, ma paroisse.”
Muni de ces notes et de quelques autres détails moins véridiques, peut-être, sur les faits et gestes de notre jeune centenaire, je pris congé de lui, certain d’en avoir assez pour mettre le présent curé de Beaumont à même de me fournir son Extrait de baptême. Je lui fis écrire, en Mars 1827, par un ami de Québec. Voici sa réponse et l’extrait qu’elle couvrait.
Beaumont, 4 Avril 1827.
“Monsieur.—Je vous envoie un Extrait de baptême qui ne ressemble guères à celui que vous m’avez demandé; je crois pourtant que c’est celui de votre vieillard, qui me paraît savoir la musique au parfait.[1] Il dit qu’il est né à Beaumont en 1705, et qu’il a été baptisé par Mr. Chasle: la chose est impossible; car le premier acte que ce monsieur a fait à Beaumont, dont il a été curé pendant quarante et quelques années, est du 16 Novembre 1718. Mr. Plante, qui avait succédé à Mr. Pinguet en 1704, était curé de Beaumont en 1705; en 1711, au mois de Septembre, il fut remplacé par le R. P. Lepoyvre, récollet, qui eut pour successeur, en 1713, Mr. Louis Mercier, mort de la peste, le 8 Mai 1715: son successeur fut Mr. Plante, qui alors était chanoine de Québec, et qui a fait les fonctions curiales de la paroisse de Beaumont jusqu’au 16 Novembre 1718. Vous voudrez bien me pardonner cette digression, et croire que j’ai cherché avec toute l’attention possible, l’acte en question, sans pouvoir en trouver d’autre que celui que je vous envoie ci-inclus. J’ai l’honneur, &c.
T. L. Ptre.”
Extrait des Régistres des actes de Baptêmes, Mariages et Sépultures de la Paroisse de St. Etienne de Beaumont, dans le District de Québec, pour l’année 1739.
“Le 25 de Février de l’an 1739, a été baptisé, dans l’église paroissiale de St. Etienne de Beaumont, par Nous, Prêtre, Curé de la dite Paroisse, François, fils de Pierre Mourougeau, habitant du dit lieu, et de Marie Boissel, son épouse légitime, le dit enfant né du jour d’hier, environ les huit heures du soir; le parrain a été Pierre Boissel, grand-père du baptisé, et la marraine Elisabeth Turgeon, femme d’Augustin Couture, lesquels ont dit ne savoir signer, de ce enquis.
(Signé) Chasle, Ptre.”
Lequel Extrait, &c. Beaumont, 4 Avril 1827.
T. L. Ptre.
Maintenant, Mr. Bibaud, comparez les noms de l’Extrait avec ceux du dialogue, et si de 1829, Mai 15, jour du décès du défunt, vous ôtez 1739 Février 24, jour de sa naissance, vous verrez que François Forgue Mourougeau n’est pas mort à 124 ans mais bien à 90 ans, 2 mois et 22 jours, je crois.
Fi donc! Pourquoi mentir, Mr. Mourougeau? C’est si laid, Messieurs les journalistes!—Votre Serviteur et Ami,
J. V.
|
En bonne phrase canadienne—Jouer du violon: en français—Avoir perdu la carte. |

Le navire Sachem est arrivé il y a quelques jours à Boston, ayant à bord deux jeunes gens de Siam, âgés de 18 ans, dont les corps sont attachés l’un à l’autre depuis leur naissance.
Nous avons examiné cet étrange jeu de la nature, disent les éditeurs du Commercial Gazette; c’est une des plus grandes curiosités que nous ayons jamais vues. La taille de ces deux jeunes gens approche de cinq pieds; leurs corps sont bien proportionnés; leur figure porte une expression agréable. Ils sont forts, actifs, doux, intelligents et pleins de sensibilité. Enfin ils sembleraient parfaitement bien constitués, si ce n’était qu’un ligament, de substance osseuse ou cartilagineuse, de sept pouces de circonférence et de quatre de longueur, partant de la région ombilicale, les tient fortement unis ensemble. Ce ligament est élastique et leur permet de se tourner en tous sens; ils font voir qu’ils ont chacun une volonté en s’efforçant quelquefois de se diriger vers des objets opposés; on dirait alors qu’ils tirent l’un contre l’autre, comme deux chiens dont la tête est passée dans un même collier. Quoique leur esprit soit distinct pour chacun, cependant leur organisation les doue d’une grande sympathie; car ils s’endorment presque au même instant. Ils jouissent d’un appétit excellent, et montrent beaucoup de vivacité. Il vont courant sur le pont et dans la chambre du navire, leurs bras passés autour du cou l’un de l’autre comme le feraient deux amis. Ils jouent passablement bien aux échecs, et ont constamment battu un passager à ce jeu difficile. Ils suivent chacun séparément une conversation avec deux personnes différentes, à l’aide de signes et de quelques mots anglais qu’ils ont appris pendant leur passage. Ils seront probablement donnés en spectacle au public, lorsque les arrangement nécessaires auront été terminés. L’un des deux s’appelle Chang, et l’autre Eng; le plus souvent on les appelle Chang-Eng.
Ces deux jeunes gens présentent dans sa perfection un phénomène qui doit exciter un grand intérêt parmi les médecins. Leur union n’est peut-être pas plus remarquable que la santé et le contentement dont ils jouissent dans un pareil état. Ils fourniront sans doute à la science des observations très curieuses.
(Courrier des Etats-Unis.)

Le 11 de Juin s’est livrée la première bataille rangée importante entre les Russes et les Turcs, et l’avantage a été du côté des premiers. Le grand-visir, qui commandait une armée d’environ 40,000 hommes, près de Pravadi, a été surpris par les généraux russes, qui l’ont attaqué au moment où il les croyait encore bien éloignés. Le combat dura quatre heures sans avantage ni d’un côté ni de l’autre; mais alors les généraux russes ayant fait marcher des troupes fraiches contre les Turcs, ceux-ci, après avoir résisté encore quelque temps, furent forcés à la retraite. Ils laissèrent, suivant le rapport russe, 2000 morts sur le champ de bataille, et 1500 prisonniers, 40 pièces de canon, la plus grande partie de leur bagage, &c. entre les mains de leurs ennemis. Les Russes avouent que leur perte a été considérable. D’après des lettres de Constantinople, le grand-visir était arrivé a Schumla avec 12,000 hommes d’infanterie et 6,000 de cavalerie.
Corfou, 11 Juin.
Des avis d’Egine disent, que le protocode du 23 Mars, reconnaissant la souveraineté du Sultan, sans définir les limites de la Grèce, a créé un grand mécontentement, qui a été augmenté par les pretentions du Consul Général Anglais, qui, ayant obtenu une audience du Président de la Grèce, lui a demandé la levée de tous les blocus, le rappel de tous les Grecs dans l’intérieur de la Morée, et la cessation des hostilités contre la Porte. Le Président a refusé formellement de retirer les Grecs de la Livadie, et a informé le Consul Britannique que son devoir lui défendait d’abandonner les avantages déjà obtenus, et qu’il ne céderait qu’à une force supérieure. En même temps, il expédia des ordres à tous les commandons, de ne pas abandonner leurs positions. Le Consul a aussi envoyé un vaisseau aux Ambassadeurs qui se rendent à Constantinople, pour les informer de la résolution du Président de la Grèce. On ne sait quel effet cela pourra avoir sur les puissances médiatrices, mais on voit que les Grecs refusent le protectorat et l’armistice qui devait précéder l’intervention des Puissances à Constantinople.
Des avis de Vienne, jusqu’au 25 Juin, rapportent que la nouvelle officielle de la victoire remportée par les Russes près de Schumla, avait occasionné d’étranges mouvemens dans cet endroit. Le Prince Metternich, qui ne s’attendait pas à une telle nouvelle, en a été attiré; il dépêcha incontinent divers couriers pour l’Angleterre et les frontières de la Transylvanie; et comme la peste avait été longtems le prétexte de faire marcher des troupes, de même en cette occasion on s’en est servi pour faire avancer des troupes vers le théâtre de la guerre pour renforcer le cordon sanitaire.
En parlant de la victoire du 11 Juin, le Constitutionuel dit: “les triomphes des soldats Moscovites dans le voisinage de Schumla, sont plus considérables qu’on ne l’avait conjecturé d’abord, et plus décisifs qu’on n’aurait pu l’imaginer. Il est difficile de prédire quel effet produiront sur le Cabinet de St. James, les nouvelles de Schumla. Il est à présumer que ces nouvelles ne rendront pas les vues du Ministère Britannique plus favorables à la Russie.”
Constantinople, le 20 Juin.
Le sultan Mahmoud vient d’apprendre que Missolonghi et Lépante étaient tombés au pouvoir des rebelles Grecs, il paraît que cet événement ne l’a pas affligé, parce qu’il a la parole des Anglais, qui lui ont promis de faire restituer ces places. En effet, leur consul à Egine vient d’écrire ici qu’il avait protesté contre leur occupation. Enfin, on se flatte qu’avant deux mois les Anglais auront une escadre dans la Mer Noire. Cela ne surprendra personne à Constantinople, où l’on parle hautement d’un traité d’alliance offensive entre la Turquie, la Perse et la Grande-Bretagne. A quoi cela servira-t-il si les Russes franchisent les Balkans?
On parle de la rentrée en campagne du général Paskevitch-Erivan; d’une nouvelle révolte en Arabie, qui appelle toute l’attention de Mehemet, et il ne serait pas surprenant d’apprendre que la Servie a levé l’étendard de l’insurrection en faveur des Russes. Il parait, d’un autre côte, que la peste, qui s’était manifestée à Galatz, a pénétré en Bassarabie et jusqu’à Odessa. Elle règne dans le camp de Schumla, à Sophie et dans plusieurs villages situés sur les bords de l’Hèbre.
Bucharest, 2 Juillet.
Un courrier, expédié de Sillistrie par le lieutenant-général Krasowsky, arrive à l’instant avec la nouvelle suivante:
La forteresse de Sillistrie a succombé sous les attaqués victorieuses des troupes russes. La garnison turque, qui, après une défense opiniâtre, était réduite à la dernière extrémité, s’est rendue prisonnière de guerre, au nombre de plus de 10,000 hommes, non compris les habitans. Dans le nombre des prisonniers se trouvent deux pachas à trois queues, Hady-Achmet et Serb-Mahmoud, ainsi qu’un grand nombre d’autres officiers. Les trophées de la victoire sont 250 canons, deux queues de cheval, plus de cent drapeaux, la flotille et une grande quantité de munitions de guerre et de bouche.
Paris, 21 Juillet.
Les journaux allemands annoncent, d’après des lettres d’Italie, qu’Athènes est tombée entre les mains des Grecs, par capitulation. Cette nouvelle est confirmée par le Journal de Rome, d’après des lettres de Corfou.
Une lettre du 4 Mars écrite de Gonzamana, par une personne digne de confiance, porte:
“Les Colombiens out éprouvé une défaite complète; de tout l’escadron de Cedana il n’est resté que 5 hommes: Camarano a été tué dans l’action. Sucre n’a plus qu’environ 2000 hommes, et il a demandé à capituler. Il y a eu un grand carnage des deux cotés.”

A une assemblée de la Société du Feu, tenue le 31 Juillet dernier, MM. T. Peltier et J. M. Quesnel, ont été élus à la place de MM. J. Molson, fils et J. Shuter, qui s’étaient disqualifiés.
La Seigneurie de Foucault appellée vulgairement Caldwell’s-Manor, a été achetée chez le Schérif, par Mr. John Donegani, pour la somme de £2700.
Nous trouvons ce qui suit à la date de Stanstead le 20 Août: “En conséquence d’avis privés reçus d’Angleterre, intimant que le bill ‘pour faire une nouvelle division de la province et en augmenter la représentation,’ passé dans la dernière session de notre parlement provincial, a reçu la sanction royale, il a été mis en circulation des invitations aux francs-tenanciers des comtés de Sherbrooke, Stanstead, Shefford, Drummondville et Missiscoui, de s’assembler à Lennoxville, le 26, à l’effet d’y choisir un nombre de délégués pour délibérer sur les moyens d’élire les personnes les plus propres à représenter ces comtés.”
Nous souhaitons fort que la nouvelle de la sanction du bill de la représentation se trouve véritable: il résulterait de cet acte de justice et de convenance une grande amélioration dans notre représentation provinciale. Nous ne voyons pas, au reste, pour quelle bonne raison, ou sous quel prétexte plausible, ce bill ne serait pas sanctionné.
Accident Malheureux. Le 17 de ce mois, Amelina, enfant de Louis Masson, écr. de St. Benoît, âgée d’environ trois ans, ayant été laissée près du foyer, mit en jouant le feu à ses hardes; Madame Masson, accourue à ses cris, la trouva toute flambante. Elle parvint, en se brulant les mains et les bras, à éteindre les flammes; mais le feu avait déjà fait trop de progrès, et l’enfant mourut au bout de quelques heures.
Le 16 de ce mois, une petite fille d’Edward Lapius, âgée d’environ trois ans, jouant avec d’autres enfans, au village de Chateauguay, près du bassin, tomba malheureusement dans une chaudière remplie d’eau bouillante, et mourut des suites de l’accident, quelques jours après.
Lundi le 24 vers 4 heures de l’après-midi, Mademoiselle Pricille Gratton, de La Chenaie, s’étant approchée d’une porte ouverte, pour observer le temps orageux qu’il faisait, la foudre l’étendit morte a l’instant même. Elle était âgée d’environ 18 ans.
Mariés. A la Pointe Lévy, le 10 du mois dernier, Dlle Anne, fille de l’honorable John Caldwell, à John Eden écr. major au 15e régiment d’infanterie;
A Québec, le 11, Mr. Joseph Pageau à Dlle Elisabeth Fluet.
Décédés. A la Prairie, le 10 du mois dernier, Mr. Antoine Boucher Belleville, Lieutenant de Milice, âgé de 54 ans;
A Montréal, le 20, Mr. Charles Ambroise Laberge, Huissier, âgé de 31 ans.
Commissionnés. E. H. Bowen et L. H. Lafontaine, écuyers, Avocats et Procureurs;
MM. C. J. Rowland, O. Bourke, J. Bte Blais, John Parker et Otis Jenks, Médecins et Chirurgiens; MM. W. Henry, O. Quinn et W. Henderson, Arpenteurs.
Printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Mis-spelled words and punctuation have been maintained except where obvious printer errors occur.
[The end of La Bibliothèque Canadienne, Tome IX, Numero 5, Septembre 1829. edited by Michel Bibaud]