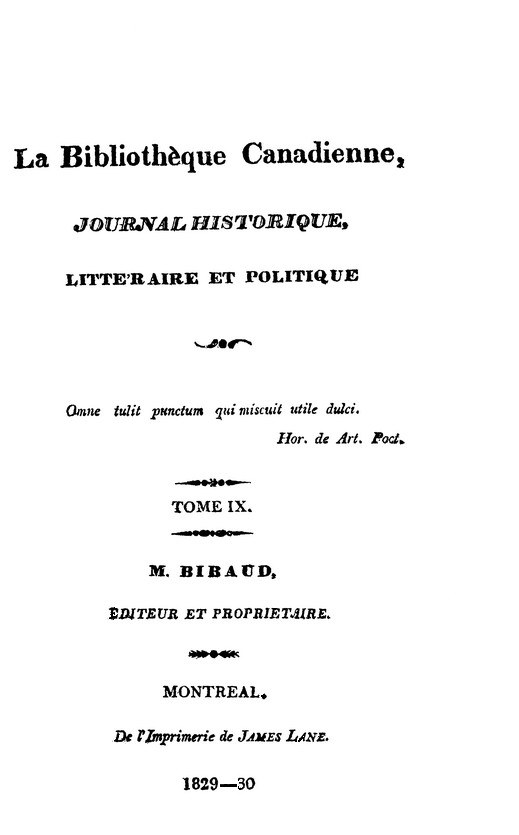
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque Canadienne, Tome IX, Numero 1, Juillet 1829.
Date of first publication: 1829
Author: Michel Bibaud (1782-1857) (Editor)
Date first posted: Dec. 21, 2021
Date last updated: Dec. 21, 2021
Faded Page eBook #20211244
This eBook was produced by: Marcia Brooks, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
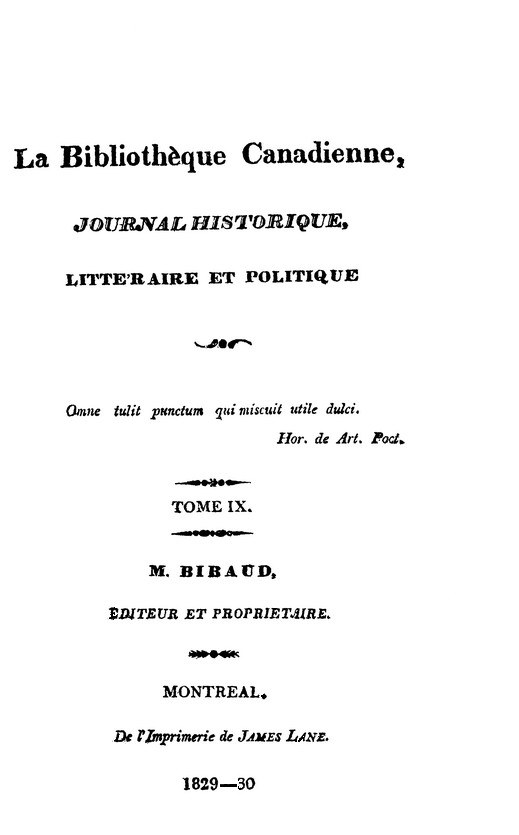
La Bibliothèque Canadienne
| Tome IX. | 1er. JUILLET, 1829. | Numero I. |
Afin de nous conformer au désir de plusieurs de nos abonnés, et de mettre noire ouvrage à la portée d’un plus grand nombre de lecteurs, en faisant en sorte qu’il offre les avantages réunis d’un journal littéraire et d’une gazette, nous nous sommes déterminés à faire paraître la Bibliothèque Canadienne deux fois par mois, en un pamphlet de 24 pages chaque fois, (y compris la couverture,) en attendant que ce nombre puisse être augmenté.
Ce changement, que les circonstances semblent rendre nécessaire, ou du moins très convenable, puisqu’il ne se publie plus dans le Bas-Canada qu’une seule gazette en langue française, nous mettra on état d’introduire dans notre publication des remarques et des observations sur les affaires politiques du pays, d’y admettre des morceaux d’un intérêt plus immédiat pour le public en général, sur l’éducation, l’agriculture, le commerce, &c. et d’y donner au moins un résumé des nouvelles étrangères les plus intéressantes et les plus authentiques.
L’intervalle d’un mois à un autre est trop long pour la plupart de ces objets: il semblait même tel à plusieurs pour l’Histoire du Canada: cette Histoire sera continuée, et pourra paraître d’autant plus nouvelle, que nous touchons à l’époque où fait celle de Charlevoix.
Afin de rendre la B. C. d’une utilité plus grande pour les marchands et autres, surtout de la campagne, nous insérerons sur la couverture le prix courant des principaux articles de commerce, ainsi que l’annonce des ventes par décret ou par encan les plus considérables et les plus importantes.
Le nombre des pages sera augmenté au bout d’un an, ou même de six mois, si l’encouragement le permet, et alors le journal pourra se publier toutes les semaines.

MM. de Longueil et Joncaire avaient négocié si heureusement chez les Iroquois, une les cinq cantons envoyèrent des députés à M. de Vaudreuil, pour faire de nouvelles excuses du passé, et protester d’une inviolable fidélité à garder leurs promesses à l’avenir. Mais quelque temps auparavant, ils avaient suscité à la colonne française un nouvel ennemi, moins politique qu’eux, mais aussi brave et beaucoup plus féroce. C’étaient les Outagamis, vulgairement appellés les Renards. Par l’entremise des Iroquois, ces barbares venaient de faire alliance avec les Anglais, à qui ils avaient promis de bruler le fort du Détroit, et de faire main-basse sur tous les Français qu’ils y trouveraient. Les Kikapous et les Mascoutins étaient entrés dans leur complot. Il étaient venus s’établir en assez grand nombre au Détroit même et assez près du fort, et ils n’attendaient, pour exécuter leur dessein, qu’un renfort de guerriers, lorsqu’ils apprirent qu’un chef outaouais, nommé Saguima, et quelques Pouteouatamis avaient tué environ cent cinquante Mascoutins, tant hommes que femmes et enfans. A cette nouvelle, ils se mirent en marche, la fureur dans le cœur, et se promèttant de ne faire aucun quartier. Mais heureusement, le commandant du fort, nommé Dubuisson, fut averti à temps du danger qui le menaçait, par un sauvage outagami, qui s’était fait chrétien, et qui avait beaucoup d’affection pour les Français.
Ce commandant n’avait avec lui que vingt Français ou Canadiens: toute sa ressource était dans les Hurons et les Outaouais, et quelques autres sauvages avec qui il vivait en bonne intelligence; mais ces derniers étaient alors à la chasse. Il les envoya avertir en diligence de se rendre auprès de lui; il fit ensuite abattre toutes les maisons qui étaient hors de l’enceinte de son fort, et prit toutes les autres mesures que le temps lui permit de prendre pour soutenir les premiers efforts de l’ennemi. Ses alliés arrivèrent bientôt et en bon ordre. Il y avait permi eux des Hurons, des Outaouais, des Sakis, des Malhomines, des Illinois, des Osages et des Missourites; et chaque tribu avait un pavillon particulier. Sur la route, ces sauvages se pressaient les uns les autres: “Il n’y a pas de temps à perdre, disaient-ils; notre père est en danger; il nous aime, son cœur nous est ouvert et son bras est appuyé sur nous: défendons-le, ou mourons à ses pieds.”
“Vois-tu cette fumée, Saguima, disaient les guerriers hurons au chef des Outaouais; ce sont trois femmes de ton village que l’on brule, et la tienne est du nombre.” Trois femmes Outaouaises étaient véritablement prisonnières des Outagamis, mais on n’en savait pas davantage, et les Hurons ne parlaient probablement ainsi que pour animer Saguima à la vengeance.
Lorsque les alliés furent près du fort, les chefs envoyèrent demander à M. Dubuisson la permission d’y entrer, et les portes leur en furent ouvertes sur le champ. On leur fit un accueil proportionné au service qu’ils rendaient, et quand ils eurent pris place autour du commandant, celui qui était chargé de porter la parole lui dit:
“Mon père, nous voici: tes enfans sont rangés autour de toi; tu nous a protégés, nous te secourons. Nous ne craignons pas la mort; au contraire; si elle nous saisit, nous lui sourirons en disant: c’est une douce mort que celle du guerrier mourant pour son père. Nous te demandons néanmoins une grâce: prie notre grand père Ononthio de prendre soin de nos enfans et de nos femmes, et de jetter un peu d’herbe sur nos cadavres, afin que les mouches ne viennent pas voltiger à l’entour, ni les oiseaux de proie s’en nourrir.” Le commandant les remercia en peu de mots, et leur fit distribuer les vivres et les munitions qui leur étaient nécessaires. Ensuite les vieillards parcoururent les rangs, pour exhorter les jeunes gens à bien faire leur devoir, et surtout à obéir fidèlement à leur père.
Cependant les Outagamis attendaient assez tranquillement les confédérés, dans le fort qu’ils avaient construit, et qui n’était éloigné de celui des Français que de la portée du mousquet. Ils répondirent bravement à la première attaque; mais le feu continuel qu’on faisait sur eux les força bientôt à creuser dé grands trous en terre pour se mettre à l’abri.
Alors les assiégeans dressèrent deux espèces d’échafauds de vingt-cinq pieds de haut, d’où ils battirent les assiégés avec succès. Ceux-ci n’osèrent plus sortir pour avoir de l’eau; leurs vivres se consommèrent, et ils souffrirent beaucoup de la faim et de la soif. Dans cette extrémité, tirant des forces de leur désespoir, ils combatirent avec une valeur qui rendit longtemps la victoire douteuse; ils s’avisèrent même d’arborer sur leurs palissades des couvertures rouges en guise de drapeaux, et crièrent de toutes leurs forces: “Corlar est notre père; son drapeau flotte sur nos têtes; il protège notre bras: ou il viendra nous secourir, où il vengera notre mort; ennemis, si vous voulez mettre votre vie en sureté, prenez le même parti que nous.”
Le chef des Pouteouatamis leur répondit: “Si la terre doit être teinte de sang, comme vous le voulez faire entendre par ce drapeau, elle le sera du vôtre: vous aviez perdu l’esprit lorsque vous vous êtes liés avec les Anglais; ils ne sont point favorisés par le Maître de la vie; ils ne font pas la guerre comme des hommes, mais comme des renards; l’eau forte qu’ils vendent aux nations, est un poison qui les fait périr.”
Ces dialogues, qui ne ressemblent pas mal à ceux des héros d’Homere ne plaisaient pourtant pas au commandant du Détroit, parce qu’ils ralentissaient le combat, et donnaient aux ennemis le temps de respirer. Ils en avaient même déjà profité pour s’emparer d’une maison qui n’avait pas été entièrement démolie, et qui joignait leurs retranchemens. Ils y avaient élevé une redoute, et tiraient à couvert du pignon; mais M. Dubuisson la fit abattre à coups de canon. Alors les Outagamis poussèrent des cris affreux, et quelques momens après, ils firent demander la permission d’envoyer des députés au commandant. Les chefs alliés y consentirent, dans l’espérance de tirer de leurs mains leurs trois femmes captives.
Le lendemain matin, les couvertures rouges disparurent et furent remplacées par un pavillon blanc. Ensuite le grand chef des Outagamis, nommé Pémoussa, se présenta à la porte du camp, accompagné de deux guerriers. On les fit entrer; le conseil s’assembla, et dès qu’ils y eurent été introduits, Pémoussa mit devant le commandant deux captifs et un collier, en le priant de lui accorder deux jours, afin que les vieillards pussent délibérer sur les moyens de l’appaiser et de lui faire satisfaction. Puis se tournant vers les sauvages, il leur présenta aussi deux esclaves et un collier, et leur dit:
“Souvenez-vous que nous sommes vos frères, et qu’en répandant notre sang, c’est le vôtre que vous versez. Nous avons malheureusement irrité l’esprit de notre père; tâchez de l’adoucir pour nous. Voici deux esclaves, qui remplaceront le peu de sang que nous pouvons avoir répandu.”
Comme les sauvages ne répondaient point, Dubuisson prit la parole, et fit entendre aux députés qu’il ne pouvait pas s’assurer de la sincérité de leur repentir, puisqu’ils n’avaient pas ramené la femme de Saguima et les deux autres qu’ils avaient prises avec elle; et qu’il ne les écouterait que quand ces trois captives lui auraient été remises. Pémoussa s’excusa sur ce que la chose ne dépendait pas entièrement de lui, et dit qu’il allait faire savoir ses intentions aux anciens. On lui accorda le reste du jour, et on lui promit de ne point tirer jusqu’à son retour, pourvu que personne ne sortît du fort. Deux heures après, trois députés arrivèrent, un pavillon blanc à la main, et suivis des trois prisonnières, qu’ils présentèrent au commandant. Ils lui témoignèrent un grand regret de lui avoir déplu, et le conjurèrent de leur laisser à tous la liberté de se retirer. Dubuisson leur répartit que c’était à ses alliés qu’ils devaient s’adresser pour cela; qu’il leur avait engagé sa parole de les laisser les maîtres absolus de faire ce qu’ils jugeraient à propos.
Cette réponse fut fort applaudie des sauvages, et le grand chef des Illinois dit, au nom de tous, aux députes: “Votre conduite passée et vos alliances avec Corlar nous montrant votre âme à nu, et elle est noire. A peine serez-vous sortis de votre camp, que vous recommencerez à former des complots sous la terre, et à vous frayer une route, pour venir écraser notre père au moment où il ne s’y attendra pas, et où nous ne serons peut-être pas à portée de le secourir. Mais nous ne voulons pas qu’il en soit ainsi: notre dernière résolution est de ne vous recevoir qu’à discrétion, et nous ne bougerons pas d’ici que nous ne vous y ayons forcés. Rentrez dans vos retranchemens; nous n’attendons que cela pour recommencer à tirer.”
Réduits ainsi à la dernière extrémité, les Outagamis et leurs alliés se battirent en furieux: ils décochaient à la fois jusqu’à trois cents flèches, au bout desquelles il y avait du tondre allumé, et à quelques unes des fusées de poudre pour mettre le feu au fort des Français. Ils y brulèrent en effet plusieurs maisons, qui n’étaient couvertes que de paille; et pour empêcher que l’incendie ne gagnât plus loin, il fallut couvrir tout ce qui restait, de peaux d’ours et de chervreuils, et les arroser à chaque instant.
Les confédérés, lassés d’une si opiniâtre résistance, parurent désespérer du succès, et Dubuisson eut lieu de craindre qu’ils ne se retirassent et ne le missent ainsi à la merci d’un ennemi qu’ils venaient de traiter avec une arrogance si impitoyable. Il fallut, pour les retenir auprès de lui, qu’il les comblât de présens, et employât tout ce que la raison et l’éloquence ont de plus persuasif. Sensibles aux reproches qu’il leur fit de vouloir le laisser dans le fort du danger, et d’abandonner la victoire au moment où elle allait couronner leurs efforts, les chefs lui jurèrent qu’ils mourraient devant la place plutôt que de s’en aller, et qu’ils chassaient loin d’eux le mauvais esprit qui les avait possédés un moment.
Les assiégés furent bientôt aux abois; ils étaient encore plus tourmentés de la faim et de la soif, que pressés par le feu des assiégeans, et les cadavres dont leur fort était rempli y causaient une infection horrible. Ils demandèrent de nouveau à parlementer: Pémoussa et un autre chef vinrent au camp des assiégeans, avec plusieurs captifs, et dans l’équipage qu’ils crurent le plus propre à émouvoir la compassion. Ils demandèrent la vie pour leurs vieillards, leurs femmes et leurs enfans, disant que pour eux, ils n’osaient pas se flatter qu’on la leur accordât. “Souvenez-vous pourtant, ajoutèrent-ils, que vous êtes nos neveux, et que c’est notre sang qui coule dans vos veines. Pourquoi seriez-vous altérés de votre sang? Ne vous serait-il pas plus honnête de l’épargner, et plus avantageux de nous avoir pour esclaves?”
Les sauvages se montrèrent aussi inéxorables que la première fois: quelques uns même proposèrent à M. Dubuisson de massacrer les députés; mais il leur répondit, en colère, qu’il fallait être ivre pour lui faire une pareille proposition. Les assiégés n’eurent plus de ressource que dans la fuite, et ils s’évadèrent en effet de nuit, à la faveur d’un orage, qui avait écarté les assiégeans. On se mit dès le matin à leurs trousses, et on les trouva assez bien retranchés à quatre lieues du Détroit, dans une presqu’île qui s’avance dans je lac de Ste. Claire. Il fallut donc recommencer un nouveau siège, qui dura quatre jours, et qui eût même été plus long, si M. Dubuisson n’y eût fait venir eux pièces de campagne. Le premier en avait duré dix neuf. Les assiégés se rendirent enfin à discrétion, et presque tous ceux qui avaient les armes à la main furent impitoyablement massacrés sur le champ. Les autres, au nombre de cent cinquante, sans compter les femmes et les enfans, furent faits esclaves et distribués entre les tribus confédérées, qui ne les gardèrent pas longtemps, mais les massacrèrent presque tous, avant de se séparer. La perte des confédérés fut de soixante hommes; mais les Outagamis et leurs alliés y perdirent plus de deux mille personnes. Nous verrons pourtant bientôt, qu’il leur restait encore assez de forces pour tenir la campagne, et donner de la tablature à leurs ennemis.
Ceci se passa à la fin de Mai et au commencement de Juin 1712. Cette même année, avant que les négociations pour la paix fussent terminées à Utrecht, les gouverneurs généraux de la Nouvelle France et de la Nouvelle Angleterre reçurent des ordres précis de leurs souverains de faire absolument cesser tout acte d’hostilité entre les deux nations et leurs alliés. Ils apprirent bientôt après que la reine d’Angleterre s’était détachée de la ligue qui avait entrepris de détroner Philippe V. Par le traité conclu entre Louis XIV et la reine Anne, la France cédait à l’Angleterre l’Acadie avec la ville de Port Royal, nommée depuis Annapolis, et tout ce que les Français avaient possédé jusqu’alors dans l’Ile de Terre-Neuve et à la Baie d’Hudson. Le Roi de France renonçait aussi aux droits qu’il prétendait avoir sur le pays des Iroquois; mais l’Angleterre y gagna peu de chose, parce que ces sauvages continuèrent à protester de leur indépendance, et à se maintenir dans leur liberté.
(A continuer.)

Il y a différentes espèces de terres; ce principe est certain et ne souffre aucune difficulté; aussi le cultivateur intelligent qui fait le choix d’une terre nouvelle, a-t-il le soin, autant que possible, de la prendre dans les lieux qui lui paraissent les meilleurs et les plus fertiles. Parmi les diverses espèces de terre qui sont les plus favorables à la culture des grains, sont les terres fortes, les terres noires, les couches végétales, l’argile qui est un mélange de matières calcaires très fines et de parties végétales: ce que les cultivateurs entendus et prudents savent fort bien distinguer.
Quelques uns mêmes négligent ou refusent de prendre de nouvelles terres en concession, parce qu’elles ne sont pas de la qualité qu’ils pourraient désirer. Il est vrai que la possession d’une bonne terre est un avantage très précieux, et on ne saurait trop louer la diligence de certains cultivateurs, qui pour se procurer de riches et fertiles propriétés, font des recherches considérables et fort dispendieuses. Mais si d’un côté la diligence des uns est louable, la négligence des autres est très blamable et fort préjudiciable à leurs intérêts. On peut en quelque façon, par le courage et l’industrie, donner pour ainsi dire, à la mauvaise terre, les forces et les qualités que la nature semble lui refuser.
L’expérience ne fait-elle pas voir tous les jours, que des terres d’une mauvaise qualité, et d’un sol ingrat, souvent abandonnées par leurs premiers propriétaires, ou cédées pour de très bas prix, deviennent par les soins et l’industrie de nouveaux propriétaires, des possessions riches et fertiles, et qui par leurs produits et leurs revenus récompensent les peines et les travaux de ceux qui leur donnent leur attention et leurs soins.
Les terrains les plus propices et les plus avantageux pour l’agriculture, sont les terrains bas, ceux qui sont près de la mer, des lacs, des fleuves, ou des rivières. Le cultivateur attentif à ses intérêts, ne saurait faire un meilleur choix, qu’en prenant une terre dans ces lieux, qui sont toujours fertiles et fort lucratifs.
Ensuite les vallées, et tous les lieux bas, sont les meilleurs terrains, et les plus favorables à l’agriculture. Ordinairement toutes les espèces de grains y viennent, avec beaucoup d’endeur et d’impétuosité. Ces sortes de terrains sont toujours gras et fertiles et promettent un avenir prospère et heureux à l’intelligent et prudent cultivateur qui en fait le précieux choix. Mais comme dans ce pays les bords du fleuve St. Laurent sont déjà habités, à la distance de plusieurs lieues, ainsi que ceux des principales rivières, le prudent cultivateur peut encore faire un heureux choix, en prenant des terres en concession dans les lieux bas et les vallées, où le sol est excellent et très fertile.
Les lieux hauts, le sommet des côtes élevées et des montagnes, ne sont pas non plus à mépriser; souvent ils renferment un sol précieux et des plus avantageux pour l’agriculture; mais ils se lassent, et se fatiguent plus promptement que les lieux bas, qui sont près de la mer, des lacs, des fleuves ou des rivières, ou qui les avoisinent.
Alors il faut joindre au travail le plus assidu, une industrie prudente et judicieuse et le soin le plus vigilant. L’art répare assez facilement les défauts et les défaillances de la nature, et le cultivateur actif jouit des avantages de l’un et de l’autre. C’est le prix de ses pénibles et intéressants travaux et la due et juste récompense de ses peines.
Les endroits pierreux possèdent communément un bon sol, et sont presque toujours favorables à l’agriculture, surtout lorsqu’ils sont couverts d’une couche de terre de quelqu’espèce que ce soit, assez épaisse pour y conserver la fraicheur et la bienfesante humidité. La pierre continuellement mise en dissolution, par l’action de l’air et du soleil, fournit un engrais excellent, qui rend les terres fertiles et très productives, ou au moins qui leur conserve leur première valeur, et les empêche de se détériorer.
Les terres jaunes, rougeâtres, la craie et les terres sablonneuses, sont les moins propres a l’agriculture. Il faut de grands soins pour les améliorer et les rendre fertiles. Elles ne devraient tomber eu partage qu’à des gens laborieux et industrieux, et assez riches pour pouvoir y ajouter un engrais abondant et étranger. Mais malheureusement ces terres sont le plus souvent possédées par de pauvres familles, qui n’ont jamais eu les moyens de s’en procurer d’une meilleure qualité, ou que l’amour du lieu natal retient misérablement dans ces pauvres retraites. Quelques fois aussi des fainéants les choisissent par préférence, afin d’avoir un pretexte d’y mener une vie indolente et oisive et souvent vagabonde. Ainsi le prudent cultivateur ne saurait prendre assez de précaution pour faire le choix d’une bonne terre. C’est de là que dépend son bien-être, sa fortune et ses satisfactions futures; car un bon choix assure au cultivateur un bonheur certain, s’il joint un travail constant aux prerieux avantages que lui offre un sol riche et fertile: mais au contraire, si le laboureur fait un mauvais choix, et qu’il soit d’un caractère insensible et indolent, l’avenir ne doit rien lui promettre de prospère et d’heureux: au contraire, des privations, l’indigence, la misère et toutes les nécessités attendent sa décrépitude et ses derniers moments: quel triste et funeste sort!
Combien n’en voit-on pas, tous les jours, expirer au sein de la misère et de l’indigence, pour avoir fait un mauvais choix, et négliger les travaux nécessaires à un sol ingrat et légé.
Le cultivateur, avant de prendre une terre en concession, ou d’en faire l’acquisition, doit observer très soigneusement si elle contient différentes espèces de bois de charpente et de construction; si les bons bois de chauffage y sont abondants. Les terres où il y a beaucoup de bois francs, sont toujours les meilleures, et le cultivateur prudent en fait toujours le choix par préférence aux autres. Les bois qui désignent presque toujours un mauvais sol, sont les pins, les trembles, les bouleaux, et autres espèces d’arbustes qui ne croissent que sur les terrains sablonneux et légers, et peu propices à la culture, parce qu’ils contiennent peu d’humidité. Le cultivateur auquel il reste encore un choix, agira sagement, en évitant ces stériles contrées. Pareillement on doit éviter de prendre une terre dans les lieux où il y a beaucoup de mine de fer, et où le sable rouge est près: l’expérience démontre que ces terres sont toujours d’une médiocre valeur, et ne produisent sans le secours des engrais, que des grains d’une très faible qualité; hormis que le cultivateur ne fit ce choix que par des vues de spéculation, de commerce, &. comme si ces terres se trouvaient à proximité de quelques forges; mais quelque choix que fasse le cultivateur d’une terre, celle où il y a des ruisseaux ou cours d’eau naturels, est toujours préférable et lui sera d’une grande utilité, et le dédommagera amplement d’un choix qui pourrait être désavantageux d’ailleurs: ces commodités sont sur une terre éloignée des rivières, d’un mérite inappréciable. Ce sont de grands moyens de facultés pour les laboureurs. Une eau limpide et claire pour le besoin de leur maison, sert en même tems à abreuver sans frais de nombreux troupeaux de bestiaux, qui font toujours la richesse et l’opulence des cultivateurs.
Les terres où il y a beaucoup de collines et de coteaux, ou qui contiennent un grand nombre de ravines et de cavées, ne sont pas les plus avantageuses, quoique le sol en soit souvent d’une bonne qualité, à cause des différents frais qu’il faut faire pour se procurer des chemins et des ponts commodes et solides, dont la construction et l’entretien sont fort dispendieux, et causent fréquemment de grandes pertes de temps: d’ailleurs lorsque ces terres ont un bon sol, elles poussent aussi bien que les terres unies, et moyennement élevées. Les terrains où les pommiers croissent, ou autres espèces d’arbres qui portent de gros fruits, sont d’un très grand avantage pour le cultivateur, et il doit leur donner une grande préférence: outre les douceurs qu’il en peut tirer pour son propre usage, il peut encore en faite un profit annuel, qui lui sera d’autant plus avantageux, qu’il lui en coutera moins pour la culture de ces arbres. On doit aussi considérer comme un grand avantage les terres où il croît beaucoup d’érables et de plaines; un cultivateur laborieux en retire presque toujours un produit assez considérable. Si les travaux qu’il faut faire pour exploiter une sucrerie, sont durs et pénibles, on en est presque toujours indemnisé par un revenu annuel, qui souvent répare une mauvaise récolte, et avec lequel on peut se procurer le pain du ménage, ou autres nécessités et besoins qui peuvent survenir dans le cours d’une année par des pertes et des accidens imprévus.
Les terres sur lesquelles ou près desquelles, il y a beaucoup de gibier, ou qui sont près des rivières qui contiennent beaucoup de poisson, ont encore un grand avantage sur les autres, et on doit en faire le choix par préférence, à cause des revenus et produits que peuvent donner la chasse et la pêche, et avec les quelles on se procure une nourriture same et délicieuse. Il est pourtant impossible de trouver tous ces avantages réunis sur une même terre ou propriété; mais lors qu’il y en a quelques uns, il faut se déterminer à en faire le choix. Car on voit tous les jours des personnes qui en sont privées, reclamer contre leur choix, et envier en quelque façon, le sort de ceux, qui jouissent de quelques unes de ces commodités. Je ne puis terminer ce chapitre sans observer que les rentes exhorbitantes à la charge desquelles on concède les terres actuellement, nuisent beaucoup à l’avancement de l’agriculture. Beaucoup de réclamations ont déjà été faites inutilement, quoiqu’appuyées sur des anciennes ordonnances, qui semblent en fixer le taux.

Voyageant dernièrement au nord du fleuve St. Laurent, j’ai vu avec regret combien de nos cultivateurs canadiens se connaissent peu en économie rurale, surtout en ce qui regarde la manière d’employer les engrais. Plusieurs, au lieu d’étendre le fumier sur le sol immédiatement avant de le labourer, ne l’y étendent qu’après que la charrue et la herse y out passé; de sorte que si l’engrais n’avait pas déjà perdu toute sa substance nutritive avant d’être ainsi employé, il la perd par l’évaporation après avoir été ainsi étendu en une couche mince sur la surface du sol. Chez d’autres, d’assez grands tas de fumier restaient aux portes des étables, sans doute pour y pourrir inutilement, ou être employé aussi peu judicieusement que chez les premiers. C’est surtout dans le bas de la paroisse de Berthier, dans une partie de celle de St. Cuthbert, et dans la nouvelle paroisse de St. Barthélemy, que j’ai eu occasion de faire, avec mes compagnons de voyage, des observations peu favorables sur la manière de cultiver de quelques uns de nos compatriotes. J’ai observé aussi dans ces quartiers, un esprit d’imitation, qui, pour être indifférent de soi, ne laisse pas d’être assez singulier. Pendant une certaine distance, par exemple, tous les fours sont couverts et tous les puits entourés de la même manière: plus loin, cette manière pour les puits, les fours, &c. est différente de la première: plus loin encore, vous voyez une autre méthode généralement suivie. Cet esprit d’imitation dans ces gens me porte à croire qu’ils imiteraient les bons exemples, en fait d’économie rurale, s’il leur en était donné de tels. En attendant, il serait à désirer que les personnes instruites qui se trouvent parmi eux, et particulièrement Messieurs les curés, voulussent bien se donner la peine de leur donner quelques leçons, quelques renseignemens, sur la meilleure manière de cultiver la terre, et particulièrement d’employer les engrais. Il est probable qu’ils profiteraient des bons avis qui leur seraient ainsi donnés gratuitement et charitablement, et qu’il en résulterait un avantage générai.
J’ai aussi entendu dire, dans ma tournée, que la mouche hessoise, ou les puces, comme disent les cultivateurs, commençaient à faire des ravages, dans quelques endroits de Berthier, de la Rivière du loup, de Nicolet, de St. Hyacinthe, &c. J’ai appris depuis qu’il y avait de l’exagération dans ce qu’on m’avait dit, quant à cette dernière paroisse. Néanmoins, il me semble y avoir encore un grand défaut de jugement dans l’obstination des habitans de cette paroisse à vouloir semer du bled sur des terres où il a été détruit plusieurs années de suite, et surtout l’année dernière, par cette vermine.
Le bled froment est, en apparence, la principale, sinon l’unique nourriture de la mouche hessoise; et il paraît n’y avoir d’autre moyen de détruire cette vermine que de lui soustraire l’aliment dont elle se nourrit. S’il n’y avait pas de feuilles sur les pommiers, on n’y verrait point de chenilles; de même si l’on ne semait pas de bled dans un champ, les germes ou les œufs des puces de l’année précédente y périraient. Que les cultivateurs de St. Hyacinthe, &c. sèment donc des pois, de l’avoine, du bled-d’inde, des navets, &c. sur les terres où les puces ont détruit le bled; ils parviendront très probablement à faire périr cette vermine destructrice, et pourront recommencer ensuite à y semer du bled, sans craindre de le voir détruit comme auparavant.
D’un autre côté, j’ai vu avec plaisir que la paucité de la dernière récolte a été une laçon utile pour les cultivateurs. Dans toutes les paroisses par où j’ai passé, tant au sud qu’au nord du St. Laurent, il a été semé beaucoup plus de bled-d’inde et de patates que d’ordinaire.
M. D.

J’ai été dernièrement témoin, particulièrement dans le district des Trois-Rivières, de faits qui m’ont paru un contraste frappant; j’y ai vu de grandes paroisses, des villages considérables, sans une seule école élémentaire, du moins sans une seule école française;[1] tandis que dans d’autres paroisses et dans des paroisses où il n’y a pas à proprement parler de villages, on en voit jusqu’à deux et trois, dans quelques unes desquelles on compte de soixante-dix à quatre-vingts écoliers. Les paroisses de St. Grégoire et de St. François, au sud du fleuve, sont celles qui m’ont paru se distinguer le plus sous ce rapport. L’état florissant de l’enseignement, dans ces paroisses, est dû, en plus grande partie, au zèle de messieurs leurs curés, qui sont les directeurs, et qu’on peut regarder comme les principaux fondateurs de ces écoles.
Cet état de choses fait espérer un grand changement, au sujet de l’éducation, pour l’avenir, et même pour un avenir assez prochain; mais à moins qu’il ne s’établisse des écoles dans toutes les paroisses, il y aura encore ce contraste, que tous ou presque tous les habitans sauront lire, écrire, &c. dans certains endroits de la province, tandis qu’en d’autres, il régnera encore la même ignorance que présentement. On peut néanmoins s’attendre que l’exemple déjà donné par tant de paroisses sera bientôt suivi par toutes les autres. Jamais du moins les circonstances n’ont été plus favorables, et il y aurait quelque chose de pis qu’une simple apathie à n’en pas profiter.
Un Voyageur.
|
Il y a des écoles anglaises à Sorel et à la Rivière du Loup; mais je crois que ni l’un ni l’autre endroit ne possèdent une école française même médiocre. |

Il y a trois ans, la foudre est tombée sur l’église de Maskinongé, et y a produit dans l’intérieur des effets tout à fait curieux. Nous allons tâcher d’en donner de mémoire une idée au lecteur, bien que nous sentions que pour les décrire exactement, il faudrait les avoir sous les yeux, et se servir de plusieurs termes d’architecture qui ne seraient pas entendus généralement.
Quoiqu’il en soit, la fendre étant tombée sur la partie la plus élevée du rond-point, la matière en a été partagée, par l’extrémité extérieure de l’aiguille, en deux portions à peu près égales, lesquelles, suivant, dans le grenier de la voûte du chœur, si l’on peut ainsi parler, deux chevrons aboutissant aux parties soulevées de l’architrave, près des angles du fond, (l’arrondissement est en polygone) sont entrées dans le chœur, en faisant éclater et tomber, au côté gauche, et en soulevant seulement, au côté droit, ces parties saillantes, composées de deux planches peintes et bordées de sculptures, à peu près quarrées: de là, la matière électrique a parcouru une sculpture en forme d’s avec fleurs, allant de bas en haut, ainsi que les ornemens de la frise, &c. également et symétriquement des deux côtés, jusqu’aux derniers angles, en gagnant les chapelles latérales; en a noirci ou terni la dorure, et a peint ou plutôt picoté en rouge, ou couleur de pourpre, diverses parties des panneaux plans qui se trouvent entre les angles dont nous venons de parler.
Jusque-là, l’égalité et la symétrie que la foudre a observées dans sa marche, des deux côtés du chœur, en laissant tout le fond derrière l’autel absolument intact, ont quelque chose de remarquable et de singulier en même temps; mais ce n’est pas tout encore: une portion de la foudre étant restée, il paraît, entre le mur et la boisure du chœur, ou s’étant introduite entre diverses parties de cette boisure, elle s’en est dégagée en la faisant éclater en quatre endroits différents, encore symétriquement et à égale distance des deux côtés, c’est-à-dire dans l’architrave, si nous nous en rapellons bien, et dans le bas des panneaux, vers le milieu du chœur. Les éclats enlevés pouvaient avoir de huit à dix pouces de longueur et se terminaient en pointe.
Un dernier fait, et qui n’est peut-être pas le moins singulier, c’est qu’une partie de la dorure enlevée de la frise &c. au côté gauche, a été portée et pour ainsi dire, plaquée sur les baguettes des pilastres cannelés de la chapelle du même côté; de manière que d’un peu loin on dirait que ces pilastres ont été marbrés par la main de l’artiste; et cela, sans qu’on apperçoive aucune trace du passage de la foudre jusque-là. La même chose ne se remarque pas à la chapelle du côté droit, et il n’a manqué que cela pour que la similitude fût parfaite, et les effets absolument les mêmes, des deux côtés de l’église.

Une nouvelle voiture, construite dans les ateliers de la rue Notre-Dame des Victoires, a été vue à Long-champ. Elle offre cela de remarquable, qu’au moyen d’un procédé sûr et ingénieux, tout le chargement se trouvant en dessous de la caisse, on n’aura plus à redouter les accidens trop fréquents occasionnés par le balancement de la voiture, dont la chute était le plus souvent déterminée par l’énormité du poids qui surchargeait l’impériale. L’avant-train est si mobile et si bien combiné, que destiné à recevoir tous les articles d’argent, ils y sont introduits par un déplacement total dé cette partie de la voiture, opéré par un seul homme. Un nouveau procédé d’enraiement, au moyen duquel le conducteur, sans quitter son siège, assujettit les deux roues de derrière, fait de cette diligence un vrai modèle offert à l’émulation de tous les entrepreneurs de voiture. Elle contient quinze places.
Le gouvernement vient d’accorder un brevet pour de nouvelles diligences à une seule roue, et pourtant inversibles. Elles pourront contenir trente à quarante personnes, dont chacune aura un coin, et seront suspendues de manière à ce que, quelle que soit la vitesse de leur marche, les voyageurs puissent écrire sans difficulté. Les magasins seront placés de chaque côté de la roue. L’économie du tir sera d’un tiers, et celle du personnel de moitié. Les plus habiles ingénieurs ont donné de justes éloges à cette invention, qui doit, assure-t-on, produire une révolution complète dans l’art du carrossier. L’auteur est un Marseillais, et sa découverte est le fruit de longues méditations.
Un M. Schulze, de Paulinzella, a inventé une nouvelle machine, qu’il appelle Cylindre à vent, pour être mise en opération au moyen de la vapeur, et remplacer les soufflets d’orgues ordinaires. Il croit que la supériorité de son invention pour les grands instrumens ne peut être contestée, attendu que la machine envoye, depuis le commencement jusqu’à la fin, une égale quantité de vent, qu’elle est d’une construction simple, occupe peu d’espace, et ne se dérange pas facilement. Le travail des anches serait bien plus puissant et plus certain que présentement, et les grands tuyaux auraient une fermeté et une profondeur extraordinaires. L’orgue le plus gigantesque pourrait être mis en jeu au moyen de ce cylindre, et l’inventeur a obvié à la difficulté de la touche, qu’on pourrait appréhender comme le résultat de sa méthode. Une petite machine à vapeur de la manufacture de Perkins suffirait pour le plus grand orgue. M. Schulze croit qu’un mécanisme de la force de cinq chevaux pourrait, au moyen de dix livres de charbon, envoyer du cylindre à vent environ 1,200,000 pieds d’air en une heure: ce qui suffirait pour faire jouer pleinement un orgue de vingt touches, pendant dix jours et dix nuits sans intermission.
A une assemblée de la Société Royale d’Edimbourg, tenue le 6 Avril, le Dr. Hope, vice-président, a présenté au Dr. Brewster, le prix de Keith, consistant en une médaille et une superbe soucoupe, qui lui avait été adjugé antérieurement, pour avoir découvert dans les minéraux deux nouveaux fluides possédant des propriétés physiques très remarquables. Dans le discours que le vice-président a prononcé en cette occasion, il a fait allusion à l’influence étendue de ces découvertes dans les théories géologiques; et comme un de ces remarquables fluides s’étend trente fois plus que l’eau, et passe de l’état de liquide à celui de vapeur au moyen d’un changement de température de quelques degrés seulement, il a en fait remarquer l’importance comme un agent mécanique, qui, s’il pouvait être obtenu en quantité suffisante, mettrait entièrement fin à l’usage de la vapeur. Comme la chaleur de la bouche a été, en une occasion, suffisante pour faire éclater le crystal de roche qui contenait le fluide, et blesser la personne qui a fait l’expérience, la chaleur animale du corps humain serait le seul chauffage nécessaire pour mettre une puissante machine en mouvement. Comme un tel fluide existe réellement, et que par le sacrifice de quelques beaux échantillons de minéraux, on pourrait l’obtenir en quantité suffisante pour l’analyse chimique, il n’est pas déraisonnable d’espérer qu’il puisse être recomposé avec ses élémens, et devenir de la plus grande utilité dans le commerce de la vie.

Un événement singulier est arrivé, il y a quelque temps, dans la maison des foux de Lancastre. Un gentilhomme des environs de Middleton, attaqué d’une maladie mentale, avait été confié, par les magistrats de la ville, aux soins d’un officier de paroisse, pour être conduit dans cet hospice. Par égard pour sa famille, on lui avait procuré une voiture, et on lui persuada sans peine qu’il ne s’agissait que d’une partie de plaisir. Il paraît néanmoins que, pendant la route, notre fou conçut quelques soupçons. Arrivé à Lancastre trop tard pour être mené de suite à sa destination, il descendit dans une auberge où l’on convint de passer la nuit. Le lendemain matin, de bonne heure, le fou se lève; soit curiosité, soit tout autre motif, il fouille dans les poches de l’officier qui dormait profondément; quelle est sa surprise d’y trouver un ordre des magistrats, d’après lequel il doit être enfermé! Notre homme serre soigneusement le fatal écrit; il se rend en diligence à la maison des foux, demande un inspecteur, et lui annonce tranquillement qu’il est chargé d’amener à Lancastre un malheureux privé de sa raison; qu’il se propose de le présenter dans la journée; puis il ajoute: “Je dois vous prévenir que sa folié est singulière; cet homme a les idées les plus extravagantes; je ne serais pas étonné qu’il prétendit que c’est moi qui suis le fou, et qu’il a reçu l’ordre de m’amener moi-même dans cette maison. Ainsi, ne faites pas attention à ce qu’il vous dira, et veillez sur lui.” Il exhibe alors son ordre, et l’inspecteur, sans rien soupçonner, lui promet de ne pas oublier sa recommandation.
Revenu promptement à l’auberge, notre homme réveille l’officier, auquel il reproche de dormir trop long-tems. On déjeune, et l’on convient d’aller faire un tour de promenade. L’officier, saisissant l’occasion, se dirige naturellement vers la maison des foux; et son compagnon, loin de le détourner, manifeste le désir d’en visiter l’intérieur. C’était justement ce que désirait son conducteur, qui s’applaudissait en lui-même de pouvoir exécuter si facilement la mission qui lui avait été confiée; ils arrivent à la porte et sont reçus par l’inspecteur. L’officier fouille dans ses poches, cherche son ordre, ne le trouve plus, témoigne sa surprise; mais pendant ce tems, son compagnon l’avait déjà présenté à l’inspecteur; et, lui rappelant ce qu’il lui avait dit le matin, il s’écrie en montrant l’officier: “Emparez-vous de lui; rasez-lui la tête, et mettez-lui un gilet de force.” Deux hommes se jettent aussitôt sur le malheureux, qui réclame inutilement contre cette violence, en soutenant que le véritable fou, c’est l’autre, et qu’il est son conducteur. On ne tient nul compte de ses cris; on l’entraîne; on le rase; on lui met la camisole; il est confiné dans une loge; et l’autre satisfait se retire.
Il retourna paisiblement à l’auberge, paya la dépense, et reprit la route de Middleton, où l’on ne fut pas médiocrement étonné de le revoir. On s’imagina d’abord qu’il avait tué son conducteur; on lui demanda ce qu’il en avait fait: “Ma foi, dit-il, je l’ai laissé à la maison des foux de Lancastre. On l’a rasé; on lui a mis la camisole de force; il est fou à lier.” Notre véritable fou ne se trompait guère. L’officier de paroisse avait presque perdu l’esprit; les mauvais traitemens qu’on lui avait fait éprouver Pavaient réduit, à peu de chose près, au même état que le gentilhomme. Cette affaire s’éclaircit enfin; l’officier fut mis en liberté après une détention de plus d’une semaine. Il revint chez lui pâle, exténué, la tête couverte d’un mouchoir, plus semblable à un fou échappé qu’à un officier de paroisse qui vient reprendre ses fonctions. La chronique ne dit pas si le vrai fou fut enfermé, ou in la joie de s’être si bien vengé lui rendit la raison.

Un journal littéraire, l’Universel, paraissant avec beaucoup de succès depuis le mois de janvier, rapporte le fait suivant, qui nous a paru digne d’intéresser nos lecteurs. C’est d’après les journaux de l’Inde britannique que ce récit est publié.
“Nous avons été témoins à Madras d’un spectacle des plus nouveaux et des plus singuliers. Un vieux brahme, appartenant à une caste élevée, vient de trouver le moyen de se tenir assis dans l’air. Il en fait l’expérience, non pour de l’argent, mais par politesse pour les personnes qui le lui demandent. Tout son appareil se compose: 1º, d’une planche supportée par quatre chevilles, et formant une espèce de chaise longue; 2º, d’un tuyau de cuivre, dans lequel il fait entrer un bambou vide dans une position perpendiculaire, et enfin d’une béquille recouverte de peau, que l’on place sur le bambou. Il apporte tous ces instrumens dans un petit sac, qu’il montre à deux qui assistent à l’expérience. Des domestiques tiennent une couverture de lit devant lui, pour le cacher d’abord aux yeux des spectateurs; après un intervalle d’un quart-d’heure à peu près, le rideau tombe, et on voit le brahme assis dans l’air, à quatre pieds environ au-dessus du sol, ne posant que l’extrémité d’une main sur la béquille, et comptant avec les doigts de cette main les grains dé son rosaire; il tient l’autre bras élevé en l’air. Il reste ordinairement presque un quart-d’heure dans cette position, mais devant, le gouverneur de Madras il s’y est maintenu pendant quarante minutes. Quand il veut descendre, il se fait cacher de nouveau par le rideau, et l’on entend alors un son semblable à celui de l’air, qui s’échappe avec force d’une vessie ou d’un tuyau. Il refuse de communiquer son secret à qui que ce soit, quoiqu’on lui ait déjà offert des sommes considérables, soit pour le vendre, soit pour accompagner en Angleterre un entrepreneur qui le ferait voir pour de l’argent. Le même individu peut rester aussi sous l’eau pendant plusieurs heures. Il n’est pas de suppositions ridicules que ne fassent les journaux de l’Inde pour expliquer le prodige apparent que nous venons d’exposer, mais jusqu’à présent leurs conjectures ne paraissent pas encore avoir été heureuses.”

Une fille de Thorigny, âgée de 25 ans, avait éprouvé depuis deux ans quelques accès d’hystérie. Le vingt-huitième jour, le médecin apprit qu’elle était morte pendant la nuit, et son étonnement fut d’autant plus grand que la veille il ne l’avait point trouvée dans un danger si imminent. Désirant s’assurer de la verité par lui-même, il s’y rendit, et la trouva couverte par le drap que lui avait mis la garde. La face était très-pâle, les levers décolorées, mais ses traits n’étaient point trop altérés. Elle avait la bouche béante, les yeux fermés, les pupilles très dilatées et nullement impressionnables à la lumière d’une bougie. Nu indice de circulation ni de respiration. La chaleur de la peau était peu sensible au toucher, quoiqu’elle ne fût point glacée ni flasque comme celle d’un cadavre. Les expérices qu’il avait tentées la veille eurent le même résultat. La peau n’avait point refroidi, et il résolut de ne pas laisser enterrer cette fille avant que la putréfaction ne s’en fût emparée. Il continua de l’observer, et, au bout de cinq jours, on crut apercevoir un léger mouvement aux couvertures; deux heures après on s’assura que le bras se contractait, les mouvemens se prononcèrent, et il fut certain que la mort n’avait été qu’apparente. Plus tard les yeux se rouvrirent, la connaissance revint et la morte se rétablit entièrement. Ce fait est fort extraordinaire, mais incontestable; un grand nombre de personnes qui lui ont donné des soins, ou qui, mues par la curiosité, l’ont vue dans cet état, pourraient convaincre les incrédules.

Je ne puis être de l’avis d’un correspondant de la Minerve, de Mr. Agricola, qui dit que nos Sociétés d’Agriculture n’ont produit aucun bien dans ce pays; et je serais presque porté à croire que le seul mécontentement de n’avoir point obtenu de prix aux exhibitions publiques d’animaux, de grains, &c. le porte à déclamer aussi amèrement qu’il le fait, non seulement contre cet Sociétés, mais encore contre la Législature Provinciale. Cet écrivain me paraît ressembler à un ouvrier, ou soi-disant tel, qui serait bien capable de démolir, mais nullement de réédifier; car non seulement il ne met rien de bon à la place de ce qu’il trouve mauvais; il n’y met rien du tout. Cela me paraît étrange dans un homme assez plein de zèle pour se croire autorisé à accuser d’en manquer les seules personnes qui en aient montré jusqu’à présent dans la chose dont-il s’agit. Et certes! ce ne sont pas les moyens de le faire qui lui manquent; car à l’en croire, il se connait mieux en agriculture, il a des idées plus nettes et plus justes sur le sujet, que tous nos législateurs et les membres de nos Sociétés d’Agriculture pris ensemble. J’ose croire pourtant que ce premier écrit de Mr. Agricola n’est qu’un début; qu’il ne fait pas connaître le mal sans avoir l’intention d’indiquer le remède; et qu’après avoir énoncé librement son opinion sur ce qui est, il l’énoncera de même sur ce qui devrait être. C’est bien le moins qu’on puisse attendre d’un homme si éminemment éclairé et zélé pour le bien public. Cette attente ne m’empêche pourtant pas de croire qu’il a eu tort de jetter uniquement sur les Sociétés d’Agriculture le blâme de n’avoir pas fait connaître à tous les cultivateurs du pays le dernier acte de notre parlement concernant l’agriculture. S’il est si nécessaire et si essentiel que les agriculteurs connaissent parfaitement le dernier acte provincial concernant leur art, pourquoi la Législature elle-même n’y a-t-elle pas pourvu? Il me semble que rien ne lui était si facile que d’ordonner qu’il fût imprimé et distribué autant d’exemplaires de l’acte qu’il serait nécessaire pour que tout le monde en connût les dispositions. Ne pouvait-elle pas même, en accordant de l’argent aux Sociétés d’Agriculture, y joindre la condition qu’elles feraient imprimer et distribuer l’acte en question à même ces derniers? Il faut donc, suivant moi, ou que les Sociétés d’Agriculture sort exemptes du tort qu’Agricola leur impute, ou que la Législature le partage, s’il y en a réellement.
Je ne prétends pas, au reste, que les Sociétés d’Agriculture, aient fait tout ce qu’elles auraient pu faire; ou quelles n’auraient pas pu faire mieux ce qu’elles out fait; mais ce n’est pas de cela dont-il s’agit maintenant: j’y reviendrai, une autre fois, s’il est nécessaire.
Habitator Terræ.

Les nouvelles attendues et reçues d’Angleterre, de temps autre, sont devenues moins intéressantes depuis la passation de l’acte pour l’émancipation des catholiques. Une question qui paraissait exciter de l’intérêt avant sa décision, était celle de savoir si Mr. O’Connell serait admis ou non, dans la chambre des communes, en vertu de son élection. Cette question a été décidée contre l’admission, à la majorité de 74, ou, si l’on veut, pour l’admission, mais à une condition que l’honorable monsieur a jugée inacceptable. Il s’agissait pour lui de prêter le serment appelé de suprématie, et ce serment, Mr. O’Connell a nettement refusa de le prêter, en disant, qu’il contenait une chose qu’il savait être fausse, et une autre qu’il croyait être fausse. Ou n’exigeait ce serment de Mr. O’Connell que parce que son élection a eu lieu antérieurement à la passation de l’acte d’émancipation il ne sera pas exigé des catholiques élus postérieurement. En conséquence du refus de Mr. O’Connell, il a été émané un nouvel ordre d’élection pour le comté de Clare. Un catholique, élu apparemment après la passation de l’acte d’émancipation, avait déjà été admis dans la chambre des commises, après avoir prêté le serment exigé par cet acte.
Quand nous disons que depuis la passation de l’acte d’émancipation, les nouvelles d’Angleterre n’excitent plus le même intérêt, nous n’oublions pas qu’il devait se discuter, dans le parlement britannique, des questions relatives au Canada, et conséquemment importantes pour nous autres Canadiens. Il y avait déjà été plusieurs fois question des affaires de ce pays, par voie de conversation, de demandes et de réponses; mais il paraît qu’un des membres avait donné avis que le 21 Mai, il proposerait que ces affaires fussent prises en considération, dans la vue d’en venir à quelque résultat positif.
L’Espagne n’offre pas de nouvelles bien importantes. En Portugal, Don Miguel continue à opprimer et à tyranniser ses prétendus sujets, au-delà de ce qu’il est possible d’imaginer, si l’on doit ajouter foi à ce qui se publie dans les journaux étrangers.
Le trait le plus frappant de la politique de la France paraît être le manque de confiance de la chambre des députés dans le ministère, et du ministère dans la chambre des députés.
Les Grecs paraissent avoir remporté quelques avantages sur les Turcs, dans la terre-ferme. Ils s’étaient, disait-on, rendus maîtres du château de Lépante, et avaient mis le siège devant Missolonghi.
Les hostilités ont recommencé entre les Russes et les Turcs, avec le printemps. Il n’y avait pas eu encore, aux dernières dates, de batailles décisives ou importantes, mais seulement quelques petits combats, où les premiers se vantaient d’avoir en l’avantage.
Quant aux rumeurs d’une alliance projettée entre la Russie et la Prusse, d’une part, et entre l’Angleterre, l’Autriche et la Turquie, de l’autre, et dont le résultat serait une guerre générale, elles ne paraissent pas assez bien fondées pour donner lieu à des remarques éditoriales.
Pour nous rapprocher de nos foyers, et parler de choses moins grandes en elles-mêmes, mais pour nous d’un intérêt plus immédiat, plusieurs personnes semblent s’étonner que la plupart des grands travaux annoncés par les votes de la Législature, ne soient pas encore commencés, et paraissent ne savoir à qui ni à quoi attribuer la cause de ce retardement. Nous sommes néanmoins sur la voie des améliorations: déjà, dans plusieurs paroisses, l’on s’est prévalu, ou l’on va se prévaloir du dernier Acte provincial, pour établir des écoles élémentaires. Il paraît aussi, d’après un journal de Québec, qui se dit bien fondé, que le gouvernement provincial se proposé de donner aux anciens habitans du pays toutes les facilités nécessaires pour s’établir sur les terres des townships qui joignent immédiatement les seigneuries: “mesure; ajoute ce journal, qui mettra les Canadiens en état d’acquérir des terres en franc et commun soccage, sans les obliger à aller loin de leurs familles et de leurs amis, au milieu d’étrangers, et dans des lieux où ils seraient privés de l’instruction religieuse de l’église à laquelle ils appartiennent.”
Le gouvernement annonce aussi qu’il concédera des terrés sur la rivière des Envies, dans la seigneurie de Batiscan. On peut s’adresser à Louis Guillet, écr., N. P. à Batiscan, ou au bureau des Commissaires, à Québec.

La Société Historique et Littéraire de Québec, et la Société pour l’encouragement des Arts et des Sciences en Canada, se sont réunies, au commencement du mois dernier, pour n’en former qu’une seule. Elle a demandé au gouvernement de la métropole, et espère en obtenir prochainement, une charte d’incorporation.
Le capitaine Bayfield et les autres messieurs qui doivent explorer la région du Sagnenay &c. sont partis de Québec le 5 Juin.
A l’assemblée annuelle des Actionnaires de la Banque de Montréal, qui s’est tenue au commencement du mois dernier, les messieurs suivants ont été nommés Directeurs pour l’année: Charles Broke, William Blackwood, John Fleming, Horatio Gates, James Molson, George Lunn, Peter M’Gill, Joseph Shuter, John Torrance, et John Try, écuyers.
La nouvelle Eglise paroissiale de Montréal, a été bénite le 7 de Juin, jour de la Pentecôte, par Messire Roux, Grand-Vicaire, assisté de MM. Mallard, Sauvage, Satin, et Richards; Prêtres du Séminaire.
MM. Tabeau et M’Guire, le premier, Curé de Boucherville, et le second, Directeur du Collège de St. Hyacinthe, se sont embarqués à New-York, le 9 Juin, pour l’Angleterre. Ces Messieurs sont chargés, dit-on, de solliciter auprès du gouvernement britannique, la confirmation des titres en vertu desquels le Séminaire de Montréal possède les biens dont-il jouit, l’obtention de lettres d’amortissement pour le Collège de St. Hyacinthe, &c.
Le prise de possession du terrain destiné à l’établissement du College M’Gill, au pied de la montagne, à eu lieu le 24. L’Evèque protestant de Québec a assisté à la cérémonie, comme Principal de l’Institution Royale, ainsi que plusieurs autres membres de la corporation.

Le 1er, Juin dernier, à Montréal, Mr. Narcisse Ducondu, Marchand, à Dlle Elise Mercure;
Le 17, A. D. Bostwick, écr. Avocat, des Trois-Rivières, à Dlle Georgiana Cuthbert, de Lanoraie;
Le 23, à la Longue Pointe, Mr. Simon Cipiot, de Montréal à Dlle Marie Emilie Truteau, de l’endroit.
A Montréal, le 6 juin dernier, chez J. P. Leprohon, écr. Dame Marie Therese Delisle, veuve de feu Mr. J. B. Parent, âgée de 85 ans et 7 mois;
A St. Pierre les Becquets, le 8, Joseph Rousseau, écr. âgé de 65 ans;
A Québec, le 12, J. Hoffmann, écr. Avocat, âgé de 29 ans;
Montréal, le 14, Dame Julie Dumont, épouse d’E. E. Rodier, écr. Avocat, âgée de 24 ans;
A Varennes, le 17, Dlle Zoe Lacaille, âgée de 20 ans;
A Montréal, le 20, P. H. Pierre, écr. Capitaine de milice.
Mr. Charles P. A. Boucher, Médecin et Chirurgien;
Mr. Pierre Piette, Notaire Public.
Mr. J. N. Cardinal, do. do.
Mr. Wm. Hough, Apothicaire.
Printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Mis-spelled words and punctuation have been maintained except where obvious printer errors occur.
[The end of La Bibliothèque Canadienne, Tome IX, Numero 1, Juillet 1829. edited by Michel Bibaud]