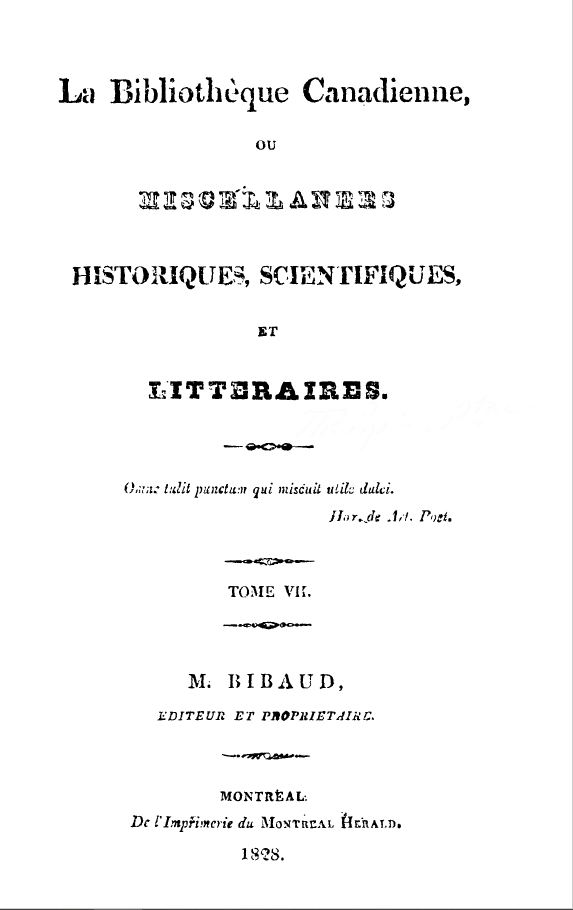
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque canadienne, Tome VII, Numero 4, Septembre 1828.
Date of first publication: 1828
Author: Michel Bibaud (1782-1857)
Date first posted: Nov. 7, 2021
Date last updated: Nov. 7, 2021
Faded Page eBook #20211114
This eBook was produced by: John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
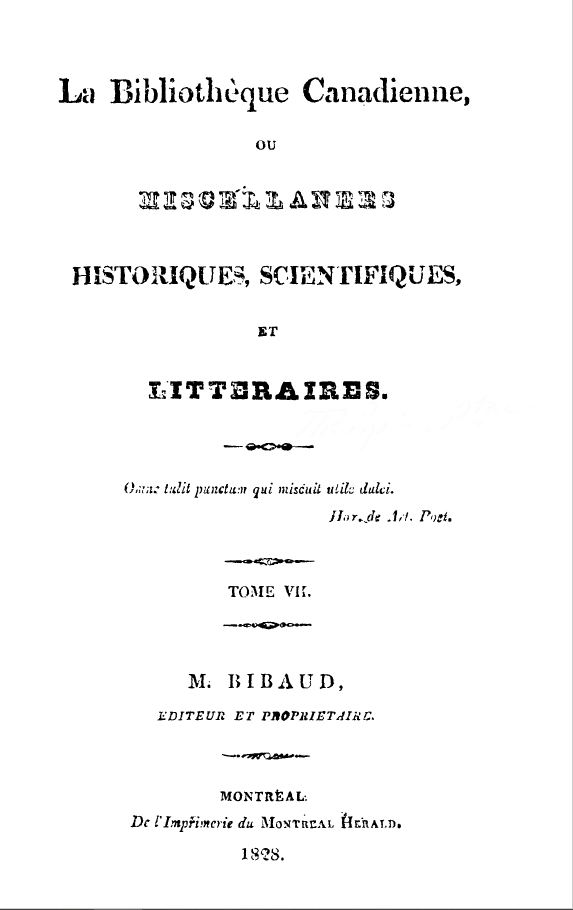
La Bibliothèque Canadienne
| Tome VII. | SEPTEMBRE, 1828. | Numero 4. |
L’armée se remit en marche pour la baie de Toulle, et y arriva le même jour. Le 24, d’Iberville envoya à la découverte plusieurs détachemens de Canadiens, qui tous firent des prisonniers; et le 26, il prit lui-même les devans avec sept hommes, pour s’emparer d’une hauteur d’où les Anglais auraient pu reconnaître l’armée, et l’incommoder dans sa marche. Après qu’il eut fait environ trois lieues, il rencontra un de ses partis, qui était allé jusqu’à St. Jean, et le retint près de lui. Un peu plus loin, il apperçut trente Anglais, qui avaient découvert l’armée: il se mit à leurs trousses; entra avec eux dans un petit havre, d’où ils étaient sortis; passa une rivière très rapide, ayant de l’eau jusqu’à la ceinture; força les Anglais dans une espèce de retranchement, et demeura maître du havre. Les ennemis y eurent trente six hommes tués sur la place; on en prit quelques uns; le reste se sauva à St. Jean. Le soir, l’armée joignit d’Iberville dans ce même lieu, où elle fut obligée de séjourner jusqu’au lendemain, à cause d’une neige si épaisse qu’elle obscurcissait l’air, et ne permettait pas de voir devant soi. Montigny, pour qui le repos était un tourment, ne laissa pas de faire une course dans les bois, et d’en ramener plusieurs prisonniers.
Le 28 au matin, toute l’armée marcha en ordre, Montigny faisant l’avant-garde avec trente Canadiens, et dévançant le gros de cinq cents pas. Après deux heures et demie de marche, il découvrit, à la portée du pistolet, un détachement de quatre-vingt-huit Anglais avantageusement postés derrière des rochers. Il ne balança point à faire feu sur eux, et ceux-ci ne voyant que trente hommes, leur répondirent d’une décharge de leur mousqueterie, et les attendirent de pied ferme. Montigny tint bon de son côté, tirant toujours en attendant l’armée. Elle le joignit bientôt: M. de Brouillait attaqua les Anglais de front; d’Iberville tourna sur la gauche pour les prendre en flanc, du côté où le rocher ne les couvrait point. Ils se battirent bien, mais au bout d’une demi-heure de résistance, ils plièrent de toutes parts. Ils avaient perdu plus de cinquante hommes, tandis que, du côté des Français, il n’y avait eu qui trois hommes de tués et trois de blessés, d’Iberville, suivi d’un petit nombre de Canadiens des plus alertes, poursuivit les fuyards, l’épée dans les reins, et les mena battant jusqu’à St. Jean, où il arriva un quart d’heure avant l’armée. Dans ce peu de temps, il s’était saisi de deux redoutes, et avait fait plus de trente prisonniers.
L’armée se logea dans les maisons du bourg. Le fort, qui restait à prendre, était revêtu d’une palissade de huit pieds de hauteur, mais du reste, en assez mauvais état. On envoya sommer le gouverneur de se rendre, par une femme, qui était du nombre des prisonniers: il la retint, et ne fit point de réponse; ce qui fit juger qu’il était déterminé à se défendre. On envoya aussitôt chercher à la baie de Toulle les canons, les mortiers et les munitions de guerre qu’on y avait laissés. Dans la nuit du 29 au 30, MM. de Muys et de Montigny furent commandés avec soixante Canadiens pour brûler les maisons les plus proches du fort. D’Iberville et Nescambiwit, chef sauvage, s’avancèrent avec trente hommes choisis pour les soutenir, et M. de Brouillan se mit en bataille avec tous ses gens, pour marcher à leur secours, s’il en était besoin. Les maisons furent brûlées, et le lendemain, un Anglais sortit du fort avec un pavillon blanc.
Sur les propositions qu’il fit, on convint d’une entrevue hors de la place, dont le gouverneur ne voulait pas que les Français vissent le mauvais état. Il se trouva au rendez-vous avec quatre des principaux habitans du bourg. M. de Brouillan lui ayant fait ses propositions, il demanda terme jusqu’au lendemain pour y répondre; mais comme on s’apperçut qu’il ne voulait que gagner du temps, parce qu’il avait découvert deux gros vaisseaux, qui louvoyaient depuis deux jours pour tâcher d’entrer dans le port, on lui déclara qu’il fallait prendre son parti à l’instant même, ou qu’on allait donner l’assaut. Comme il n’était pas en état de le soutenir, il convint de se rendre le jour même, aux conditions suivantes: 1º. qu’on lui fournirait deux bâtimens pour le conduire avec tout son monde en Angleterre; 2º. que personne ne serait fouillé; 3º. que ceux des Anglais qui vondraient se retirer à Bonneviste le pourraient, faire en toute sûreté.
Cette capitulation signée de part et d’autre, le gouverneur anglais rentra dans sa place, et en sortit, un moment après, avec deux cent cinquante hommes, sans les femmes et les enfans. Il n’avait eu qu’un soldat blessé dans une escarmourche lorsqu’on allait reconnaître le fort; mais toute cette garnison n’était guère composée que de pêcheurs, qui savaient à peine tirer un coup de fusil, et leur commandant était un simple bourgeois, choisi pour l’occasion par les capitaines de vaisseaux. Le fort était assez bon, mais, dépourvu de tout: la garnison n’y avait pas de vivres pour vingt-quatre heures, ni un morceau, de bois pour se chauffer; aussi n’y était-elle entrée qu’au moment où M. d’Iberville avait paru dans le bourg. Les deux navires qui n’avaient pu entrer dans le port assez à temps pour secourir la place, prirent le parti de s’en retourner en Angleterre.
Le 2 Décembre, Montigny fut envoyé avec douze hommes à Portugalcove, dans la baie de la Conception, éloignée de trois lieues de St. Jean, pour y arrêter un grand nombre de fuyards, qui voulaient se réfugier à Carbonnière, et il en prit trente. Dugué de Boisbriand, gentilhomme canadien, fit encore un plus grand nombre de prisonniers, près de St. Jean, en un lieu que Charlevoix nomme Kirividi, et bientôt le nombre s’en trouva de plus de cent.
Après le partage du butin, qui ne se fit pas san, de nouvelles altercations entre. MM. de Brouillan et d’Iberville, le gouverneur de Plaisance proposa de garder St. Jean, et d’en donner le commandement à M. de Muys. D’Iberville y consentit, mais à condition qu’il n’y resterait aucun Canadien, n’en ayant, pas, disait-il, un seul de trop pour les expéditions qu’il méditait. De Muys n’avait garde d’accepter à cette condition le commandement dont on voulait le charger, et la résolution fut prise et exécutée sur le champ d’abandonner cette conquête, après avoir brûlé les forts, et généralement tous les bâtimens qui étaient encore sur pied. Cela fait, MM. de Brouillan et de Muys se disposèrent à retourner à Plaisance, et M. d’Iberville ne songea plus qu’à continuer la guerre avec les braves qui s’étaient attaches à sa fortune.
Il y employa près de deux mois, au bout desquels il ne resta plus aux Anglais, dans l’île de Terre-Neuve, que Bonneviste et Carbonnière. Le premier de ces postes, dit Charlevoix, était trop bien fortifié pour pouvoir être insulté par une aussi petite troupe de gens, qui, marchant sur la neige, et presque toujours dans des chemins impraticables à tout autre qu’à des Canadiens et des sauvages, ne pouvaient porter que leurs fusils et leurs épées, avec ce qu’il fallait de vivres pour ne pas mourir de faim. L’île de Carbonnière est inabordable pendant l’hiver, pour peu qu’elle soit défendue, et plus de trois cents Anglais s’y étaient réfugiés des autres places qu’on leur avait enlevées. Les vagues lui faisaient alors un rampart qu’une armée entière, avec une bonne artillerie, n’eût jamais pu forcer.
On fit, dans ce reste de campagne, six ou sept prisonniers, parmi lesquels il faut sans doute compter un bon nombre de femmes et d’enfans. On les envoya à Plaisance; mais le plus grand nombre s’en sauvèrent, parce qu’il n’y avait pas à ce poste assez d’endroits fermés pour s’assurer d’eux.
Après M. d’Iberville, qui donna, dans cette expédition, de grandes preuves de sa capacité, et qui se trouvait partout où il y avait plus de risques à courir et de fatigues à essuyer, et Montigny, qui ordinairement prenait les devans, et laissait peu à faire à ceux qui le suivaient, Dugué de Boisbriand, d’Amour de Plaine, Boucher de la Perriere, tous trois Canadiens, et Nescambiwit, furent ceux qui se distinguèrent le plus.
M. d’Iberville retourna à Plaisance, pour y attendre le secours qu’il avait demandé de France, par M. de Bonaventure, et sans lequel il ne pouvait tenter d’achever sa conquête. Il l’attendit vainement, et l’arrivée de Serigny, son frère, qui mouilla dans cette baie, le 18 Mai 1697, avec une escadre et des ordres de la cour, l’obligea de renoncer à cette entreprise, pour aller cuellir de nouveaux lauriers dans les glaces, de la Baie d’Hudson.
En lisant le récit de cette expédition de Terre-Neuve, on ne peut s’empêcher de la regarder du même œil que celles qu’on a déjà vu entreprendre aux Français contre la Nouvelle York et la Nouvelle Angleterre. Dans toutes ces entreprises, l’unique but apparent des assaillants est de tuer, de piller, de détruire, de faire des déserts de lieux auparavant habités et florissants. Ici pourtant, on voit un motif raisonnable, un but utile; les auteurs de l’entreprise voulaient oter aux Anglais la pêche et le commerce de la morue, pour les donner exclusivement à leur nation; mais pour y réussir, il aurait fallu ne pas conquérir uniquement pour ravager, mais pour conserver; et remplacer les anciens habitans, qu’on chassait, par des nationaux; mais ces moyens manquant, dans cette petite guerre, comme dans les précédentes, le résultat fut de faire du mal à autrui sans se procurer à soi-même aucun avantage réel et positif.
Tel était l’esprit du temps dans ce pays, que tout particulier se croyant en droit de s’armer et d’aller tuer, ravager et piller partout où sa volonté ou le hazard le conduisait chez les Anglais ou les sauvages. Dans le même temps que d’Iberville et Brouillan étaient occupés à détruire les établissemens anglais de Terre-Neuve, deux ou trois petits partis de dix ou quinze hommes chacun se mirent en campagne pour aller chercher fortune ou rencontre du côté de la Nouvelle York. Une de ces troupes tomba dans une ambuscade, près d’Orange, et tous ceux qui la composaient furent tués ou faits prisonniers. Une autre rencontra des sauvages dé la Montagne, qui les prisent pour des Anglais, et fut en partie détruite. Digne récompense de ces téméraires et coupables maraudes. Mais, en reprenant les choses d’un peu plus haut, suivons encore une fois d’Iberville dans les parages du détroit et de la baie d’Hudson.
Le 2 Septembre 1696, une galiote à bombes et quatre autres vaisseaux anglais parurent à la vue du fort Bourbon: il n’y avait pas plus de deux heures qu’ils étaient mouillés dans la rade, lorsque MM. de Serigny et de Lamotte-Egron y arrivèrent aussi sur deux bâtimens. Mais le partie étant trop inégale pour hazarder le combat, ces messieurs se retirèrent aussitôt. Lamotte-Egron fit naufrage et se noya, en voulant se rendre à Québec: Sérigny reprit la route de France, et arriva heureusement à la Rochelle.
Le fort n’était guère en état de résister à l’escadre anglaise: on ne laissa pas néanmoins d’y faire d’abord une assez bonne contenance. Le 5 et le 6, la galiote soutenue de deux navires, fit un assez grand feu, à lu faveur duquel les Anglais voulurent tenter la descente. Mais le sieur Jérémie, qui servait dans la place en qualité d’enseigne, s’étant embusqué derrière des buissons avec quarante fusilliers, fit sur les premières chaloupes qui s’approchèrent des décharges si fréquentes et si bien dirigées, qu’il les contraignit de s’éloigner.
Alors la galiote recommença à jetter des bombes; et comme il n’y avait pas dans le fort un seul endroit où la poudre fût en sûreté, le sieur de La Forest, qui y commandait, ne vit d’autre parti à prendre que celui de capituler. Il demanda d’être conduit sur les terres de France avec toute sa garnison, et qu’il fût permis à chacun d’emporter ce qui lui appartenait. Ces deux articles furent accordés; mais les Anglais ne furent pas plutôt entrés dans la place, qu’ils dépouillèrent les Français et les envoyèrent prisonniers en Angleterre. Ils furent néanmoins élargis quatre mois après leur arrivée, et se rendirent presque tous en diligence à la Rochelle pour s’embarquer sur l’escadre que M. de Sérigny devait conduire à Plaisance, et qui y arriva, comme nous l’avons vu plus haut, le 18 Mai 1697.
Les instructions qu’il remit à son frère portaient qu’avant de passer à la baie d’Hudson, il ferait un tour à la rivière St. Jean, pour voir si le fort de Naxoat n’avait pas besoin de secours. Mais la saison étant trop avancée pour entreprendre deux expéditions en des lieux si éloignés l’un de l’autre, il fut résolu qu’on irait droit au fort Bourbon. L’escadre, composée de quatre navires et d’un brigantin mit à la voile le 8 Juillet, et arriva le 28 à l’entrée du détroit d’Hudson. D’Iberville l’avait passé le 3 Août; mais alors il se trouva au milieu de glaces flottantes, qui poussées avec violence par les courans, mettaient à chaque instant ses vaisseaux en danger de périr. Aussi dès le 5, le brigantin fut écrasé entre un de ces écueils flottans et Le Palmier, que montait M. de Sérigny, et cela si subitement qu’on eut à peine le temps de sauver les hommes.
Le 28, d’Iberville, qui montait le Pélican de 50 canons, se trouva dans une mer libre, mais seul, et ne sachant ce qu’étaient devenus ses autres vaisseaux, que les glaces lui avaient cachés depuis le 11. Il crut néanmoins qu’ils avaient pris les devans, parce que, la veille, il avait entendu tirer des coups de canon, et il fit voile pour le Port Nelson, à la vue duquel il arriva le 4 Septembre. Le soir, il jetta l’ancre assez près du fort Bourbon, et envoya su chaloupe à terre, avec le sieur de Martigny, son cousin germain, pour prendre connaissance de la place, et des vaisseaux anglais qu’il avait apperçus dans le détroit d’Hudson.
Le lendemain, vers six heures du matin, il découvrit, à environ trois lieues sous le vent, trois vaisseaux qui louvoyaient pour entrer dans la rade. Il leur fit les signaux dont il était convenu avec Sérigny, et comme ils n’y répondirent point, il ne douta plus que ce ne fussent les ennemis. Il se prépara aussitôt à les attaquer, quoiqu’il n’eût pas plus de cent cinquante hommes en état de combattre, et qu’il eût à faire à trois navires dont l’un était plus fort que le sien, et les deux autres portaient chacun trente deux pièces de canon.
Malgré cette inégalité, il arriva sur eux avec une intrépidité qui les étonna: vers les neuf heures et demie du matin, on commença à se canonner, et jusqu’à une heure après midi, le feu fut continuel et très vif des deux côtés. Alors d’Iberville, qui avait conservé le vent, arriva tout court sur les deux frégates, et leur envoya, plusieurs bordées à dessein de les désemparer; puis il alla à la rencontre du troisième vaisseau, nommé le Hamshire, qui l’approchait, ayant vingt six canons en batterie sur chaque bord, et deux cent cinquante hommes d’équipage. Il le rangea sons le vent, son canon pointe à couler bas, et lui envoya sa bordée. Elle fut fuite si à propos, que le Hamshire, après avoir fait au plus sa longueur de chemin, coula à fond. D’Iberville revira aussitôt de bord, et tourna sur le Hudson’s Bay, celui des deux autres vaisseaux anglais qui était le plus à portée d’entrer dans la rivière Ste. Thérèse; mais comme il allait l’aborder, le commandant baissa son pavillon et se rendit.
D’Iberville chassa ensuite le troisième, appellé le Deringue, dont il n’était qu’à une portée de canon; mais n’osant forcer de voiles, parce qu’il était fort délabré, il revira de bord, pour se raccommoder; après quoi, il se remit à la poursuite du seul ennemi qui lui restât, et qui était déjà à trois lieues de lui. Il s’en était déjà fort approché, lorsque le soir, une brume épaisse s’étant élevée tout à coup, il le perdit de vue, ce qui l’obligea de revenir sur ses pas. Cependant rien ne l’empêchant plus de s’approcher du fort Bourbon, il alla mouiller dans la rade, le 6 au matin, et fit embarquer un mortier et cinquante bombes dans le Hudson’s Bay, pour commencer l’attaque, en attendant ses trois autres vaisseaux. Mais le lendemain, le vent s’étant élevé, et la mer grossissant extraordinairement, il alla mouiller au large; ce qui ne l’empêcha pas d’être jetté à la côte, et d’aller échouer avec sa prise, à l’entrée de la rivière Ste. Thérèse.
La tempête ayant eu lieu de nuit, on ne put prendre les mesures nécessaires pour sauver les vaisseaux, en tâchant de les faire échouer dans un endroit sûr; aussi se trouvèrent-ils crevés et pleins d’eau dès avant le jour. Néanmoins, le calme étant revenu, l’équipage se sauva à terre, et emporta tout ce qui était nécessaire pour l’attaque du fort; mais on n’avait plus de vivres, et on ne pouvait s’en procurer qu’en se rendant maître de la place: aussi d’Iberville fit-il tout préparer en diligence pour y donner l’assaut. Il avait à peine commencé ce travail, lorsqu’il apperçut ses trois navires, qui, peu de temps après, mouillèrent dans la rade. Ils avaient essuyé la même tempête; mais comme ils s’étaient trouvés beaucoup plus au large, ils en avaient beaucoup moins souffert.
Cette jonction procurait des vivres à d’Iberville, et lui assurait la prise du fort Bourbon; aussi ne songea-t-il plus à donner l’assaut, qui n’était pas nécessaire, et pouvait lui couter beaucoup de monde. Le 10, il fit dresser des batteries, et le 12, il commença de faire jetter des bombes. Le commandant, nommé Henry Bailay, n’attendait apparemment que cela pour se rendre. Le lendemain, il battit la chamade, et convint de livrer sa place, aux conditions suivantes: 1°. Qu’on ne toucherait point à ses papiers, ni à ses livres de compte, qui appartenaient à la compagnie de Londres; 2°. Qu’on laisserait aux officiers et aux soldats leurs hardes, leurs malles, et généralement tout ce qui leur appartenait; 3°. Qu’ils seraient traités comme les Français; 4°. Qu’on les enverrait incessamment en Angleterre; 5°. Que la garnison sortirait avec toutes les marques d’honneur, et ne serait point désarmée.
Dès que cette capitulation eut été signée, le commandant sortit avec cinquante deux hommes, dont dix-sept s’étaient sauvés du Hudson’s Bay dans le fort, lors du naufrage de ce vaisseau et du Pélican, et recouvrèrent ainsi leur liberté. D’Iberville ayant pris possession de sa conquête, y établit pour commandant le sieur de Martigny, et M. de Boisbriand, frère de M. Dugué, en qualité de lieutenant de roi. On fit entrer dans la rivière le Palmier, celui des trois navires qui avait été le plus maltraité par la tempête, et Sérigny y fut laissé avec cinquante hommes, pour le ramener en France, supposé qu’on pût le réparer. D’Iberville mit à voile le 24 Septembre, avec le Wesp, et le Profond, sur lequel il avait fait embarquer l’équipage du Pélican, et arriva à Belle-Isle le 8 Novembre.
Il ne se passa rien de bien important dans le centre de la colonie, depuis l’automne de 1696 jusqu’au printemps de l’année suivante: à l’exception des petits partis dont nous avons parlé un peu plus haut, les Français et les sauvages domiciliés se tinrent plus tranquilles que d’ordinaire; et cela d’après les ordres du comte de Frontenac, qui avait reçu, par la voie de l’Acadie, des dépêches de la cour, où on lui donnait des avis qui ne lui permettaient pas de dégarnir la colonie de troupes. Le ministre lui mandait qu’il y avait dans les ports d’Angleterre des vaisseaux qui devaient faire voile incessamment pour aller joindre une escadre qu’on armait à Boston pour attaquer le Canada. Il ajoutait que le roi voulait qu’il tînt prêts mille ou douze cents hommes, pour exécuter les ordres qu’il recevrait de sa majesté, au cas qu’il n’y eut rien à craindre pour Québec.
Les Iroquois s’appercevant bientôt qu’on ne songeait plus à les aller inquiéter chez eux, se mirent de toutes parts en campagne; ce qui obligea le gouverneur de Montréal de multiplier les partis, pour rompre leurs mesures. Le comte de Frontenac sentit alors le tort qu’il avait eu de ménager une nation, à laquelle il avait fait trop de mal pour espérer de la gagner jamais, et qu’il n’avait pas assez affaiblie, pour la mettre hors d’état d’inquiéter les Français; et ce qui se passait alors dans les contrées de l’ouest vint ajouter encore à son chagrin et à sa sollicitude.
Un assez grand nombre de Miamis des bords de la rivière Maramek, ou Merrimak, une de celles qui se déchargent dans le lac Michigan, en étaient partis, sur la fin du mois d’Août de l’année précedente, pour s’aller réunir avec leurs frères établis sur la rivière St. Joseph, et avaient été attaqués en chemin par des Scioux, qui eh avaient tué plusieurs. Les Miamis de St. Joseph, instruits de cet acte d’hostilité, allèrent chercher les Scioux jusque dans leur pays, pour venger leurs frères, et les rencontrèrent retranchés dans un fort, avec des Français du nombre de ceux qu’on appellait coureurs de bois. Ils les attaquèrent à plusieurs reprises avec beaucoup de résolution, mais ils furent toujours repoussés, et contraints enfin de se retirer, après avoir perdu plusieurs de leurs gens. Comme ils s’en retournaient chez eux, ils rencontrèrent d’autres Français, qui portaient des armes et des munitions aux Scioux, et ils les leur enlevèrent, sans néanmoins leur faire d’autre mal. Ils firent ensuite savoir aux Outaouais ce qui venait de se passer, et ceux-ci envoyèrent une députation au comte de Frontenac, pour lui représenter qu’il était absolument nécessaire d’appaiser les Miamis, si l’on voulait qu’ils ne se joignissent pas aux Iroquois. Ils étaient en effet tellement irrités contre les Français, que Nicholas Perrot, si accrédité parmi eux, fut sur le point d’être brûlé, et n’échappa à leur fureur que par le moyen des Outagamis, qui le tirèrent de leurs mains.
Le général fit aux députés la réponse qu’il jugea la plus convenable, et prit les mesures qu’il crut les plus propres à empêcher que cette affaire n’eût les suites fâcheuses qu’on lui faisait appréhender. Mais celle qu’il en appréhendait le plus lui-même, parce que son autorité en aurait souffert, c’était la suppression de ce qu’on appellait alors des congés, et dont le gouverneur général avait la distribution. Dès l’année précedente, sur les plaintes qui avaient été faites contre les inconveniens et les suites fâcheuses des courses de bois, le roi avait expressément défendu au gouverneur de permettre à aucun Français de monter dans les pays des sauvages, pour y faire le commerce. D’après ses représentations pourtant, et celles de MM. de Callières et de Champigny, il fut finalement jugé, dans le conseil du roi, que comme il ne convenait pas d’abandonner les postes qu’on avait établis parmi les sauvages, il fallait se contenter de réprimer les abus du commerce des particuliers avec ces peuples, sons entreprendre de le supprimer entièrement.
(A continuer.)

Le lieu de la naissance de Chistophe Colomb n’est pas précisément indiqué; les uns désignent Nerni ou Cuguero, petits bourgs voisins de Gênes; d’autres, Savone et Plaisance. Seulement il est certain que ses parens, sujets de la république de Gênes, jouissaient d’une grande réputation d’honnêteté; qu’ils perdirent leur fortune pendant les guerres d’Italie, et qu’alors, pour subsister, ils se livrèrent au commerce maritime. Leur fils Christophe ayant, dès sa première jeunesse, manifesté un goût marqué pour la navigation, ils s’attachèrent à développer ses talens naturels, par une éducation analogue. Christophe apporta beaucoup d’ardeur et d’application à l’étude des sciences, qui seules pouvaient le conduire à la connaissance entière de l’art qu’il chérissait; aussi, par ses rapides progrès dans le dessin, la géométrie, la cosmographie et l’astronomie, se trouva-t-il en état d’entrer, avant quinze ans, vers 1461, dans la carrière où il devait s’illustrer.
Il accompagna d’abord des marins génois, dans quelques voyages aux ports de la Méditerrannée; mais bientôt, brûlant d’étendre ses connaissances maritimes, il entreprit de visiter les mers du Nord, dans lesquelles il s’avança jusqu’à plusieurs degrés en dedans du cercle polaire. Il s’attacha ensuite à un de ses parens, nommé aussi Colomb, marin distingué, qui, avec une petite frégate armée à ses frais, s’était enrichi et rendu célèbre par ses courses, tantôt contre les Turcs, tantôt contre les Vénitiens, rivaux des Génois dans le commerce. Pendant quelques années, que dura cette association, Christophe fut d’un grand secours à son parent, qu’il éclaira de ses lumières, et défendit par son courage; mais le génie de Colomb se trouvait trop à l’étroit dans ce genre de navigation.
Les Portugais jouissaient alors d’une certaine renommée dans les découvertes; leurs entreprises hardies ouvraient un vaste champ à tous ceux qu’animait le désir de voir des pays nouveaux, ou celui de se distinguer; déjà plusieurs marins, amis de Christophe, étaient entrés à leur service. Colomb les imita, et ne tarda pas à se faire distinguer par son mérite et par ses talens. Etabli en Portugal, il y épousa la fille de Perestrello, navigateur expérimenté, qui avait découvert les îles de Porto-Santo et de Madère. Perestrello étant mort, ses journaux et ses cartes devinrent la propriété de Colomb, qui en profita pour étudier les premières opérations des Portugais: il y puisa des renseignemens curieux, des observations importantes, que toutefois il ne se permit d’adopter, qu’après les avoir vérifiés par lui-même; à cet effet, il entreprit plusieurs voyages, dans lesquels il se montra un des plus habiles navigateurs de l’Europe.
Toujours avide de connaître, et capable de méditations profondes, Colomb ne cessait d’établir des rapprochemens, souvent lumineux, entre les anciennes et les nouvelles découvertes; il s’appliquait surtout à remonter aux principes qui avaient guidé les Portugais, persuadé qu’on pouvait non seulement aller plus loin qu’eux, mais encore trouver, en prenant une direction opposée à la leur, un chemin plus court que celui par lequel ils cherchaient une communication avec le continent de l’Inde. Cette opinion hazardée le conduisit naturellement à une autre, dont il crut devoir tirer les plus grandes conséquences. En examinant l’étendue de la route que faisaient alors les Portugais le long de la côte d’Afrique, il conjectura que puisque l’on pénétrait si loin au midi, on parviendrait aussi à découvrir de nouvelles terres, en se portant à l’occident. Le raisonnement, l’autorité des cosmographes et les indices des navigateurs, le fortifièrent dé plus en plus dans son idée. Il rapporte lui-même avec une bonne foi qui ne diminue en rien sa gloire, les principes et les faits sur lesquels il appuyait sa théorie. La figure sphérique de la terre étant connue, et la grandeur de son volume déterminée avec quelque exactitude, il suivait évidemment de là, que les continens de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, ne formaient qu’une petite portion de la superficie du globe terrestre . . . . Il paraissait très vraisemblable que le continent du monde connu, placé sur un des côtés du globe, fût balancé par une quantité à peu près égale de terres dans l’hémisphère opposé. . . . Des pilotes, s’étant avancés à l’ouest, avaient trouvé des roseaux d’une grosseur énorme, et ne ressemblant aucunement aux roseaux ordinaires; d’autres, des pièces de bois travaillées do main d’hommes, flottant sur les eaux et poussées par un vent d’ouest, d’où l’on pouvait conclure qu’elles venaient de quelque terre inconnue, située vers ce même point. . . . . Lorsque le vent soufflait de l’occident, la mer jettait parfois, sur le rivage des Açores, de grands pins déracinés que ces îles ne produisaient pas. . . . . On avait vu jusqu’à des hommes d’une espèce nouvelle dans des pirogues. Enfin, les corps morts de deux de ces étrangers, ayant été jettés sur les côtes, on s’était convaincu que leurs traits n’offraient aucun point de similitude avec ceux des habitans du monde connu.
Sans doute Colomb, encourage par ces faits et plusieurs autres semblables, et d’après ses propres observations, pouvait croire son opinion bien fondée; mais, comme tous les grands hommes, joignant aux talens la modestie, il voulut encore s’éclaircir des lumières de ceux de ses contemporains qu’on citait avantageusement dans les sciences. Il leur communiqua ses idées avec une noble défiance, qui tempérait en lui l’enthousiasme d’un créateur de projets. L’un d’entr’eux, nommé Paul Felique, médecin florentin, et savant distingué, approuva non seulement le projet, mais fournit encore à son auteur des faits qu’il ignorait, des cartes et des renseignemens précieux, en l’engageant à suivre une aussi belle entreprise, qui le couvrirait de gloire, et procurerait à l’Europe les plus grands avantages.
Dès lors pleinement convaincu de la vérité de son système, Colomb dut s’occuper de la confirmer par un voyage; mais les frais d’une telle expédition lui rendaient indispensable la protection de quelque puissance de l’Europe. Colomb pensa aussitôt à sa patrie; il eût désiré qu’elle profitât du fruit de ses travaux. Le sénat de Gênes rejetta son projet comme chimérique. Quelle confiance en effet Colomb pouvait-il inspirer à ses compatriotes, parmi lesquels il n’habitait plus depuis longtemps, et qui surtout ignoraient son habileté et son caractère. Colomb porta son hommage au prince dont il était devenu le sujet. Jean II, roi de Portugal, parut goûter ses propositions; mais, jaloux lui-même de se distinguer par des opérations maritimes, et avide de nouvelles possessions, il fit partir secrètement une caravelle, pour ravir à Colomb la gloire de sa découverte. Cette expédition eut le succès qu’elle méritait; le pilote chargé de suivre le plan de Colomb en était incapable; après avoir erré pendant quelque temps sur la mer, il revint en assurant que le projet devait être considéré comme un rêve. Indigné de ce procédé, Colomb quitta le Portugal, et passa en Espagne vers la fin de l’année 1484, dans l’intention de soumettre son plan à Ferdinand et à Isabelle, qui gouvernaient alors les royaumes réunis de Castille et d’Arragon; mais craignant d’éprouver auprès de cette puissance, quelque nouveau désagrément, il envoya, en même temps, son frère Barthelemy vers le roi d’Angleterre, Henry VII. Ce prince, un des plus instruits et des plus puissants de l’Europe, accueillit favorablement le projet, et donna l’assurance qu’il ferait tous les frais de son exécution. Christophe Colomb ne put profiter des dispositions du roi d’Angleterre; il se trouvait définitivement engagé avec l’Espagne, lorsqu’il apprit l’heureuse négociation de son frère, dont le voyage avait été retardé par divers accidens.
Mais Colomb n’était pas parvenu à se faire écouter de la cour d’Espagne, sans éprouver de grandes difficultés: il lutta tour à tour contre le caractère défiant et circonspect de Ferdinand, et contre l’incertitude d’Isabelle son épouse, qui, d’un caractère plus élevé et plus entreprenant, se laissait sans cessa influencer par les rapports de juges ignorants, chargés d’examiner le projet, et qui, tous à l’envi, le condamnaient. Cinq ans s’étaient écoulés en de vaines promesses, et Colomb, fatigué de solliciter sans succès une réponse formelle, se disposait à quitter l’Espagne, lorsque le prieur Jean Perez, confesseur de la reine, le pria de retarder son voyage de quelques jours. Ce religieux estimait Colomb, parce qu’il lui connaissait de grands talens et beaucoup de vertus; assez instruit dans les mathématiques, il s’était livré à un examen approfondi de son systême, et l’avait trouvé solidement établi. Perez se charges de voir la reine, et lui parla du projet dans termes les plus propres à la convaincre de sa réussite. Frappée des représentations d’un homme qu’elle respectait, et craignant surtout de voir passer dans les mains d’une autre puissance tant d’avantages présumés, Isabelle voulut de nouveau faire examiner le projet de Colomb, à qui elle envoya un présent, pour le dédommager du temps précieux qu’on lui avait fait perdre. Cet illustre navigateur se vit encore au moment d’être condamné par d’autres juges aussi peu éclairés que les premiers; Ferdinand faillit même de rompre tout à fait la négociation. Mais pendant les nombreux délais qu’il avait été obligé d’accorder, Colomb s’était fait des amis et des protecteurs puissants, qui parvinrent enfin à lui faire accorder ce qu’il désirait.
Colomb passa avec Isabelle et Ferdinand un contrat par lequel ces souverains le créaient, lui et ses héritiers, grand-amiral et vice-roi de toutes les îles et continens qu’il découvrirait, en lui accordant le dixième de tous les bénéfices qui résulteraient du commerce des productions étrangères. Isabelle mit beaucoup d’empressement à ordonner les préparatifs de l’expédition. Quant à Ferdinand, quoique son nom figure dans le traité, il témoignait encore une telle défiance dans l’exécution du projet, qu’il ne voulut y prendre aucune part en sa qualité de roi d’Arragon; il stipula avec son épouse que toute la dépense en serait supportée par la couronne de Castille. Colomb prit congé de leurs majestés, et se rendit dans le port de Palos, petite ville de l’Andalousie, où l’on équippait les vaisseaux destinés à l’expédition.
L’armement ne répondit ni à la dignité de la nation, ni à l’importance de l’entreprise, dont les frais, qui avaient tant effrayé le trop circonspect Ferdinand, s’élevèrent à peine à quatrevingt-dix mille francs de notre monnaie. Il se composait de trois bâtimens, le plus gros d’un port peu considérable; les deux autres ne pouvaient guère passer que pour des chaloupes. Ils étaient approvisionnés pour un an, et portaient quatrevingt-dix hommes, parmi lesquels on distinguait quelques gentils-hommes de la cour d’Isabelle, chargés d’accompagner Colomb, et les trois frères Pinzon, riches et bons marins de Palos, qui voulurent suivre la fortune du héros navigateur. Le plus gros vaisseau, monté par Colomb, en sa qualité d’amiral, reçut de lui le nom de Sainte-Marie, en l’honneur de la Vierge, dans laquelle il avait une grande dévotion; le second, appellé la Pinta, était commandé par Martin Pinzon, et le troisième, la Nigna, par Jacques Pinzon.
Il fallait le génie et le courage de Colomb, ainsi que l’intime conviction, où il était, d’accomplir son grand projet, pour s’abandonner à une navigation hazardeuse, dans des mers inconnues, avec d’aussi faibles moyens. L’illustre voyageur ne se dissimulait sans doute pas les dangers qu’il allait braver; mais que ne peuvent, dans une grande âme, le désir d’acquérir de la gloire et la confiance dans la Divinité! Colomb ne voulut pas s’embarquer avant d’avoir, par un acte public de dévotion, appellé sur lui et sur ses compagnons la protection du Tout-puissant. Ils se rendirent processionnellement à l’église du monastère de Rabida, où ils se confessèrent, reçurent l’absolution, et communièrent des mains du respectable Jean Perez, qui n’avait cessé de s’employer en faveur de Colomb. Dans cette touchante cérémonie, tous les assistans adressèrent à Dieu leurs prières pour le succès de l’entreprise, qui ne pouvait manquer d’étendre la foi chrétienne. Enfin le lendemain, Mardi 3 Août 1492, au lever du soleil, et en présence d’une foule considérable de spectateurs qu’agitaient la crainte et l’espoir, Colomb mit à la voile pour cette expédition mémorable, dont les résultats devaient avoir une si grande influence sur les destinées du monde.
La fin au numéro prochain.

Monsieur Bibaud voudrait-il insérer dans sa Bibliothèque Canadienne les vers suivants, qui terminent le second acte de la Médée de Seneque, et que plusieurs ont considérés comme une prédiction de la découverte de l’Amérique?

- - - - - - - - - Venient annis
Sæcula seris, quibus Oceanus
Vincula rerum laxet et ingens
Pateat tellus, Tiphysque novos
Detegat orbes, nec sit terris
Ultima Thule.
Après une longue période d’années, un temps viendra, où l’Océan rompant tout obstacle à la communication entre les peuples divers, de vastes régions se présenteront, un autre Tiphys découvrira un nouveau monde, et Thulé ne formera plus les dernières limites de la terre.
Christophe Colomb, qui fut ce Tiphys nouveau qu’avait annoncé le poëte tragique, donna le nom de San-Salvador à l’île où il aborda en 1492; les Caraïbes la nommaient Guanahani: c’est une Lucayes.

Mr. Bibaud obligera un de ses souscripteurs, en donnant place dans son intéressant recueil aux treize vers latins suivants, qui renferment le système de la classification des Serpents, des continuateurs de Buffon. On les a accompagnés de quelques explications.
Squammarum, generi colubrorum, est unicus ordo Sub ventre; et duplex sub caudá, est scutellarum.
Squammarum ordo unas sub caudâ est, ventreque, Bois.
Instruitur largis sub caudâ, ventreque, squammis Crotalus, extremæque sonant crepitacula caudæ.
In tergo, paribus squammis, et ventre teguntur Serpentes illi Physicus quos nuncupat Angues.
Cingitur orbiculis squammosis Amphisbœna.
Cœciliis, rugis tantum latera ambo plicantur.
Langaha subtegitur magnis propè tempora, squammis, Ventrem deindè tegunt, nec non primordia caudœ, Orbes squammosi; concludunt tenuia scuta.
Parva Acrochordi variant tubercula pellem.
Explication des vers ci-dessus.
Genre des Serpents.—Systeme de Lacepede.
1er genre.—Colubri.
Sous ce nom on désigne ce genre de serpens qui ont un seul rang de grandes écailles sous le ventre, et deux rangs de petites plaques sous la queue. On en compte 96 espèces.
2d genre.—Boa (ou Boa constrictor.)
Ceux qui n’ont qu’un seul rang de grandes plaques tant au-dessous du corps, qu’au-dessous de la queue. (10 espèces.)
(C’est de la première espèce de ce genre qu’est l’Anaconda, qui paraît être le même que le Pimberah et le Buyo, et qu’on nomme aussi le Devin ou serpent Devin. De ce genre, était le serpent de Regulus sur le fleuve Bagrada. On lui a donné aussi improprement le nom de Dragon.)
3e. Genre.—Crotalus (ou Serpent à Sonnettes.)
Ceux qui ont de grandes plaques sous le ventre et sous la queue, dont l’extrémité est terminée par des écailles articulées et mobiles, qu’on a nommées sonnettes. (4 espèces.)
(Peut-être que la 4e. espèce de ce genre, qu’on forme du serpent qu’on a nommé le Muet, est nulle, n’étant fondée que sur l’état de ce serpent, dans sa première année, où la sonnette n’est point, ou qu’imparfaitement, formée.)
4e. Genre.—Angues.
Ceux qui n’ont au-dessous du corps et de la queue que des écailles semblables à celles du dos. (13 espèces.)
5e. Genre.—Amphisbœne.
Ce mot qui signifie Double-marcheur, désigne ceux qui sont entourrés partout d’anneaux écailleux. (2 espèces.)
(Le serpent à deux tètes serait un monstre, et n’entrerait dans ce genre, que s’il en avait la conformation.)
6e. Genre.—Cœcilia.
Ceux dont les cotés sont plissés. (2 espèces.)
7e. Genre.—Langahah.
Genre de serpens qui se trouvent dans l’île de Madagascar, dont le dessous du corps présente, vers la tête, de grandes plaques; ne montre ensuite que des anneaux écailleux; et dont la queue, garnie de ces mêmes anneaux à son origine, n’est revêtue que de simples écailles à son extrémité, (une espèce.)
8e. Genre.—Acrochorde. (de Java.)
Ceux dont la peau est revêtue de petits tubercules, (une espèce.)
Dans le systême de Vallemont de Bomare, les colubri forment le 3e. genre, et les serpens à sonnettes le premier. On peut observer que ce n’est pas dans leur signification naturelle, mais seulement par convention que les mots angues et colubres sont employés dans la classification des serpents; et qu’il est faux que les Amphisbènes aient une tête à chaque extrémité; et que les Cœciliœ soient privés de la vue. Les serpens à sonnettes n’appartiennent qu’à l’Amérique. On ne voit pas que les autres espèces, particulières à ce continent, et qui se trouvent principalement dans le Haut-Canada, aient été classées. On désirerait que quelque amateur s’en occupât.

Bleecker.—(Ann-Elisa), dame qui a joui d’une célébrité littéraire à New-York, fille de Mr. Brant-Schuyler, née en Octobre 1752. Dès sa tendre jeunesse, elle aima passionnément les livres. En 1769, elle fut mariée à John I. Bleecker, écuyer, et vécut pendant plusieurs années tranquille et heureuse, à Tomhanie, superbe village, situé à dix-huit milles au-dessus d’Albany. L’approche de l’ennemi par le Canada, en 1777, l’obligea de quitter sa retraite et interrompit sa félicité: des chagrins domestiques enveloppèrent son esprit comme d’un nuage obscur, et cette dame, qui était douée d’une grande sensibilité, ne put surmonter le poids accablant de ses chagrins. Après que la paix eut été signée, elle revint à New-York, dans l’espérance d’y revoir ses anciennes connaissances; mais la dispersion de ses amis, et la désolation qui s’offrit à sa vue de toute part, lui caussèrent une douleur qui l’accabla: elle retourna dans sa chaumière, où elle mourut le 23 Novembre 1773. Elle fut l’amie des vieillards et des infirmes, et sa bonté envers les pauvres du village qu’elle habitait, fut cause des regrets dont sa mort fut accompagnée. Après son décès, quelques uns de ses écrits furent recueillis et imprimés en 1793, sous le titre d’Œvres posthumes d’Ann-Elisa Bleecker, en prose et en vers. Les Mémoires de sa vie, écrits par sa fille, ont été insérés au commencement. On y trouva aussi la collection des Essais composés par sa fille, madame Faugères.
Faugeres (Maguerite); distinguée dans la littérature, fille d’Ann-Elisa Bleecker, née en 1771, passa les premières années de sa vie chez ses parens, retirés dans le village de Tomhanie, à 18 milles d’Albany, et fut très bien élevée par sa mère; mais elle la perdit dans l’âge où ses conseils lui étaient le plus nécessaires. Bleecker, qui jouissait d’une fortune considérable, passa à New-York, quand la guerre fut terminée, et vit avec plaisir sa fille parvenue à l’âge où ses grâces et son esprit attiraient de tous côtés les hommages; mais elle eut le malheur de mal placer ses affections. Son choix tomba sur un homme dissipé, et malgré les remontrances les plus vives de son père, elle épousa, en 1792, Peter Faugeres, médecin à New-York. Elle ne fut pas longtemps sans se repentir d’avoir préféré les conseils d’une passion aveugle à ceux de la raison. Sa vie ne fut plus qu’un enchaînement de chagrins et de malheurs; dans l’espace de trois ou quatre ans, la grande fortune qu’elle avait apportée à son mari fut entièrement dissipée; l’affection de son père, tant qu’il vécut, lui procura des secours; mais en 1796, elle était réfugiée dans un grenier, avec l’auteur de ses maux et un enfant. En 1798, Faugères fut attaqué de la fièvre jaune et succomba. Son épouse se plaça à New-Brunswick, dans une pension de jeunes demoiselles, pour seconder l’institutrice. La multiplicité de ses talens et la douceur de son caractère la rendaient plus qu’aucune autre propre à ces fonctions. Une année après, elle passa à Brooklyn, où elle se chargea de l’éducation de plusieurs enfans des principales familles. Sa santé, qui s’affaiblissait, ne lui permit pas longtemps de se livrer à ce travail. Enfin, elle mourut en 1801, âgée de 30 ans, à New-York, chez un ami qui lui avait offert une retraite. Madame Faugères avait du goût pour la poésie. Beaucoup de ses productions, qui ont eu du succès, furent insérées dans le Magazine de New-York, et dans le Museum Américain. En 1793, elle publia les Memoirs (notice biographique) de sa mère, à la tète des Œuvres de cette dame. Plusieurs autres Essais par elle-même furent joints à ce volume. Sans avoir jamais mis le pied sur aucun théâtre, elle donna, en 1795 ou 1796, une tragédie intitulée, Bélisaire. Ses plus précieux manuscrits sont entre les mains de Mr. Hardie, de New-York, qui a manifesté l’intention de les publier.—(Dictionnaire Biographique.)

Un Français, M. Bourrouse de Laffore, vient d’attacher son nom à une nouvelle Méthode de Lecture en peu de leçons, déjà éprouvée à Turin et dans le midi de la France, par des expériences multipliées. L’auteur appelle cette méthode Statilégie. Le public reconnaissant lui a donné le nom de Méthode Lafforienne, c’est celui qu’elle mérite, c’est le seul qui lui restera.
Les résultats en sont si étonnans, qu’ils n’ont d’abord trouvé que des incrédules, et nous-mêmes nous ne voulons pas dissimuler que nous avions soupçonné quelque exagération dans les premiers récits de ses panégyristes. Comment ajouter foi à un prodige à moins que l’évidence n’en soit démontrée? Apprendre à lire en huit ou dix jours à des enfans de cinq à six ans, ou à des personnes totalement illétrées, mais chez qui un âge plus avancé rend les impressions plus difficilement transmissibles; donner même en quelques heures à l’inexpérience des premières années, ou à l’ignorance endurcie de la maturité, la connaissance parfaite des élémens et des signes de la langue écrite, voilà, nous l’avouons, ce qui nous semblait passer les bornes du possible. Cependant il n’y avait de franchi que celles de la vraisemblance; nous en avons en ce moment sous les yeux des preuves irréfragables.
Ce sont des procès-verbaux d’expériences faites publiquement dans les villes de Nîmes, le 12 mai dernier, d’Agen, le 26 du même mois, de Montpellier, le 10 juin suivant, en présence d’un concours nombreux des plus notables habitans, des autorités civiles, judiciaires, militaires, universitaires, et, ce qui est plus concluant encore, des professeurs de la faculté de médecine de Montpellier, parmi lesquels on remarque MM. Delpech et Lallemand qui, examinant la découverte de M. Delaffore, dans ses rapports avec la science qu’ils exercent et qu’ils enseignent, ont reconnu et se sont fait un devoir de publier que M. de Laffore, en mettant à contribution “la physiologie et l’anatomie, avait jeté les fondemens d’un systême inébranlable.” Ce sont ces mêmes savans qui n’ont pas balancé de déclarer “que la découverte de M. Laffore restera comme un monument, et que le jour où elle sera partout enseignée, sera certainement un beau jour dans les progrès de l’esprit humain.”
Obligés de cédera des témoignages aussi unanimes et aussi imposants, nous formons des vœux bien sincères pour que M. Delaffore, en confiant à quelques personnes éclairées de la capitale le secret de ses procédés, nous mette bientôt à même de voir et d’entendre par nous-mêmes l’application de sa découverte. C’est de Paris, comme du cendre de l’instruction et des lumières, qu’elle doit se propager avec rapidité jusqu’aux extrémités du royaume. Ce n’est qu’à Paris que le scepticisme le plus opiniâtre sera définitivement vaincu.—Pap. Français.

M. Julia-Fontenelle lit un mémoire intitulé: Recherches chimiques et médicales sur les combustions humaines spontanées.
Les observations qui font le sujet de ce mémoire méritent, à plus d’un titre, de fixer l’attention. En effet, outre l’intérêt qu’elles sont susceptibles de présenter par leur nature même, elles offrent un nouvel exemple d’un de ces phénomènes dont on a, dans ces derniers tems, révoqué en doute l’existence, uniquement parce que, très singuliers et peu susceptibles d’explication, ils sont d’ailleurs assez rares pour ne pouvoir être constatés autrement que par un ensemble de témoignages, et que ces témoignages, suffisants pour entraîner la conviction, peuvent toujours être rejetés par des esprits prévenus, ou qui, peu attentifs, ne se donnent pas la peine d’en peser la valeur.
Existe-il des combustions humaines spontanées? Telle est la première question qu’examine l’auteur. Cette question, il la résout par l’affirmative. Quinze observations de combustions humaines spontanées, qu’il rappelle successivement, lui permettent, non seulement d’établir la réalité incontestable du phénomène, mais encore de faire connaître les principales circonstances qui accompagnent sa manifestation. Résumant ces circonstances, il faut remarquer:
1°. Que les personnes mortes de combustion spontanée faisaient, pour la plupart, un usage immodéré des liqueurs alcooliques;
2°. Que cette combustion est presque toujours générale, mais qu’elle peut n’être que partielle.
3°. Qu’elle est beaucoup plus rare chez les hommes que chez les femmes, et que les femmes chez lesquelles elle s’est développée étaient presque toutes âgées. Une seule malade était âgée seulement de 17 ans, et la combustion chez elle ne fut que partielle;
4°. Que le corps et les viscères ont été constamment brûlés, tandis que les pieds, les mains, et le sommet du crâne, ont presque toujours échappé à la combustion.
5°. Quoiqu’il soit démontré qu’il faut plusieurs voies de bois pour incinérer un cadavre par la combustion ordinaire, l’incinération s’opère dans les combustions spontanées sans que les objets les plus combustibles placés dans le voisinage soient brûlés. Dans une observation très singulière, par la coïncidence d’une double combustion spontanée opérée sur deux personnes réunies dans une même chambre, on a vu cette double combustion ne pas produire celle de l’appartement ni des meubles.
6°. Il n’est pas démontré que la présence d’un corps enflammé soit nécessaire pour développer les combustions humaines spontanées; tout porte à croire le contraire.
7°. L’eau, bien loin d’éteindre la flamme, semble lui donner plus d’activité; et, quand la flamme a disparu, la combustion continue à s’opérer.
8°. Les combustions spontanées se sont montrées plus fréquemment en hiver qu’en été.
9°. On n’a point obtenu de guérison de combustions générales, mais seulement d’une partielle.
10°. Ceux qui éprouvent une combustion spontanée sont en proie à une chaleur interne très forte.
11°. La combustion se développe tout à coup, et consume le corps en quelques heures.
12°. Les parties du corps qui n’en sont point atteintes sont frappées de sphacèle.
13°. Chez les individus atteints de combustion spontanée, il survient une dégénérescence putride qui amène aussitôt la gangrène.
14°. Le résidu de cette combustion se compose de cendres grasses et d’une suie onctueuse, l’une et l’autre d’une odeur fétide qui se trouve également répandue dans l’appartement, qui en imprègne les meubles et qui frappe l’odorat à une grande distance.
L’auteur expose ensuite les deux théories de la combustion qui partagent actuellement le monde savant: celle de Lavoisier, et celle qu’a proposée M. Berzelius dans ces derniers tems. Il passe alors aux théories proposées pour l’explication du phénomène qu’il a spécialement en vue.
La plupart des auteurs qui se sont occupés des combustions spontanées ont cru voir une relation intime entre leur manifestation et l’usage immodéré que faisaient des substances spiritueuses les individus qui en étaient atteints. Ils pensent que ces liqueurs, se trouvant continuellement en contact avec l’estomac, pénètrent à travers les tissus, et les imbibent jusqu’à saturation, de manière qu’il suffit ensuite de l’approche d’un corps enflammé pour en déterminer la combustion.
M. Julia-Fontenelle ne croit pas qu’on puisse s’arrêter à cette explication.
Il se fonde 1° sur ce que rien ne démontre la réalité de cette prétendue saturation des organes chez les personnes abandonnées à l’usage des boissons spiritueuses; 2° sur ce que cette saturation elle-même ne suffirait pas pour rendre le corps humain combustible; et, pour démontrer cette assertion, il donne le résultat de plusieurs expériences, dans lesquelles il a vainement tenté de rendre inflammable de la chair de bœuf qu’il avait laissée plusieurs mois tremper dans de l’eau-de-vie, et même dans de l’alcool ou dans de l’éther.
Une autre explication des combustions humaines a été proposée. M. le docteur Marc, et avec lui plusieurs autres médecins, d’après le développement de gaz hydrogène qui a lieu en plus ou moins grande quantité dans les intestins, ont été portés à croire qu’une telle formation devait avoir lieu dans les autres parties du corps, et que ce gaz pouvait prendre feu par l’approche d’un corps enflammé, ou bien par une action électrique produite par le fluide électrique qui se serait développé chez les individus ainsi brûlés. D’après cela MM. Lecat, Kepp et Marc supposent, chez les sujets atteints de combustion spontanée, 1° un état idio-électrique; 2° le développement de gaz hydrogène; 3° son accumulation dans le tissu cellulaire.
Cette dernière manière de voir paraîtrait confirmée par une observation très curieuse de M. Bailly. Ce médecin, faisant, en présence de plus de vingt élèves, l’ouverture d’un cadavre sur tout le corps duquel était un emphysème plus considérable aux extrémités inférieures que partout ailleurs, remarqua que, chaque fois qu’on y faisait des incisions longitudinales, il s’en dégageait un gaz qui brûlait avec une flamme bleue. La ponction de l’abdomen en donna un jet qui produisit une flamme de plus de six pouces de hauteur. Un fait remarquable, c’est que les gaz intestinaux, loin d’augmenter la flamme, l’éteignaient.
M. Julia-Fontenelle, se fondant sur des raisons analogues à celles qui lui ont fait rejeter la première hypothèse, ne croit pas devoir admettre la présence du gaz hydrogène comme cause des combustions spontanées. Il s’appuie, en particulier, sur des expériences dans lesquelles il a vainement tenté de rendre combustibles des tranches de viande fort minces, les tenant pendant trois jours plongées dans du gaz hydrogène pur, dans du gaz hydrogène percarboné, dans du gaz oxide de carbone, ou dans du gaz oxigène.
Enfin, suivant lui, les combustions humaines ne sont point dues non plus à une combinaison de la matière animale avec l’oxigène de l’air, quelles que soient les altérations que cette matière puisse subir;
1°. Parcequ’il ne se développe pas une température suffisante;
2°. Parce qu’en admettant cette combustion comme réelle, le résidu serait un charbon qui ne pourrait être incinéré qu’à une température rouge, tandis qu’au contraire on n’a que do la cendre;
3°. Parce que l’un des produits des combustions humaines spontanées est une substance onctueuse, que ne donne jamais la combustion des substances animales;
4°. Parce qu’elle ne produit presque point de produits ammoniacaux, tandis qu’il s’en produit toujours dans toute combustion animale.
Après avoir ainsi rejeté toutes les hypothèses proposées jusqu’ici, M. Julia-Fontenelle en conclut que ce phénomène est le résultat d’une décomposition interne, et est tout-à-fait indépendant de l’influence des agens extérieur; nous reproduiront textuellement ses conclusions:
“Nous regardons, dit-il, ce qu’on nomme combustions humaines spontanées, non comme de véritables combustions, mais comme des réactions intimes et spontanées qui sont dues à des produits nouveaux auxquels donne naissance une dégénérescence des muscles, tendons, viscères, &c. Ces produits en s’unissant présentent les mêmes phénomènes que la combustion, sans dépendre aucunement de l’influence des agens extérieurs, soit en admettant l’effet des électricités opposées de Berzélius, soit en citant, par exemple, l’inflammation de l’hydrogène par son contact avec le chlore, l’arsénic, ou l’antimoine en poudre, projetés dans ce dernier gaz, &c.
“On pourrait m’objecter cependant que quelle que soit la cause qui détermine cette combustion, le calorique dégagé doit être considérable, et, par conséquent, incendier tous les objets voisins. Nous répondrons à cela que toutes les substances combustibles ne dégagent pas, bien s’en faut, une égale quantité de calorique par la combustion. Davy a démontré qu’une gaze métallique ayant 160 trous par pouce carré, et faite avec un fil de 1-60 de pouce de grosseur, se laisse traverser, à la température ordinaire, par la flamme du gaz hydrogène, tandis qu’elle est imperméable à celle de l’alcool, à moins que la gaze ne soit très fortement chauffée. D’après le même chimiste, une gaze chauffée au rouge laisse passer le flamme du gaz hydrogène sans se laisser traverser par le gaz hydrogène percarboné. Il est probable, d’après cela, que les produits dus à la dégénérescence du corps peuvent être combustibles, sans cependant dégager autant de calorique que les autres corps combustibles connus, et sans laisser de résidu comme ces deux derniers gaz; et, en dernière analyse, nous pensons que, chez quelques sujets, et principalement chez les femmes, il existe une diathèse particulière, laquelle, jointe à l’asthénie qu’occasionnent l’âge, une vie peu active, l’abus des liqueurs spiritueuses, peut donner lieu à une combustion spontanée. Mais nous sommes loin de considérer comme cause matérielle de cette combustion ni l’alcool, ni l’hydrogène, ni une surabondance graisseuse. Si l’alcool joue un rôle principal dans cette affection morbifique, c’est en contribuant à sa production, c’est-à-dire à produire, avec les causes précitées, cette dégénérescence dont nous avons parlé, laquelle donne lieu à de nouveaux produits très combustibles, dont la réaction détermine la combustion du corps.
“Il est fâcheux que les observations publiées jusqu’ici ne soient pas plus complètes. Nous nous proposons de recueillir tout ce qui sera propre à nous éclairer sur un sujet si important pour la médecine légale.”
M. Moreau de Jonnes commence la lecture d’un mémoire intitulé; “Recherches de géographie botanique sur le maïs (ou bled-d’inde), la synonymie de cette céréale, son pays originaire, l’étendue de sa culture, et son antiquité chez les peuples aborigènes du Nouveau-Monde.”
L’auteur a pour but de prouver: 1°. que le maïs était cultivé en Amérique à l’époque de la découverte du Nouveau-Monde; 2° que ni les Arabes, ni les Romains, ni les Grecs ne l’ont jamais connu dans l’ancien continent, et qu’en particulier la plante d’Afrique que quelques auteurs ont regardée comme identique au maïs n’était autre qu’une espèce particulière de millet. Ces différents points une fois établis, M. Moreau de Jonnès se propose de chercher quelles lumières peut fournir l’étude archéologique du maïs relativement à l’histoire de l’Amérique avant là conquête. Ce sera l’objet d’une seconde lecture dont nous entretiendrons nos lecteurs.—(Journal Français.)

Nous voyons disparaître si rapidement les tribus sauvages de dessus le sol de l’Amérique, que nous avons à craindre qu’il ne reste pas même l’idée d’aucune de leurs langues, après quelques siècles. Mais, serait-ce donc une si grande perte? Sans doute: la perte d’une langue n’est pas une chose de si petite conséquence, que les savans ne puissent et ne doivent la regretter. On regrette tous les jours qu’on ne puisse découvrir le sens d’un écrit carthaginois qu’on dit être conservé dans une bibliothèque d’Europe. Dans quelques siècles d’ici, les savans chercheront peut-être en vain quelques traces des langues qui ont été si longtemps parlées en Canada. Si l’on regrette déjà que nous laissions perdre les anciens noms de nos lacs, rivières, montagnes, &c. pour y suppléer par des nouveaux, que sera-ce, si par notre négligence, nous laissons éteindre toute idée de ces langues? C’est cette réflexion d’un de vos écrits dans votre savante et intéressante Bibliothèque Canadienne,[1] Mr. Bibaud, qui m’a donné la pensée de vous adresser un court précis de la logique du langage mikmaque, invitant ceux qui ont quelques connaissances dans les autres langues sauvages à en faire autant. Ces précis doivent être extrêmement courts, puis qu’ils ne sont en partie que pour satisfaire la curiosité des savans, qui aiment à avoir quelques idées même des langues qu’ils ne parlent point. Les préjugés que l’on conserve contre les tribus sauvages, à cause de leur manière de vivre, qui est si éloignée de nos coutumes; la rebutante malpropreté de plusieurs de leurs familles; la vie vagabonde et fainéante de plusieurs d’entr’eux, principalement de ceux qui courent les côtes nord et sud du fleuve St. Laurent, depuis Gaspé jusqu’à Québec, et qui ne sont souvent que de vils rebuts, chassés par sentence des chefs, des villages qu’ils déshonorent par leur mauvaise conduite; tout cela nous porte naturellement à croire que ces peuples ne peuvent rien posséder qui mérite le moins du monde la plus légère attention en leur faveur. Mais, ici comme ailleurs, il paraît que l’auteur des langues se plaît à confondre la vanité des superbes, en donnant des langues si riches, si énergiques, si abondantes, à des peuples que nous croyons si méprisables. Un avantage que pourrait nous procurer, un jour, ces analyses des langues sauvages, c’est qu’on parviendra peut-être à les comparer avec les langues des peuples du nord de l’Asie, et qu’on pourra découvrir par là un problème qui nous est encore caché; c’est-à-dire d’où viennent les anciens habitans de l’Amérique; de quels peuples sont-ils descendus? Et en interrogeant l’histoire de ces peuples, on pourra peut-être découvrir à quelle époque cette partie du globe terrestre a commencé d’être habitée. Comme ces prétentions paraîtront peut-être chimériques à quelques uns, hâtons-nous de leur prouver qu’elles ne sont pas si vaines. D’après les relations des missionnaires jésuites, sagma, au Japon, signifie empereur; chez les Mikmaques, sagma est le pluriel de sagmau, et signifie chef ou prince. Sanyapsi, d’après les mêmes relations, signifie les pénitens; et anyapsi chez les Mikmaques, veut dire, je fais pénitence. Combien d’autres ressemblances ne pourrions-nous pas trouver, si nous étions à même de puiser dans les langues orientales? Je ne parlerai point des mœurs, des usages, de la physionomie de nos sauvages, et même de quelques parties de leurs habillemens; tous les voyageurs s’accordent à dire, dans leurs relations, qu’ils ont les plus grands rapports avec les peuples d’au-delà de l’océan Pacifique: quelques uns même prétendent qu’on a rencontré chez eux des sauvages du Canada. Mais enfin, quoiqu’il en soit, Mr. Bibaud, si vous jugez que mon ouvrage n’ennuie point trop vos lecteurs, je vais commencer.
Les sauvages Mikmaques distinguent deux genres dans leur langue: le genre noble pour les choses qui ont vie, et le genre ignoble pour les choses qui en sont privées. Ces deux genres influent non seulement sur les noms et les adjectifs, mais encore sur les verbes, comme nous le verrons.
Ils ont deux nombres, le singulier et le pluriel, pour les noms, adjectifs et pronoms; mais ils ont de plus le duel pour les verbes. Ils ont deux temps, le présent et le passé, pour les noms et adjectifs. Ils n’ont pas de pronoms possesifs, mais ils emploient l’initiale des pronoms personnels, avec une désinence particulière de leurs noms, pour exprimer la possession d’une chose. Il faut au moins un exemple pour éclaircir ces règles.
Les pronoms dont on prend l’initiale sont nil, je ou moi; kil, toi; oula, cela; kinou et ninen, nous; kilau, vous; ouaguela, ces choses. (Négueum, ou négom signifie, lui, elle; néguela, eux, elles). On dira donc, n’ousse, (e final muet,) mon père; k’ousse, ton père; oussel ou ouss’l, son père; n’oussinou, ou n’oussinen, notre père; k’oussionau, votre père; oussioinal, leur père . . . Au temps passé, on dira, n’oussak, mon père; n’oussinak’, nos pères; et de plus, en parlant des absents, on dira, n’oussi-ouo-ouak’. Il faut observer que le k’ accentué final ne se prononce pas; il est comme nos s au pluriel: dans le corps du mot, il ne se prononce pas non plus, mais il marque une forte aspiration, et a quelque rapport avec notre h aspirée.
Avant de passer plus loin, faisons remarquer la différence entre ninen et kinou. Cette différence est remarquable, le premier s’emploie quand on adresse la parole à une personne distinguée de celles qui parlent: des sauvages parlant à des Français, diront: ninen elnouiek; nous sommes sauvages, ou plutôt hommes;[2] mais en parlant entr’eux, ils diront: kinou elnouikou. On aurait bien des langues savantes à parcourir avant de trouver une distinction si délicate et ci bien raisonnée.
Au passé, les noms propres se terminent en ok; comme Piel, Pielok, Pierre: les nobles en ak; comme, n’oussak, mon père; les ignobles en ek, comme, oulagan, oulaganek, plat. C’est un beau plat, oula oulagan kelougit; c’était un beau plat, oula oulaganek keloulkebenek.
La marque du pluriel dans les noms nobles est k’, mais, ce k’ exige quelquefois le changement des lettres finales du mot: epit, une femme, epigik, des femmes; sagmau, un chef, sagmak’, des chefs. Dans les noms ignobles, le pluriel est en al, il, el, oul: m’kechen, un soulier, m’kechenel, des souliers. Cette l finale se prononce comme dans le mot anglais able.
Chich au bout d’un mot annonce un diminutif: pibenaskaw, un pain; pibenacanchich, un petit pain. K’chi devant le mot a un effet contraire: pattiach, un pêtre, k’chipattiach, un évêque: chabéouit, sage, k’chichabéouit, très sage.
Je ne parlerai point de leurs pronoms, qui suivent en tout les mêmes règles que les noms, comme, tan, lequel, pluriel, tanit, tanak, au passé noble, tanek, au passé ignoble; tanel, présent ignoble singulier, et tannkel, pluriel.
La langue mikmaque peut passer pour une des langues les plus riches en verbes; tous les noms et adjectifs sont susceptibles de devenir verbes: koundeau, pierre; koundeoui, je suis pierre. Ils ne peuvent même souvent exprimer les noms que par quelques personnes de leurs verbes, comme, un sage, chabéouit; il est sage, celui qui est sage: le créateur, kijoulk, il nous a crées; le sauveur, ouchtaoulk, celui qui nous a sauvés; le père, ouégouigit, il est père &c.
On distingue les conjugaisons par le présent de l’indicatif: il y en a en i comme kelougi, kelougin, kelougit, je suis, tu es, il est beau, (en prononçant lou long; en le prononçant bref, il signifie, je parle); d’autres en aye, eyr, em, ou, &c. Je n’entrerai point dans ces divisions; je me contenterai de donner un temps avec ses personnes, et ensuite la première personne singulière des autres temps.
| Indicatif Present. | Sing. | Amalkaye, je danse, amalkau, tu danses, amalkal, il danse. |
| Duel. | Amalkaykou (kinou), nous dansons; amalkayek (ninen), nous dansons; amalkayok, vous dansez; amalkaldigik, ils dansent. | |
| Plur. | Amalkaldikou (kinou) nous dansons; amalkaldiek (ninen), nous dansons; amalkaldiok’, vous dansez; amalkaldigik, ils dansent. | |
| Imparfait. | Amalkayep, je dansais. | |
| Parfait. | Kigi amalkayep, j’ai dansé. | |
| Plus que parfait. | Kichkigi amalkayep, j’avais dansé. | |
| Futur. | Amalkadech, je danserai. | |
| Fut. passé. | Kigi amalkadech, j’aurai dansé. | |
| Second présent. | Amalkanel, lorsque je danse. | |
| Second passé. | Amalkanek, lorsque je dansais. Ce temps est susceptible de prendre kigi et kichkigi, lorsque j’ai, j’avais dansé. | |
| Impératif. | Amalka, danse. | |
| Subjonctif. | présent. | N’t amalkau, que je danse. Ce temps prend l’initiale des pronoms; mais si le verbe commence par une voyelle, ils ajoutent un t. Nous faisons la même chose dans la phrase interrogative, Y a-t-il? |
| Imparfait. | Amalkag, je danserais. | |
| Plus que parfait. | Amalkacben, j’aurais dansé. | |
| Plus que parf. cond. | Amalkachen, si j’avais dansé. | |
| Infinitif. | Duel. | Amalkamk, danser, ou danse. |
| Plur. | Amalkaldemk, danser, ou danse. |
Tous les temps du verbe reviennent à l’infinitif: il serait trop long de les donner. Ces temps peuvent se rendre en français par on; comme, on a dansé, on aurait dansé. Le gérondif, amalkamkel, amalkaldimkel, en dansant.
La plupart des verbes, (peu excepté, comme amalkaye), subissent une contraction dans les temps futurs, et même aux secondes personnes de l’impératif: chaktem, j’obéis, chk’ettech, j’obéirai; chk’eten, obéis. Mais ce serait manquer au génie de cette langue de ne point parler des désinences en chenek, chebenck; chenik, chebenik; chenika, chebenika. Les troisièmes personnes duelles et plurielles des temps passés se terminent ainsi, de même que les adjectifs qui se rapportent à ces terminaisons; ce qui donne aux Mikmaques une grande facilité de rimer les phrases de leurs discours, qu’ils partagent avec une telle mesure, que ces phrases rimées paraissent cadencées, et ont une espèce de rithme qui leur donne l’air et la grâce de la poésie.
La négation influe sur les verbes; comme, mou amalkau, je ne danse pas; mou amalkaun, tu ne danses pas; mou amalkaut, il ne danse pas, &c.
Un verbe en mikmaque exprime par ses différentes désinences, toutes les relations auxquelles il peut avoir rapport; par exemple, nemideguei, je vois, signifie l’action de voir en général: mou nemidegau, je ne vois pas. Si l’on ajoute un régime du genre ignoble, on dit, nemidou, je vois cela, cette chose; mou nemidou, je ne vois pas. Avec un régime noble, nemik, je le vois; mou nemiouk, je ne le vois pas.
Le verbe réfléchi, nemichi, je me vois; mou nemichiou, je ne me vois pas: le passif nemikougi, je suis vu; mou nemikougiou, je ne suis pas vu. Le verbe réciproque mental, qui fait connaîtra que l’action se passe dans l’esprit ou l’imagination, nemidelchi, je crois voir; mou nemidelchiou, je ne crois pas voir: elnoui, je suis homme; elnouidelchi, je me crois homme. Le verbe personnel mental, qui exprime que l’action est modifiée en quelque chose dans la pensée: nemidagi, je vois dans ma pensée; mou nemidagiou, je ne vois pas dans ma pensée. Eliei, je vais; elidagi, je vais de la pensée, ou je convoite, je désire. On voit qu’il serait long de conjuguer un verbe en entier, d’après toutes ses désinences; mais ce sont ces désinences qui rendent cette langue si riche, et qui donnent occasion aux sauvages d’exprimer tant de choses en si peu de mots: par exemple, tepchei, j’écoute; tepchedem, j’écoute cela; ouèlei, je suis bien; de ces deux mots on forme ouelchedem, j’écoute cela avec plaisir. Atkaye, je demeure; atkadem, je demeure en un lieu; kejaloueï, j’aime; de ces deux mots on forme, kejatkadem, j’aime à demeurer en tel lieu. Ouelkadem, signifierait la même chose; ou, je demeure avec plaisir en un lieu. Avec tedli, adverbe qui signifie, où, ici, on forme tedlakadem, je demeure ici: en sorte que ces deux mots, kejatkadem, tedlakademen, signifient littéralement, j’aime à demeurer là où tu de demeures.
Mais comme les Mikmaques ont une manière très singulière d’exprimer le pronom régime des verbes, il faut en parler avant de terminer ce précis des règles de leur langue. Il n’y a que la désinence du verbe qui fasse connaître ces pronoms personnels régimes; car d’ailleurs ils ne sont aucunement exprimés. Il sera donc assez curieux de lire un temps de cette espèce de verbe.
Nemoul, je te vois; nemoulok’, je vous vois, il vous voit, ils vous voient: nemichk, il te vois; nemoulek, nous te, nous vous voyons: nemichkik, ils te voient: nemin, tu me vois; nemiek, tu nous vois, vous nous voyez: nemit, il me voit: nemoulk (kinou); neminamet (ninen), il nous voit: nemiok’, vous me voyez; nemigik, ils me voient: nemoulkouik, neminamegik, ils nous voient: nemik, je le vois; nemit, tu le vois; nemiagel, il le voit: nemikou, nemiket, nous le voyons; nemiok’, ils le voient vous le voyez; nemiatigel, ils le voient.
Le régime indirect s’exprime de la même manière: Eouikemoul, je t’écris; mais il y a encore une désinence pour faire accord avec le régime direct pluriel: ce que je t’écris, tan eouikemoul; les choses que je t’écris, tanel eouikemoulanel: j’aime Dieu, kijoulk kejaln; j’aime Dieu par-dessus toutes choses, kijoulk m’chet kok’oual pagigiou-k’chalnanel.[3] Le mot pagigiou, plus, occasionne la contraction du verbe. On voit que cette langue ne marche pour ainsi dire que par verbes. Si l’ou a un nom pour régime d’un verbe, et qu’il y ait moyen d’y suppléer par un verbe, il ne faut pas manquer de l’employer: ainsi, j’écoule avec plaisir ton chant, se tourne par, j’écoute avec plaisir comme tu chantes; ouelchedem deli-n’toun.
On peut conclure, d’après les différentes désinences de leurs mots, que les sauvages se permettent souvent des inversions pour rendre leurs phrases plus élégantes; et pour cela, lorsque le sujet et l’objet du verbe sont de la troisième personne, le régime prend une désinence qui fait connaître que le verbe le gouverne: Dieu a dit au pécheur, ou à celui qui pèche, kijoulk elachenel padanntouligel; ou, padanntouligel elachenel kijoulk: le Seigneur a parlé au Seigneur, Sagmau elachenel Sagmamel; ou, Sagmau Sagmamel elachenel.
Voici la manière d’exprimer le génitif, ou la possession d’une chose: Le Dieu des Dieux, Nixkamk ou’nixkamoual; Dieux leur Dieu.
Mais en voila suffisamment, je pense, pour satisfaire la curiosité des gens de lettres, sans être trop à charge à ceux qui ne se soucient pas d’acquérir la moindre connaissance de la logique d’une langue qui les intéresse peu, et qui pourraient peut-être m’accuser de vouloir les faire parler mikmaque malgré eux. Votre, &c.
J. M. B.
|
Tome V, Numéro III, Pages 108 et suivantes. |
|
Les sauvages s’appellent exclusivement hommes dans leurs langues: ils appellent les Français ouenous, qu vient de oubek einou, homme blanc; anglecio elnou, homme anglais, &c. |
|
Cette phrase fournit un exemple de leur amour pour la rime. |

Que j’aime la mythologie
Du chantre d’Achille et d’Hector!
Qu’il a de grâce et de magie!
Tout ce qu’il touche devient or.
Tour-à-tour gracieux, terrible,
Voyez sortir de son pinceau,
De Polyphème l’antre horrible.
Et la grotte de Calypso.
Toujours neuf, sans être bizarre,
Créant ses héros et ses dieux,
Que loin des gouffres du Tartare
Son vaste Olympe est radieux!
De Neptune frappant la terre,
Le trident s’ouvre les enfers.
Tes noirs sourcils, dieu du tonnerre.
D’un signe ébranlent l’univers.
Je m’attendris au doux sourire
Qu’Andromaque a mouillé de pleurs.
Le dieu qui foudroyait soupire.
Et l’Ida se couvre de fleurs.
Du ton naïf heureux modèle,
Qu’Homère est doux, intéressant.
Quand d’Ulysse le chien Adèle
Expire en le reconnaissant!
Il embellit la fureur même,
Quand son Achille est sans pitié;
On frémit, on admire, on aime
Le bras vengeur de l’amitié.
Homère au soleil de la Grèce
Emprunte ses plus doux rayons;
Mais Ossian n’a point d’ivresse;
La lune glace ses crayons.
Sa sublimité monotone
Plane sur de tristes climats:
C’est un long orage qui tonne
Dans la saison des noirs frimats.
Parmi les guerrières alarmes,
Traînant son lecteur aux abois,
Il parle d’armes, toujours d’armes
Il entasse exploits sur exploits.
De mânes, de fantômes sombres,
Il charge les ailes des vents;
Et le souffle des pâles ombres
Se mêle au souffle des vivants.
Il n’a point d’Hébé, d’ambroisie,
Ni dans le ciel ni dans ses vers:
Sa nébuleuse poésie
Est fille des rocs et des mers.
Son génie errant et sauvage
Est ce diable qui, dans Milton,
S’en va de nuage en nuage
Roulant jusques au Phlégéton.
Vive Homère! que Dieu nous garde
Et des Fingals et des Oscars,
Et du sublime ennui d’un barde
Qui chante au milieu des brouillards!
M. LE BRUN.

Les gens de lettres, pour se délasser de la fatigue des travaux littéraires, se sont créés des amusemens souvent bizarres.—Caton s’ennivrait pour se reposer des soins du gouvernement; et Seneque conseille cette petite distraction aux écrivains qui travaillent beaucoup!—Socrate et Henri IV jouaient avec leurs enfans.—Tycho-Brahé s’amusait à polir des verres de lunettes. Barclay était homme de lettres le matin, et jardinier le soir. Balzac se plaisait à dessiner.—Rohaut et le comte de Caylus couraient les boutiques, pour voir travailler les ouvriers—Hugh Blair et le grand Arnaud se délassaient en lisant des romans. Montaigne se vante d’avoir trouvé une agréable société dans son chat. Scipion aimait la danse, et le cardinal de Richelieu trouvait le plus grand plaisir à sauter par-dessus un mur.
La prison ne trouble pas toujours l’homme de lettres dans ses travaux.—Boece était dans les fers, lorsqu’il composa son excellent ouvrage sur les consolations de la philosophie.—Grotius écrivit en prison son commentaire sur St Mathieu.—Buchanan produisit, dans le donjon d’un monastère de Portugal ses belles paraphrases sur les Psaumes de David. Pelisson, pendant les années de son emprisonnement, poursuivit avec ardeur ses études de grec, de philosophie, de théologie, et fit divers bons ouvrages.—Cervantes composa la plus grande partie du Don Quichotte, pendant sa captivité en Barbarie.—Louis XII, lorsqu’il était duc d’Orléans, fut longtemps renfermé dans la tour de Bourges: il s’y appliqua aux études, et dut à cette circonstance d’être un monarque éclairé dans un siècle ignorant.—Marguerite, femme de Henri IV, ayant été renfermée au Louvre, y composa une très judicieuse apologie des irrégularités de sa conduite. Charles I, roi d’Angleterre, fit, pendant sa détention, le Portrait d’un Roi, ouvrage estimable, qu’il adressa à son fils.—Howell composa presque tous ses ouvrages dans la prison de Fleet: il dut à la fertilité de sa plume le moyen de subsister doucement dans les fers; et ses livres sont pleins de tant d’agrémens, qu’on ne se douterait guère qu’ils ont été faits en prison.—Le savant Selden, arrêté pour avoir attaqué les dîmes ecclésiastiques et les prérogatives de la noblesse et des rois prépara ses meilleurs ouvrages pendant sa détention.—Le cardinal de Polignac avait formé le plan de l’Anti-Lucrèce, où il réfute les argumens des sceptiques; mais ses occupations publiques l’empêchaient toujours d’exécuter ce grand dessein. Deux exils lui laissèrent heureusement des loisirs; et l’Anti-Lucrèce fut le fruit des disgrâces de son auteur.—C’est dans l’exil que J. B. Rousseau composa son Ode au comte Duluc, le chef-d’œuvre du genre lyrique. Enfin, la Henriade fut esquissée, et en grande partie terminée, par Voltaire, pendant son incarcération à la Bastille.—Plusieurs bons ouvrages furent composés dans les prisons, sous le règne de la terreur.
Il y a eu aussi des morts poétiques et grammaticales.—L’empereur Adrien fit en mourant cette célèbre apostrophe à son âme, qui a été si heureusement traduite par Pope.—Lucain ayant reçu de Neron l’ordre de mourir, se fit ouvrir les veines, et expira en récitant un passage de sa Pharsale, où il avait décrit la mort d’un soldat blessé.—Chaucer dit adieu à toutes les vanités humaines, dans une pièce intitulée: Ballade faite par Geoffroi Chaucer, sur son lit de mort.—Pendant que des fanatiques déchiraient Corneille Dewith en lambeaux, ce grand homme s’éteignait en récitant la troisième ode du troisième livre d’Horace, qui contient des sentimens conformes à la situation où il se trouvait.—Gilbert, qui fut le plus malheureux, et qui serait devenu le plus grand des poëtes de son temps, mourut en balbutiant une ode sacrée, qu’il composait pendant son agonie.—Metastase fit deux belles stances, quelques minutes avant sa mort.
Les anecdotes qui suivent sont d’une teinte différente.—Le père Bouhours était, comme on sait, un grammairien qui donnait plus d’attention aux mots qu’aux choses. Au moment où il se mourait, il fit venir ses amis, et leur dit, en expirant: Je vais, ou je vas mourir, car l’un et l’autre se disent.—Malherbe, à l’article de la mort, reprochait encore à ses domestiques leurs solécismes, et les reprenait sur des fautes de langue. Son confesseur lui dépeignant les douceurs de l’autre vie avec des expressions triviales, “Ne m’en parlez plus, lui dit-il; votre mauvais style m’en dégouterait.”—Lamotte-le-Vayer aimait beaucoup à s’occuper des pays lointains: il mourut en demandant à ses amis, d’une voix éteinte: Eh bien quelles nouvelles avons-nous du Mogol?—Le mathématicien Lagny étant à l’agonie, et ne reconnaissant plus aucun de ceux qui entourraient son lit, un de ses amis s’avisa de lui demander quel était le quarré de douze? Lagny, qui n’avait plus que le souffle, lui répondit, sans savoir peut-être ce qu’il disait, Cent quarante-quatre; et il rendit l’âme. (Dictionnaire de la Folie et de la Raison.)

Il est inutile de chercher l’origine de la poésie: on la retrouve chez tous les peuples sauvages ou policés. Avant que les hommes passent transmettre à la postérité, les évènemens remarquables de leur temps, en les rédigeant en corps d’histoire, ils en composaient des espèces de poëmes lyriques, qu’ils chantaient à leurs enfans, afin de leur faire aimer la gloire de leur patrie, et de les attacher à elle par une espèce d’orgueil national. C’était aussi par des chants poétiques qu’ils imploraient la divinité, ou la remerciaient de sa munificence. Les premiers monumens de l’histoire hébraïque sont des cantiques sacrés: les poëmes d’Homere nous ont fait connaître les commencemens de la Grèce, et le barde Ossian a été le premier historien des Ecossais. Les Gaules ont eu aussi leurs ardes, qui chantaient au milieu des armées et dans les festins: ces poëtes subsistèrent jusque sous nos premiers rois; mais la poésie proprement dite ne jetta quelques lueurs en France que sous Charlemagne; puis il n’en fut plus question jusqu’au commencement du douzième siècle, que les troubadours ou trouvères, lui rendirent la vie, en allant chanter de tous côtés les belles et les héros.
Abélard, si célèbre par ses amours et par ses malheurs, essaya un des premiers de faire des vers dans le langage vulgaire que l’on parlait en France, de son temps: il chanta cette Heloise qu’il aimait si tendrement, et pour laquelle son sort devint si déplorable. La traduction de la vie d’Alexandre du latin en français fut ensuite commencée par Lambert Licors, et achevée par Alexandre de Paris, qui, pour cet ouvrage même, donna son nom aux grands vers ou vers aléxandrins. Le Roman de la Rose vint plus tard. Sous le règne de Charles V, on vit paraître les chants royaux, les ballades, les rondeaux, les pastorales et les virelais; et Villon, du temps de Louis XI, donna aux vers français un tour plus aisé et plus naturel. Sous Louis XII, Saint-Gelais traduisit l’Odyssée d’Homère, l’Enéide de Virgile et les Epitres d’Ovide.
Arriva le règne de François I: la poësie prit alors une forme à la fois plus régulière et plus gracieuse: on lit toujours avec plaisir les pièces légères de Clément Marot, fruits d’un génie facile, qui devina les grâces convenables à notre langage. A partir de cette heureuse époque jusqu’à Henri IV, la poésie profit que peu de progrès. Enfin Malherbe vint. . . . .
Avec un goût sévère et un esprit qui avait de l’élévation, ce poëte sentit que notre langue manquait de noblesse et de régularité; et c’est à lui donner ce double et précieux avantage qu’il s’attacha dans ses compositions. Boileau n tracé de main de maître cette révolution opérée dans la poésie française.
Enfin Malherbe vint, et le premier en France,
Fit sentir dans les vers une juste cadence:
D’un mot mis à sa place enseigna le pouvoir,
Et réduisit la muse aux règles du devoir.
Par ce sage écrivain la langue réparée
N’offrit plus rien de rude a l’oreille épurée,
Les stances avec grâce apprirent à tomber,
Et le vers sur le vers n’osa plus enjamber.
Tout reconnut des lois; et ce guide fidèle
Aux auteurs de ce temps sert encor de modèle.
Ainsi, sans être un de ces hommes que l’on place au premier rang, Malherbe prépara le beau siècle littéraire de Louis XIV; et la poésie noble n’eut peut-être pas encore paru avec tant d’éclat et de correction, si son goût difficile et son oreille délicate n’eussent trouvé et reconnu le vrai génie de notre langue. (Petit Dict. des Inventions, &c.)

Ce sont des lieux anciennement creusés dans les rochers, ou formés par la nature, qui servent de sépulcre aux Guanches. Leur étendue est plus ou moins grande, suivant la disposition du terrain. Les corps y sont conservés dans des peaux de chèvre, avec des courroies de même matière. Les coutures sont si égales et si unies, qu’on n’en peut trop admirer l’art. Chaque enveloppe est parfaitement proportionnée à la grandeur du corps; mais ce qui parait vraiment surprenant, c’est que ces corps sont presque tous entiers. Ils sont placés dans diverses caves, les uns de bout et les autres couchés sur des lits d’un bois que les Guanches savent rendre si dur, qu’il n’est pas possible de le percer. Embaumés par un procédé qui n’est connu que de ce peuple, les cadavres sont aussi légers que s’ils étaient de paille. Plusieurs voyageurs qui en ont vu qui étaient sortis de leur enveloppe, assurent, qu’on y distingue parfaitement les nerfs, les tendons, et même les veines et les artères, qui paraissent comme autant de petites cordes.
Ce n’est pas sans beaucoup de difficultés que l’on peut parvenir à obtenir des Guanches la permission de visiter leurs cavernes sépulcrales, et l’on s’exposerait au danger de perdre la vie, si l’on risquait de le faire sans leur agrément; car le respect qu’ils ont pour les corps de leurs ancêtres est si grand, que la seule curiosité des étrangers passe chez eux pour une profanation: mais si en raison des services qu’on a pu leur rendre, ils consentent à conduire un étranger dans les tombeaux qui leur sont propres, rien ne peut les décider à laisser voir ceux où sont déposés les corps de leurs rois et des grands hommes qui ont illustré leur pays: si on les presse sur ce point, ils répondent qu’il y a effectivement plus de vingt caves destinées à ces seules sépultures; ruais qu’elles sont inconnues, même parmi eux, a l’exception de quelques vieillards qui sont dépositaires de ce grand secret, et qui ne doivent jamais le révéler.—(Merveilles du Monde.)
|
Naturels de l’île de Ténériffe, dont l’origine n’est pas bien connue. |

Cette source, qui a la propriété de pétrifier les objets avec lesquels elle se trouve en contact, est située au pied d’un rocher de pierre à chaux, à une petite distance de la rivière nommée Nidd. Après avoir coulé pendant l’espace d’environ soixante pieds, elle se divise et s’étend d’elle-même sur le sommet d’un rocher, d’où elle tombe ensuite, de trente ou quarante places différentes, dans un canal qu’on a creusé tout exprès pour la recevoir. Chaque goutte d’eau produit en tombant un son musical, qui provient sans doute de la courbe que décrit intérieurement le rocher, depuis sa base jusqu’à son sommet, qui offre une saillie de quinze pieds. Plusieurs arbrisseaux, parmi lesquels on distingue le semper-vivum, concourent à embellir le spectacle agréable que procure la chute multipliée de cette source.
L’eau qui coule goutte à goutte à travers la cavité du roc, dépose de belles particules de terre nitreuse, qui s’incrustent sur les feuilles, la mousse et les autres objets qu’elle rencontre en tombant. Parmi les pétrifications auxquelles ces diverses incrustations donnent lieu, on remarque de très gros morceaux de mousse, sous les formes les plus curieuses, et des nids d’oiseaux avec les œufs, qui ont pris la consistance de pierre.—Ibid.

Le Métapalo est un arbre qui croît dans les montagnes des Andes, du côté de Tarigagna. Il croît faible et mince, à côté d’un puissant arbre, auquel il sejoint, et le long duquel il monte jusqu’à ce qu’il soit parvenu à le dominer. Alors il élargit sa houpe d’une manière extraordinaire, et jusqu’à dérober les rayons du soleil à l’arbre qui lui servit d’appui. Il se nourrit de sa substance jusqu’à ce qu’il l’ait consumé et détruit, et reste ainsi maître de la place. Alors il devient si gros, qu’on s’en sert pour faire de très grands canots, son bois y étant extrêmement propre, par la quantité de ses libres et sa légèreté.—Ibid.

A notre siècle, épris de beautés fantastiques.
Rappelons un instant les modèles antiques.
Homere le premier arrête nos regards:
C’est un soleil levé sur la route des arts.
Virgile, d’ornemens prodigue avec réserve,
Tient toujours dans ses mains le flambeau de Minerve.
Joignant la pureté de l’ensemble et du trait,
Terence offre des mœurs un fidèle portrait.
Horace, nous donnant le précepte et l’exemple,
Guidé par Apollon nous conduit dans son temple.
Tacite charge encore ses tableaux rembrunis:
Quand il peint les tyrans, ils sont déjà punis.
Mais à l’antiquité restant toujours fidèles,
Nous pouvons parmi nous suivre d’autres modèles.
Par le même génie ils ont été poussés,
Et les anciens par eux sont souvent surpassés.
Le Sophocle français, notre premier grand-homme.
Elève à sa hauteur Pompée, Auguste et Rome.
Racine, qu’Euripide eût nommé son vainqueur,
Seul a su pénétrer tous les secrets du cœur.
La raison et le goût, par le moderne Horace,
En vers législateurs son gravés au Parnasse.
Moliere, successeur du Menandre romain,
D’un regard plus profond sonde le cœur humain.
Et couvrant la raison d’un voile diaphane,
Joint le goût de Térence au sel d’Aristophane.
Inspiré par la grâce et par le sentiment,
Ce La Fontaine, au sein d’un abandon charmant.
Semble même ignorer les trésors qu’il fait naître:
C’est Psyché caressant l’amour sans le connaître.
M. FAYOLLE.

M. Smart, convaincu de l’utilité des toits presque plats, surtout à Londres, et dans d’autres grandes villes, où le terrain a beaucoup de valeur, a imaginé de placer sur les poutres de très fortes lattes, laissant peu d’intervalle entr’elles, et d’établir dessus un lit de briques avec ciment. Ces briques sont recouvertes par un lit de tuiles et maintenues avec du mastic, et leur surface supérieure est enduite de deux couches d’huile de lin, que l’on verse bouillante dessus le toit, qui paraît droit, et a cependant une inclinaison suffisante vers le bord, pour faciliter l’écoulement de l’eau. Le prix de cette toiture est la moitié de celui du plomb; son seul inconvénient est son poids.
Pour construire ce toit, l’auteur fait dans les poutres une incision longitudinale; il coupe au milieu la languette supérieure, et ayant fait une incision presque à l’extrémité de chacune des languettes, il la relève pour former un angle de 10 à 16 degrés avec la pièce principale, et les maintient par un coin placé entre elles.
Un artiste de Boston, nommé Adam Stewart a inventé un instrument auquel il donne le nom de Syrène, dont l’harmonie et l’effet sont, dit-on, prodigieux: il a les touches du piano, avec cette différence, qu’elles sont assez rapprochées pour qu’on puisse en faire vibrer onze à la fois. Le son s’élève à la force de celui d’un grand orgue, et descend jusqu’à la douceur de la flute et de l’harmonica. Il embrasse quatre octaves avec tous leurs demi-tons; et, ce qui étonnera peut-être plus encore, c’est que l’espace qu’il occupe n’est que d’un demi-pied cube, et que son poids n’excède pas quatorze livres.
Cette découverte annoncée a peut-être quelque analogie avec celle déjà connue en France, dont nous avons vu quelque part a description suivante:
“L’auteur a imaginé de monter des tubes en verre et des gobelets en cristal, sur une sorte de piano, et d’opérer à volonté, par un ruban saupoudré de résine et humecté, un frottement sur un ou plusieurs de ces tubes ou gobelets.
“Une pédale sert à mettre le ruban sans fin en mouvement, et les touches du piano font appuyer le ruban et produire des sons très agréables et très forts à toutes les notes correspondantes.”
Mr. Robert Ward, de New-York, a inventé une nouvelle espèce d’obus, auquel il a donné le nom de Torpedo, et dont l’effet doit être des plus destrutifs. Il prétend qu’un petit navire pourra, armé d’une seule pièce de 24, chargée d’un de ces obus, attaquer et détruire le plus fort bâtiment de guerre. La forme de ce projectile est conique; sa basle est armée d’ailes tranchantes, qui lui donnent, au moyen de la force d’impulsion qu’il reçoit, le pouvoir de traverser l’épaisseur du navire dans les flancs duquel il doit éclater; et comme l’explosion sera, à volonté, produite ou simultanément, ou, par une mèche invisible, à feu plus ou moins lent, il sera impossible de se garantir de ses effets. Une souscription était ouverte pour l’achat d’un vieux bâtiment sur lequel on pût faire l’essai de ce nouveau foudre de guerre.—(Journal Français.)

En certain bourg, au bon homme Lucas,
Messire Artus passait un bail à ferme,
Et prétendait au bout de chaque terme,
Outre le prix, avoir un cochon gras.
Pour un cochon, je n’y répugne pas,
Dit le fermier, mais gras, c’est autre chose:
Que sais-je, moi, ce qu’il arrivera;
Le grain, peut-être, ou le gland manquera:
Point ne me veux soumettre à telle clause.
Artus répond que point n’en démordra.
Messieurs, leur dit le notaire équitable,
Vous pouvez prendre un milieu; l’on mettra,
Qu’au sieur bailleur le preneur donnera,
Bon an, mal an, un cochon raisonnable.
La Monnaye.

Nous avons devant nous le détail manuscrit d’un fait remarquable qui a eu lieu récemment dans le comté de Buckingham, (dans la Virginie). En exploitant les carrières d’ardoise de la Rivière James, on a tiré du milieu d’une masse solide de rocher, un morceau d’écorce de pin de huit pouces de longueur, de cinq de largeur, et de trois quarts de pouce d’épaisseur. L’écorce était aussi parfaite et aussi saine, que si elle eût été tout récemment prise de l’arbre, excepté qu’elle était un peu grillée, ternie, et avait, à l’extérieur, une apparence cendreuse, qu’on aurait cru provenir du charbon, ou de l’ambre, et qui était peut-être occasionnée par la mine. Ce morceau d’écorce était enseveli dans le roc, à environ onze pieds de son sommet, et ce roc était lui-même couvert de huit ou dix pieds de terre solide et de glaise, qui probablement n’avait jamais été remuée par la main de l’homme. Il faut que cette écorce ait une grande antiquité. Le propriétaire voulait préserver le lit de roc dans lequel elle reposait; mais il était trop solide et trop dur pour être séparé autrement que par la force explosive de la poudre; et malheureusement la mine le détruisit entièrement, en le brisant en petits fragmens.—(Journal de Richmond.)
Un agent de Mr. Disbrow a employé la perforation, pour avoir de l’eau, à Providence, Etat de Rhode-Island,—avec un entier succès. En un endroit, au bout d’un quai, à quelques centaines de verges du rivage primitif, les travailleurs pénétrèrent d’abord à travers la terre de rapport, ensuite à travers de la fange, à la profondeur de vingt pieds, puis par une prairie marécageuse, d’où il fut tiré d’excellente tourbe; puis par une couche de sable, de petits cailloux et de gravois quartzeux, avec de l’eau imprégnée de couperose et d’arsenic; et finalement, à trois ou quatre pieds plus bas, et à trente-cinq pieds au-dessous du lit de la rivière, par un vignoble fournissant des vignes, des grappes et des semences de raisins, des glands, des noisettes, des graines d’une variété de fruits inconnus; et trouvèrent enfin une source d’eau pure. Ces découvertes excitent beaucoup d’intérêt parmi les curieux.—(Journal de New-York.)
Le 5 Août, comme les travailleurs ôtaient les tuiles de quelques vieilles maisons à Basingstoke, ils découvrirent, pris entre les chevrons, les restes desséchés d’un chat tenant dans sa gueule un rat pareillement desséché. Il paraît que le chat avait sauté sur le rat, et qu’étant tombé dans la situation où il a été trouve, il n’avait pu s’en tirer, et était conséquemment mort de faim. Le temps a desséché les corps des deux animaux comme des momies égyptiennes. Ils sont présentement en la possession de M. Thomas Wainwright, l’ingénieux dessinateur polygraphe de Basingstoke. Ils sont bien dignes de l’inspection des curieux.—(Journal de Londres.)

A Montréal, le 15 du présent mois de Septembre, Mr. Louis Coursolles, de St. Jude, à Dlle. Hélène Dorion, de Montréal;
A Québec, le même jour, Edouard Carron, écuyer, Avocat, à Dlle. Joséphine Deblois;
Au même lieu, le 23, Mr. Nicholas Julien à Dlle. Hélène Fluet.
Le 1er. du présent mois de Septembre, à la Rivière du Loup, Dame Reine Raimbault, veuve de feu A. Gagnon, écuyer, N. P.
Le 7, à St. Jean, Dlle. Marguerite Marchand, fille de Mr. J. G. Marchand, de Plattsburg, âgée de 16 ans;
Le 10, à Montréal, Pierre Huguet-Latour, écuyer, âgé de 56 ans;
Le même jour à St. Laurent, Mr. J. Bte. Herigault, Chirurgien, âgé de 38;
Le 13, à St Valentin, Dame Josephte R. Verboncœur, épouse de Mr. H. Gauvin;
Le 17, à Montréal, Dlle. Sophia Sewell, fille de S. Sewell, écuyer;
Le 21, à Berthier, Mr. G. H. Rolland d’Arminault, N. P. âgé de 24 ans;
Le 23, à Québec, John Goudie, écuyer, Avocat;
Le 24, à Montréal, Elisabeth Catherine Elise Ariane, enfant de Joseph Roy, écuyer, âgée de 3 ans;
Le 30, au même lieu, Mr. J. M. Hupé, âgé de 74 ans.
Printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Mis-spelled words and punctuation have been maintained except where obvious printer errors occur.
[The end of La Bibliothèque canadienne, Tome VII, Numero 4, Septembre 1828. by Michel Bibaud]