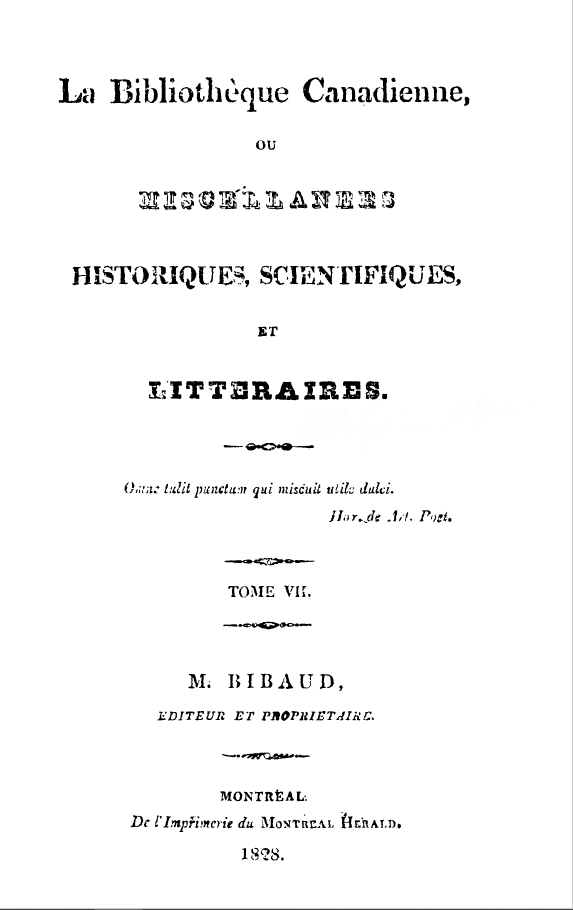
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque canadienne, Tome VII, Numero 2, Juillet 1828.
Date of first publication: 1828
Author: Michel Bibaud (1782-1857) (editor)
Date first posted: Nov. 1, 2021
Date last updated: Nov. 1, 2021
Faded Page eBook #20211101
This eBook was produced by: John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
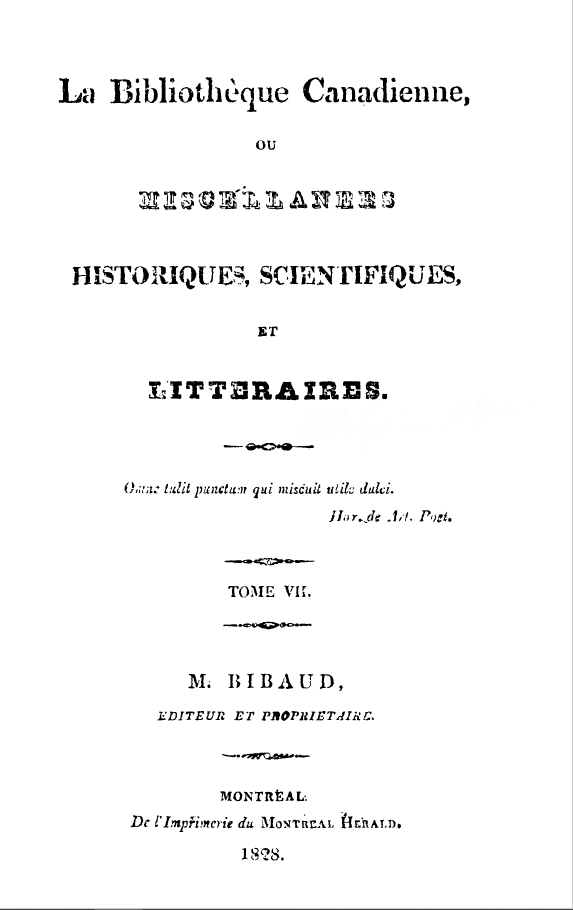
La Bibliothèque Canadienne
| Tome VII. | JUILLET, 1828. | Numero 2. |
Tandis que les sauvages de l’Acadie harcelaient ainsi la Nouvelle Angleterre, MM. d’Iberville et de Serigny se rendaient maîtres du Port Nelson, de la Baie d’Hudson. Ils arrivèrent à l’entrée de la rivière Ste. Thérèse, le 24 Septembre, sur deux vaisseaux, la Salamandre, commandé par le premier, et le Poli, par le second. Ils firent leur débarquement le jour même, et la nuit suivante, quarante Canadiens investirent le fort. Ce fort était une maison quarrée, à laquelle on avait attaché quatre bastions. En ligne de la palissade, il y avait deux autres bastions, dont l’un servait de logement aux officiers: entre les deux était une espèce de demi-lune, où il y avait une batterie de huit pièces de canon de huit, qui battaient sur la rivière, et en bas une plateforme à rez de chaussée, avec six pièces de gros canon. Le corps de la place était muni d’une double palissade, et avait trente-six canons et six pierriers. La garnison était de cinquante-trois hommes; mais le commandant était un marchand, ou traitant, qui n’entendait rien à la guerre.
Le 27, après qu’on eut déchargé du Poli dans la Salamandre tout ce qui était nécessaire pour le siège, les deux commandans voulurent s’approcher du fort; mais les glaces les arrêtèrent un mois entier. Enfin le 28 Octobre, la Salamandre mouilla à un mille au-dessus de la place, et M. d’Iberville fit camper tout son monde à terre.
Le siège commença d’une manière assez triste pour MM, d’Iberville et de Serigny: Chateaugué, ou Chateauguay, leur frère, qui servait sur le Poli, en qualité d’enseigne, s’étant avancé le 4 Novembre, pour empêcher les assiégés de faire une sortie, fut tué d’un coup de mousquet.[1] Depuis le 4 jusqu’au 9, on ne fut occupé qu’à se loger. Le 9, on commença de former les batteries, qui furent en état le 13 à midi. Mais avant de les faire servir, d’Iberville envoya sommer le commandant de se rendre.
Cet officier se voyant sur le point d’être bombardé, manquant de bois, et n’ayant aucune espérance d’en pouvoir faire, si les Français s’obtinaient à passer l’hiver dans leur camp, et surtout ne connaissant rien à l’art militaire, répondit qu’il consentait à livrer sa place, et que le lendemain, il enverrait son lieutenant pour régler la capitulation. Il tint parole: le lieutenant demanda que tous les officiers fussent logés dans le fort pendant l’hiver; qu’on ne touchât ni à leurs hardes ni à leurs papiers, et qu’aussitôt que la navigation serait libre, on les transportât en France, d’où ils auraient la liberté de passer en Angleterre. Tout cela fut accordé: la capitulation fut signée le même jour, et fut exécutée de bonne foi. M. d’Iberville prit possession de la place, le lendemain, et lui donna la nom de Fort Bourbon. Les provisions de bouche qui s’y trouvèrent aidèrent aux Français à passer agréablement l’hiver, qui fut plus rude et plus long que de coutume; mais au printemps, ils furent presque tous attaqués du scorbut: M. de Tilly, lieutenant du Poli, et dix autres Canadiens en moururent. La navigation ne se trouva libre qu’à la fin de Juillet: d’Iberville attendit encore jusqu’au commencement de Septembre, dans l’espérance de faire quelque prise: mais aucun vaisseau anglais ne parraissant, il nomma M. de la Forêt commandant du Fort-Bourbon, et M. de Marigny son lieutenant; leur laissa soixante-quatre Canadiens et six sauvages du Sault St. Louis, et prit la route du Canada, avec ses deux navires. Mais les vents contraires l’ayant retenu longtemps sur les côtes de Labrador, il tourna du côté de France, et arriva à La Rochelle le 9 Octobre.
Cependant l’intérieur de la colonie ne jouissait pas, à beaucoup près, d’un état de tranquilité, ou du moins de sécurité parfaite. Les Iroquois, malgré leurs députations et leurs promesses, se remontraient autour des habitations françaises, et y exerçaient leurs ravages accoutumés. Le comte de Frontenac crut, contre l’avis de bien des gens, que le remède le plus efficace à ces maux était le rétablissement du Fort de Catarocony, projet qu’il n’avait pas perdu de vue, depuis son retour en Canada. Afin d’en hâter l’exécution, il partit pour Montréal, où il arriva le 8 Juillet, escorté de cent-dix habitans des gouvernemens de Québec et des Trois-Rivières. Il leva encore cent hommes de milice, deux cents soldats et deux cents sauvages, dans le gouvernement de Montréal, avec trente-six officiers. Dès que cet armement fut prêt, il se mit en chemin sous la conduite du chevalier de Crisasi. Cet officier montra, dans l’exécution des ordres qu’il avait reçus de son général, une conduite qui lui mérita les éloges de ceux-mêmes qui désapprouvaient le plus l’entreprise. En quinze jours de temps, il fit le trajet difficile entre Montréal et le lac Ontario, et rebâtit le fort de Catarocouy. Son zèle et sa vigilance ne se bornèrent pas là: avant de retourner à Montréal, il envoya quatre-vingts sauvages, divisés en petites troupes,à la découverte de différents côtés, et le résultat prouva que cette mesure de précaution n’était pas inutile. En effet, quarante de ces découvreurs étant allés du côté d’Onnontagué, quelques uns d’entr’eux, qui s’étaient avancés jusqu’à la rivière de Chouaguen, y virent descendre trente-quatre canots d’Iroquois, et ils entendirent même quelques uns de ces sauvages qui se disaient les uns aux autres, que bientôt ils rendraient aux Français et à leurs frères du Sault St. Louis, une visite à laquelle ils ne s’attendaient pas. Les autres partis confirmèrent qu’un grand nombre d’Iroquois étaient en campagne; et tous firent assez de diligence pour donner au gouverneur de Montréal le loisir de mettre ses postes hors d’insulte, et à M. de Frontenac celui de former un corps de huit cents hommes dans l’Isle Perrot.
Les ennemis n’en eurent pas moins la hardiesse de s’avancer jusqu’à Montréal, et de débarquer même par petits pelotons dans cette île, où ils massacrèrent quelques habitans. Sur l’avis qu’en eut le gouverneur général, il jugea à propos de diviser sa petite armée, et de la répartir dans les paroisses pour y couvrir les moissonneurs. Cette disposition déconcerta toutes les mesures des Iroquois. Ne pouvant rien faire par petites troupes, ces barbares s’avancèrent en un corps assez considérable jusque derrière Boucherville; mais ils y furent défaits par M. de la Durantaye; et ainsi finit la campagne dans le centre de la colonie. Les commencemens en avaient été encore plus funestes pour les Iroquois dans les quartiers de l’ouest. M. de Lamotte-Cadillac avait déterminé les sauvages voisins de son poste à faire des courses sur l’ennemi commun: ces sauvages amenèrent un grand nombre de prisonniers à Michillimakinac. Les Iroquois voulurent s’en venger sur les Français, et marchèrent en grand nombre pour contraindre les Miamis à se déclarer contre eux; résolus, s’ils le refusaient, de les chasser eux-mêmes de la rivière St. Joseph, où il y avait une nombreuse bourgade de ces sauvages. Par bonheur, M. de Courtemanche se trouvait dans cette bourgade avec quelques Canadiens, lorsque les Iroquois y parurent: il se joignit aux Miamis, et tomba si brusquement sur les Iroquois, qui ne s’attendaient à rien moins, qu’après en avoir tué et blessé un grand nombre, il obligea le reste à prendre la fuite en grand désordre.
Cet échec leur fut très sensible; mais ils en furent dédommagés par la perfidie d’un chef huron, que les Canadiens avaient surnommé Le Baron. Il avait empêché sous-main les Hurons de Michillimakinac d’aller en guerre comme les autres, et tandis qu’il descendait à Québec avec les députés des sauvages alliés, pour faire au gouverneur général des protestations d’un éternel attachement, il avait envoyé son fils avec trente guerriers qui lui étaient entièrement dévoués, vers les Tsonnonthouans. Ils y conclurent avec ce canton un traité dans lequel ils comprirent les Outaouais; et lorsque cette intrigue éclata, la partie était si bien liée, qu’il fut impossible à M. de Lamotte de la rompre. Tout ce qu’il put faire, ce fut de suspendre l’exécution du traité, du moins de la part des Outaouais.
Une autre chose inquiétait ce commandant: les sauvages de son district se plaignaient depuis longtemps de la cherté des marchandises que leur vendaient les Français. Ne pouvant pas remédier lui-même à ce désordre, dont il était plus à portée qu’aucun autre de voir les suites funestes, il suggéra aux députés qu’il envoyait à Montréal sous un autre prétexte, de présenter un collier pour demander la diminution du prix des marchandises, et d’insister sur ce point comme sur une chose dont ils étaient bien résolus de ne se point départir. Ils le firent, et allèrent même un peu plus loin que ne l’avait prétendu M. de Lamotte: ils parurent devant le comte de Frontenac comme des gens qui proposent la paix ou la guerre; et en lui présentant leur collier, ils ne dissimulèrent point, que s’il ne leur accordait leur demande, ils prendraient leur parti.
Une telle proposition faite avec un air de menace ne pouvait pas être écoutée favorablement, et le collier fut rejetté avec hauteur. Le comte de Frontenac fit aux députés les reproches que méritait leur insolence; mais il sut mêler à propos, parmi les marques de ressentiment, des manières qui laissaient entrevoir plus de bonté que de colère; de sorte qu’il fut aisé aux sauvages de comprendre qu’ils seraient satisfaits sur le prix des marchandises. Mais comme ils s’étaient expliqués de manière à faire juger qu’ils n’étaient pas trop disposés, indépendemment même de cet article, à continuer la guerre, le général leur témoigna une grande compassion de leur aveuglement, qui leur ôtait la connaissance de leurs véritables intérêts. Il ajouta que pour lui il était bien résolu de faire la guerre; qu’il aurait été charmé de voir tous ses enfans se joindre à lui, pour venger le sang d’un grand nombre de leurs frères; mais qu’il n’avait pas besoin d’eux; qu’il ne pouvait mieux les punir de leur indocilité, qu’en leur laissant la liberté de faire ce qu’ils voudraient; qu’ils se souvinssent seulement de l’avis qu’il leur avait donné, que les Iroquois n’auraient jamais d’autre vue, par rapport à eux, que de les détruire, et que l’expérience devait leur avoir appris qu’ils ne cherchaient à les détacher de son alliance, qu’afin de pouvoir venir plus aisément à bout de leur dessein.
Une fermeté si bien assaisonnée étonna les députés, et donna surtout à penser au chef huron; mais elle ne lui fit pas rompre le silence qu’il avait gardé jusqu’alors: il se contenta de dire qu’il n’était chargé d’aucune parole de la part de sa nation; qu’il avait seulement ordre d’entendre ce que son père Ononthio voudrait bien lui dire, afin d’en faire rapport à ses frères. Le gouverneur, qui avait été instruit de toutes ses menées, lui dit qu’il avait beau dissimuler; qu’il le connaissait, et qu’il ne le craignait point. Alors les Outaouais et les Nipissings prièrerent M. de Frontenac d’être bien persuadé qu’ils n’avaient point de part à tout ce que cet homme pouvait faire qui dût lui déplaire: les derniers ajoutèrent qu’ils ne voulaient pas retourner dans leur pays, mais qu’ils étaient résolus de rester auprès de leur père, pour être témoins de l’entreprise qu’il allait exécuter.
Quelque temps auparavant, M. Lesueur avait conduit à Montréal un assez grand convoi de l’extrémité occidentale du lac Supérieur: tandis que M. de Frontenac donnait audience aux sauvages qui l’avaient accompagné, un chef Sciou s’approcha de lui d’un air fort triste, lui appuya ses deux mains sur les genoux, et lui dit, les larmes aux yeux, qu’il le conjurait d’avoir pitié de lui; que toutes les autres tribus avaient leur père, et que lui seul était comme un enfant abandonné. Il étendit ensuite une robe de castor, sur laquelle ayant rangé vingt-deux flèches, il les prit les unes après les autres, nomma à chacune un village de sa nation, et demanda au général de vouloir bien les prendre tous sous sa protection.—M. de Frontenac le lui promit; mais il ne fut pris aucune mesure pour donner suite à cette promesse, et tirer avantage de la démarche du chef Sciou.
M. de Frontenac fit partir un Français avec les députés outaouais, pour avertir M. de Lamotte-Cadillac de la résolution qu’il avait prise de porter incessamment la guerre dans les cantons iroquois. Cet envoyé trouva le commandant de Michillimakinac fort embarrassé: des députés iroquois avaient été reçus par les sauvages de son poste, et en avaient obtenu tout ce qu’ils souhaitaient: non seulement ils avaient conclu un traité de paix avec les Hurons et les Outaouais; ils les avaient encore fait résoudre à s’unir avec les ennemis des Français pour leur faire la guerre. M. de Lamotte s’était donné inutilement bien des mouvemens, pour obtenir d’être présent à leurs conférences; mais Onaské, chef des Outaouais Kiskakons, l’avait instruit de tout ce qui s’y était passé. Il ne restait plus qu’à déconcerter ces intrigues; et la chose devint encore plus difficile après le retour des députés, qui avaient été à Montréal, et pendant l’absence desquels tout ceci s’était tramé. Ces députés publièrent, en arrivant, que tous les Français étaient morts, c’est-à-dire que tout pour eux était désespéré: ils assurèrent en particulier qu’ils n’osaient paraître sur mer: qu’ils n’avaient ni vin, ni eau de vie, et qu’eux-mêmes revenaient avec les mêmes chemises qu’ils avaient portées à Montréal, Ononthio ne s’étant pas trouvé en état de leur en donner d’autres.
Dans cette extrémité, M. Lamotte ne se déconcerta point; le Français qui était venu avec les députés loi ayant remis les lettres du gouverneur, par lesquelles il apprit les avantages remportés depuis peu par les Français sur les Iroquois, il eut soin de les faire beaucoup valoir, surtout l’action de M. de la Durantaye auprès de Boucherville. Il déclara ensuite que malgré la disette des marchandises, causée par le retardement des vaisseaux de France, que les vents contraires, et non la crainte des Anglais, avaient empêchés d’arriver aussitôt que de coutume, il donnerait tout ce qu’il lui en restait dans ses magazins au même prix où elles avaient toujours été, et qu’il les donnerait même à crédit.
Cette proposition eut un bon effet: Onaské et quelques autre émissaires du commandant s’en prévalurent pour faire ouvrir les veux aux plus échauffés, sur les conséquences des démarches qu’ils venaient de faire; et lorsque M. de Lamotte les vit ébranlés, il les assembla. Il leur dit, que pour peu qu’ils voulussent réfléchir sur tout ce qui s’était passé depuis qu’il était parmi eux, ils reconnaîtraient que ce n’était point lui qui les avait trompés, ainsi qu’ils s’en étaient plaints, mais qu’ils s’étaient laissé séduire par de mauvais esprits, dont ils auraient dû se défier. S’appercevant que ce reproche les avait touchés, il jugea qu’il serait inutile de leur faire un plus long discours, et sans leur laisser le temps de se consulter, il leur proposa d’envoyer plusieurs partis contre les Iroquois, qui étaient actuellement en chasse avec les Hurons et quelques Outaouais.
A peine le commandant eut-il cessé de parler, qu’Onaské, Ouilamek, chef Poutéouatami, et en Algonquin, nommé Mikinac, se déclarèrent chefs de l’entreprise, et rassemblèrent aussitôt un nombre considérable de guerriers. Ils coururent de suite chercher les Iroquois: on se battit avec acharnement sur le bord d’une rivière; mais à la fin, les Iroquois furent obligés de se jetter à la nage pour se sauver. Les vainqueurs amenèrent à Michillimakinac trente-deux prisonniers, et y aportèrent trente chevelures, avec un butin d’environ cinq cents peaux de castor. Plusieurs Hurons étaient du nombre des prisonniers; on les remit entre les mains de leur tribu, qui parut très sensible à cette déférence.
Après un coup de cet éclat, il n’y avait pas à craindre que les Outaouais s’accommodassent, au moins de sitôt, avec les Iroquois. “Telle est,” dit Charlevoix à cette occasion, “la déplorable condition de ceux qui ont à gouverner des barbares sans foi et sans principes d’honneur, de ne pouvoir jamais compter sur leur parole et de ne trouver souvent d’autre moyen d’éviter d’être les victimes de leur perfidie, que dans leur facilité même à trahir leur serment, sans autre motif que leur légèreté naturelle. Les Outaouais venaient de violer le foi qu’il nous avaient si souvent jurée; de nouveaux sermens les avaient attachés aux Iroquois, et ils redeviennent sur le champ leurs ennemis!” L’histoire des peuples civilisés, surtout celle des révolutions, des guerres et des interventions militaires du commencement de ce siècle, prouve que cette remarque n’est pas exclusivement applicable à des barbares à des sauvages.
Quelque temps après le combat dont nous venons de parler, M. d’Argenteuil arriva de Montréal à Michillimakinac, et y publia les grands préparatifs que faisait le comte de Frontenac pour aller attaquer les Iroquois dans leur pays. M. de Lamotte invita les sauvages à se joindre à leur père; mais il les avertit qu’il leur faisait cette invitation de lui-meme, n’en ayant reçu aucun ordre de son général. Onaské déclara d’abord qu’il irait combattre sous la bannière d’Ononthio, et le commandant se flatta, pendant quelque temps, qu’une troupe de quatre cents guerriers irait grossir l’armée française; mais divers incidens rompirent toutes ses mesures, et l’on eut tout sujet de croire que les Hurons avaient détourné ce coup, pour se venger de l’affront qu’ils avaient reçu dans la défaite des Iroquois.
Le comte de Frontenac ayant résolu de pénétrer, au printemps, jusqu’au centre du pays des Iroquois, donna ordre au gouverneur de Montréal d’envoyer préalablement cinq ou six cents hommes de son gouvernement et de celui des Trois-Rivières, dans le canton d’Agnier. Ce parti fut bientôt prêt; mais comme il était sur le point de se mettre en marche, on reçut avis que la mine était éventée, et que les Agniers prenaient des mesures pour être secourus, non seulement par les autres cantons, mais encore par les Anglais de la Nouvelle York.
M. de Callières le fit savoir au comte de Frontenac, qui lui manda d’envoyer seulement trois cents hommes choisis pour tomber sur les chasseurs Iroquois, qui devaient être en grand nombre, comme de coutume, et sans défiance, entre le fleuve St. Laurent et la Grande Rivière. Ce, détachement partit à la fin de Janvier (1696,) sous les ordres de M. Louvigny; mais il fut arrêté treize jours, près de Montréal, par les neiges, qui tombèrent cette année en beaucoup plus grande abondance que d’ordinaire. Il continua ensuite sa route jusqu’à cinq lieues de Catarocouy, avec des fatigues incroyables, trouvant partout une neige de sept à huit pieds d’épaisseur. Il envoya de là des sauvages à la découverte; ceux-ci marchèrent pendant dix jours, et rencontrèrent enfin dix Iroquois et une femme: ils en tuèrent trois et prirent le reste. Ces prisonniers furent amenés à Montréal: un on deux furent brûlés par les sauvages, et les autres distribués dans les villages du Sault et de la Montagne. Quelques autres prisonniers, qu’on fit, à l’approche du printemps, rapportèrent que les Iroquois s’étaient tenus tout l’hiver enfermés dans leurs forts, et qu’ils se proposaient de venir en grandes troupes, pour empêcher les Français de faire leurs semences.
Au mois de Mai, le chevalier de Callières descendit à Québec, pour régler avec le gouverneur général les opérations de la campagne, dont les préparatifs étaient déjà fort avancés; et quand tous arrangemens eurent été pris, il retourna à Montréal, pour tenir la main a l’exécution de ce qui avait été conclu. Le 22 Juin, le comte de Frontenac l’y joignit, accompagné de M.de Champigny, du chevalier de Vaudreuil, de M. de Ramesay, gouverneur des Trois-Rivières, des troupes et des milices du gouvernement de Québec et de celui des Trois-Rivières. Celles du gouvernement de Montréal étaient déjà assemblées, et il ne restait plus rien à faire que de se mettre en marche.
L’armée partit de Montréal le 4 Juillet, et se rendit le même jour à la Chine, où arrivèrent aussi cinq cents sauvages, dont on fit deux troupes: la première, composée d’Iroquois du Sault St. Louis et d’Abénaquis domiciliés, fut mise sous les ordres de M. de Maricourt, capitaine: la seconde, où étaient les Hurons de Lorette et les Iroquois de la Montagne, eut pour commandans MM. de Beauvais et Legardeur, frères, tous deux lieutenants. Dix Outaouais, auxquels se joignirent quelques Algonquins, des Sokokis et des Nipissings, formèrent une bande séparée, sous le commandement du baron de Békancour.
Les troupes furent partagées en quatre bataillons, de deux cents hommes chacun, sous les ordres de quatre anciens capitaines, MM. de la Durantaye, de Muys, Dumesnil et de Grais. On fit aussi quatre bataillons des milices canadiennes: celui de Québec était commandé par M. de St. Martin capitaine réformé; celui de Beaupré, par M. de Grandville, lieutenant; celui des Trois-Rivières, par M. de Grandpré, major de la place; et celui de Montréal, par M. Deschambauts, procureur du roi, de cette ville. M. de Subercase, capitaine, faisait les fonctions de major-général, et chaque bataillon, tant des troupes que des milices, avait son aide-major.
Le 6, cette armée, la plus nombreuse qui eût encore été formée en Canada, alla camper dans l’Isle Perrot, et le lendemain, elle en partit dans l’ordre suivant: M. de Callières menait l’avant-garde, composée de la première bande de sauvages, et de deux bataillons de troupes; elle était précédée de deux grands bateaux, où était le commissaire d’artillerie, avec deux pièces de campagne, et des mortiers pour jetter des grenades, des artifices et autres munitions semblables. Quelques canots, conduits par des Canadiens, les accompagnaient, avec toutes sortes de provisions de bouche. Le comte de Frontenac suivait, environné de canots, qui portaient sa maison et son bagage, et d’un bon nombre de volontaires, et ayant avec lui M. Lavasseur, ingénieur en chef. Les quatre bataillons de milice, plus forts que ceux des troupes réglées, faisaient le corps de bataille, que commandait M. de Ramesay, sous le général; et les deux autres bataillons des troupes, avec la seconde bande des sauvages, formaient l’arrière-garde, sous les ordres du chevalier de Vaudreuil. Cet ordre ne fut point interrompu pendant la route, si ce n’est que le corps qui avait fait un jour l’avant-garde, faisait l’arrière-garde le lendemain.
On arriva le 19 à Catarocouy, où l’on séjourna jusqu’au 26, pour attendre quatre cents Outaouais, que M. de Lamotte-Cadillac avait promis, mais qui ne parurent point, non plus que quelques voyageurs français, qui devaient les accompagner. Le 28, l’armée se trouva à l’entrée de la rivière de Chouaguen. Cette rivière étant étroite et rapide, le général, avant de s’y engager, envoya cinquante découvreurs par terre, de chaque côté. On ne put faire, ce jour-là, qu’une lieue et demie. Le lendemain, l’armée fut séparée en deux corps, pour faire plus de diligence, et pour occuper les deux bords de la rivière, par terre et par eau. Le comte de Frontenac prit la gauche, avec M. de Vaudreuil, les quatre bataillons de troupes et un bataillon de milices. MM. de Callières et de Ramesay tinrent la droite, avec tout le reste. Sur le soir, on se réunit, après avoir fait trois lieues de chemin, et l’on s’arrêta au pied d’une chûte de dix à douze pieds de hauteur, qui occupe toute la largeur de la rivière. Une partie de l’armée s’était mal à propos engagée dans le courant de cette chûte, et il eût été dangereux de la faire reculer. M. de Callières sut remédier à cette imprudence: il fit metre tout son monde à l’eau; fit porter les canons par terre, et trainer les bateaux sur des rouleaux jusqu’au-dessus de la chûte. Cette opération, qui dura jusqu’à dix heures du soir, se fit dans le plus grand ordre, à la lueur de flambeaux d’écorce. Le rapide passé, on marcha avec plus de précaution, non seulement parce qu’on approchait de l’ennemi, mais parce que les chemins étaient extrêmement mauvais.
Enfin l’armée entra dans le lac de Gannentaha, par un endroit nommé le Rigolet, qu’il n’eût pas été facile de forcer, si les ennemis eussent eu la précaution de s’en saisir. On y trouva deux paquets de joncs pendus à un arbre: on y compta quatorze cents trente tiges; ce qui signifiait qu’autant de guerriers Iroquois attendaient les Français et lès défiaient au combat. L’armée traversa le lac en ordre dé bataille. M. dé Callières, qui tenait la gauche, feignit de faire là descente de ce côté-là, où étaient les ennemis, et dans le même temps, le chevalier de Vaudreuil la fit sur la droite, avec sept ou huit cents hommes; puis, tournant autour du lac, il alla joindre M. de Callières: alors tout le reste de l’armée débarqua.
(A continuer.)

|
Ce fut le troisième de cette famille (Lemoyne), remarque Charlevoix, qui mourut au service de ton prince. Les deux autres étaient MM. de Ste. Hélène et de Bienville. |
Le Combat des Trente, c’est ainsi qu’on le nomme dans l’antique province de Bretagne, est un fait d’armes chevaleresque, aussi célèbre parmi les Bretons que le fut chez les Romains le combat des Horaces. Il n’eut point pour objet ou pour résultat l’asservissement d’une nation à une autre; ce ne fut pas, comme on l’a tant répété, pour savoir qui avait plus belle amie des Anglais ou des Bretons, ni pour jouter en l’honneur des Dames; que trente braves allèrent défier l’ennemi, et s’exposèrent à la mort ou à la captivité. On a calomnié ces braves chevaliers, en leur prêtant des motifs aussi frivoles. Leur résolution fut inspirée par un vif sentiment d’humanité, et leur dévouement fut honorable de tout point.
Les querelles de la comtesse de Blois et de la comtesse de Montfort pour la possession du duché de Bretagne, avaient couvert cette malheureuse contrée de sang et de ruines. Les Français défendaient les droits de la duchesse de Blois, et la veuve du comte de Montfort avait appellé les Anglais sous ses bannières. Le capitaine Daggeworth, que les écrivains de cette époque nomment Dagorne, commandait, au nom de cette princesse, la ville et le territoire d’Auray. Ce Daggeworth, ou Dagorne, en chef prévoyant et expérimenté, défendit à ses troupes de piller et de maltraiter les marchands et les cultivateurs: il savait se faire obéir; mais il fut défait en bataille rangée par les barons de Bretagne, et il perdit la vie dans le combat. A peine fut-il mort que les exactions et les meurtres recommencèrent. Le capitaine qui lui succéda, nommé Bemborough, s’empara de Ploermel, ravagea la contrée et la remplit de deuil et de misère. Beaumanoir, chevalier de haute renommée, accompagné d’un autre vaillant personnage, nommé Jean, alla trouver les Anglais pour les inviter à faire cesser ces inutiles désordres. Les deux Bretons rencontrèrent en route une foule de pauvres paysans horriblement maltraités, dont ils eurent grand’pitiê; les uns avaient les fers aux pieds et aux mains, d’autres étaient attachés par les pouces, tous étaient liés deux à deux, trois à trois, comme les animaux que l’on mène au marché. Beaumanoir les vit, et son cœur se brisa. Il s’adressa à Bemborough avec fierté: “Chevaliers d’Angleterre, dit il, vous vous rendez bien coupables, de tourmenter ces pauvres habitans, eux qui sèment le blé, et qui vous procurent en abondance le vin et la bonne chère. Je vous dis toute ma pensée; s’il n’y avait pas de laboureurs, ne faudrait-il pas aux nobles défricher et cultiver la terre en leur place, battre le blé et endurer la pauvreté? et ce serait grande peine pour ceux qui n’y sont pas accoutumés. Qu’ils aient donc la paix dorénavant, car ils ont trop souffert depuis que l’on a oublié les sages ordonnances et les dernières volontés de Dagorne.” Bemborough en colère répondit au chevalier: “Taisez-vous, Beaumanoir, et ne nous rompez pas la tête. Edouard sera couronné roi de France, et les Anglais seront partout les maîtres, malgré vous et tous les Français.” Beaumanoir reprit naïvement: “Songez un autre songe, celui-ci est mal songé. De telles forfanteries ne valent néant, et il en arrive souvent mal à ceux qui le plus en disent.” Le héros breton, ne pouvant rien obtenir de Bemborough, lui porta alors un défi; et il fut résolu que de chaque côté on combattrait loyalement, à cheval, trente contre trente. Les barons de Bretagne, avertis de l’entreprise, se rassemblèrent pour rendre grâces à Dieu, et espérèrent que leurs campagnes seraient bientôt délivrées du joug de l’avide Bemborough et de ses soldats. On connaît le résultat du combat, qui se livra dans la lande de Mi-Voie, l’an 1350, le Samedi tenant Lœtare Jérusalem. Bemborough et la plupart de ses compagnons furent tués; le reste se rendit à rançon. Quatre Bretons succombèrent dans l’action, qui fut terrible. Beaumanoir, blessé, demanda à boire; mais Geoffroy Dubois lui répondit: Bois ton sang, Beaumanoir, ta soif se passera, et tout l’honneur de la journée sera pour nous! Il le fut en effet.
Cette belle et généreuse action a été mise au rang des fables par quelques critiques qui s’étayaient de ce qu’aucun historien français n’en avait fait mention, et de ce que les historiens bretons n’en avaient parlé que sur la foi d’un manuscrit de 1470, conservé dans la bibliothèque de Rennes. Cependant le fait avait été raconté par Froissart, qui lui avait accordé toutes les louanges qu’il mérite; mais, dans un grand nombre de manuscrits de cet écrivain, et dans toutes les éditions qu’on en a publiées, il se trouve que, par un singulier hasard, les chapitres des années 1350, 1351, et jusqu’à 1356, ont été remplacés par un extrait des grandes chroniques de Saint-Denis. M. Buchon à retrouvé, dans un manuscript du prince de Soubise, les morceaux enlevés à Froissart, et il s’est assuré de leur authenticité, en comparant ce nouveau texte à celui de deux autres manuscrits qui appartiennent à M. Johnes en Angleterre. Il a donc publié, dans ses Chroniques nationales et étrangères, le récit du Combat des Trente, extrait des Chroniques de Froissart (tom. III, 7e addition.) D’une autre part, M. de Freminville, ancien officier de marine, occupé de recherches historiques sur les antiquités de la Bretagne, a découvert à la bibliothèque du Roi un récit en vers du Combat des Trente, manuscript du xvie siècle. Ainsi la réalité de cet épisode des guerres de la Bretagne au xive siècle est maintenant établie par des pièces irrécusables.

Lettre de John Neilson, écuyer, à F. X. Vaillancourt, écuyer, Assistant-Secrétaire de la Société d’Agriculture de Québec; datée,
Au Carouge, le 24 Mars, 1825.
Monsieur,
Je regrette beaucoup que les circonstances ne me permettent pas de me trouver à l’exhibition qui doit avoir lieu mercredi prochain, et à la distribution des prix pour les produits des terres pour l’année dernière.
Je m’étais proposé de soumettre au Comité le résultat de deux expériences que j’ai fait faire l’été dernier, à ma terre du Carouge, dans l’espérance que cela pourrait être utile.
Le peu de chose qu’un grand nombre de nos cultivateurs retirent maintenant de terres anciennement défrichées, surtout de celles dont le sol n’est pas de la première qualité, me parait venir de ce que ces terres sont épuisées des substances qui servent de nourriture aux plantes utiles, ou de ce que le peu de nourriture qui leur reste, est pris par de mauvaises herbes naturelles au sol et au climat.
Il faut donc, pour augmenter le produit de ces terres, détruire les mauvaises herbes et remettre à la terre des engrais ou matières qui fournissent de la nourriture aux plantes qui sont utiles à la nourriture de l’homme et des bestiaux.
Tout les cultivateurs savent combien il est difficile de détruire les mauvaises herbes lorsqu’elles se sont emparées du sol. C’est le premier travail d’amélioration, et un travail absolument nécessaire: car autrement les engrais, qui ne devraient nourrir que des plantes utiles, serviraient de nourriture à de mauvaises herbes, qui étoufferaient les bonnes.
En Europe, depuis près d’un demi-siècle, on a réussi à doubler et tripler le produit des vieilles terres, en détruisant les mauvaises herbes et en engraissant les terres, principalement à même les moyens que chaque terre fournit par elle-même. On s’est apperçu que l’on détruisait les mauvaises herbes en remuant souvent la terre pendant l’été, ce qui expose les graines de ces herbes à végéter et périr, et facilite la destruction de celles qui poussent de racine, en les exposant au soleil et en les ramassant lors des hersages. La terre ainsi nettoyée, on y mettait des engrais qui servaient aux récoltes de l’année d’ensuite. C’était beaucoup d’ouvrage, et la perte de la récolte d’une année; cependant on y gagnait. Mais on s’est avisé ensuite de faire le même travail pendant l’été, et de retirer une récolte la même année. On y a parfaitement réussi depuis une trentaine d’années, en introduisant la culture en rangs de 2 pieds et demi l’un de l’autre, et un cours de récoltes nouveau. On préfère, pour semer en rangs, des choses qui ne demandent à être semées qu’après les semences ordinaires. Cette culture suit toujours une récolte de grain, dont le chaume a été labouré l’automne. Si la terre est bien sale, on la herse, laboure de travers et herse encore, par un temps sec et de soleil, après les semences ordinaires. A chaque hersage on ramasse soigneusement les racines des mauvaises herbes. Après le dernier hersage, on fait les rangs, on y met l’engrais; si ce sont des patates ou des fèves que l’on veut semer, on les met par-dessus le fumier, et on les enterre à mesure, afin que le fumier ne sèche pas; si ce sont des bettes, des carrottes, des choux, des navets, etc., on enterre aussi à mesure le fumier ou l’engrais dans le rang, et l’on sème ou plante ensuite, selon la saison, sur le haut du rang. Presque tout l’ouvrage se fait à la charrue et par la force des chevaux et l’art du laboureur. On a inventé de petites charrues et des herses pour remuer la terre entre ces rangs, chaque fois que les semences de mauvaises herbes germent, que leurs racines poussent, ou bien lorsque les plantes qu’on y a semées demandent ce travail, soit pour ôter ou remettre la terre contre leurs racines.
On a employé, généralement, le produit de cette nouvelle culture en rangs à la nourriture des bestiaux, ce qui a mis le cultivateur en état d’en hiverner un plus grand nombre, et en meilleur état, et aussi de ramasser plus de fumier.
Après ces récoltes de légumes en rang, on sème le champ ainsi nettoyé et engraissé en grain, et avant le dernier hersage, on y sème de la graine de trèfle et foin, ce qui donne une récolte abondante de grain, et l’année d’ensuite de foin, et un bon pacage la troisième année; la quatrième année, on le laboure et le sème en grain; la cinquième année, on recommence à nettoyer et engraisser par une récolte en rangs. Dans ce cours de récoltes, toute la terre labourable se trouve divisée de manière qu’il y a chaque année 1 champ de légumes en rang, 2 de graines de foin et 1 de pacage, sans que le même champ porte la même récolte deux années de suite. Les parties de la terre non labourables servent de pacage additionel.
Par ces moyens, les cultivateurs en Europe ont véritablement doublé et triplé le produit de toutes leurs terres sèches depuis trente ans, sans aucune augmentation sensible de travail. Toutes les terres ainsi cultivées, au lieu de s’épuiser, s’améliorent annuellement.
Tout ce qui nous manque pour introduire une semblable culture ici, et un cours de récoltes aussi avantageux sur toutes les anciennes terres sèches et épuisées, serait un peu de connaissance parmi nos cultivateurs de la manière de faire les travaux et les outils qu’on y emploie, la manière de conserver les légumes et de s’en servir pour la nourriture des bestiaux, le soin et l’emploi des engrais, et l’introduction, peut-être, de quelque grain qui puisse se cultiver en rangs, et la manière de se fournir de graines de foin, surtout de trèfle, à même sa propre terre.
C’est en vue d’introduire dans la culture en rangs un grain qui puisse être utile et souffrir en même temps le nettoyage et l’engrais de la terre, que j’ai fait faire une expérience l’année dernière avec le sarrasin. J’en ai semé un pot dans deux rangs à 2 pieds et demi l’un de l’autre, dans mon champ de légumes: le sol est composé d’un tuf rouge, qui ne produisait, avant les améliorations que j’y ai faites par la nouvelle culture, depuis 5 ans, qu’un peu d’oseille sauvage, de petites ronces et des immortelles. La semence de ce pot de sarrasin se fit en même temps que mes navels, du 15 au 18 juillet. Il a été mis un peu de fumier vert dans les rangs. La récolte se fit à la fin de septembre, et le produit à été de trois minots; ce qui fait sur le pied de 108 minois par arpent, et 48 pour 1. Au prix du sarrasin à Québec, le printemps dernier, le produit d’un arpent de très mauvaise terre, cultivé de cette manière en sarrasin, serait de £15; 16; les patates dans le même champ, l’année dernière, ne se seraient vendues que £6: 10 par arpent; les navets, £20 par arpent; ces derniers se vendent bien au-dessus de leur valeur réelle. Le sarrasin fournit une excellente nourriture pour la volaille, les cochons, et même une nourriture saine pour l’homme; comme les navets, il vient à maturité, quoique semé longtemps après les travaux ordinaires du printemps.
Beaucoup de monde dans ce district ont ramassé delà graine de mil; mais peu de personnes paraissent avoir essayé le trèfle, qui est encore plus nécessaire que le mil dans un bon cours de récoltes. J’ai fait l’année dernière, de trois à quatre cents bottes de foin de trèfle et mil par arpent, sur un terrain naturellement plus mauvais que celui où j’ai fait semer le sarrasin. Il avait été semé en grain l’année précédente, J’ai fait faucher ce trèfle lorsqu’il était en fleur, excepté un cinquième d’arpent du plus chétif sur un butte. Il a été fauché en septembre; le produit a été de 40 livres de graine de trèfle: ce qui fait 230 livres par arpent. Le trèfle des Etats-Unis se vend à Québec à 1s. la livre, souvent rempli de mauvaises graines, on gâté à ne pas lever.—La qualité de celui qui a été produit sur ma terre me paraît supérieure. Au prix du trèfle américain, il donnerait £11; 1 par arpent. Le foin dont on a tiré la graine ne pourrait servir qu’à faire du fumier. On l’a battu avec des fléaux pour en tirer la graine, et l’ouvrage a été considérable. Dans les Etats-Unis, on a des machines pour nettoyer la graine de trèfle, qui nous serviraient bien ici.
Je vous envoie un échantillon du sarrasin et du trèfle, par mon fermier. J’ai l’honneur d’être, votre très humble et obéissant serviteur,
J. NEILSON.
M. Vaillancourt, Assist. Sec. Soc. Ag Q.
P.S. La quantité de terre laborable épuisée que j’ai mise en bon état et sous le cours de récoltes mentionné dans cette lettre, depuis 7 ans, se monte à environ 20 arpens. Je ne pouvais nourrir sur ma terre alors que trois vaches et deux chevaux; encore il fallait souvent acheter du foin et de l’avoine. Je n’ai fait charier de la ville qu’une trentaine de voyages de fumier, la première année, et j’ai employé depuis pour aider à la décomposition du tas d’engrais que j’avais ramassé sur ma terre, quelques pipes de chaux. Je n’ai employé constamment aux ouvrages de la terre, qu’un seul homme, que j’ai fait aider pendent les foins et les récoltes. La terre nourrit maintenant six vaches et trois chevaux, en abondance de tout. Toute la terre labourable était pleine de marguerites, de chiendent, de chicorée sauvage, d’oseille sauvage et autres mauvaises herbes; maintenant on n’en voit presqu’aucune dans les champs qui ont été soumis à un ours de récoltes régulier, et ces champs s’améliorent visiblement. Je fais ramasser annuellement sur ma terre des engrais pour environ un arpent sans compter le fumier, qui me met en état d’engraisser un champ de cinq arpens chaque année, outre le fumier nécessaire pour le jardin. Il est certain que la même chose pourrait se faire avec deux, trois, et quatre fois autant de bestiaux, de terre, et moins de quatre fois autant d’hommes. Les engagés ne font que rarement autant d’ouvrage que les hommes qui appartiennent à la famille du cultivateur lui-même, qui, ordinairement, conduit mieux sa terre que celui qui n’a pas été élevé à cela. Avec la connaissance des améliorations dans l’agriculture qui ont été mises en pratique dans les anciens pays fort peuplés, les cultivateurs canadiens auraient une supériorité marquée, sur tout dans ce pays, sur les meilleurs cultivateurs qui pourraient nous venir de l’Europe.
J. N.

Il est parlé, dans un article de notre numéro de Mai dernier, du Sumac ou Vinaigrier, comme étant d’une grande utilité dans les tanneries: nous tenons le morceau suivant de Mr. M’Farlane, le tanneur de la Côte des Neiges auquel il est fait allusion dans l’article en question.
“Le Sumac ou Rhus, est un genre de plante dont les botanistes comptent au moins neuf espèces, outre plusieurs variétés. L’espèce qui croît spontanément sur la montagne de Montréal et aux environs, et qui est même une production naturelle de la plupart des sols secs du Bas-Canada, semble être le rhus typhinum,[1] ou sumac à bois de cerf. Il s’élève à la hauteur de huit ou dix pieds, et porte des branches irrégulières, qui, durant le premier été de leur croissance, sont couvertes d’un duvet très doux au toucher. Les feuilles, en forme de fer de lance, sont opposées en nombre impair, de treize, quinze, dix-neuf, &c. sur le même pédicule, qui a de douze à quinze pouces de longueur. La surface inférieure est plus veloutée, et d’un vert moins foncé que la supérieure. La floraison et la fructification ont lieu aux ex trémies des rameaux (péduncules) destinés à ces opérations naturelles, en grappes ou épis à grains serrés, de couleur de pourpre, qui demeurent sur l’arbre tout l’hiver, et même jusqu’au commencement d’une nouvelle fructification. Les graines sont portées au loin par le vent, et germant partout où le terrain est ouvert et mou. Les endroits où le feu a passé, dans les bois ou dans les champs, semblent être les plus favorables à la crue du sumac canadien.
“On emploie les feuilles et les rameaux de cette plante dans les tanneries: mais en Canada, le sumac n’a pas eu jusqu’à présent tout l’effet désiré; parce qu’en même temps qu’il tanne la peau, in donne au cuir une teinte verdâtre; tandis que le sumac commun importé du Levant, ou du midi de l’Europe, donne au cuir une belle couleur claire. La plante qui produit cette couleur est le rhus coriarium, ou sumac des tanneurs, espèce différente, dont les fleurs et les fruits sont de couleur jaunâtre.
“Peut-être que quand des savans se seront plus assidûment appliqués à l’avancement des arts utiles, on pourra remédier à ce défaut dans le sumac du Canada: peut-être aussi sera-t-il possible de naturaliser le rhus coriarium dans ce pays. Quoiqu’il en soit, il est certain que le sumac à cornes de cerf est cultivé pour l’usage des tanneries, dans quelques uns des Etats-Unis, dans celui de New-York, par exemple, où il se vend, dit-on, £20 le tonneau, lorsqu’il est moulu et prêt à être employé.
“Il est probable que la teinte verdâtre donnée au cuir par le sumac du Canada provient de l’espèce d’écorce qui est employée en même temps; car on se sert rarement, ou plutôt on ne se sert jamais du sumac, pour compléter le procédé, sans y joindre quelqu’autre ingrédient. En Angleterre, c’est ordinairement l’écorce de chêne: dans ce pays, c’est ordinairement l’écorce de cette espèce d’épinette appellée pruche, qui, employée seule, ne manque jamais de donner au cuir une couleur rouge ou pourprée.”

|
Mr. J. Lambert croit que c’est le rhus glabrum. |
On ne peut pas dire que la littérature, les arts et les sciences sont peu fleurissants en Canada, parce qu’ils n’y ont jamais fleuri; et d’après ce que j’ai dit des défauts du système d’éducation en usage dans la colonie, il n’est pas probable qu’ils s’élèvent beaucoup au-dessus de leur niveau actuel, du moins de notre temps. La politique du gouvernement français était de tenir le peuple dans l’ignorance; il n’y avait point d’imprimeries; et l’on ne pouvait faire venir des livres de France qu’avec difficulté, et à grands frais. La légèreté et la dissipation qui régnaient dans la société tendaient encore à déprécier le savoir. Les Jésuites et leurs missionnaires étaient les seuls hommes qui eussent du goût pour les sciences, et qui possédassent les moyens de cultiver ce goût. Ils étudièrent avec ardeur l’histoire naturelle du pays, et les mœurs de ses habitans; et c’est d’eux que nous tenons la plupart de ce que nous savons de l’intérieur de l’Amérique Septentrionale.
Si, sous le gouvernement français, les Canadiens avaient été disposés à cultiver les arts et les sciences, cette disposition se serait développée sous le marquis de la Galissoniere, qui fut le gouverneur le plus actif et le plus entreprenant qui fut envoyé en Canada, et qui avait une connaissance étendue dans chaque branche des sciences. Il était à tous égards, un homme d’état accompli, et ses connaissances dans l’histoire naturelle, la philosophie et les mathématiques, devinrent utiles aux vues de son gouvernement. Il se procura des renseignemens des parties les plus éloignées de la colonie, concernant ses habitans, ses animaux, ses arbres, ses plantes, ses terres et ses minéraux; ainsi que sur les lacs, les rivières et les mers qui baignent cette portion étendue de l’Amérique qu’il gouvernait. Il était même en état de faire la description des places éloignées qu’il n’avait pas vues, mieux que les gens qui les habitaient. Enfin M. de la Galissonière était l’homme qu’il fallait pour exciter dans l’esprit des Canadiens un goût pour les sciences et les beaux arts, si cet esprit n’avait été qu’endormi; mais le fait est que descendant d’hommes paresseux, inquiets et volages, ils n’eurent jamais la moindre inclination ni la moindre habileté à se tirer de l’état d’ignorance et de dissipation dans lequel ils étaient plongés.
L’état des arts et de la littérature n’a pas fait des progrès bien rapides, après la conquête du pays par les Anglais. Les marchands et les colons qui s’établirent parmi les Français, étaient peu propres à répandre le gout des arts et des sciences, à moins que ce ne fût la science des trocs et l’art de gagner cent pour cent sur ses marchandises.
Pendant plusieurs années, on n’imprima dans la colonie d’autre ouvrage qu’un almanac: on ne pouvait même trouver des talens pour la publication et des souscriptions pour le soutien d’une gazette; ce qui était d’autant plus surprenant, que ces ouvrages périodiques sont très goutés des Anglais, et existaient depuis plus de cent ans dans les colonies voisines. A présent, les gazettes se répandent sur tout cet immense territoire (des Etats-Unis) comme des brins de paille devant un vent violent; et en fait de mérite, plusieurs ne valent pas plus que ces fétus.
Depuis quelques années, les Canadiens ont paru désirer se faire une réputation littéraire: ils semblent vouloir compenser la négligence avec laquelle ils ont traité jusqu’à présent cet avantage utile et agréable dans la société. La publication de six papiers-nouvelles par semaine, est une preuve de la prospérité progressive du pays, quoique ce puisse n’être qu’un symptôme trompeur du progrès de la littérature.
Quatre de ces papiers se publient à Québec, et deux à Montréal. Ces papiers avec un almanac, et les Actes du Parlement Provincial, sont tous les ouvrages qui s’impriment dans le Bas-Canada. Deux de ces papiers-nouvelles sont établis depuis quinze ou seize ans: ce sont les Gazettes de Montréal et de Québec, qui se publient en français et en anglais.
Les gazettes parlent peu des mœurs et dos manières de la société: elles laissent ces sujets aux autres feuilles hebdomadaires. Ces feuilles sont le Quebec Mercury et le Canadian Courant, qui se publient en anglais seulement; le Canadien et le Courier de Québec, qui se publient en français.
Le Canadien est conduit par quelques hommes de loi et quelques membres de l’Assemblée, mal affectionnés, ou plutôt mécontents; c’est le seul papier de l’opposition qu’il y ait dans la province; mais les paysans, ou ne peuvent pas le lire, ou font très-peu d’attention aux plaintes qu’il contient contre le gouvernement. Il leur suffit de ne point sentir les fardeaux et les calamités dont les autres se plaignent. Cependant les éditeurs et les correspondans du Canadien abusèrent tellement de la liberté de la presse dans le cours de l’année 1808, que Sir James Craig jugea à propos d’ôter à plusieurs de ces Messieurs les commissions qu’ils avaient dans la milice canadienne.
Il faut pourtant avouer qu’il est bon d’observer de près les dépenses publiques de chaque pays; et la faillite (defection) du dernier commissaire-général en Canada, ainsi que la vente honteuse des forges de St. Maurice, justifient un examen soigneux de la conduite des officiers publics. J’ai aussi entendu dire qu’il existe dans le gouvernement du Haut-Canada des abus criants, qui devraient être examinés sans délai. Les purs républicains mêmes des Etats-Unis, qui reprochent sans cesse aux anciens gouvernemens de l’Europe, leur corruption et leurs vices, avouent qu’ils ont fait dernièrement le procès à un vice-président pour trahison,—à un sénateur pour conspiration,—à un commandant en chef de la marine, pour lacheté,—et à un commandant en chef de l’armée, pour intrigue et corruption!
L’autre papier français appellé le Le Courier de Québec, est d’un très petit format, et se publie tous les Samedis, à raison de deux piastres par an. Deux ou trois jeunes Canadiens-français ont établi ce papier, afin d’y insérer leurs pièces fugitives. Ces messieurs ont établi, depuis peu, une Société Littéraire qui, quoiqu’elle ne renferme point les talens et les connaissances d’un Institut National, ou d’une Société Royale, mérite néanmoins tout l’encouragement que le gouvernement du Canada est en état de donner à un tel établissement. Dans un tel pays, la première lueur du génie doit être apperçue avec plaisir.
Le Mercury et le Canadian Courant se remplissent de nouvelles étrangères et locales. Les essais originaux qui paraissent dans ces papiers, n’ont rapport qu’au pays, et sont généralement le fruit de l’esprit de parti, de l’aigreur, et de l’envie de médire; et conséquemment, sont presque toujours écrits en dépit de l’esprit, du bon sens, et de la nature.[1]
La seule bibliothèque publique qu’il y ait en Canada, se trouve à Québec, dans une des salles de l’évéché. Elle est petite, et très médiocrement fournie de livres nouveaux. Les livres qu’elle contient ne circulent dans cette ville que parmi ceux de ses habitans qui sont souscripteurs. Les romans sont en grande vogue parmi les dames du Canada, comme ils le sont parmi celles d’Europe. Ce sont les seuls livres qui semblent avoir des charmes pour les personnes du beau sèxe d’à présent, et peu importe, dans l’opinion de plusieurs, quel est le contenu de ces livres, et comment ils sont écrits. Mais généralement parlant, la lecture n’est pas un amusement aussi commun ici qu’en Angleterre; et je crois que les dames du Canada passent la plus grande partie de leur temps à ne rien faire, ou, ce qui revient à peu près à la même chose, à faire des riens.

|
In Wit, and Sense, and Nature’s Spite. |
Le caméléon, si célèbre par tout ce qu’on en dit; le caméléon, qu’on accuse de changer de forme et de couleur, pour prendre celles de tous les objets dont il approche; le caméléon, auquel on compare ces hommes bas et rampants, qui, n’ayant jamais d’avis à eux, se plient à toutes les formes, embrassent toutes les opinions, et ne se repaissent que de fumée et de vains projets; le caméléon enfin, dont les poëtes ont fait, dans le délire de leur imagination, un animal fantastique, n’est qu’un lézard, dont les plus grands n’ont guère plus de quatorze pouces de longueur totale. Sa tête, applatie par-dessus, l’est aussi par les côtés; son cou est très court, et sur sa tête on voit une espèce de capuchon, ou plutôt de pyramide à cinq faces, formée par cinq arrêtes, qui partent du museau, du sommet de la tête et des coins de la gueule. Ses yeux sont vifs et bons. Au-dessous de sa gorge est une petite poche. De petites éminences très lisses sont répandues sur sa peau.
Sans entrer dans de plus grands détails sur la structure tant intérieure qu’extérieure du caméléon, nous ne nous occuperons que des particularités qui ont pu donner lieu à la ressemblance qu’on lui attribue avec ce qu’on appelle les vils courtisans. La première peut venir de la manière dont la nature a formé pour lui seul l’organe de la vue. Non seulement ses yeux sont enveloppés des membrances conservatrices: mais ils sont encore mobiles, indépendants l’un de l’autre; de sorte que quelquefois il les tourne de façon que l’un regarde en arrière, et l’autre en avant; ou bien il voit de l’un des objets qui se trouvent placés au-dessus de lui, tandis que de l’autre, il apperçoit ceux qui sont placés au-dessous.
Quant à la seconde ressemblance, qui caractérise la versatilité de ceux qu’on lui compare, elle consiste dans le changement si fréquent et si rapide des teintes de sa peau, qu’il est assez difficile d’assigner qu’elle est sa couleur naturelle. Par exemple, s’il est à l’ombre ou en repos depuis quelque temps, les petites éminences qui le couvrent sont d’un rouge pâle, et le dessous de ses pattes est d’un blanc jaunâtre. Exposé au soleil, la partie de son corps qui est éclairée devient souvent d’un gris plus brun, et la partie sur laquelle les rayons du soleil ne tombent pas directement offre des couleurs plus éclatantes, et des taches qui paraissent isabelles, par le mélange du jaune tendre, que présentent alors les petites éminences, et du rouge clair du fond de la peau. Dans les intervalles; ces petites éminences offrent du gris mêlé de verdâtre et de bleu, et le fond de la peau est rougeâtre. Dans d’autres circonstances, le caméléon change en un clin d’œil; tantôt il est d’un beau vert, tacheté de jaune; mais dès qu’on le touche, il paraît tout à coup couvert de taches noirâtres, assez grandes, mêlées d’un beau vert. Lorsqu’on l’enveloppe dans un linge ou dans une étoffe d’une couleur quelconque, il devient quelquefois plus blanc qu’à l’ordinaire; mais il est bien démontré, malgré tout ce qu’on a pu dire de contraire, qu’il ne prend pas les couleurs des objets qui l’environnent.
D’après les observations qui ont été faites sur ce quadrupède ovipare, il paraît certain que la crainte, la colère et la chaleur sont les seules causes des diverses couleurs qu’il présente, et qui ont été le sujet de toutes les fables qu’on s’est plu à faire sur son compte.
Le caméléon se trouve dans tous les climats chauds, tant de l’ancien que du nouveau continent. Sa destinée paraît être d’intéresser de toutes les manières; car si, dans les pays policés, il a donné naissance à des contes ridicules et à des superstitions absurdes, il jouit sur les bords du Sénégal et de la Gambie, de la plus grande vénération; et la religion des Nègres du cap de Monté, non contente de leur défendre de le tuer, leur ordonne de le secourir et de l’aider, lorsque, tremblant le long d’un rocher, il cherche à en descendre, en s’attachant péniblement avec ses ongles, se retenant avec sa queue, et se consumant en vains efforts. Mais une fois qu’il est mort, tout culte cesse, et il est mangé par ces mêmes Nègres, après qu’ils l’ont fait sécher au soleil.
Cet animal, ainsi que les autres lézards, peut vivre près d’un an sans manger: c’est vraisemblablement ce qui a fait dire qu’il ne se nourrissait que d’air.
L’île d’Eléphanta située sur la côte de Malabar, à une distance d’environ trois lieues de Bombay, consiste en deux montagnes de roc, couvertes d’arbres et de broussailles. Sa circonférence est à peu près de trois milles. Le premier objet qui frappe la vue, en débarquant dans cette île, est une figure d’éléphant taillée dans le roc, de grandeur naturelle, qui se trouve au milieu de la campagne. On apperçoit aussi dans le même endroit un cheval de pierre si bien fait, qu’on le prendrait pour un animal vivant.
Mais, quelque digne d’admiration que soient ces deux monumens, il en est un troisième qui a excité et qui excite encore l’attention des curieux, et qui a fourni une ample carrière aux discussions des antiquaires. C’est une fameuse pagode, ou temple payen, taillé entièrement dans le roc, et dont les Portugais ont rapporté beaucoup de merveilles. Sa grandeur est d’environ cent vingt-cinq pieds en quarré, et sa hauteur de quatre-vingts. Quatre rangs de colonnes massives, aussi taillées dans le roc, uniformes dans leur ordre, et placées à une distance régulière, forment trois magnifiques avenues à la principale entrée du temple, dont la voute n’est qu’un grand rocher. L’extrémité du centre de l’avenue du milieu est occupé par une figure colossale, à trois têtes, et dont la hauteur, à partir de la base du rocher, est de quinze pieds. Elle représente la trinité de la mythologie des Indous: Brama, Wishnou et Shiva: le Créateur, le Préservateur, et le Destructeur. La figure de Brama, qui est au milieu, déploie des traits réguliers sur lesquels se peignent la douceur et la sérénité. Celle de Wishnou présente les mêmes caractères. Mais la sévérité et la vengeance expriment de la manière la plus frappante, les attributs du terrible Shiva: une de ses mains tient un naja (ou serpent à lunettes), et l’autre des fruits et des fleurs, parmi lesquels on distingue la grenade et le lotus, si souvent introduits dans la mythologie des Indous.
Du côté opposé à ces trois divinités, auxquelles des figures de géans semblent servir de gardes, on en voit une plus gigantesque que toutes les autres; elle est appuyée sur un nain. Cinquante figures d’hommes et de femmes, rangées dans la plus exacte symétrie, remplissent l’intervalle qui se trouve entre les trois divinités et leurs gardes. Elles sont chacune de douze à quinze pieds de haut. Quelques unes ont six bras, d’autres trois têtes. Il en est enfin dans le nombre qui sont si monstrueuses, qu’elles ont le doigt de la grosseur de la jambe d’un homme ordinaire. A l’exception d’une de ces figures, qui représente une amazone, il n’en est aucune qui indique un caractère particulier: et soit que celles des femmes se rapportent à des déesses ou à des mortelles, les ornemens qu’elles portent consistent, comme ceux des femmes des Indous, dans des bracelets et des bagues, qui tiennent à la cheville et aux doigts de leurs pieds. Quant aux hommes, ils n’ont que des bracelets. L’espace qui se trouve entre ces figures est rempli de petits êtres aériens, qui voltigent avec une variété infinie, au milieu des figures colossales que nous venons de décrire.
Les côtés du temple, ainsi que les extrémités de ses avenues collatérales, sont décorés de semblables figures. On en voit qui portent sur la tête des couronnes fort bien travaillées, ou des sceptres dans les mains. Quelques unes ont sur la tête d’autres petites figures qui sont comme en prière. Il y en a aussi qui s’appuient sur des femmes, ou sur la tête d’une vache, animal fort respecté dans l’Inde; d’autres enfin qui prennent une jolie fille par le menton, ou qui déchirent en pièces de petits enfans. Mais en général, toutes ces figures manquent d’un caractère décidé, et l’espèce de molesse qui les caractérise donne à croire qu’elles appartiennent, plutôt à la sculpture égyptienne, qu’à la sculpture grecque.
A la droite et à la gauche du temple, on voit des avenues qui conduisent à des excavations; celles de la droite sont les plus ruinées; cependent on y apperçoit encore quelques vestiges de sculptures. Un étang occupe l’une d’elles. On ignore si c’est à la nature ou à l’art qu’il doit son origine. A gauche est un petit temple dont la façade est ouverte, et la voute supportée par des colonnes d’une architecture différente de celle du grand temple. Les côtés sont décorés de sculptures; la voute et les corniches sont peintes en mosaïque.
Ce temple contient deux bains, dont l’un a dû être d’une magnificence extrême. Une figure colossale se trouve entre les deux bains.
Plus on considère ce temple, ces colonnes et ces figures taillées dans le roc, et moins on peut concevoir la hardiesse de l’entreprise, l’immensité des travaux qu’elle a occasionnés, et le génie extraordinaire de celui que en a donné le plan.—(Merveilles dit Monde.)

La chute de Niagara est sans contredit la plus prodigieuse de toutes ces contrées. C’est un incident réellement étrange en géographie, qu’un fleuve de 700 mètres de largeur, sur une profondeur moyenne de 15 pieds de courant, à qui tout à coup manque le sol de la plaine où il serpente, et qui, d’un seul jet, précipite toute sa masse de 144 pieds de hauteur, dans un terrain inférieur, où il poursuit son cours, sans que d’ailleurs l’œil du spectateur apperçoive aucune montagne qui ait gêné ou barré sa route. L’on n’imagine point par quelle localité singulière la nature a disposé et nécessité cette scène prodigieuse; et quand on l’a reconnu, l’on demeure presque aussi surpris de la simplicité des moyens que de la grandeur du résultat.
Sur le prolongement du même coteau d’où tombe le St. Laurent, et aussi sur la rive méridionale du lac Ontario, la rivière Génésée subit deux ou trois chutes, dont la somme additionnée égale celle de Niagara, et prouve que l’escarpement conserve son niveau avec une régularité remarquable: j’ai dit deux ou trois chutes, parce que les voyageurs diffèrent entr’eux sur ces nombres, et que n’étant pas témoin, je ne puis résoudre la question. M. Arrow-Smith n’en compte que deux, dont la plus voisine du lac a 75 pieds anglais de hauteur, et la seconde, au-dessus d’elle, 96 pieds; ce qui fait 171 pieds anglais, et revient à 157 pieds français, de hauteur totale.
M. Pouchot, officier français en Canada dans la guerre de 1756, compte trois chutes;[1] la première large de deux arpens et haute de 60 pieds; la seconde peu considérable; la troisième large de trois arpens et haute de 100 pieds; faisant une hauteur totale de 160 pieds.
Cette somme de 160 pieds coïncide très bien, comme l’on voit, avec les 157 pieds de M. Arrow-Smith, dont les auteurs paraissent avoir négligé la seconde cascade.
Bougainville, le célèbre navigateur autour du monde, qui fit aussi la guerre de 1756 au Canada, évalue, dans son journal manuscrit qu’il m’a communiqué, cette seconde chute à 20 pieds: ce serait donc une hauteur totale de 180 pieds. Or Niagara compte pour sa chute 144 pieds; et pour la pente des rapides qui la précèdent, environ 50 pieds anglais, ou à peu près 46 pieds de France; en total, 190 pieds. La différence se réduit à 10 pieds; et si l’on considère que ces élévations varient selon les époques des eaux basses et des débordemens, l’on conviendra que des mesures prises en temps divers, par diverses personnes, peuvent difficilement mieux cadrer.
Au-dessous de Québec, sur la rive nord du St. Laurent, une rivière médiocre forme une cataracte, célèbre sous le nom de Montmorency: elle a 220 pieds de hauteur sur une nappe de 46 à 50 de large, et elle présente des effets très pittoresques, par l’apparence blanche et neigeuse qu’elle prend dans cette énorme chute.
Au-dessus de la même ville, sur la rive sud, est la chute d’une autre rivière appellée la Chaudière: elle est moins haute de moitié que les précédentes; mais sa largeur est de 225 à 230 pieds.[2] Une troisième chute, nommée le Cohoes, est celle de la Mohawk, trois milles avant son embouchure dans le fleuve Hudson: elle est évaluée par les uns à 65 pieds; par d’autres, à cinquante seulement: la nappe d’eau a environ 800 pieds de large: elle est brisée par beaucoup de roches.
Une quatrième chute est celle du Potomac, à Matilda, six milles au-dessus do George-town: elle a environ 72 pieds de hauteur, sur 8 à 900 de large. Le fleuve, qui jusqu’alors avait coulé dans une vallée bordée de coteaux, sauvages comme ceux du Rhône en Vivarais, tombe tout à coup, comme le St. Laurent, dans un profond ravin de pur roc, granit micacé, taillé à pic sur les deux rives: il s’en dégage, quelques milles plus bas, par un évasement de la vallée dans le pays inférieur.
L’on compte encore plusieurs autres chutes remarquables plutôt par leur hauteur que par leur volume: telle est celle de Falling-Spring, sur l’une des hautes branches de la rivière James, venant de Warm-Spring. M. Jefferson, qui la cite dans ses Notes sur la Virginie, l’évalue à 200 pieds anglais de hauteur; mais sa nappe n’a que 15 pieds de largeur.
Telle est encore celle de Paissaik, dans le New-Jersey, haute de 66 à 70 pieds, et large d’environ 110. Quant à celle appellée St. Antoine, sur le Mississipi, au-dessus de la rivière St. Pierre, je dirai seulement, d’après M. Arrow-Smith, qu’elle a 29 pieds anglais, c’est-à-dire un peu moins de 27 pieds de France.
M. de Volney, à qui nous avons emprunté ces détails, ne parle point de la chute de Kakabbika, comparable, sous plusieurs rapports, à celle de Niagara. Il ne dit rien non plus de la terrible chute du Saguenay, dont aucun voyageur, dit-on, n’a encore osé s’approcher assez pour en pouvoir mesurer, même à peu près, la hauteur et la largeur.
A tous ces grands accidens de la nature, continue l’auteur, notre Europe n’offre de comparable que la chute de Terni en Italie, et celle de Lauffen, sous Schaffouse, où le Rhin se précipite, selon M. Coxe, de 70 à 80 pieds. Ce voyageur observe que la nappe d’eau est brisée par de grandes masses de rochers, et c’est avec sa hauteur, un second motif de la comparer à celle du Potomac. Quant à la chute de Terni, elle est la plus haute de toutes, puisqu’elle a 700 pieds de hauteur; mais le volume d’eau n’est pas très considérable.

|
De la rivière Génésée, qu’il appelle Casconchiagon, au tome troisième de ses Mémoires, publiés à Yverdun, en 1781. |
|
On a déjà vu, dans ce journal, des descriptions détaillées des chutes de Niagara, de Montmorency et de la Chaudière. |
Gorgias le Léontin avait acquis, par une étude de plus de soixante ans, une érudition si vaste, que sa tête pouvait passer pour une encyclopédie de sciences. Un jour, il osa proposer, à l’assemblée des jeux olympiques, de répondre à toutes les questions qu’on voudrait lui faire: et quoiqu’il y eût dans cette circonstance une foule de savans, capables, sinon de remporter, du moins de disputer longtemps la victoire, le mérite reconnu de Gorgias les empêcha de se montrer, et leur silence mit le comble à la gloire de ce philosophe. Pour honorer ses talons, et pour en perpétuer la mémoire, la Grèce entière fit ériger, dans le temple de Delphes, une statue d’or massive, qui représentait Gorgias un livre à la main.
Marguerite d’Ecosse, épouse de Louis XI, roi de France, voyant Alain Chartier, homme très savant, mais très laid, qui dormait dans une salle par où elle passait, s’approcha de lui, et lui baisa la bouche. Ses dames, surprises de cette bonté pour un homme aussi mal voulu des Grâces, qu’il était bien venu des Muses, lui en firent des reproches. “Ce n’est pas l’homme, que j’ai baisé, leur dit la princesse, mais la bouche d’où il sort, tous les jours, tant de belles choses.”—(L’Abeille Française.)

Extrait du discours de M. Villenave, à la séance du 18 Mai de la Société Philotechnique.
“......... Dans une petite république presque ignorée parmi nous, et que la politique de trois souverains, qui n’ont pu s’entendre pour sa possession, a laissée debout sur les débris de la Pologne, presqu’aux portes de Kracovie, est la montagne de Bronislawa (mot composé de deux autres mots qui signifient défendre la gloire.) C’est sur cette montagne que les Polonais ont voulu élever à Kosciuszko un monument que le despotisme ne pût abattre, qu’aucune révolution ne pût détruire, que le temps même ne pût outrager. Ce monument n’est donc ni une statue, ni un obélisque: c’est ... une montagne élevée sur une autre montagne; c’est un ouvrage de géants, continué pendant plusieurs années, naguère terminé, et qui a en pour but, non de détrôner quelque Jupiter de la terre, mais d’honorer éternellement un grand citoyen, qui avait défendu l’indépendance de son pays.
“La tombe du héros n’a point été placée au sommet du monument. Elle reste encore dans l’enceinte de la ville, sur la montagne de Wamel, où seul avec Joseph Poniatowski, Kosciuszko partage l’honneur de la sépulture des rois, et se place près du grand Sobieski.
“Un lustre entier à été employé à la création de cette montagne. On a souscrit dans toute la Pologne dans la Lithuanie, et jusque dans l’empire des Czars. Toute la jeunesse de Warsovie, la noblesse, les femmes, les vieillards, les enfans, ont remué la terre ou manié la bêche. Des rubans, des banderolles étaient attachés aux brouettes qu’un sexe délicat, qui a des émotions pour la gloire et qui sait les transmettre et les exciter, disputait aux hommes l’honneur de faire rouler sur les flancs de la montagne, de faire gravir sur ses étroits sentiers: c’était l’enthousiasme de tout un peuple; c’était l’élan patriotique d’une nation qui, effacée dans le présent, se cherchait dans l’avenir!....
“Ceux que l’éloignement retenait; ceux qui, trop affaiblis par l’âge, ne pouvaient travailler, envoyaient des contributions volontaires. Avec le produit de cette souscription nationale, un comité composé de professeurs de l’université, de membres de l’académie et de la société des sciences de Cracovie, a pu acheter le terrain qui descend de la montagne de Bronislawa et une vallée qui est à ses pieds, pour y établir une colonie de vétérans sous le nom de Koscinszko. Cette colonie va ouvrir un noble asile aux guerriers qui ont survécu au héros, et qui combattirent avec lui pour la liberté.
“J’ai cru, messieurs, devoir appeler un moment votre attention sur un des faits les plus mémorables de nos jours. Il annonce que les nations savent toujours manifester leurs sentimens, et voici une éloquence toute nouvelle: un peuple qui ne peut s’exprimer par la parole ou par les livres, et qui parle par des montagnes! Et voici encore un comité! Les grands intérêts de la Grèce, devenus ceux du monde civilisé, ont aussi fait établir des comités de secours dans presque toute l’Europe et jusque par-delà les mers qui séparent les deux hémisphères. On ne cesse de signaler un comité directeur: il existe en effet; mais ce n’est pas seulement à Paris, c’est ailleurs encore; autour et au loin de la France, on peut l’accuser, on peut le dénoncer. Ce comité directeur se compose de trois grands coupables: l’esprit humain, qui est en travail partout où il n’est point en marche; la civilisation, qui ne peut reculer; et le temps qui s’avance toujours.”

Mr. le Rédacteur—Vous trouverez dans le National Intelligencer du 31 Mai, une lettre du général Varnum, mentionnant la guérison d’un cancer (ou chancre) effectuée au moyen de la Pyrola. Je crois, monsieur, que vous rendriez service à l’humanité, en donnant à cette lettre une place dans votre journal; et vous pouvez ajouter la morceau suivant concernant la même plante, lequel je tiens d’un ami.
Quand les sauvages Osages étaient à Washington, un monsieur très respectable, qui ne perd aucune occasion d’ajouter au fonds des connaissances humaines, ou de soulager les affligés, leur demanda s’ils n’avaient pas découvert, dans les environs de cette ville, quelqu’une des plantes qu’ils regardaient comme médicinales dans leur tribu? “Oui, lui répondirent-ils, nous avons vu ici la reine des plantes, et nous le la montrerons.” Ils l’emmenèrent donc dans les bois, et lui montrèrent la plante qu’ils appellent Pipsissewa, comme je le tiens de la bouche de mon ami. On a fait depuis un grand nombre d’expériences sur l’usage de cette plante, dans les maladies cancéreuses les plus désespérées avec un succès étonnant.
D’après la description qu’on m’a faite de la plante, c’est la pyrola, et en cherchant, dans l’Encyclopédie de Rees, l’article Pyrola, vous trouverez, vers la fin, qu’il est dit que cette plante est en grande estime parmi les naturels de l’Amérique du Nord, sous le nom de Sissipewa.
Si je ne me trompe, cette plante est très commune dans ce pays, et les propriétés médicinales en ont été jusqu’à présent entièrement inconnues ou négligées. J’espère que cette petite notice portera ceux qui sont en état de le faire à donner des éclaircissemens sur le sujet.
Extrait de la lettre du Général Vernum à laquelle il est fait allusion dans l’article précédent.
“Il y a environ sept ans, ma femme fut attaquée d’un cancer à la cheville du pied, lequel crût avec une grande rapidité, et lui causa des douleurs qui devenaient de plus en plus aigües: elle en fut affligée de cette manière l’espace de neuf mois, durant lesquels on n’épargna ni peines ni soins pour lui procurer tout le soulagement qu’on pouvait attendre de la médecine et de la chirurgie. On essaya deux fois inutilement de déraciner le mal, en y appliquant des caustiques végétaux: plusieurs autres applications furent également sans succès. Le membre devint faible et parfois fort enflé. La plaie était large et profonde; et la malade avait perdu l’appétit et paraissait dépérir tous les jours. Dans cet état, nous commençâmes à faire usage du remède qui a produit sa guérison. Le principal ingrédient est une plante toujours verte, qui se trouve dans tous les états du nord, dans les terres à bois qui produisent un mêlange de chênes et de sapins. Le peuple lui donne differents noms: les botanistes l’appellent pyrola. Nous faisions une forte décoction, en faisant bouillir la pyrola dans de l’eau pure, mise dans un vaisseau contenant une grande quantité de souffre pulvérisé, et nous jettions la décoction dessus lorsqu’elle bouillait. Madame Varnum prenait une petite potion de cette décoction deux ou trois fois par jour, et en lavait la plaie et les parties adjacentes, plusieurs fois dans la journée, et tenait constamment sur la cheville un linge chaud trempé dedans. Elle prenait environ une once de sel médicinal commun, tous les deux jours. La décoction était renouvellée quand il en était besoin. Nous commençâmes ce système d’opération vers le milieu d’Avril, 1815, et nous le continuâmes sans interruption, ni relâche, ni variation. Au bout de quelques jours, la malade commença à en éprouver les heureux effets: ses douleurs s’appaisèrent peu à peu, et elle recouvra son appétit et ses forces, tant dans le membre affligé que dans tout son corps, et au bout de six semaines, sa plaie fut entièrement fermée et guérie, et sa santé parfaitement rétablie.”
Autre remède pour les cancers.
Réduisez en cendres un demi-boisseau ou trois picotins d’écorce de chêne rouge des champs; faites les bouillir jusqu’à ce que les trois gallons soient réduits à un; passez ce gallon au couloir, et faites le bouillir jusqu’à ce qu’il devienne une substance épaisse semblable à du lait de beurre ou à de la crême; étendez-en une petite quantité sur un morceau de soie ou de charpi de la grandeur de la place ou partie affectée. Dans plusieurs cas venus à ma connaissance, deux emplâtres ont suffi pour opérer une guérison complète, quand le cancer était dans un endroit d’où le remède pouvait pénétrer aussitôt jusqu’à sa racine; autrement, il faut plusieurs emplâtres, le remède devant être renouvellé toutes les deux heures, jusqu’à ce que les racines du cancer soient suffisamment amorties. Appliquez ensuite à la plaie une emplâtre consolidante mêlée d’un peu d’onguent mercurial, et pansez-la jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement guérie; ce qui arrivera au plus tard, au bout de vingt ou trente jours. J’ai connu plusieurs personnes qui ont été parfaitement guéries par la recette ci-dessus, laquelle n’a jamais failli en aucun cas. Ce remède a guéri en particulier un cancer qui avait été coupé deux fois par un habile chirurgien.
Ayant été moi-même très alarmé par un cancer, il y a environ trois ans, après avoir suivi pendant quelque temps les ordonnances d’un médecin très expert, j’appliquai au mal, contre l’avis du docteur et en dépit des craintes de ma famille, mais très heureusement pour moi, deux emplâtres du remède ci-dessus, avec le succès le plus complet; tellement qu’il n’a paru depuis aucun symptôme de la maladie.
WILLIAM LEIGH.
Nouvelle preuve de la vertu efficace de la Pipsissewa pour la guérison des cancers.
James Lewis, de ce comté, est venu nous trouver pour nous prier de faire savoir qu’il a été guéri d’un cancer avancé, dans l’espace de trois semaines, au moyen d’une espèce de thé ou tisanne de Pipsissewa, et d’une forte décoction de la même plante appliquée sur la plaie. Le cancer était sur sa joue, et la cicatrice, qui parait encore, montre qu’il avait déjà fait des progrès alarmants. Il affirme que cette plante guérit d’autres éruptions.—(Gazette de Kentucky.)

Monsieur le Rédacteur—Ayant vu dans votre journal plusieurs articles concernant le Chardon du Canada, et ayant eu la satisfaction d’en détruire plusieurs touffes, par un procédé différent de ceux que j’ai vu recommander, je me sens disposé à le communiquer au public.
En 1822, je découvris le chardon du Canada dans un pâturage où je tenais vingt moutons. Je les fauchai deux ou trois fois par un temps humide; mais ils n’en parurent que croître davantage, et le printemps suivant, ils s’étaient étendus sur beaucoup plus de terrain qu’ils n’en avaient occupé d’abord, et étaient beaucoup plus forts. Je les fis couper de nouveau. Je pris ensuite environ deux pintes de sel, que je répandis dessus, et les moutons, qui en étaient affammés en mangèrent autant qu’ils purent, et continuèrent à se tenir sur le lieu, jusqu’à ce qu’ils eussent écrasé et enfoui dans la boue les chardons et les autres herbes. Je continuai à répandre du sel sur les chardons, une ou deux fois par semaine, pendant plusieurs mois; je mis d’autres animaux dans l’enclos; en peu de temps, le terrain se trouva presque nu, et le peu de chardons qui y restaient se couvrirent de rouille. Je labourai le terrain, le printemps suivant; je l’ensemençai ensuite, et je crois qu’il n’y reste pas présentement un seul chardon. J’en découvris une autre touffe dans une autre pièce de terre; je la traitai de la même manière; et j’y ai maintenant une pièce de grains, où j ai la satisfaction de dire qu’on ne voit plus de chardons.—(Gazette de Worcester.)

A tout enfant encor dans le bas-âge
On va porter et bonbon et joyau;
On le caresse, on parle son langage:
Chéri partout, c’est l’Amour au berceau.
A quatorze ans, il ne cherche qu’à plaire,
Il s’adonise avec un soin nouveau:
Cheveux frisés, parure régulière,
Air composé; c’est l’Amour au pinceau.
A quarante ans, capricieux, volage,
Il quitte Iris, Catin, Lise, Isabeau:
D’un vin fumeux vient-il de faire usage,
Il les reprend; c’est l’Amour au tonneau.
A soixante ans, le désir seul l’agite,
Mais le plaisir lui serait un fardeau:
Il cherche en vain la gaité qui l’évite;
Rien ne lui plaît; c’est l’Amour au tombeau.
———————
Nargue du temple de la gloire,
Où l’on ne vit qu’après la mort!
Nargue des filles de mémoire!
Leur ton et me glace et m’endort.
Ici, sans grimper sur leurs traces,
Nous allons trouver de plain-pié,
Du bon vin servi par les Grâces,
Dans le temple de l’amitié.

En parlant, au Tome III, No. 4, de la Bibliothèque Canadienne, des Sources Minérales de notre pays, nous avons oublié de faire mention d’une des principales, qui est celle de Ste. Marie de la Nouvelle Beauce. Voici ce qu’en disait la Gazette de Québec du 31 Août 1818.
“Une précieuse source d’eau minérale très limpide, découverte depuis peu, près de l’église de Ste. Marie dans la Nouvelle Beauce, a excité considérablement l’attention du public. La découverte de cette source combinée avec les avantages locaux de cette belle paroisse, pourra attirer dans la Beauce un grand concours de dames et de messieurs, durant l’été. Cette source est sur le terrain de l’honorable juge Perrault, qui est, dit-on, disposé, ainsi que Messieurs Taschereau, seigneurs de la paroisse, à donner toute sorte de facilité aux messieurs qui voudront y bâtir des maisons de campagne, en concédant des emplacemens convenables le long de la rivière Chaudière, qui, dans cet endroit, a plus de deux arpens de largeur. On a déjà construit un bâtiment de briques près de l’église, et l’on dit qu’en y peut bâtir en briques avec un tiers moins de dépenses que si l’on y bâtissait en pierres ou en bois.”
Monsieur—Les qualités médicinales de plusieurs sources d’eau minérale, tant en Europe qu’en Amérique, sont bien connues: l’Allemagne et l’Angleterre sont célèbres par leurs eaux médicinales, et l’Amérique ne leur cède point en célébrité sous ce rapport: les sources de Walston et de Saratoga dans l’état de New-York, sont en grande réputation, et l’on s’y rend de toutes les parties du Canada et de l’Union américaine. Que plusieurs des indispositions du corps humain soient guéries, ou soulagées par l’eau minérale, c’est ce qui est connu et avoué par tout le monde. Mais le public n’est pas encore généralement informé que nous jouissons en Canada de ce bienfait de la providence. Les sources minérales qui se trouvent près des moulins de Mr. Leinhi, dans le township de Cornwall, dans le Haut-Canada, méritent d’attirer l’attention du public. Elles coulent hiver et été, et sont connues dans le voisinage depuis plusieurs années: il a été opéré par leur moyen des cures remarquables, et tous les ans, dans les mois de Juin, Juillet et Août, il s’y rend une foule de personnes de toutes les classes. C’est surtout depuis deux ans que leurs vertus ont généralement été connues et estimées. L’eau en est extrêmement légère, contenant une grande portion d’esprit minéral subtilisé et une petite portion de terre; elle est tant soit peu ferrugineuse (chalybeate), purgative et altérative. Il conste qu’elle a soulagé un grand nombre de personnes dans les diverses indispositions des reins: elle a la vertu d’adoucir les humeurs âcres et vicieuses, et de prévenir les maladies provenant de ces causes. Elle provoque admirablement la digestion, et fait disparaître les obstructions de divers genres. Elle produit des effets surprenants dans les affections goutteuses (rheumatic) athérétiques et scorbutiques, et effectue promptement et radicalement la guérison de plusieurs des maladies de la peau; nettoie et ferme les ulcères. On a vu des personnes venir, ou se faire porter à ces sources, le corps tout couvert de pustules ulcéreuses, et s’en retourner parfaitement nets et guéris, au bout de quelques semaines. Ces eaux ont aussi guéri des rhumatismes bilieux et des convulsions: enfin leurs vertus sont connues par expérience de plusieurs centaines de personnes des deux sexes; mais il arrive souvent que nous prisons d’autant moins une chose qu’elle est plus près de nous, et conte moins. Il reste à ajouter à cette communication, que si quelques uns étaient portés à douter de la vérité de ces assertions, on leur citerait, aux sources, des personnes et des maladies guéries, autant qu’il serait nécessaire pour les satisfaire.
A. B.
Williamstown, 7 Juillet, 1828.
N. B.—Si tout ce qu’on dit, ou seulement la moitié de ce qu’on dit ici de ces sources, est véritable, elles méritent bien de devenir aussi célèbres et aussi fréquentées que celles de Saratoga et de Walston. Le voyage à Cornwall est aussi agréable, et moins conteux, du moins pour les habitans de la ville et d’une grande partie du district de Montréal, que celui de Saratoga. Il se fait, comme on sait, par bateau à vapeur, de La Chine aux Cascades, et du Coteau du Lac jusqu’à Cornwall même. Sur toute la route entre ce village et Montréal, le pays offre une diversité de sites, de scènes et d’objets qui ne peuvent que frapper agréablement les regards du spectateur, et lui faire considérer le voyage comme une promenade des plus divertissantes.

Développement extraordinaire des facultés intellectuelles et morales, à la suite de certaines maladies.
Pendant le séjour que les envoyés des Etats-Unis firent à Fond du Lac, pour négocier un traité avec les peuplades indigènes répandues autour du lac Supérieur, M. MacKenney, membre de la légation, fit de fréquentes visites à une jeune Indienne de quinze à seize ans, attaquée d’une hémiplégie dont les effrayans progrès annonçaient la fin prochaine de cette infortunée. Une couche de roseaux étendus sur la terre était son lit de douleur. On lui prodiguait toutes les ressources de la médecine des sauvages, c’est-à-dire que les sorciers s’évertuaient autour d’elle, pour chasser la maladie; mais la jeune fille avait perdu tout espoir. Elle ne s’occupait que du soin de consoler ses parens et de leur inspirer la résignation dont elle donnait l’exemple. Cette touchante piété filiale augmentait chaque jour l’intérêt que M. MacKenney portait à sa maladie; ce qu’il admirait surtout en elle, c’était une raison supérieure, une justesse d’idées et d’expressions, dont il semble qu’une intelligence non cultivée n’est pas susceptible. Il n’eut pas le tems d’observer jusqu’au bout ce phénomène si digne d’attention, et ce qui l’affligea beaucoup, il ne put rien faire pour lui rendre la santé; il n’y avait point de médecin attaché à la légation, et M. MacKenney n’était que militaire. D’ailleurs, l’état de la malade ne laissait plus d’espérance; les nerfs optiques étaient paralysés, de manière que l’infortunée était aveugle.
Un voyageur à observé, dans une région montagneuse de la France, un fait analogue à celui que M. MacKenney a vu sur le lac Supérieur. Dans un village de la Lorraine, où il s’était arrêté la nuit, ce voyageur fut conduit par son hôte dans la chambre qui lui était destinée; il fallait, pour cela, traverser une pièce où la jeune fille de la maison reposait sur un lit. “Ne faites pas de bruit, dit le malheureux père, notre pauvre fille dort peut-être, et cela lui arrive si rarement! son sommeil nous est si précieux! en vérité, cet enfant vaut mieux que nous tous.” Malgré les précautions du père et du voyageur, la jeune malade entendit le bruit que l’on ne put se dispenser de faire en ouvrant la porte de sa chambre; elle appela son père, d’une voix si douce, qu’elle semblait résonner sur le cœur; la conversation s’engagea. “Ses idées, dit le voyageur, ne s’étendaient pas hors du cercle qu’elle avait parcouru, c’est-à-dire des objets qu’elle avait vus, et des livres qu’elle avait pu lire et comprendre; mais, sur tout ce qui était à sa portée, ses notions étaient si justes, si nettes, si lucides; elle en parlait avec une propriété d’expressions si remarquable, qu’il était impossible de ne pas admirer la précision et l’admirable simplicité de son langage. Chacune de ses pensées manifestait si bien la céleste pureté de son âme! Son père avait raison: on ne pouvait s’empêcher d’en convenir après l’avoir vue et entendue; et cependant sa famille valait beaucoup: elle était très estimée dans le village, et tous les habitans s’affligeaient d’avance du malheur dont elle était menacée.”
Une petite-vérole répercutée avait mis cette jeune fille dans l’état déplorable où le voyageur la vit. La maladie avait épargné son beau visage, dont la pâleur n’affaiblissait point l’aimable expression; elle a succombé sans doute. Il semble que les êtres de cette nature n’apparaissent sur la terre que pour y laisser de longs regrets.
On pourrait multiplier les citations et rapporter beaucoup d’autres exemples, presque tous de jeunes filles qui ont acquis, au pris de leur santé, et le plus souvent de leur vie, une intelligence et des qualités peu communes. Cette singulière influence des maladies tient-elle à l’organisation du sexe féminin? Avant de s’occuper des moyens de résoudre cette question, il serait indispensable de constater les faits dont on aurait à rechercher la cause. Ces faits ont été observés et recueillis par des hommes: ils n’ont pu voir, sans une profonde émotion, dans un être faible et délicat, la force morale aux prises avec les souffrances physiques. L’observateur était peut-être trop affecté pour conserver cette indifférence philosophique qui laisse voir les choses telles qu’elles sont. Les recherches le cette nature sont plus difficiles qu’on ne le pense, et, pour les faire avec succès, il ne suffit pas d’être médecin.
M. Bianchi rend compte (à la Société Géographique de Paris) de la Relation des Voyages de Sidi-Aly, fils d’Housein, amiral de Soliman II, traduite de l’allemand de M. Diez, par M. Moris.
Sidi-Aly, surnommé Kiatibi-Roumi, fils de Hussein, inspecteur des chantiers impériaux, fut un des marins les plus célèbres et les plus instruits de l’empire ottoman au seizième siècle. Il fit ses premières armes sous Khaireddin (Barberousse), et fut ensuite chargé par Soliman, comme amiral de la flotte d’Egypte, de réunir à Suez les flottes ottomanes qui se trouvaient dans le golfe Persique et dans la mer des Indes. Plusieurs fois Sidi-Aly se mesura avec succès contre les escadres portugaises dans ces parages. Mais une tempête, en dispersant ses vaisseaux, en fit échouer plusieurs et le jeta lui-même sur la côte de Guzerate. Il vendit les débris de sa malheureuse flotte au sultan de cette contrée, et une partie de ses troupes s’enrôla dans l’armée des Indiens. Quant à lui, accompagné de 50 des siens, il prit le parti de retourner à Constantinople par terre. C’est de la relation de ce voyage que se compose la plus grande partie de l’ouvrage traduit par M. Moris. De 1553 à 1556, Sidi traversa le Guzerate, le Sind, le Zaboulistan, le Bedackchan, le Kotlant, le Maveraennehar (ou la Transoxane) et le désert de Keptchak. Ici, dit le rapporteur, l’impossibilité d’aller plus avant obligea le voyageur de rétrograder vers le S.-O., et lui fit découvrir une nouvelle route par le Khowarezru, le Khorassan, le Perse et le Kurdistan: ce fut de là qu’il revint par la Mésopotamie et la Romélie à Constantinople. Cette Relation se recommande autant par les faits historiques que par les détails curieux qu’elle contient sur les localités, les mœurs, les usages, les croyances et l’histoire naturelle des contrées parcourues. Sidi-Aly, ajoute M. Bianchi, d’après le sentiment de Hadji-Khalfah, se montra aussi savant dans la science de la navigation et de l’astronomie qu’habile écrivain en vers et en prose. Dans le cours de son voyage, ses talens furent d’un grand secours à plusieurs des princes auprès desquels il séjourna. Il les aidait dans leurs guerres, servait de médiateur dans leurs différens, et les charmait par ses poésies. Chaque prince lui fit les propositions les plus avantageuses pour le retenir près de lui. Le sultan de Delhi le fit rétrograder de Lahore pour mettre à profit ses connaissances dans l’astronomie, et le combla de largesses. Le sultan de Guzerate lui offrit le pays de Bardedj, et le Khan des Usbecks voulut lui faire accepter la ville de Boukhara. Mais son amour pour la patrie autant que son attachement pour la maison ottomane l’emporta dans Sidi-Aly sur toutes les offres de fortune.
On a de lui plusieurs ouvrages: 1º le Mouhit (Océan,) qui traite de la mer des Indes; 2º un traité sur l’emploi de l’astrolabe, ou quart de cercle, etc. intitulé: Miroir de l’Univers; 3º une traduction du livre des conquêtes, intitulé: Futouhué.
Depuis se mort, l’armée navale des Turcs n’a point eu d’hommes qui l’aient égalé jusqu’au tems de Hadji-Khalfah: telle est du moins l’opinion de Hadji-Khalfah lui-même. Cependant M. Bianchi pense que les hommes de mer auxquels on pourrait sous quelques rapports le comparer dans ces derniers tems, sont Hassan-Pacha et Hussein. Le premier est connu par ses combats contre les Russes dans la mer Noire, et le second par les améliorations si importantes qu’il a introduites dans la marine ottomane.
Une dame anglaise, âgée de soixante-quinze ans, écrivit de Londres à son fils, à Paris: “Mon cher Guillaume, je me suis enfin décidée à t’aller rejoindre à Paris: comme je ne veux pas avoir l’air d’une sotte à mon arrivée, j’ai l’intention, avant mon départ, de consacrer trois mois à apprendre le français par principes. La reine Elisabeth, selon ce que nous dit Ascham, apprit complétement le latin entre Pâques et Noël; pourquoi n’apprendrais-je pas, dans le même temps, une langue plus aisée?”
Réponse.—“Ma chère mère, conformément à votre demande, je vous envoie les meilleurs écrivains sur la langue française; ce sont Grammaire du Dufief, 2 vol. in-8º; Dictionnaire de Lavaux, 2 vol. in-4º; Traité des difficultés de la langue française, par le même, 2 vol. in-8º en 1,400 pages à double colonne; je suis fâché que le caractère en soit si menu, mais il n’y en a pas d’autre; Dictionnaire des Synonymes, par Lavaux, 2 vol. in-8º, même caractère. Ainsi, vous voyez que vous n’avez qu’à étudier la grammaire, parcourir les dictionnaires, et apprendre par cœur, 2,800 pages de difficultés, et à peu près 2,000 pages de synonymes. Il y a beaucoup d’autres bons livres sur cette matière; mais ce petit nombre suffira pour remplir vos vues.
“Dans le vif espoir de vous voir dans trois mois, je suis votre fils affectionné.—Signé G. Durham.”

En lisant les fables du modeste et bon Lafontaine, qui n’a point admiré celle de la laitière et du pot au lait?
Cette fiction ingénieuse, qui, dans l’accident de la laitière, a pour but de prouver la fragilité des calculs humains, a beaucoup d’analogie avec celui que vient d’éprouver la fille Jarly, et qui a donné lieu à une action devant le tribunal de simple police.
Caroline Sarlo est propre aux spéculations, elle possède au plus haut degré l’intelligence du commerce, elle se livre particulièrement au monopole des œufs et des fromages, aussi tout le canton de Seignelai se plait à protéger l’activité et l’industrie de la jeune et jolie biquetière! c’est le terme du pays.
La foire d’Auxerre approche, la vente sera sûre, le bénéfice réel; il ne faut pas laisser échapper une pareille occasion, aussi Caroline se met-elle en quête et bientôt dans son magasin sont réunis 100 œufs et 100 fromages.
Comme fortune pour elle ne fait que de commencer, elle n’a pas encore de voiture, mais elle possède un coursier à longues oreilles, le plus docile animal de la contrée.
Au jour indiqué, deux paniers, l’un contenant les œufs, l’autre les fromages, sont placés sur le dos du patient aliboron, et dès le matin Caroline, son sceptre à la main le dirige vers la ville; il suivait tout pensif le chemin de Monterean à Auxerre en longeant un fossé plein d’eau, tandis que Caroline non loin de lui, songeant à son petit bénéfice, fredonnait griment un air villagegeois; mais hélas! sa gaité ne sera pas de longue durée.
Bientôt au-devant d’elle et sur la chaussée se présentent trois chartiers de bateaux, ayant chacun un trait composé de trois chevaux: on sait que ces messieurs ne sont pas très civilisés, ce n’est pas parmi eux que l’on rencontre l’urbanité, la politesse française; Caroline en fait une triste expérience.
Se faisant d’avance un malin, ou plutôt un cruel plaisir du tort et du chagrin qu’ils vont faire éprouver à la pauvre Caroline, dont l’air décent, la figure, la taille légère devraient leur inspirer tout autre sentiment, ils quittent la chaussée, mettent leurs chevaux au trot; l’un d’eux accroche un des paniers, l’âne chancelle, perd l’équilibre, et voilà Martin qui plonge jusqu’au cou dans l’eau avec ses marchandises.
Le pauvre animal veut se relever; en se débattant il broye tous les œufs, et oncque de la vie on ne vit omelette plus copieuse, tandis que tous les fromages surnageant les uns sur les autres, se décomposent, se divisent et disparaissent sous les eaux.
Caroline éplorée voit dans un instant se détruire toutes ses espérances et le fruit de ses économies. Son compagnon d’infortune est prêt à périr; elle se jette dans le fossé et embrasse martin dans l’attente d’une mort prochaine, car, les quatre pattes en l’air, il buvait déjà à longs traits; quelqu’un vient au secours, le baudet gagne la rive, et Caroline en est quitte pour ses œufs brisés, ses fromages fondus et toutse ses espérances déçues.
Mais plus heureuse que Perrette de Lafontaine, il lui restait la ressource d’une demande en dommage et intérêts, qui a été accueillie, et a réussi malgré tous les efforts faits pour tromper la justice sur les véritables coupables: des témoins, consciencieux amis de la vérité, ont dissipé le nuage qui la voilait, le malveillant à été reconnu et puni d’une condamnation à l’amende, et à cinquante francs de dommage en intérêts envers Caroline.

Tel est le titre d’un petit ouvrage qui vient de nous être communiqué. Nos lecteurs verront sans doute avec plaisir qu’il est d’un de leurs compatriotes. Nous regrettons que le temps et l’espace nous manquent pour en faire l’analyse; peut-être aussi fandrait-il être médecin pour la faire convenablement. Nous nous contenterons donc de recommander aux messieurs de la profession de se procurer ces opuscules, comme l’auteur les appelle, et pour leur en donner le désir, nous leur mettrons sous les yeux les deux extraits qui suivent.
“Les fragmens qui font le sujet de cette brochure (dit l’auteur, par voie d’introduction,) ont été présentés à deux sociétés sa vantes de Paris, qui en ont ordonné l’impression, et qui ont admis l’auteur au nombre de leurs membres.
“La Gazette de Santé, dans sa revue mensuelle, a distingué ce travail, qu’elle a jugé digne de l’attention et des réflexions des médecins français. Malgré l’importance, un peu exagérée peut-être, que l’on a bien voulu accorder à ces opuscules, faits à la hâte, je suis loin de me dissimuler leur imperfection. Et pour ne parler que de la Note sur les fièvres bilieuses, elle seule eût pu fournir la matière d’un long volume: mais le temps, l’absence des documens indispensables, et une infinité d’autres difficultés qui entourrent un étranger, m’ont mis dans l’impossibilité de remplir un but aussi important.”
Voici la début de la Note sur les fièvres bilieuses, dont il est parlé ci-dessus:
“Sandwich est une paroisse située entre le lac Erié et le lac Huron, sur les bords du détroit qui sert de communication à ces deux lacs. C’est un pays très plat, continuellement couvert d’eaux stagnantes que les chaleurs de l’été dessèchent partiellement; du reste, peu cultivé. Les bords du détroit fournissent, par leur grande fertilité, au-dela du nécessaire pour les besoins particuliers du petit nombre d’individus qui l’habitent. Les effluves marécageux qui se dégagent pendant l’été, sont la cause incontestable d’une épidémie de fièvre bilieuse qui attaque tous les ans ce pays, au mois de Septembre. J’ai été à même d’observer cette maladie pendant trois années consécutives, et j’ai pu remarquer que, tous les ans, elle avait un caractère particulier, qui la dominait, au point d’obliger les médecins à changer le traitement dans sa base. Ainsi, en 1819, elle était accompagnée de la plupart des symptômes de l’hépatite; en 1820, ce fut une péripneumonie; en 1821, ni le poumon ni le foie ne furent effectés, mais l’estomac. Quand je dis que c’était une fièvre bilieuse avec hépatite, ou péripneumonie, ou gastrite, je ne veux pas qu’on croie que le symptôme que je signale était la maladie elle-même; car la maladie existait avant que le symptôme apparût, et elle existait encore quand il était dispart, et il fallait toujours traiter la fièvre quand on avait guéri le symptôme. La preuve encore, c’est que la maladie principale se terminait toujours par une crise commune aux trois années, telle que des sueurs copieuses ou des évacuations alvines, ou bien les unes et les autres à la fois, selon les sujets; et cette crise n’influait en aucune manière sur la disparition de l’hépatite, de la péripneumonie ou de la gastrite, puisque toutes les traces de ces affections avaient déjà disparu par les moyens appropriés, quand arrivait la crise qui amenait une franche convalescence. Je sais combien cette manière de voir diffère de l’opinion émise et soutenue avec opiniâtreté par quelques médecins français, qui sont persuadés que tous les symptômes morbides ont pour cause un mal local et circonscrit dans une partie déterminé de l’organisme. J’ai fait tons mes effets pour constater la réalité de cette manière de voir, et je pense qu’elle ne peut pas être adoptée d’une manière absolue.—Il y a certainement plusieurs maladies dont la nature a été beaucoup éclairée par la localisation; mais toutes ne sont pas de ce nombre, et je suis d’avis que les maladies bilieuses dont je parle doivent en être retranchées, comme je crois qu’on en trouvera la preuve dans les observations suivantes, que je regarde comme le type des épidémies de 1819 et de 1820.”
Nous regrettons de n’avoir pas de place pour ces observations (maladie et traitement), non plus que pour les réflexions dont elles sont suivies.
Mr. le Dr. Doucet, (qui est revenu de France à New-York, à ce que nous croyons), se propose de publier sur le même sujet des fièvres bilieuses automnales du Détroit, un ouvrage beaucoup plus étendu que celui dont nous venons de parler.

A Lotbinière, le 1er de Juillet courant, par Messire Daveluy, Mr. J. B. Morand, Marchand, à Dlle. Luce Hélène L’Heureux;
Aux Trois-Rivieres, le 14, par Messire Cadieux, L. C. Cressé, écuyer, Avocat, à Dlle. Julie Angélique Badeaux, fille de Joseph Baddaux, écuyer, Notaire du Roi pour le district;
A Montréal, le 21, Mr. E. M’Kay, Marchand, à Dlle. Luce Boucher, tous deux de cette ville:
A Québec, le 29, par Mgnr. le Coadjuteur, André Lauchlin Fraser, écuyer, Seigneur de St. André, à Dlle. Julie Pouliot, de Québec;
Dernièrement, à Montréal, Daniel Salmon, écuyer, Avocat, à Dame Veuve Wm. Porteous, ci-devant de Laprairie.
Le 14 du courant, à Québec, Messire Louis Desfossés, un des Chaplains de l’église de St. Roch, âgé de 26 ans;
Le 15, à St. Charles, (River Boyer,) Hubert Turgeon, écr., Seigneur du dit lieu, âgé de 24 ans;
Le 17, à Berthier, Messire Ceramt, Vicaire, âgé de 70 ans.
Le même jour, à l’Islet, J. F. Couileard Després, écuyer, Major de milice, et ci-devant membre de la Chambre d’Assemblée, âgé de 64 ans;
Le 19, à Laprairie, Mr. Jean Forton, âgé de 78 ans;
Le même jour, à St. Eustache, à l’âge de 13 ans, Dlle. Eulalie Dumont, fille d’E. N. L. Dumont, écuyer, Seigneur de la Rivière du Chêne;
A Halifax, le 20, à l’âge de 34 ans, Mr. Edward Pyke, fils de J. G. Pyke, écuyer, et frère de l’honorable Juge Pyke, de Montréal;
A Montréal, le 29, Dame Catherine Roy, veuve de feu Mr. C. S. Delorme, âgée de 81 ans.
Printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Mis-spelled words and punctuation have been maintained except where obvious printer errors occur.
[The end of La Bibliothèque canadienne, Tome VII, Numero 2, Juillet 1828. edited by Michel Bibaud]