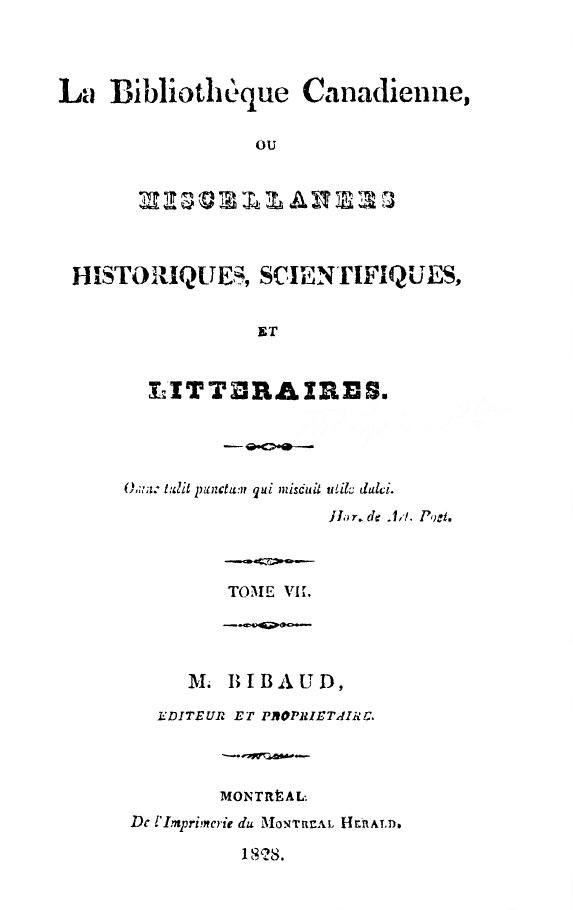
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque Canadienne, Tome VII, Numero 1, Juin, 1828.
Date of first publication: 1828
Author: Michel Bibaud (editor)
Date first posted: May 14, 2020
Date last updated: May 14, 2020
Faded Page eBook #20200540
This eBook was produced by: John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
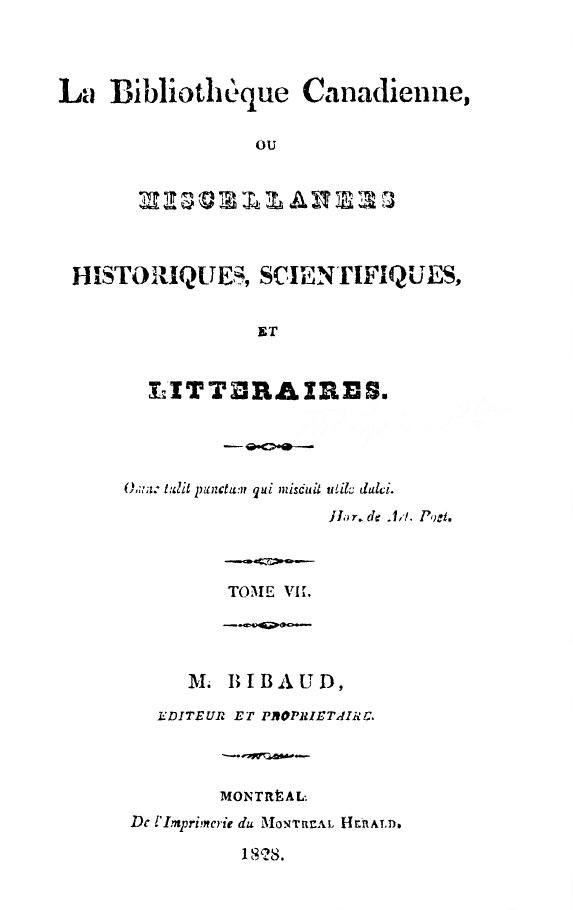
La Bibliothèque Canadienne
| Tome VII. | JUIN, 1828. | Numero 1. |
Les autres études ne sont ni de tous les âges, ni de tous les temps, ni de tous les lieux; mais les lettres sont un aliment pour la jeunesse, et une recréation pour la vieillesse: elles sont un ornement dans la prospérité; un refuge et une consolation dans l’adversité: elles égaient au dedans; elles n’embarrassent point au-dehors: elles veillent avec nous, elles voyagent, elles demeurent à la campagne avec nous.—Ciceron.
Heureux le sage instruit des lois de la nature,
Qui du vaste univers embrasse la structure.
O vous à qui j’offris mes premiers sacrifices,
Muses, soyez toujours mes plus chères délices!
Dites-moi quelle cause éclipse dans leur cours
Le clair flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours;
Pourquoi la terre tremble, et pourquoi la mer gronde;
Quel pouvoir fait enfler, fait décroître son onde;
Pourquoi de nos soleils l’inégale clarté
S’abrège dans l’hiver, se prolonge en été;
Comment roulent les deux, et quel puissant génie
Des sphères dans leurs cours entretient l’harmonie.—Virgile.
Du globe tu peignis les visibles beautés,
Ses riches ornemens, ses aspects enchantés;
Ose plus aujourd’hui: pénètre sa structure,
Ses vastes fondemens, sa noble architecture,
Les formes, les couleurs, les principes des corps,
Et leur guerre féconde, et leurs secrets accords;
Suis dans tous ses degrés la nature vivante;
Fais naître les métaux, fructifier la plante;
Soumets la brute à l’homme, élève l’homme à Dieu.—Delille.
Combien de l’homme encor les étonnants ouvrages
Secondent dans leurs jeux la nature et les âges!
En limpide nectar il fond les végétaux;
Le fer se tourne en cendre, et la cendre en métaux.
Heureux donc le rival de la toute-puissance,
Qui des êtres divers analysant l’essence,
Les détruit, les refait, les combine à son gré.—Idem.
Au milieu de ces hostilités, il y eut quelques lueurs de paix. Le 10 Juin (1693), Tareha, chef onneyouth, arriva à Montréal avec un habitant de cette ville, nommé St. Amour, qui était captif chez les Iroquois depuis quatre ans. Il proposa au chevalier de Callières l’échange de cet homme avec un de ses neveux, et lui remit une lettre du P. Millet, toujours prisonnier à Onneyouth. Ce religieux mandait que Tareha était bien intentionné, et qu’on pouvait ajouter foi à ce qu’il dirait.
M. de Callières l’envoya incontinent à Québec, où le comte de Frontenac lui accorda de bonne grâce l’échange qu’il demandait. Ce bon accueil l’ayant enhardi, il présenta au comte des colliers de la part des principales cabannes, ou familles d’Onneyouth; et pour convaincre le général de la droiture de sa conduite, il l’avertit de se tenir sur ses gardes, particulièrement au temps de la moisson. Tout en donnant cet avis, Tareha assura que les Cantons n’étaient pas éloignés de faire la paix; que les familles qui l’avaient député la souhaitaient avec ardeur, depuis longtemps, et que si elles avaient différé à la demander, c’était uniquement par la crainte de paraître devant leur père irrité; qu’il s’était enfin risqué pour le bien public, espérant que sa franchise ferait sa sureté.
Le comte de Frontenac était trop accoutumé à ces sortes de protestations pour s’y laisser tromper, et le témoignage d’un missionnaire qui n’était pas libre, ne lui paraissait point une preuve suffisante de la sincérité de celles de Tareha: il répondit néanmoins à ce chef, que quoique la perfidie des Onnontagués à l’égard du chevalier d’Eau et des Français qui l’accompagnaient, et les cruautés inouies que les Iroquois exerçaient journellement sur les prisonniers français, l’autorisassent à user de représailles, il voulait bien encore écouter un reste de tendresse pour des enfans qui ne méritaient plus ce nom; qu’il n’avait donc rien à craindre, ni pour sa vie, ni même pour sa liberté; mais que si les Cantons voulaient sincèrement entrer en négociation, ils se pressassent de lui envoyer des députés; qu’il voulait bien encore avoir patience jusqu’à la fin de Septembre; mais que, ce terme expiré, il n’écouterait plus que sa juste indignation. Tareha promit d’être de retour à cette époque, quelque chose qui pût arriver, et reprit le chemin d’Onneyouth.
Peu de jours après, St. Michel, qui s’était échappé d’Onnontagué, où il avait été conduit, l’année précédente, arriva à Québec, et rapporta que les Anglais avaient construit, dans la principale bourgade de ce canton, un fort à huit bastions et à trois enceintes de palissades, pour servir de refuge aux femmes, enfans et vieillards, en cas d’attaque de la part des Français: il ajouta que huit cents Iroquois étaient sur le point de se mettre en campagne, pour empêcher les colons de faire leur récolte; et que les Cantons n’avaient jamais été plus éloignés de faire la paix qu’ils ne l’étaient alors, quoique plusieurs familles onneyouthes parussent fort lasses de la guerre.
Dans le temps que St. Michel parlait ainsi, les huit cents Iroquois étaient déjà aux Cascades, à l’extrémité du lac St. Louis. Sur l’avis qu’en reçut le gouverneur général, il fit partir le chevalier de Vaudreuil avec cinq compagnies d’anciennes troupes de ligne et cent soldats de recrue, qui venaient de lui arriver de France. De son côté, le gouverneur de Montréal avait assemblé nu corps de sept à huit cents hommes, et il marcha à leur tête jusqu’aux Cascades; mais ni M. de Callières, ni le chevalier de Vaudreuil ne trouvèrent plus l’ennemi: il avait décampé, à la nouvelle des préparatifs qui se faisaient contre lui.
On apprit en même temps que le grand armement qui s’était fait à Boston, et qu’on avait cru destiné à attaquer Québec, avait été attaquer la Martinique, et y avait échoué, avec une perte considérable. Les trois mille hommes qui devaient faire une irruption par terre, ne parurent pas non plus; et pour comble de bonheur, on vit arriver à Montréal, le 4 Août, deux cents canots chargés de pelleteries, sous la conduite du sieur d’Argenteuil. Ce grand convoi portait pour près de cent mille francs de castor, et les principaux chefs de toutes les tribus du nord et de l’ouest, à l’exception de celle des Miamis, y étaient en personne. Dès que M. de Frontenac en eut reçu la nouvelle, il partit pour Montréal, et y arriva escorté de ces mêmes chefs, qui étaient allés au-devant de lui jusqu’aux Trois-Rivières. Dès le lendemain, il se tint un grand conseil où tout se passa à la satisfaction des assistans. L’orateur huron parla longtemps, et fit un grand récit de toutes les expéditions que sa tribu avait faites contre les Iroquois. Les autres se contentèrent de dire qu’ils étaient venus pour entendre la voix de leur père, pour recevoir ses ordres, et le prier en même temps de leur faire donner à un prix modéré les marchandises dont ils avaient besoin.
M. de Frontenac n’épargna rien pour achever de s’attacher toutes les tribus dont les députés se trouvaient à Montréal: tous ces sauvages partirent charmés de ses manières et comblés de ses présens. Il les fit suivre de près par un grand nombre de Français, sous la conduite du chevalier de Tonti, qui continuait de commander aux Illinois, et que ses affaires avaient obligé de descendre à Québec. MM. de Courtemanche et de Mantet furent de ce voyage, ainsi que M. d’Argenteuil, qui fut nommé lieutenant de M. de Louvigny; M. Le Sueur, qui fut chargé de faire un établissement à Chagouamigon, et Nicholas Perrot, à qui le gouverneur recommanda d’empêcher de gré ou de force les Miamis de traiter avec les Anglais, de qui ces sauvages avaient reçu des présens, par l’entremise des Mahingans.
On apprit, dans le même temps, que le fort Ste. Anne de la Baie d’Hudson avait été pris par les Anglais, au commencement de Juillet. Trois vaisseaux de cette nation avaient hiverné à soixante-dix lieues de ce fort, et s’en étaient approchés, dès que la navigation avait été libre. Ils s’étaient bien douté que la garnison était faible, mais ils n’auraient jamais pu s’imaginer qu’elle ne consistât qu’en quatre hommes, dont l’un était aux fers pour cause de meurtre.
Les Anglais avaient débarqué quarante hommes pour attaquer le fort: les trois Français en tuèrent d’abord deux, et contraignirent ensuite les autres de s’éloigner. Mais les Anglais ayant appris de quelques sauvages l’état de la place, et le nombre de ceux qui la défendaient, ils eurent honte d’avoir reculé devant trois hommes, auxquels néanmoins ils firent l’honneur d’en opposer jusqu’à cent. Ces braves comprirent qu’il leur serait impossible de résister à tant de monde; mais ne voulant pas devenir prisonniers de guerre, ils trouvèrent le moyen de s’embarquer dans un canot, sans être appercus, et furent assez heureux pour se rendre à Québec sans accidens. Ils y trouvèrent le gouverneur général fort chagrin de ce que le retardement des vaisseaux de France avait fait manquer encore une fois l’expédition depuis si longtemps projettée contre le Port Nelson.
Vers la fin de Septembre, Tareha revint à Québec, suivant sa promesse, et y amena une femme onneyouthe, que le seul désir de voir le comte de Frontenac, avait engagée à faire ce voyage. Ce n’était pas tout-à-fait, remarque Charlevoix, la reine de Saba; mais l’Iroquoise était animée du même motif que cette princesse, et le général français en fut tellement flatté, qu’il crut voir dans cette femme quelque chose de plus qu’une sauvagesse. Le comte de Frontenac avait d’ailleurs plus d’une raison de faire à cette femme un bon accueil: elle avait rendu de grands services aux Français prisonniers dans son canton, et c’était à elle principalement que le P. Millet était redevable de la vie. “Dieu,” dit encore Charlevoix, “donna à sa charité la même récompense qu’en reçut autrefois le centenier Corneille; il l’éclaira comme lui des lumières de l’évangile; elle fut baptisée sous le nom de Susanne,” et se fixa au Sault St. Louis, où elle mourut dans un âge avancé.
Ce fut probablement à la considération de cette femme que le comte de Frontenac reçut assez bien Tareha, quoi qu’il fût extrêmement choqué des propositions que lui fit ce sauvage. Après avoir apporté pour excuse de ce que son canton n’avait pas envoyé de députés au général pour traiter de la paix, que les Anglais avaient empêché les Onneyouths de suivre les sentimens de leur cœur, il ôsa le prier d’envoyer lui-même des ambassadeurs à Orange, où ces mêmes Anglais voulaient absolument que cette grande affaire se négociât.
Le gouverneur général ne fut pas peu indigné de se voir joué ainsi par une nation dont il s’était flatté d’être estimé et redouté. Il voulut pourtant donner à entendre à Tareha qu’il était persuadé qu’il pensait en son particulier beaucoup mieux qu’il ne parlait au nom de ceux qui l’avaient député: il lui fit des présens, et le congédia, en lui disant qu’il voulait bien ne pas interpréter trop défavorablement les excuses des Onneyouths; mais qu’il ne tarderait pas à faire repentir les Cantons de n’avoir point profité des dispositions favorables où il était à leur égard, à son arrivée de France, et d’avoir ajouté l’insolence à la mauvaise foi.
Au commencement de l’année 1694, deux Onnontagués vinrent à Montréal, pour demander à M. de Callières, si les députés des cinq cantons, qui, dirent-ils, étaient déja en chemin, seraient bien reçus à prier leur père Ononthio de leur accorder la paix. Le gouverneur de Montréal leur répondit que probablement ils seraient écoutés, s’ils se présentaient. Ils se retirèrent avec cette réponse, et il se passa deux mois sans qu’on entendît parler de rien. M. de Callières n’en fut nullement surpris: cependant, pour ne pas manquer à ce qui dépendait de lui, il jugea à propos d’envoyer quelques partis du coté de la Nouvelle York, afin de voir si, par le moyen des prisonniers qu’on ferait sur les Iroquois, on ne découvrirait point les véritables causes de l’envoi de leurs premiers députés, ou du retard des seconds.
Le 23 Mars, deux Agniers vinrent à Montréal faire les excuses de Téganissorens, qui devait être le chef de la députation, et dirent qu’il fallait s’en prendre aux Anglais, si les Cantons avaient manqué à leur parole; mais que pourtant la députation ne tarderait pas beaucoup à arriver. En effet, Téganissorens arriva à Québec, au mois de Mai, avec huit députés. C’était le temps des semences, et cette circonstance fit dissimuler au gouverneur général le peu de fond qu’il faisait sur cette députation. Il donna aux députés une audience publique avec beaucoup d’appareil, et prolongea ensuite leur séjour autant qu’il était nécessaire pour donner aux habitans le loisir d’ensemencer leurs terres.
Ce délai eut encore un autre effet, qui ne fut pas moins avantageux à la colonie. M. de Louvigny avait quelque sujet d’appréhender une rupture avec les tribus du nord et de l’ouest, ou du moins un accommodement entr’elles et les Iroquois; ces derniers ne cessant de leur insinuer que les Français voulaient faire la paix avec les Cantons, sans se mettre en peine de leurs intérêts. Tout ce qu’il avait pu gagner, ç’avait été d’engager les principaux chefs de ces tribus à s’éclaircir par eux-mêmes de la vérité. Ces chefs arrivèrent à Québec deux jours après le départ des Iroquois. Le gouverneur ayant su d’eux-mêmes le sujet de leur voyage, envoya un exprès à Téganissorens, pour le prier de revenir à Québec. Il y accourut sur le champ; il y vit les chefs du nord et de l’ouest; et ceux-ci, après l’avoir entendu, crurent comprendre que les Iroquois n’avaient en vue que de leur faire prendre le change; d’empêcher leurs partis de courir sur l’ennemi commun, et de les brouiller avec les Français, pour avoir ensuite meilleur marché des uns et des autres.
Avant son départ, Téganissorens, qui en son particulier, voulait sincèrement la paix, proposa au comte de Frontenac, le rétablissement du fort de Catarocouy, comme un moyen de la hâter et de la rendre durable. Le gouverneur saisit cette ouverture avec toute l’ardeur dont il était capable: il fit travailler avec une extrême diligence à un grand convoi, qui devait conduire à ce poste une garnison, des ouvriers, des munitions, et tout ce qui était nécessaire à un établissement dont il prétendait faire le boulevard de la colonie. Il en donna le commandement au chevalier de Crisasi; mais comme cet officier allait s’embarquer, il reçut ordre de désarmer.
La cause de ce changement était l’arrivée de Serigny à Montréal, où se trouvait le gouverneur général, avec une commission du roi pour la levée d’un détachement considérable destiné à une entreprise contre le Port Nelson, de laquelle il avait été chargé conjointement avec son frère d’Iberville. Il n’y avait pas un moment à perdre, si l’on ne voulait pas faire manquer ce projet pour la troisième fois; et il fallut prendre une partie des hommes qui devaient accompagner le chevalier de Crisasi. On donna cent vingt Canadiens et quelques sauvages du Sault St. Louis à Serigny; le reste fut congédié jusqu’à nouvel ordre.
Au commencement de Septembre, Oureouharé, qui avait accompagné Téganissorens à son retour, revint avec treize prisonniers français, qu’il avait délivrés, et parmi lesquels étaient les deux Hertel, pris deux ans auparavant dans la déroute de M. de la Gemeraye, et qu’on avait crus morts; mais il n’amenait point d’autres députés que ceux de son canton de Goyogouin et de celui de Tsonnonthouan. La considération que le comte de Frontenac avait pour leur conducteur les fit écouter favorablement, et ce général voulut que les chefs du nord et de l’ouest, qui étaient descendus avec un grand convoi de pelleteries conduit par M. de Louvigny, fussent présents à l’audience qu’il leur donna.
Oureouharé, qui portait la parole, présenta d’abord un collier dont le sens était qu’il avait brisé les fers de treize Français: il en présenta ensuite d’autres pour marquer que les cantons dont on voyait les députés s’appercevant que la négociation de Téganissorens traînait trop en longueur, et sachant qu’elle était traversée par les Anglais, avaient pris les devans, et chargé leurs envoyés de prier Ononthio de ne pas s’impatienter, de l’assurer qu’ils voulaient, à quelque prix que ce fût, rentrer dans ses bonnes grâces, et le conjuraient de suspendre encore sa hache pour quelque temps.
Le gouverneur leur répondit qu’il acceptait le premier collier, et qu’il revoyait avec plaisir ses enfans, qu’il avait pleurés comme morts; qu’il savait bon gré aux députés des deux cantons de leur empressement à l’assurer de leurs bonnes dispositions; mais qu’il ne recevait point les autres colliers, par lesquels on prétendait arrêter son bras, et qu’il allait frapper incessamment, si on ne se hâtait point de lui rendre une réponse précise sur tout ce qu’il avait déclaré à Tareha et à Téganissorens. Dans un festin, qu’il leur donna ensuite, il s’étudia à bien convaincre les Goyogouins et les Tsonnouthouans, qu’il souhaitait la paix, mais plutôt pour eux-mêmes que pour lui, et en père qui ne châtie qu’à regret ses enfans.
Vers la fin d’Octobre, le P. Millet arriva à Québec, après cinq ans de captivité, et donna avis au gouverneur que Tareha le suivait de près avec les députés d’Onneyouth. Ils débarquèrent en effet, peu de jours après. M. de Frontenac les reçut d’abord assez mal; mais il se radoucit ensuite, en faisant réflexion que ces négociations avaient au moins cela d’utile, qu’elles procuraient quelque repos aux habitans de la colonie. C’était d’ailleurs pour lui une nécessité de faire au moins semblant de s’y prêter, ou d’aller attaquer les Iroquois avec des forces capables de les détruire, et il s’en fallait bien qu’il en eût de suffisantes pour une pareille entreprise. Il ne pouvait guère compter que sur deux mille hommes, y compris les troupes, les milices et les sauvages domiciliés; la prudence ne permettant pas de dégarnir les postes les plus exposés, qui étaient en assez grand nombre.
Au reste, si les Anglais cherchaient à empêcher les Iroquois de faire la paix avec les Français du Canada, ceux-ci ne travaillaient pas avec moins d’activité à empêcher tout accommodement entre les Abénaquis et la Nouvelle Angleterre. Ces derniers n’étaient pas moins que les Iroquois fatigués d’une guerre qui, outre les pertes qu’elle leur causait, les forçait de se tenir continuellement sur leurs gardes. Dès le mois de Mai de cette année 1694, deux de leurs chefs s’étaient engagés à conclure un traité de paix avec le gouverneur de la Nouvelle Angleterre; et ce général, après avoir reçu des otages, s’était rendu en personne à Pemkuit, pour accélérer la conclusion du traité. Mais dans le temps qu’il se tenait le plus assuré de mettre enfin son gouvernement hors d’insulte de la part de voisins si dangereux, le sieur de Villieu, le même qui s’était si fort distingué au siège de Québec, secondé de M. de Thury, missionnaire à Pentagoët, trouva le secret de regagner un chef malécite, nommé Mataouando, qui s’était déja déclaré pour la paix; leva un parti de deux cent cinquante sauvages des environs de Pentagoët et de la rivière St. Jean; se fit joindre par ceux de la mission du P. Bigot l’ainé; se mit à la tête de tous ces guerriers, et les mena sur la rivière de Pescadoué, au milieu des habitations anglaises, et à douze lieues seulement de Boston. Il y avait en cet endroit deux forts un peu éloignés l’un de l’autre; la petite armée se partagea en deux troupes, et les forts furent emportés en très peu de temps. Il y périt, suivant Charlevoix, deux cent trente Anglais; il fut brulé cinquante ou soixante maisons; et cet exploit ne couta aux vainqueurs qu’un seul homme blessé. Un chef abénaquis, nommé Taxous, enhardi, ou plutôt animé par un succès si prompt et si peu couteux, choisit quarante des plus lestes de sa troupe, arriva, après trois jours de marche, auprès d’un petit fort situé près de Boston, l’attaqua en plein jour, s’en rendit maître, nonobstant une vigoureuse résistance, et alla ensuite faire le dégat jusqu’aux portes de la capitale.
Ces hostilités irritèrent d’autant plus le chevalier Phibs, que sur les assurances qu’il avait données d’un accommodement prochain avec les sauvages, tout le pays était dans une sécurité parfaite, et qu’après des irruptions si brusques, et si peu attendues, le peuple de Boston murmurait hautement et paraissait prêt à se soulever contre lui. Il partit pour Pemkuit, et dès qu’il y fut arrivé, il envoya dire à ceux avec qui il avait traité, qu’ils eussent à lui remettre deux des leurs, qui s’étaient trouvés à l’attaque du premier fort; sinon qu’il les regarderait tous comme complices d’une hostilité faite contre le droit des gens, et après la parole donnée de n’en faire aucune, ajoutant qu’il était à Pemkuit en état de tirer vengeance de cette perfidie.
Ces menaces n’embarrassèrent pas peu les sauvages; ils avaient donné des otages au général anglais, et plusieurs avaient des parens prisonniers à Boston. Ces considérations les firent balancer longtemps sur le parti qu’ils avaient à prendre: à la fin, le plus grand nombre fut d’avis qu’il fallait envoyer des députés au gouverneur de la Nouvelle Angleterre, pour lui faire des excuses sur le passé, et l’assurer qu’à l’avenir il n’aurait plus sujet de se plaindre d’eux. Ils l’auraient fait sans doute, sans les efforts de leurs missionnaires pour rassurer les plus timides, et faire entendre à tous qu’ils avaient fait trop de mal aux Anglais, pour être en droit de s’attendre à en être bien traités à l’avenir, et qu’il allait de leur salut de demeurer inviolablement attachés aux Français. M. de Villieu engagea en même temps plusieurs de leurs chefs à aller avec lui à Québec; d’autres le suivirent de près; et tous renouvellèrent au gouverneur général les protestations d’une fidélité inviolable.
(A continuer.)

Hésiode, dans sa Théogonie, en compte neuf, filles de Jupiter et de Mnémosyne. “Dans l’Olympe,” dit-il, “elles chantent les merveilles des dieux; connaissent le passé, le présent, l’avenir, et rejouissent la cour céleste de leurs harmonieux concerts.” Ciceron en compte d’abord quatre, Thelxiope, Mnémè, Aède et Mélète, filles du deuxième Jupiter; puis neuf, qui ont eu pour père Jupiter troisième, et pour mère Mnémosyne; et enfin neuf nommées comme les précédentes, mais nées de Piérus et d’Anthiope. Pausanias en compte trois, savoir, la Mémoire, la Méditation et la Chant, dont le culte fut établi en Grèce par les Aloïdes: c’est-à-dire qu’on personnifia les trois choses qui constituent le poëme. Varron n’en admettait que trois, et dit que Sicyone donna ordre à trois sculpteurs de faire trois statues des Muses, pour les placer dans le temple d’Apollon, et cela dans l’intention de les acheter de celui qui aurait le mieux réussi. Mais comme elles se trouvèrent toutes également belles, la ville les acheta pour les dédier à Apollon. Au reste, ce nombre de trois était tiré de ce qu’il n’y a que trois modes de chant; la voix sans instrumens; le souffle avec les instrumens à vent, et la pulsation avec des lyres, &c.
Diodore donne encore aux Muses une autre origine. “Osiris,” dit-il, “aimait la joie, et prenait plaisir au chant et à la danse. Il avait toujours avec lui une troupe de musiciens, parmi lesquels étaient neuf filles instruites de tous les arts qui ont quelque rapport à la musique, d’où vient leur nom de Muses; elles étaient conduites par Apollon, un de ses généraux; de là peut-être son nom de Musagète, donné aussi à Hercule, qui avait été comme lui un des généraux d’Osiris.” Leclerc croit que la fable des Muses vient des concerts établis par Jupiter en Crète; que ce dieu n’a passé pour le père des Muses, que parce qu’il est le premier parmi les Grecs qui ait eu un concert réglé, et qu’on leur a donné Mnémosyne pour mère, parce que c’est la mémoire qui fournit la matière des poëmes.
L’opinion commune est donc qu’il y a neuf Muses, auxquelles Hésiode est le premier qui ait donné des noms. “On les fait présider,” dit encore Diodore, “chacune à différents arts, comme à la musique, à la poésie, à la danse, à l’astrologie, &c.” On les dit vierges, parce que les bienfaits de l’éducation sont inaltérables; elles sont appellées Muses, d’un mot grec (myein) qui signifie expliquer les mystères, parce qu’elles ont enseigné aux hommes des choses importantes, mais hors de la portée des ignorants. Chacun de leurs noms renferme une allégorie particulière: Clio est ainsi appellée, parce que ceux qui sont loués dans les vers acquièrent une gloire immortelle; Eutherpe, à cause du plaisir que la poésie savante procure à ceux qui l’écoutent; Thalie, pour dire qu’à jamais elle fleurira; Melpomène, pour signifier que la mélodie s’insinue jusque dans le fond de l’âme des auditeurs; Terpsichore, pour marquer le plaisir que ceux qui ont appris les beaux-arts retirent de leurs études; Erato semble indiquer que les savans s’attirent l’estime et l’affection; Polymnie, que plusieurs poëtes sont devenus illustres par le grand nombre d’hymnes qu’ils ont consacrés aux dieux; Uranie, que ceux qu’elle instruit élèvent leurs contemplations et leur gloire jusqu’au ciel: enfin la belle voix de Calliope lui a fait donner ce nom, pour nous apprendre que l’éloquence charme l’esprit et entraine l’approbation des auditeurs.
Les anciens ont regardé les Muses comme des déesses guerrières, et les ont souvent confondues avec les bacchantes. Non seulement elles furent mises au rang des déesses, mais on leur prodigua tous les honneurs de la divinité. On leur offrait des sacrifices en plusieurs villes de la Grèce et de la Macédoine. Elles avaient à Athènes un magnifique autel. Rome leur avait aussi consacré deux temples, et un troisième, où elles étaient fêtées sous le nom de Camœnes. Les Muses et les Grâces n’avaient ordinairement qu’un temple; on ne faisait guère de repas agréables sans les y appeller, et sans les saluer le verre à la main. Hésiode leur donne l’amour pour compagnon, et Pindare confond leur juridiction. Mais personne ne les a tant honorées que les poëtes, qui ne manquent jamais de les invoquer au commencement de leurs poëmes, comme les déesses capables de leur inspirer cet enthousiasme si nécessaire à leur art. Le Parnasse, l’Hélicon, le Pinde, étaient leur demeure ordinaire. Le cheval Pégase paissait ordinairement sur ces montagnes et aux environs. Parmi les fontaines et les fleuves, l’Hippocrène, Castalie et le Permesse leur étaient consacrés, ainsi que, parmi les arbres, le palmier et le laurier.
On les peint jeunes, belles, modestes, vêtues simplement.—Apollon est à leur tête, la lyre à la main et couronné de laurier.—Comme chacune préside à un art différent, elles ont des couronnes et des attributs particuliers. Les peintures d’Herculaneum offrent les neuf Muses ornées de leurs divers attributs.—
Vers le seizième siècle, les deux provinces de Valachie et de Moldavie se soumirent aux Turcs par capitulation. En conséquence, elles furent régies par des hospodars indigènes, auxquels la Porte, dans ses firmans, donna le titre de vayvode, mot slavon synonyme de prince. Flatté de la soumission volontaire de ces principautés, le gouvernement ottoman octroya à leurs hospodars des prérogatives considérables. Leur rang fut mis au-dessus de celui des pachas à trois queues; il égalait la dignité de gouverneur ou vice-roi de Bagdad. A leurs nominations, ils obtenaient du sultan une audience solennelle; ils plantaient trois queues devant la porte de leur palais; les jours de cérémonie, ils portaient une espèce de pelisse d’étiquette, nommée capanitza, qu’aucun pacha n’avait droit de porter, et qui était réservée aux vice-rois de Bagdad et aux khans de Crimée. Ils faisaient leur entrée dans leur capitale précédés de deux peiks et de deux solaks, espèce de satellites attachés dans les grandes pompes à la garde personnelle du Sultan. Ils jouissaient ainsi des distinctions les plus honorables.
Les principautés étaient dites détachées par la chancellerie ottomane, parcequ’elles payaient un tribut déterminé et séparé de celui que devaient les autres provinces de l’empire ottoman. Mais toutes ces prérogatives regardaient les hospodars ainsi que le divan du pays, c’est à dire le sénat, formé par les boyards ou seigneurs indigènes. Le peuple de la Valachie et de la Moldavie était esclave de ces seigneurs dans toute la force du mot, et ne possédait aucun privilége, aucun droit. Cependant la Porte trouva bientôt, dans les discordes continuelles des principaux boyards, un prétexte de reprendre une partie des droits qu’elle leur avait conférés. A la merci du caprice des sultans, environnées des places frontières sur la rive droit du Danube et sur leur propre territoire, menacées par les forteresses de Chotzim, de Bender, d’Akermann, d’Okzacoff et de Kil-Bouroun, ces deux malheureuses provinces devinrent la proie d’une foule de spoliateurs. Un khan de la Crimée, un mizza ou seigneur tartare, un pacha commandant de l’une des places fortes, appuyé d’une pétition de quelques boyards intrigants, pouvait, sur une simple calomnie, faire déposer les hospodars, et même leur ôter la vie. Les ministres de la Porte, non moins rapaces que les khans et les pachas, tantôt partageaient avec les accusateurs les biens de l’hospodar disgracié et les dons de son successeur, et tantôt s’appropriaient seuls les dépouilles de la victime.
En 1716, le drogman de la Porte, Nicolas Maurocordato, profitant de la disgrâce de l’hospodar indigène Brankovan, réussit à se faire nommer à sa place, et fut le premier Grec qui obtint cette dignité.
Les Moldaves et les Valaques, plongés dans les ténèbres les plus épaisses, n’offraient nulle éducation, nul commerce, nulle industrie, mais une absence totale de civilisation. La neuvième partie des terres était en friche; on ignorait jusqu’aux premiers élémens de l’économie rurale. Les hospodars grecs civilisèrent les deux principautés. Nicholas Maurocordato fonda en Valachie une imprimerie et une école publique, où l’on enseignait le slavon, le grec littéral et le latin. Son frère Constantin Maurocordato fut le bienfaiteur des paysans valaques; il les affranchit du servage le plus monstrueux qui ait jamais existé, et il introduisit dans le pays la culture du blé de Turquie, qui est devenu leur principale ou plutôt leur unique nourriture. Les hospodars grecs qui succédèrent aux Maurocordato rendirent aussi de grands services aux nations valaque et moldave; ils firent traduire dans le dialecte du pays la Bible, les saints Evangiles, les Psaumes, la liturgie, et tout ce qui concerne le rituel de l’église d’Orient. Sous l’hospodar Alexandre Ypsilanty, un boyard indigène de Valachie, nommé Tennaquitza Vakaresky, rédigea le premier une grammaire, et régularisa le patois de son pays.
Les hospodars grecs Alexandre Ypsilanty, Grégoire Ghika, Charles Callimachy, et Jean Caradza, furent les législateurs de la Valachie et de la Moldavie. Ces provinces suivent encore aujourd’hui les codes que ces princes firent imprimer, et qui, rédigés d’après celui de Justinien, renferment aussi les coutumes non écrites qui avaient auparavant force de lois, bien qu’elles fussent incertaines, interprétées à volonté, et souvent contradictoires.
Les hospodars grecs, malgré les divers moyens qu’ils possédaient pour faire face aux cabales de leurs rivaux succombaient souvent à leurs attaques, et ne pouvaient vivre que dans la crainte surtout depuis les guerres désastreuses de la Turquie avec la Russie et l’Autriche. Un nouveau grand-visir, un nouveau favori du sultan, trouvaient, pour renverser les hospodars, une arme toujours sûre en les accusant de trahison. Calomniés comme partisans, tantôt de l’Autriche, et tantôt de la Russie, ces princes infortunés éprouvaient le courroux du sultan, perdaient leur place et leur bien; rarement même terminaient-ils leurs jours d’une manière naturelle. Les deux principautés furent mises sous la protection de la Russie par les traités de Canardza, de Jassy et de Bucharest. Mais quoi qu’elles fussent ainsi délivrées de l’influence de voisins puissants, tels que les khans de Crimée, les sultans tartares de Boudzak et de Cavouchan,les pachas d’Ismaïlow, de Bender, de Chotzim, d’Oczakoff et de Kil-Bouroun, toutefois elles avaient à souffrir des vexations continuelles des garnirons des places frontières sur le Danube, et surtout de cet essaim de négocians turcs, accapareurs privilégiés (nommés capanlys) qui faisaient le monopole de toutes les denrées produites par les deux provinces. La protection de la Russie et la surveillance exercée par ses consuls ne pouvaient empêcher ces abus, qui s’introduisaient sous différentes formes et sous des prétextes spécieux. D’après une convention confirmée par un édit autographe du grand-seigneur, le gouvernement des hospodars devait durer sept ans. Pendant cet intervalle, leur personne était inviolable et les traités avec la Russie ne permettaient pas de les destituer avant un examen rigoureux de leur conduite, examen que faisaient les deux puissances contractantes.
Malgré ces clauses, les hospodars Grégoire Ghika et Constantin Chantzérv furent assassinés en pleine paix: Mavrojény et Alexandre Ypsilanty eurent la tête tranchée; Nicholas Caradza, Constantin Mourouzy, Alexandre Maurocordato, Ttléko Soutzo et Alexandre Mourouzy furent arbitrairement destitués. Le ministère ottoman avait toujours la ressource de forcer les hospodars secrètement et par menaces, à donner leur démission comme volontaire. C’est ainsi que Jean Caradza, persécuté par Halet, favori de Mahmoud, fut obligé d’abdiquer officiellement, et de se réfugier en Europe pour éviter la mort.
Mais de tous les maux qui pesaient et qui pèsent encore sur les deux provinces, le plus sensible et le plus accablant était ce reste odieux de droit féodal que l’humanité de Constantin Maurocordato n’a pas été à même d’extirper. Ce droit consiste en corvées gratuites auxquelles chaque paysan est tenu pour le service des seigneurs propriétaires. Les corvées ne doivent être que de onze jours par année; mais elles deviennent infiniment plus onéreuses par l’énormité des abus que se permettent les seigneurs indigènes à l’égard des malheureux cultivateurs. Ces onze jours se multiplient jusqu’au nombre de quarante, de cinquante et au-delà, de manière que les paysans n’ont pas la faculté de labourer leurs terres. Les hospodars redressaient souvent ces abus; mais les seigneurs, par mille ruses, arrachaient aux paysans des contrats dont les articles stipulaient cette augmentation de service. Outre ces abus ruineux, il existe encore une multitude de privilèges qui font retomber sur les cultivateurs tout le poids des impôts, tandis que des classes nombreuses de laïques et d’ecclésiastiques jouissent de plus ou moins grandes immunités.
Comme les deux principautés de Valachie et de Moldavie pouvaient échoir à tout Fanariote qui savait assez bien les langues orientales et le français pour devenir interprète de la Porte, les intrigues d’une si grande quantité d’aspirans devenaient pareillement funestes aux hospodars en place, et, par conséquent elles influaient sur le sort des provinces. Les Ypsilanty, les Mourouzy, les Soutzo, les Caradza, avant de devenir princes, étaient grands postchniks, ou premiers ministres des hospodars de Valachie et de Moldavie. Le gouvernement turc, ainsi que les nations grecque, valaque et moldave, ne donnaient le titre de prince qu’aux hospodars; leurs enfans s’appellaientt beï-zadès ou fils du prince; mais cette distinction n’appartenait jamais à leurs petits-fils: ceux-ci n’étaient que simples boyards ou seigneurs.
Quelque éphémère que fût la domination des hospodars, toutefois les provinces qui leur étaient soumises servaient de refuge à tous les Grecs persécutés par les Turcs dans les autres parties de l’empire ottoman. Une multitude de Macédoniens, de Thraces, d’Epirotes, de Thessaliens, exerçaient divers métiers dans ces provinces toutes chrétiennes; d’autres formaient des relations commerciales avec l’Allemagne, et surtout avec la ville de Leipsick; la plupart s’enrichissaient par leur industrie rurale, en cultivant à titre de fermiers les terres fertiles des boyards indigènes.
Les lycées de Jassy et de Bucharest, capitales des deux provinces, étaient bien organisés: on y enseignait le grec, le latin, l’allemand, le français, les sciences naturelles et la philosophie. Outre ces lycées, il y avait aussi des écoles secondaires dans les chefs-lieux de chaque district. L’imprimerie de Jassy était assez bien assortie; et dans les dernières années, on avait fondé à Bucharest un théâtre, sur lequel on représentait des tragédies et des comédies françaises, ou des pièces traduites en grec. Les étrangers de quelque nation, de quelque religion qu’ils fussent, étaient favorablement accueillis. Le mérite obtenait l’estime; un homme industrieux et doué de quelque talent était sur de réussir. La langue grecque avait été presque généralement adoptée; et, à l’exception du bas peuple, tous les habitans l’entendaient: la haute classe surtout parlait le grec avec une grande pureté; plusieurs boyards se distinguèrent même par des écrits en grec ancien ou littéral. En Valachie, les Brankovan, les Nestor, les Kimpinian, les Philipesko et les Golesko; en Moldavie, les Stourdza, les Paskan, les Kisnovan, les Balsonk et les Dragustzy, ne le cédaient pas, en fait de littérature grecque ancienne, aux Grecs les plus instruits.—Les femmes de plusieurs boyards de ces provinces étaient ou des princesses ou des nobles grecques; plusieurs Grecs aussi épousaient les filles des seigneurs du pays. Cet amalgame polissait les hautes classes des deux principautés, et y introduisait les mœurs, les usages et la langue de la Grèce. D’un autre côté, les armées russes et autrichiennes qui occupèrent ces contrées à plusieurs reprises y apportèrent les manières européennes, le luxe et les beaux-arts. Toute la haute société apprit le français et l’allemand. La danse et la musique devinrent des articles d’éducation. On voyait même, chez les boyards les plus riches, des institutrices allemandes et françaises. Cependant on remarquait dans ces provinces la frivolité à côté de la politesse, et le relâchement des mœurs à côté de l’urbanité....

J’ai cru m’appercevoir, dans mes voyages aux États-Unis, que les Français n’ont pas la même aptitude à y former des établissemens agricoles, que les émigrants d’Angleterre, d’Irlande et d’Allemagne. De quatorze ou quinze exemples de farmers ou cultivateurs français que j’ai oui citer sur le continent, deux ou trois seulement promettaient de réussir; et quant aux établissemens en masse de villages, tels que Gallipolis, tous ceux que les Français avaient ci-devant entrepris ou formés sur les frontières de Canada ou de Louisiane, et qui ont été abandonnés à leurs seules forces, ont langui et fini par se détruire; tandis que de simples individus irlandais, écossais ou allemands, s’enfonçant seuls avec leur femme dans les forêts, et jusque sur le sol des sauvages, out généralement réussi à fonder des fermes et des villages solides. A l’appui de mon opinion, ou plutôt des faits, je vais citer l’exemple de la colonie française du Poste-Vincennes sur la Wabash (ou Ouabache), que je visitai après Gallipolis.
Après trois jours de marche forcée, nous arrivâmes, le 2d Août 1796, au village louisianais nommé Poste-Vincennes sur la rivière Wabash. L’aspect du local est une prairie irrégulière d’environ trois lieues de long sur une de large, bordée de tous côtés de l’éternelle forêt, parsemée de quelques arbres et d’une quantité de plantes à ombelle, hautes de trois à quatre pieds. Des champs de maïs, de tabac, de bled, d’orge, de pastèques, même de coton, entourrent le village, composé d’une cinquantaine de maisons, dont la blancheur égaie la vue, après la longue monotonie des bois.... Chaque maison, selon la bonne coutume canadienne, est isolée de toute autre, et environnée de sa cour et de son jardin, clos de palissades. Mon œil fut réjoui de la vue des pêchers chargés de fruits, mais attristé de celle de l’odieux stramonium,[1] qui foisonne universellement aux lieux habités, depuis Gallipolis et plus haut.
J’étais adressé à l’un des principaux propriétaires né hollandais, parlant bien français; je reçus chez lui pendant dix jours tous les bons offices d’une hospitalité aisée, simple et franche. Le lendemain de mon arrivée, il y avait audience des juges du canton; je m’y rendis pour faire mes observations sur le moral et le physique des habitans rassemblés. Dès mon entrée, je fus frappé de voir l’auditoire partagé en deux races d’hommes totalement divers de visage et d’habitude de corps; les uns ayant les cheveux blonds ou châtains, le teint fleuri, la figure pleine, et le corps d’un embonpoint qui annonçait le santé et l’aisance; les autres ayant le visage très maigre, la peau hâve et tannée, et tout le corps comme exténué de jeûne, sans parler des vêtemens, qui annonçaient la pauvreté. Je reconnus bientôt que ces derniers étaient les colons français établis depuis environ soixante ans dans ce lieu, tandis que les premiers étaient des colons américains qui, depuis quatre à six ans seulement, y avaient acheté des terres qu’ils cultivaient. Les Français, à la réserve de trois ou quatre, ne savaient point l’anglais; les Américains, presque en totalité, ne savaient guère plus de français. Comme j’avais appris, depuis un an, assez d’anglais pour converser avec eux, j’eus l’avantage, pendant mon séjour, d’entendre les récits et les rapports des deux parts.
Les Français, lamentant leur détresse, me racontèrent que depuis quelques années et particulièrement depuis la dernière guerre des sauvages (1788,) la fortune avait pris à tâche de les accabler de pertes et de privations; auparavant, et depuis la paix de 1763, époque de la cession du Canada à l’Angleterre, et de la Louisiane à l’Espagne, ils avaient joui, sous la protection de cette dernière puissance, d’un degré et d’un genre singulier de bien-être. Presque abandonnés à eux-mêmes, au sein des déserts, éloignés de soixante lieues du plus prochain poste sur le Mississipi, sans charge d’impôts, en paix avec les sauvages, ils passaient la vie à chasser, à pêcher, à faire la traite des pelleteries, à cultiver quelques grains et quelques légumes pour le besoin de leurs familles. Plusieurs d’entr’eux avaient épousé des filles sauvages, et ces alliances avaient consolidé l’amitié des tribus environnantes. Le Poste avait compté jusqu’à trois cents habitans. Pendant la guerre de l’indépendance, l’heureux éloignement où ils étaient de son théâtre, les préserva longtemps d y être compromis; mais vers 1782, sur des motifs bien ou mal fondés, un officier kentokois ayant dirigé contre eux un petit corps, ils furent pillés, et leurs bestiaux, richesse principale, dévorés et enlevés. Le traité de 1783 annexa leur colonie aux États-Unis, et sous ce régime ils commencèrent de réparer leurs pertes. Malheureusement, vers 1788, des hostilités se déclarèrent entre les sauvages et les Américains. Il fut dur d’opter entre deux amis; mais le devoir comme la prudence les ayant joints aux Américains, les sauvages commencèrent contre eux une guerre d’autant plus cruelle, qu’elle fut celle d’une amitié déçue et irritée. Les bestiaux furent tués, le village bloqué, et pendant plusieurs années, à peine les habitans purent-ils cultiver à la portée du fusil; des requisitions militaires vinrent se joindre à ces calamités. Cependant, en 1792, le congrès ému de pitié, donna quatre cents arpens à chaque tête contribuable, et cent arpens de plus à chaque homme de milice. C’eût été la fortune de familles américaines; ce ne fut pour ces colons, plutôt chasseurs que cultivateurs, qu’un don passager que sans prudence, sans lumières, ils vendirent chacun moins de deux cents livres à des Américains; encore ceux-ci les payèrent-ils en toiles et autres marchandises leur rapportant vingt et vingt-cinq pour cent de bénéfice. Ces terres, de qualité excellente, se vendaient déjà en 1796, deux dollars l’arpent (total 2000 livres au lieu de 200 livres,) et j’oserais assurer qu’aujourd’hui elles en valent dix. Ainsi réduits la plupart à leurs jardins ou au terrain le plus indispensable, les habitans du Poste n’ont plus eu pour vivre que le secours de leurs fruits, de leurs légumes, des pommes de terres, du maïs, et très rarement quelque viande de chasse. Il n’est donc pas étonnant qu’ils soient devenus maigres comme des Arabes. Ils crient à la supplantation, à la spoliation, et surtout ils se plaignent qu’en tout procès et contestation, étant jugés par des lois américaines qu’ils n’entendent pas, et par cinq juges, dont deux français n’entendent que médiocrement les lois et la langue, il leur est impossible de soutenir la concurrence. Les Américains repoussent ces reproches par ceux de l’ignorance, du défaut de toute industrie et d’une indolence indienne. Il est vrai que cette ignorance est extrême en tout genre; jamais dans ce village il n’avait existé d’école avant que la révolution française y eût poussé M. l’abbé R ..., que j’y trouvai missionnaire.... Sur quatrevingt-dix têtes françaises à peine en pouvait-on citer six qui sussent lire et écrire, tandis que parmi les Américains, sur cent individus, homme ou femme, quatre-vingt-dix au moins savent l’un et l’autre. Le langage de ces Français n’est pas un patois, comme on me l’avait dit, mais un français passable, mêlé de beaucoup de termes et de locutions de soldat. Cela devait être ainsi, tous ces postes ayant été primitivement fondés ou habités en majeure partie par des troupes; le régiment de Carignan a servi de souche au Canada. Je voulus savoir l’époque de fondation et l’histoire première du Poste-Vincennes; mais ... à peine pus-je tirer quelques notions précises sur la guerre de 1757, quoi qu’il y ait là des vieillards de temps antérieur. Ce n’est que par apperçu que je suppose l’origine première vers 1735.
De leur côté, les colons américains me confirmèrent la plupart de ces récits; mais envisageant les faits sous un autre point de vue; “Si les Canadiens,[2] me dirent-ils, se trouvent dans une fâcheuse situation, ce n’est pas à nous, c’est à eux-mêmes ou à leur gouvernement qu’ils en doivent adresser la reproche. Ce sont, il est vrai, de bonnes gens, hospitaliers et sociables; mais ils sont d’une ignorance, d’une paresse demi-sauvages; ils n’entendent rien en affaires ni domestiques, ni civiles, ni politiques; leurs femmes ne savent ni coudre ni filer, ni faire du beurre: elles perdent tout leur temps à voisiner, à babiller, et la maison reste sale et en désordre. Les maris n’ont de goût que pour la chasse, la pêche, les voyages de long cours, et une vie toute dissipée. Ils ne font jamais comme nous des provisions d’une saison à l’autre; ils ne savent ni saler, ni fumer le porc, le daim, ni faire la bière, le saour-crout, ni distiller le bled ou les pêches, toutes choses capitales pour un cultivateur. S’ils ont quelques denrées ou marchandises, ils veulent, pour s’indemniser de la petite quantité, les vendre quinze et vingt pour cent plus cher que nous qui avons abondance; et tout leur argent s’en va en achats de babioles, de futilités, en amourettes de sauvagesses, espèce de filles aussi coquettes et bien plus gaspilleuses que les blanches: de même tout leur temps se consume en causeries, en narrations interminables d’avantures insignifiantes, et en courses à la ville,[3] pour voir leurs amis. Lorsque la paix de 1783 rendit ces habitans citoyens des États-Unis, au lieu de sujets du roi d’Espagne qu’ils étaient, leur première demande fut celle d’un officier commandant; et ils eurent toute la peine possible à comprendre ce que c’était qu’une administration municipale choisie par eux et dans leur sein. Aujourd’hui même, ils n’ont pas de sujets capables de la former. Ils ne veulent pas apprendre notre langue, et nous qui sommes les maîtres du pays, nous ne sommes pas faits pour apprendre celle d’une peuplade de quatre-vingt à quatre-vingt-dix personnes, qui demain se dégouteront et s’en iront en Louisiane, et qui feront bien; car avec leur peu d’industrie, ils sont incapables de soutenir notre concurrence.”
D’après les récits des Américains et des Canadiens, pareil état de choses a lieu dans les établissemens illinois et de la haute Louisiane: le découragement, l’apathie, la misère règnent également chez les colons français de Kaskaskias, de Cahokias, de la Prairie du Rocher, de St. Louis, &c. La nature du gouvernement y a contribué d’une part, en ce que le régime, d’abord français, puis espagnol, étant purement militaire, l’officier commandant est un véritable aga, ou pacha, qui donne, vend, ôte à son gré les privilèges d’entrée, de sortie, d’achat et d’accaparement de denrées; en sorte qu’il n’existe aucune liberté, ni de commerce, ni de propriété, et que pour deux ou trois maisons riches, la totalité des habitans est dénuée et pauvre.
D’autre part, les mœurs et les habitudes des premiers colons ont été une cause originelle de non succès et de ruine: soldats dans le principe, ou contraints de le devenir par leurs guerres avec les voisins, ces colons ont été conduits par la nature des choses à préférer une vie tour à tour agitée et dissipée, indolente et oiseuse, comme celle des sauvages, à la vie sédentaire, active et patiente des laboureurs anglo-américains. Aussi, lorsque dans ces dernières années, ceux-ci ont pu s’introduire dans les établissemens illinois, sur la rive gauche du Mississipi, leur industrie y a pris un tel ascendant, qu’en cinq ou six ans, ils sont devenus les acquéreurs et les possesseurs de la majeure partie des villages. Les anciens colons en détresse leur ont vendu à vil prix, comme au Poste-Vincennes, leurs inutiles possessions.... D’autre part, le gouvernement espagnol, pour donner de la valeur à ses terres, ayant adopté la mesure de les concéder à des Américains qui se naturalisent, ces Américains supplantent, en commerce, en agriculture, en industrie, en activité, les colons français, qui se retirent peu à peu devant eux, et passent en Canada ou en Basse-Louisiane.
A l’extrémité des prairies, près du Mississipi, est le village de Kas; il est tellement ruiné qu’il n’y reste pas douze familles canadiennes; et cependant en 1764, le colonel Bouquet y comptait quatre cents têtes: en face, à l’autre bord du fleuve, était ci-devant Ste. Geneviève, assez gros village cité pour sa saline: le Mississipi, dans ses débordemens, l’a totalement balayé: les habitans se sont retirés à deux milles de là, sur des hauteurs, où ils vivent dans des maisons à pans de bois, chacun sur sa terre.... Au village de la Prairie du Rocher, on ne compte que dix familles, et celui de Cahokias ou Caho, n’a pas plus de quarante feux, au lieu de quatre-vingts qu’il avait en 1790. En face de Caho est St. Louis ou Pancore, ville ou bourg de soixante-dix maisons rassemblées, ayant un beau et inutile fort en pierre, de deux acres en superficie, avec seulement cinq ou six familles riches, sur cinq cents têtes blanches d’un peuple pauvre, indolent et fievreux.......
Quelques traits de la vie journalière des colons des deux peuples feront connaître les véritables raisons de ce dépérissement général des établissemens français sur les frontières de la Louisiane, et même du Canada,[4] comparé à l’accroissement non moins général de ceux des Anglo-américains.
Le colon américain de sang anglais ou allemand, naturellement froid et flegmatique, calcule à tête reposée un plan de ferme; il s’occupe sans vivacité, mais sans relâche, de tout ce qui tend à sa création, ou à son perfectionnement. Si, comme quelques voyageurs lui en font le reproche, il devient paresseux, ce n’est qu’après avoir acquis ce qu’il a projetté, ce qu’il considère comme nécessaire ou suffisant.
Le Français, au contraire, avec son activité pétulante et inquiète, entreprend par passion, par engoûment, un projet dont il n’a calculé ni les frais, ni les obstacles; et il arrive souvent qu’après avoir commencé et défait, corrigé et changé, après s’être tourmenté l’esprit de désirs et de craintes, il finit par se dégouter et par tout abandonner.
Le colon américain, lent et taciturne, ne se lève pas de très grand matin; mais une fois levé, il passe la journée entière à une suite non interrompue de travaux utiles.... Si le temps est beau, il sort et laboure, coupe des arbres, fait des clôtures, &c.; si le temps est mauvais, il inventorie la maison, la grange, les étables, raccommode les portes, les fenêtres, les serrures, pose des clous, construit des tables ou des chaises, et s’occupe sans cesse à rendre son habitation sûre, commode et propre.
Le colon français se lève matin, ne fût-ce que pour s’en vanter; il délibère avec sa femme sur ce qu’il fera, il prend ses avis; ce serait miracle qu’ils fussent toujours d’accord: la femme commente, contrôle, conteste; le mari insiste ou cède, se fâche ou se décourage: tantôt la maison lui devient à charge, et il prend son fusil, va à la chasse ou en voyage, ou causer avec ses voisins. Tantôt il reste chez lui, et passe le temps à causer de bonne humeur, ou à quereller et gronder. Les voisins font des visites ou en rendent; voisiner et causer sont pour des Français un besoin d’habitude si impérieux, que sur toute la frontière de la Louisiane et du Canada, l’on ne saurait citer un colon de cette nation, établi hors de la portée et de la vue d’un autre.
Avec la causerie et le perpétuel caquet domestique, le Français évapore ses idées, les soumet à la contradiction, suscite autour de lui des tracasseries féminines, des médisances et des querelles de voisins, et finit par avoir gaspillé son temps sans résultats utiles à lui et à sa famille. L’on croit que ces détails sont des bagatelles; mais ils sont l’emploi du temps; et le temps, comme l’a dit Franklin, est l’étoffe dont nous fabriquons la vie. Il faut que cette dissipation morale et physique ait une efficacité particulière à rendre l’esprit superficiel: car ayant plusieurs fois questionné des Canadiens de frontière sur des distances de lieux et de temps, sur des mesures de grandeur ou de capacité, j’ai trouvé qu’en général ils n’avaient pas d’idées nettes et précises; qu’ils recevaient les sensations sans les réfléchir; enfin qu’ils ne savaient faire aucun calcul un peu compliqué. “Il y a, me disaient-ils, d’ici à tel endroit, la distance de deux fumées de pipe; l’on peut, ou l’on ne peut pas y arriver entre deux soleils, &c.” (Volney, Tableau du Climat et du Sol des États-Unis, 1821.)
|
Plante d’une odeur narcotique et nauséabonde. |
|
C’est le nom que les Américains donnent à tous les habitans français de leur frontière à l’ouest et au nord. |
|
C’est-à-dire à la Nouvelle-Orléans, distante de près de 500 lieues par le fleuve. |
|
Au Fort Détroit, lorsque j’y passai, le plus grand nombre des Français parlait de se retirer sur le terrain du roi (Georges) plutôt que de se former au régime municipal et laborieux des Américains. |

La Cour des plaids communs vient d’être saisie d’un procès singulier, et dont l’issue ne paraît pas moins extraordinaire. M. Rolfe avait fait en décembre 1826 une chute de cheval, et avait reçu un coup violent au genou. Il appella M. Stanley, chirurgien de l’hôpital Saint Barthélemy. M. Stanley ayant examiné la partie malade, reconnut l’existence d’un corps mobile; il déclara qu’il y avait fracture de la rotule, et que M. Rolfe aurait la jambe roide toute sa vie, si on n’était obligé d’en faire l’amputation. Les attelles furent posées, et demeurèrent cinq à six jours. Au bout de ce temps, M. Stanley leva l’appareil, banda le genou, au milieu des cris du malade, qui souffrait cruellement, et dit que ses soins lui paraissaient inutiles, le repos absolu étant le seul remède qu’il pût indiquer. M. Rolfe fut réduit à ne pouvoir marcher sans béquilles. Son infirmité et ses souffrances durèrent ainsi jusqu’au mois de Septembre 1827, qu’il consulta un autre chirurgien, M. Lilley. Celui-ci, après un mois de soins, s’apperçut que le corps mobile paraissait se rapprocher de la peau, et vouloir sortir. Il fit une incision et retira ce corps mobile, qui n’était point une esquille, mais tout simplement un caillou; le malade, dont la rotule n’était aucunement fracturée, fut promptement rendu à la santé.
M. Rolfe crut devoir traduire M. Stanley devant la Cour des plaids communs, comme coupable ou d’inhabileté, ou de négligence.
Les débats ont eu lieu le 22 Février dernier. Après explications des parties, on a entendu les premiers chirurgiens de l’Angleterre. Le célèbre sir Astley Cooper, premier chirurgien de Sa Majesté Britannique, a déclaré que, selon son opinion, le traitement suivi par M. Stanley était correct, et qu’il était le seul qu’on pût adopter en toute sécurité. M. Brodie, M. Travers et M. Green, chirurgiens de l’hôpital Saint-Thomas, et M. Bell, ont rendu témoignage à l’habileté reconnue de M. Stanley et à la convenance du traitement. Le juge, M. Burrough, dans son résumé, a fait observer aux jurés quelle était la faiblesse du système de la plainte; il leur a représenté qu’ils ne pouvaient l’accueillir sans décider implicitement que dès le premier coup d’œil, M. Stanley aurait dû reconnaître que le corps mobile était une pierre, et non pas un os, ce qui était absurde. Malgré ces réflexions, les jurés ont condamné M. Stanley, et adjugé au plaignant 30 livres sterling (750 francs) de dommages et intérêts.

Parler des efforts qui se sont faits, depuis un certain nombre d’années, pour fournir à la jeunesse canadienne les moyens d’acquérir plus facilement une éducation ou élémentaire ou classique, ce serait répéter ce que nous avons dit déja plusieurs fois, ou dire ce que tout le monde connaît: mais personne n’a encore parlé, ni longuement, ni même brièvement, de l’établissement nouveau auquel nous donnons le nom qu’il a dans l’endroit, et qu’il doit avoir ailleurs, celui de Collège de Chambly. Nous avons dit, il est vrai, au Tome III, No. I, de la Bibliothèque Canadienne, que “Mr. Mignault, Curé de Chambly, avait posé la première pierre d’un édifice destiné à l’éducation dans sa paroisse; que le terrain avait été donné par Mr. Mignault lui-même à la fabrique pour cet objet; que plusieurs des paroissiens avaient contribué à cette bonne œuvre avec un libéralité digne d’éloge, &c.” Nous annoncions par là-même que ce nouvel établissement était le fruit du zèle et de la libéralité de Mr. le Curé et des principaux habitans de Chambly, favorisés par le dernier statut provincial pour la propagation de l’éducation dans cette province; mais nous ignorions qu’il devait être le cinquième de nos collèges canadiens,[1] et nous n’aurions jamais pu imaginer qu’il se trouverait sitôt dans l’état florissant où nous l’avons vu dernièrement.
Pour commencer par le matériel, l’édifice, qui n’est encore qu’un corps-de-logis, auquel on se propose d’ajouter deux aîles, lorsque le besoin le requerra, a 60 pieds (mesure française) de longueur en-dedans des murs, sur 50 pieds de profondeur, aussi en-dedans des murs; c’est-à-dire entre 64 et 65 pieds de front, en-dehors. Il a deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, qui contient la cuisine, le réfectoire et les chambres des domestiques. Le premier étage comprend une salle de recréation de 35 pieds sur 25, un parloir, et la chambre du vice-principal, ou vice-président, si nous pouvons nous servir de ces expressions, sur le devant; et la salle d’étude, l’école française, la chambre de l’éconôme et un corridor, sur le derrière. Au second étage se trouvent le dortoir de 60 pieds sur 25; quatre chambres pour les professeurs, ou régens, et les classes, et un corridor.
La hauteur du rez-de-chaussée est de huit pieds, d’un plancher à l’autre; celle du premier étage de dix pieds, avec plafond; et celle du deuxième étage, de neuf pieds, aussi avec plafond.
Le collège est bâti sur un site élevé en comparaison de celui de la rue sur la rivière; il est isolé de tout autre bâtiment, et éloigné du chemin passant, et conséquemment du bruit, et de la poussière, en été, et l’on y jouit constamment d’un air aussi salubre que la saison et le temps le peuvent donner. La position du terrain n’a pas permis de faire de cet édifice un ornement immédiatement apparent pour le village, c’est-à-dire de le placer sur la rue principale, en face du bassin; mais cet avantage est amplement compensé par ceux qui viennent d’être énumérés.
Le vers latin qui suit le titre est le motto adopté par le fondateur, que nous croyons pouvoir appeller présentement le principal du collège, pour être inscrit sur une pièce de marbre, qui est, ou doit être placée au fronton, au-dessus de la porte principale de l’édifice. On construit maintenant une galerie partant des portes qui se trouvent dans les pignons, et régnant sur toute la devanture, pour servir de promenade aux écoliers, lorsque l’état du terrain, aux environs, n’est pas favorable à cet exercise.
La pierre fondamentale à été posée le 12 Juin 1826, et le bâtiment s’est trouvé en état de servir à sa destination le 1er Février 1827.
Quoi qu’encore dans son enfance, cet établissement procure déja une éducation élémentaire, mercantile ou classique, à 74 enfans ou jeunes gens, de Chambly, des paroisses des environs, même de nos deux villes principales, et de plusieurs endroits des États-Unis. Parmi les élèves américains, dont le nombre est assez considérable, il en est un de New-York, et un autre de Hartford, dans le Connecticut. Il y a actuellement dix-huit pensionnaires et quatre écoliers à demi-pension. Le prix pour les premiers est de £20 par an: les externes paient une piastre par mois.
Il y a présentement trois maîtres, ou régens, outre le vice-président, pour nous servir d’un terme usité dans les universités ou collèges des États-Unis. Ce dernier, tout en donnant des leçons de théologie aux régens, qui sont de jeunes ecclésiastiques, veut bien se charger encore de l’enseignement des belles-lettres. Les trois ecclésiastiques enseignent, l’un, la lecture et la grammaire française; un autre, la langue anglaise, l’écriture et l’arithmétique; il donne aussi des leçons de grammaire grecque, mais à un seul écolier, qui avait fait ailleurs un commencement d’études. Le troisième enseigne la grammaire latine, la grammaire française, et les élémens de la géographie.
Quant aux réglemens, ils sont les mêmes que ceux des autres collèges de la province, à l’exception des déviations qu’exige ou que permet la localité, et qui tendent toutes au plus grand bien-être des maîtres et des écoliers. Il est loisible, par exemple, aux pensionnaires d’aller, de temps à autre, faire un repas champêtre, le diner ou le souper, dans les îles boisées qui se trouvent au bas des rapides, à l’entrée du magnifique Bassin de Chambly, et de prendre, aussi souvent que le temps et les circonstances le permettent, l’exercise salutaire et recréatif du bain, dans la chaude saison. Comme le temps de Noël à l’Epiphanie est celui où les enfans, surtout ceux de la campagne, aiment le plus à se trouver chez leurs parens, à cause des fêtes, des visites, &c., on a cru qu’il conviendrait de partager les vacances en deux portions, l’une d’un mois, du 1er Septembre au 1er Octobre, et l’autre de quinze jours, de la fête de Noël à celle des Rois inclusivement. L’uniforme des autres collèges canadiens a été adopté pour celui de Chambly; mais il n’est de rigueur que pour les pensionnaires et les écoliers à demi-pension.
Il y a un jeu de paume à chaque pignon du collège, dont la façade regarde le midi. Outre ce jeu, les quilles, le trictrac, la bagatelle, les échecs, le baggamon, &c., servent tour à tour, ou suivant le goût, de recréation aux élèves.
Le site de Chambly est assurément un des plus beaux du Bas-Canada; pour en avoir au moins une légère idée, qu’on se représente d’abord une île et une pointe charmantes; puis une suite de maisons, dont plusieurs ont de l’élégance et sont ombragées de hauts peupliers, avec une belle église, formant un village de plusieurs arpens de longueur presque en ligne droite; ensuite, sur une ligne faisant avec la première un angle presque droit, des maisons ou des magasins plus épars, et laissant voir dans leurs intervalles les champs et les bois plus éloignés; puis au bord de l’eau et sur le penchant de la côte, une forteresse régulière et vénérable par son antiquité; un peu plus loin, une église, petite mais élégante; de grands hangards, de longues casernes, un village, en un mot, plus considérable que le premier, appellé le Canton, et qui par la variété de son sol, la beauté de plusieurs de ses bâtimens, ses moulins, ses belles rangées d’arbres, mériterait seul une description particulière; auprès, des rapides écumeux et bruyants, des îles boisées ou verdoyantes; de l’autre côté de la rivière, les maisons de ferme à distances à peu près égales, et la plupart entourrées de grands et beaux arbres; dans le lointain la haute et longue montagne de Rougement; enfin la Pointe Olivier avec son village et sa belle église, et au milieu de tout cela, le superbe élargissement de la rivière Richelieu appellé le Bassin de Chambly. C’est surtout lorsqu’on vogue sur cette magnifique nappe d’eau, par un bon jour, que le spectacle est vraiment enchanteur: les trois clochers du Village, du Canton et de la Pointe semblent représenter les extrémités d’un triangle scalène et presque droit, dont les côtés sont bordés d’objets qui, par la grandeur, la beauté et la diversité, frappent on ne peut plus agréablement les yeux du spectateur.
Si la situation offrait quelque désavantage, par rapport au collège, ce serait peut-être sa trop grande proximité de Montréal, la distance d’un lieu à l’autre n’étant que d’environ cinq lieues. Mais cet inconvénient, si c’en est un, est compensé, du moins jusqu’à un certain point, par la facilité de communication avec les états de Vermont et de New-York, qui ont commencé, et continueront sans doute, de fournir un bon nombre d’élèves à l’institution.
Ce serait peut-être ici le lieu de dire quelque chose de l’excellente école de filles tenue au même lieu, par les demoiselles Brousseau et Vaillancour; mais pour en parler avec connaissance de cause, nous attendrons les renseignemens que ne tardera pas de fournir l’examen public auquel ces estimables institutrices out commencé, nous dit-on, de préparer leurs élèves.
|
Celui de Ste. Anne est le sixième. |

Dans un ouvrage sur la jurisprudence publié depuis peu, à Paris, M. Dumont rapporte l’anecdote suivante de feu le baron Masères.
Après que M. Masères eut été admis au barreau, il se passa un temps considérable sans qu’il obtînt une seule cause. Un ami, qui pensait qu’il ne manquait qu’une occasion au jeune avocat pour déployer ses talens, engagea un procureur à lui confier une cause de grande importance pour les parties. Masères, après l’avoir étudiée, s’apperçut qu’elle était tout-à-fait injuste, et que la conséquence de son succès serait la ruine de la partie adverse. Mais il y avait dans la cause de cette dernière un point faible, qui, si on n’y prenait garde, en occasionnerait la perte. Masères, au lieu de s’en réjouir, ou de se livrer aux sentimens que la perspective du triomphe aurait pu inspirer à des âmes vulgaires, se trouva agité de la plus grande inquiétude, et même tourmenté de la crainte de voir une famille ruinée par un manque d’habileté ou d’attention pour sa défense. Dans sa replique, il ne put s’empêcher d’attirer l’attention de l’avocat de sa partie adverse sur le point en question, et de lui suggérer tout ce qu’il aurait dû remarquer ou qu’il avait oublié. En un moment, l’affaire prit une nouvelle tournure, et Masères perdit sa cause. Son ami l’acosta ensuite, et le complimenta sur sa délicatesse; mais il lui dit en même temps qu’il n’avait plus rien à espérer au barreau; qu’il avait commis un crime irrémissible, en trahissant son client, et qu’à l’avenir aucun procureur ne lui confierait une cause de la moindre importance. L’avocat consciencieux reçut cette condamnation avec orgueil, et renonça à la loi pour se livrer aux mathématiques, pour lesquelles il avait un goût particulier. Quelques années après, le même ami de Masères, dinant à la table de lord Shelburne, qui était alors premier ministre, lui raconta l’anecdote. “Vous m’avez rendu un service,” dit sa seigneurie au narrateur: “nous avons à nommer un juge pour le Canada, et si M. Masères veut accepter la place, elle lui sera donnée. Un avocat qui est trop scrupuleux pour sa profession doit faire un excellent juge.” M. Masères accepta l’emploi, et s’en acquitta, pendant plusieurs années, à la grande satisfaction du public.[1] “Cette anecdote,” dit M. Dumont, “que je tenais de lord Shelburne, (le marquis de Landsdowne,) m’a été racontée ensuite, avec tous les détails, par le baron Masères lui-même.”
|
M. le baron Masères a été Avocat-général dans ce pays, depuis 1766 jusqu’à 1769. |

Cette cause importante a été mise devant la cour, Mercredi dernier, (24 Juin) et plaidée avec habileté par le procureur général pour le défendeur, l’avocat du demandeur n’ayant pas paru pour soutenir son exception, et le dernier jour du Terme, les juges ont rendu leur jugement comme suit:—
Mr. le Juge en Chef Sewell.—Cette cause est une action pour voie de fait. La déclaration du demandeur expose que le défendeur est entré dans la maison du demandeur, et y a saisi et vendu certains effets mobiliers appartenant au demandeur, sans être légalement autorisé à le faire; et en conséquence il demande une compensation en dommages. Le défendeur, par une exception péremptoire en droit, justifie l’entrée, la saisie et la vente des effets en question, sous l’autorité d’un jugement rendu contre le demandeur par une cour martiale de milice, pour une amende de dix schelins par lui encourue en vertu des dispositions des ordonnances de la 27e Geo. Ill, chap. 2, et de la 29e Geo. III, chap. 4, pour avoir manqué à son devoir. Le demandeur a répondu à cette justification du défendeur par une dénégation générale en fait et en droit. La cause a été entendue par plaidoyers, et la question qui nous est maintenant soumise est de savoir si la justification est suffisante pour faire rejeter l’action. Si les faits exposés dans le plaidoyer sont vrais, la question se réduit à savoir si les ordonnances de milice passées dans la 27e et la 29e de Geo. III, sont ou ne sont pas maintenant en force.
Ces ordonnances out été passées par le gouverneur et le conseil législatif, sous l’acte de Québec, avant l’établissement de la présente constitution, et c’étaient des actes permanents. Mais par le statut provincial de la 34e Geo. III, chap. 4, elles furent révoquées, ou rapportées,[1] en ces termes: “Et qu’il soit de plus statué, que depuis et après la passation de cet acte, une ordonnance passée dans la 27e année du règne de sa Majesté, intitulée, &c. et aussi une ordonnance passée dans la 29e année du règne de sa Majesté, intitulée, &c., seront, et sont par le présent révoquées.” Mais le statut provincial de la 34e Geo. III. n’était pas un acte permanent; c’était un acte temporaire en conséquence de la 35e section, qui est ainsi conçue: “Qu’il soit de plus statué, par l’autorité susdite, que cet acte sera et continuera d’être en force, depuis le passation d’icelui, jusqu’au 1er Juillet de l’année de notre seigneur 1796, et pas plus longtems.” Et de là s’est élevé le doute, la question de savoir si les ordonnances rapportées par ce statut l’avaient été permanemment, ou temporairement.
J’admets le principe qu’un acte temporaire peut révoquer un statut permanent; mais pour qu’une telle révocation ait lieu, il faut que l’intention de la législature à cet effet soit claire et manifeste; car, au premier apperçu, un acte que la législature déclare être temporaire généralement ne doit avoir qu’un effet temporaire. “Si,” dit Mr. le juge Bayley, en parlant de la clause ordinaire de continuation dans les actes temporaires, dans la cause du Roi vs. Rogers, (10 East, p. 575) “cet acte s’applique à l’acte entier, la question est décidée.” Et je le considère comme s’appliquant à l’acte entier; et après le temps limité pour l’opération de l’acte, je considère la question comme étant la même que si cet acte ne se trouvait plus dans le livre des statuts.
Si la présente cause avait été appuyée sur le même fondement, je l’aurais regardée comme un cas où il était particulièrement nécessaire que l’intention de la législature, quant à une révocation permanente, fût manifestée par le statut même; car l’effet de la révocation permanente de ces ordonnances aurait été de priver la province, son gouvernement et ses habitans, de la protection d’une milice, et conséquemment de les laisser sans défense, dans le voisinage immédiat d’une puissance étrangère; et suivant moi, on ne peut pas présumer par une simple interprétation, que telle a été l’intention de la législature.
Mais le cas présent est appuyé sur un meilleur fondement, savoir, l’interprétation de la législature elle-même, quant à l’effet de l’acte de la 34e Geo. III, chap. 4, sur les ordonnances, laquelle est exprimée dans l’acte subséquent de la 43e Geo. III, chap. 1. sec. 53. Pour expliquer ceci, je dois observer que l’acte de la 34e Geo. III, chap. 4, fut continué par celui de la 36e Geo. III, chap. 1, sec. 53, jusqu’au 1er Juillet 1802, et de là jusqu’à la fin de la session alors prochaine du parlement provincial; mais ces deux actes furent révoqués par la section 53e de la 43e Geo. III, et cela pour empêcher l’opération des ordonnances des 27e et 29e Geo. III, qui en conséquence de cette révocation des statuts, seraient redevenues en force, si leur révocation avait été temporaire. Ces ordonnances furent révoquées de nouveau par la même section 53e durant la continuation de la 43e Geo. III; et cela montre clairement que les statuts précédents et la suspension des ordonnances qu’ils contenaient, furent regardés par la législature sous le même point de vue, quant à la durée, et conséquemment que son intention primitive n’a été que d’opérer une révocation temporaire, et rien de plus. S’il en avait été autrement, et que l’intention de la législature eût été de faire d’abord une révocation permanente, il n’aurait pas été nécessaire d’en faire une seconde.
On admettra que la législature est le meilleur interprète de ses intentions et de ses actes; et comme il n’a été fait aucun changement dans aucun des actes subséquents à celui de la 43e Geo. III, qui se rapportent à la question qui nous est soumise, et que la révocation originelle des ordonnances a été temporaire, et non permanente, nous sommes d’opinion que lors de l’expiration du dernier statut de la 59e Geo. III, chap. 21, au 1er Mai 1827, les ordonnances sont redevenues et ont été depuis en force.
Mr. le Juge Kerr. Depuis que cette question a commencé d’être agitée, je n’ai pas eu le moindre doute sur le sujet. C’est simplement une question d’interprétation, savoir, si le statut expérimental de la 34e Geo. III, chap. 4, et les autres actes subséquents de même nature, ont opéré, ou non, la révocation permanente des ordonnances provinciales de milice. Le préambule même de la 34e du feu roi, montre que la législature avait à cœur de pourvoir à la protection et à la sureté de la province, et qu’elle regardait une milice bien organisée comme le meilleur moyen de parvenir à cette fin. Les paroles du préambule sont: “Vu qu’il est essentiel pour la protection et la défense de cette province, d’établir une milice respectable et bien réglée.” Les mêmes expressions se trouvent dans l’acte suivant, et, je crois, dans chacun des actes temporaires subséquents relatifs à la milice; et devons-nous présumer gratuitement, et sans aucune disposition législative à cet effet, que, par la clause de révocation dans ces statuts temporaires, la législature ait eu l’intention de priver la province de la protection et de la sécurité que la milice pouvait procurer? Loin que la législature ait déclaré d’une manière claire et distincte qu’elle voulait que ces ordonnances fussent annullées pour toujours, nous trouvons dans les termes mêmes des actes temporaires la plus forte présomption que telle n’était pas son intention. Il y a une autre circonstance, découlant de la loi civile du pays, qui est pour moi d’un très grand poids: ici, la milice est, sous certains rapports, une administratrice de la justice, qui prête main-forte au bras civil, en même temps qu’elle constitue une force militaire pour la défense du pays. Pouvons-nous donc présumer que les législateurs aient eu si peu à cœur les intérêts de leurs concitoyens, que de vouloir priver les magistrats civils de son aide? Le cas du Roi vs. Rogers me paraît décisif, et je suis d’opinion que le jugement doit être en faveur du défendeur.
Mr. le Juge Bowen. Je concours très volontiers dans le résultat de l’opinion que viennent d’énoncer les savants juges qui m’ont précédé, bien que j’aie été d’une opinion différente, lorsque le rétablissement, ou le non-rétablissement des ordonnances a été pris en considération pour la première fois, dans un autre endroit, où j’ai l’honneur d’avoir un siège. Cela provenait de ce que je n’avais pas fait attention à la seconde révocation de ces ordonnances, contenue dans la 53e section du statut de la 43e Geo. III, chap. 1, et que je n’avais considéré la question que d’après les termes de révocation tels que contenus dans le premier statut de la 34e Geo. III, chap. 4. Ce dernier est intitulé, “Acte qui pourvoit à la plus grande sureté de la province, au meilleur règlement de la milice d’icelle, et qui rapporte certains actes ou ordonnances y relatifs.” Le préambule dit, “qu’une milice respectable, soumise à des règlemens convenables, est essentielle à la protection et à la défense de cette province, et que les lois maintenant en force sont inefficaces pour parvenir aux fins proposées.” La 31e section statue alors, “que depuis et après la passation de cet acte, (Mars 1793) une ordonnance de la ci-devant province de Québec passée dans la 27e année du règne de sa Majesté, intitulée, Acte ou ordonnance, &c. et aussi une ordonnance passée dans le 29e année du règne de sa Majesté, intitulée, &c. seront, et sont par le présent révoquées.” Et par la 35e section, il est statué, “que cet acte sera et continuera d’être en force, depuis la passation d’icelui, jusqu’au 1er Juillet 1796, et pas plus longtems; pourvu toutefois que si au temps fixé ci-dessus pour l’expiration de cet acte, la province se trouvait en état de guerre, d’invasion ou d’insurrection, le dit acte continuerait et serait en force jusqu’à la fin de telle guerre, invasion ou insurrection.” Dans tous les cas, on ne peut constater l’intention de la législature que par le langage dont elle s’est servie dans ses dispositions législatives, et ce devient toujours une question d’interprétation que de savoir quelle a été l’intention réelle de la législature.
C’est une règle claire que par la révocation d’un statut révocatoire, le statut originel redevient en force; car par-là la législature déclare que la révocation n’existe plus; et c’est la même chose, si la loi révocatoire elle-même statue que la révocation ne sera que temporaire. Mais il n’est pas vrai de dire, comme on l’a fait, qu’une loi perpétuelle ne peut jamais être annullée permanemment par une loi temporaire; car c’est un principe reconnu en loi, qu’un statut, quoique temporaire à l’égard de quelques unes de ses dispositions, peut avoir une opération permanente sous d’autres rapports. Ce point a été discuté à la Cour du Banc du Roi, en Angleterre, en 1803, lorsqu’il fut question de savoir si le statut de la 26e Geo. III. chap. 108, sec. 27, qui rapportait celui de la 19e Geo. II, chap. 35, étant lui-même expiré à la fin de la session du parlement, après Juin 1795, le dit statut de la 19e Geo. II ne se trouvait pas rétabli; et lord Ellenborough, en énonçant l’opinion de la cour, s’exprime ainsi: “De ce qu’une loi est temporaire dans quelques unes de ses dispositions, il ne s’en suit pas qu’elle ne puisse point avoir une opération permanente sous d’autres rapports. Le statut de la 26e Geo. III, chap. 108, révoque absolument celui de la 19e Geo. II, chap 35, quoique les dispositions qui lui sont substituées ne soient que temporaires.”
Pour rendre raison de l’interprétation que j’avais adoptée d’abord, il ne sera peut-être pas hors de propos de comparer les termes invocatoires de l’acte de la 26e Geo. III. chap. 108, avec mêmes termes de notre statut provincial, que j’ai déjà cités. “Et qu’il soit de plus statué par l’autorité susdite, que cet acte commencera d’être en force le Lundi 24 Juin 1795, et de là jusqu’à la fin de la session alors prochaine du parlement, et que depuis et après le dit 24 Juillet 1786, les dits actes des 19e, 23e, 24e, 31e et 32e Geo. II. et des 6e et 21e du règne de sa présente Majesté, seront, et sont par le présent révoqués.” Ces termes révocatoires, suivant le sens que je leur donne, ne sont pas plus absolus que ceux de notre statut provincial de la 34e Geo. III, chap. 4. L’emploi des mots “cet acte,” dans la clause ci-dessus, fournit une réponse à plusieurs des argumens tirés de la cause du Roi contre Rogers, qu’on a regardée comme décidant la question sous considération. Ce cas, loin de détruire le principe que j’ai soutenu d’abord, ne tend, suivant moi, qu’à l’appuyer et le confirmer. Lord Ellenborough y dit: “Dans tout acte qui révoque ou modifie une loi antérieure, il est question de savoir si la révocation est totale, ou partielle et temporaire. Ici, il s’agit de constater si les dispositions du statut de la 42e, qui était originellement perpétuel, ont été révoquées entièrement par celui de la 46e du Roi, ou seulement pour un temps limité. Le dernier acte déclare, à la vérité, que certaines dispositions de l’acte précédent seront révoquées; mais ce mot ne doit pas être pris dans un sens absolu, s’il paraît, par la teneur générale de l’acte, qu’il n’y était employé que dans un sens limité.”
Je crois en avoir montré suffisamment, s’il s’agissait encore d’une question d’interprétation à décider, ou si la chose était nécessaire, pour justifier l’opinion que j’ai eue d’abord sur le sujet, que la révocation contenue dans l’acte de 1793 (34e Geo. III) était alors regardée comme une révocation absolue. Mais la même législature m’ayant ôté subséquemment en 1803 (et c’est cette circonstance seule qui me fait départir de ma première opinion, dans laquelle, sans cela, je persisterais encore, quelle qu’en pût être la conséquence,) le droit de m’enquérir quelle a pu être sa véritable intention, en 1793, en révoquant de nouveau les ordonnances en question; cette interprétation législative de la clause révocatoire dans le statut de 1793, ne me permet pas d’interpréter différemment les mêmes termes révocatoires contenus dans le statut de 1803, qu’on a laissé expirer au 1er Mai 1827, après l’avoir eu continué par différents statuts.
Les voies de fait supposées pour lesquelles le demandeur cherche à obtenir des dommages du défendeur, étant des actes faits en vertu des ordonnances rétablies, je suis d’opinion avec les autres juges, qu’il est prouvé qu’elles justifient pleinement le défendeur.
Mr. le Juge Taschereau.—Le cas actuel se rattache en principe à ceux qui ont été cités par le défendeur. Il est évident que la législature n’a jamais eu l’intention de révoquer permanemment les ordonnances de milice; et que les termes et le sens des divers statuts auxquels on a fait allusion demandent cette interprétation. C’est pourquoi le jugement doit être en faveur du défendeur.—(Traduit du Star de Québec.)
|
Rapporter est le terme usité en France, depuis la révolution, pour signifier révoquer, annuller. On a coutume de se servir, dans ce pays, des mots rappel et rappeller, pour signifier révocation et révoquer; mais nous ne croyons pas que cette traduction littérale des mots anglais, repeal, to repeal, soit autorisée par le bon usage. |

E gallico sermone à viro canadensi in latinum conversa.
Tres in cauponâ potabant Martis alumni;
Cum rixâ strepitus non mediocris erat.
Cum vino fragor augescit: puer hospitis intrat,
Exigit impensas; ense petitus obit ...
Oh! puer est! periit! sors aspera!.. Pereitus ird
Miles, cur, hospes, vociferaris, ait?
Nil perdes; damnum hoc addatur sumptibus ... ohe!
Chartæ inscribantur vina, lagena, puer.
E tardo elicias nova ut argumenta cerebro,
Hortensi, frontem sollicitare soles:
Sed frustra pulsas frontem, appellasque cerebrum;
Namque tuum caput est non habitata domus.
Passas erat morsum à deformi Aurelius angue:
Ecquid mirificum contigit indè, putas?
Percussus periit, dices, Aurelius.... Error.
Disruptâ serpens occidit ipse cute.
Ardebat flammis latè se expendentibus ædes:
Antèque erat mulier flebilis atque gemens.
Ebrius exclamat, propè qui titubabat, age, eia,
Tu mulier plorans, nùm domus ista tua est?
Ista mea est ... Ignis tuus ergo? accendere quæso,
Hunc tabaci calamum fas sit ab igne tuo.
Dùm pulsando infert aut aufert follibus auram
Clericus, et fundunt organa dulce-melos;
Dentibus infrendens in traclantem organa, clamat:
En psalmum insufflo, cantat his antiphonam!
Auri quidquid habet vorat aut bibit helluo magnus:
Unum veslis habet globulum, trigintaque nasus.
N.B.—C’est ici le lieu de corriger une erreur de copiste, ou une faute d’impression, qui s’est glissée dans une des inscriptions latines publiées dans le numéro d’Avril dernier. A la page 187, ligne 12e de la troisième inscription, pour portam, lisez palmam. Lisez aussi inglorius, au lieu d’inglorious, à la ligne 1ère de la première inscription.

Pour détruire le ver à choux, arrosez le terrain, à la racine des plantes, avec une forte décoction des feuilles, de la tige et des racines de l’ellébore, ayant soin que la décoction, lorsque vous l’appliquerez, ne soit pas plus chaude que l’atmosphère.[1]
Pour détruire la mouche bleue (lytta,) qui exerce ses ravages dans les champs de patates, de luzerne et de fêves de Windsor, remplissez d’eau un arrosoir jusqu’aux deux tiers de sa capacité; sur cette eau versez de l’huile de poisson à la hauteur de deux pouces; mêlez bien le tout ensemble, et avant que les deux substances aient eu le temps de se séparer, arrosez de leur mêlange les plantes infestées par les mouches. Cet arrosage détruit l’insecte sans faire tort à la plante.
|
Cette plante se trouve ici dans quelques jardins. Ceux de nos jardiniers qui ne l’ont pas chez eux, feraient peut-être bien de se la procurer, pour pouvoir s’en servir au besoin, sans être obligés de recourir à leurs voisins ou à leurs amis. |

Le 15 Mars 1791, on donnait Cinna sur un des théâtres de Paris. Le nouveau parterre croyant que l’on voulait jouer un député dans chaque rôle de conjuré, cria: “A bas! à bas! l’auteur à la lenterne!” Alors un acteur s’avance et dit: “Messieurs, l’auteur n’est point coupable; c’est un nommé Corneille, mort il y a plus de cent ans.—Eh bien, s’il est mort, nous n’avons que faire de ses pièces!” s’écria un citoyen en veste: “pourquoi ne pas jouer Charles IX, de l’ami Chénier? Parlez-moi de ça; c’est un auteur qui se porte bien, lui:” et aussitôt tout le monde cria: “Charles IX! Charles IX!” La troupe civique obéit, joua la farce patriotique de Chénier, et se promit bien de ne se plus mettre du Corneille dans la tête.—Encyclopédie Comique.

Ci-gît qui fut de belle taille,
Qui savait danser et chanter,
Faisait des vers vaille que vaille,
Et les savait bien réciter;
Sa race avait quelque antiquaille,
Et pouvait des héros compter;
Même il aurait livré bataille,
S’il en avait voulu tâter!
Il parlait fort bien de la guerre,
Des cieux, du globe de la terre,
Du droit civil, du droit canon,
Et connaissait assez les choses,
Par leurs effets et par leurs causes:
Etait-il honnête homme? Oh non!
Scarron.

Nous avons annoncé, dans un de nos derniers numéros, que les principaux chefs de cette nation devaient aller trouver l’agent des États-Unis, à sa résidence, pour entendre une communication du Président touchant la constitution adoptée récemment par les Chéroquis. Comme plusieurs hommes d’influence des États voisins et d’ailleurs, particulièrement des membres du Congrès, soit par une crainte mal fondée, soit par une volonté déterminée de s’opposer à toute amélioration parmi les Indiens, ont poussé le cri d’alarme, “qu’une tribu sauvage au cœur de l’Union a pris une attitude d’indépendance, en formant une constitution, et qu’il faut s’y opposer,” nous appréhendions que l’Exécutif ne regardât de mauvais œil quelques uns des principes de notre gouvernement naissant. Nous avons été néanmoins heureusement désappointés. Les paroles du Président n’intiment en aucune manière qu’il faille empêcher les Chéroquis de former une constitution: au contraire, elles donnent à entendre que cette constitution peut-être organisée par le gouvernement général, si ses dispositions n’enfreignent pas les relations qui existent entre les États-Unis et les Chéroquis. Ce ne fut jamais l’intention des auteurs de cette constitution, ni de leurs constituans, de donner atteinte à ces relations. Nous croyons que les Chéroquis sont convaincus de l’importance, particulièrement en ce moment de crise, où les ennemis abondent, de tenir la main du Président, ou en d’autres termes, du gouvernement général, en adhérant religieusement aux traités existants.—Phœnix Chéroquis.
Outre la Narration du dernier voyage du capitaine Franklin à l’océan arctique, par le Canada, Mr. Murray prépare pour la presse deux ouvrages importants, qui se rattachent au premier, et qui doivent être publiés sous l’autorité du gouvernement. Le premier est la Botanique de l’Amérique Britannique du Nord, par le Dr. Hooker. L’expédition a rapporté 2,500 espèces de plantes, outre 3000 espèces de mousses. Toutes ces plantes seront décrites, et l’on y joindra celles dont il est parlé dans les autres auteurs; de manière à former une Flore complète de l’Amérique britannique du Nord. Le Dr. Hooker est très capable de remplir cette tâche.
Le second est la Zoologie du même pays, par le Dr. Richardson, un des messieurs de l’expédition. On y joindra la description de tous les animaux connus de la même région; et l’ouvrage sera enrichi de gravures représentant les espèces nouvelles ou rares.—Papier de Londres.
La Statistique de cette Province par l’Arpenteur-général, est presque achevée, nous dit-on, et sera probablement publiée dans quelques semaines. Elle comprendra, outre un recensement, un état des produits de l’agriculture en grains, animaux, &c. et une esquisse minéralogique. Le tout doit être donné par comtés et districts, et formera un ajouté utile à la Topographie du même auteur.—Gazette de Québec.
L’exploration du pays situé au nord de Québec, sur les bords du Saguenay, du lac St. Jean et de la rivière St. Maurice, qui, en vertu du statut provincial, aurait dû se faire le printemps dernier, sera commencée, apprenons-nous, par les commissaires, entre le 10 et la fin de Juillet. Un parti se propose de remonter la rivière de la Malbaie, et de traverser ensuite le pays jusqu’à Chicoutimy, pour y rencontrer un autre parti, qui doit remonter le Saguenay par Tadoussac. Les rivières qui se jettent dans le lac St. Jean seront examinées, ainsi que le pays à la ronde, à la distance de 45 milles de ses bords; et un parti qui remontera la rivière jusqu’au poste de Chamachoua, traversera les hauteurs jusqu’aux sources du St. Maurice, par lequel il descendra aux Trois-Rivières, et de là à Québec, au commencement des gelées.—Ibid.

A une assemblée de cette Société, tenue il y a quelques mois, il fut lu un écrit de Mr. Green, son Sécrétaire, sur “Certaines Peintures produites dans cette Colonie.” Cette communication fut regardée comme tellement importante, que sur la proposition du Comte de Dalhousie, patron de la Société, il fut résolu unanimement que l’écrit et les échantillons en question devaient être transmis à la Société des Arts de Londres, sous les auspices de laquelle on en pourrait faire des essais plus convenablement. En conséquence de cette résolution, le papier et les échantillons furent confiés à Mr. R. Symes, de cette ville, pour être mis entre les mains du Dr. Aikin, Secrétaire de l’Institution; commission dont ce monsieur s’est acquitté avec soin et attention.
Voici la description des peintures en question:—
1 Une laque rouge, ressemblant au carmin, mais approchant plus de l’écarlate; plus durable qu’aucun rouge de chochenille: extraite d’un gallium.
2 Une laque d’un rouge brun durable, extraite de la même racine.
3 Une autre laque brune durable, extraite de l’enveloppe extérieure de la noix douce, juglans cathartica.
4 Une ochre d’un jaune clair, de St. Augustin et de Lorette, avec une recette pour la convertir en un orangé brillant.
5. Une terre jaune transparente, de la Baie St. Paul, avec une recette pour lui donner une couleur brune foncée.
6 Une terre rouge opaque, ressemblant au rouge de Perse, appellé rouge sauvage; des Iles de la Magdeleine.
7 Un rouge opaque, plus brillant que le premier, préparé avec la même matière.
8 Un oxide métallique brun transparent, ressemblant à la terre d’ombre de Turquie; de Ste. Foy.
9 La matière avec laquelle les sauvages teignent en jaune brillant et durable. Des semences de myrica gale, des bords des lacs et des rivières. Un arbrisseau odoriférant.
Aucune des substances ci-dessus n’avait été remarquée (que nous sachions) comme étant propre à l’usage des artistes dans les couleurs à l’huile.
Il paraîtra par les lettres suivantes, que nous avons permission de publier, que la Société des Arts a fait beaucoup de cas des échantillons ci-dessus et de l’écrit de Mr. Green, en conférant à ce monsieur l’honneur de sa médaille d’or d’Isis, laquelle a été remise à Mr. Symes, et apportée par lui à Québec, ce printems.
Milord—J’ai ordre d’exprimer à votre Seigneurie la satisfaction que la Société a éprouvée à la lecture de l’intéressant écrit de Mr. Green concernant certaines peintures, produits des colonies que vous gouvernez. La valeur intrinsèque de la communication est beaucoup augmentée dans l’opinion de la Société, par le vote émis (sur la proposition de votre Seigneurie) par la Société Littéraire et Historique de Québec; lequel, en nous mettant en possession d’une production qui fera honneur au prochain volume de nos transactions, nous met en correspondance avec une Institution très respectable.—La médaille d’or d’Isis, qui accompagne cette lettre, est un remerciment que la Société fait à Mr. Green pour sa communication: le prix en sera aussi augmenté dans l’opinion de Mr. Green, et de la Société des Arts, si votre Seigneurie veut bien avoir la bonté de présenter la médaille à Mr. Green, à la prochaine assemblée de l’Institution dont il est Secrétaire.—J’ai l’honneur d’être, &c.
Arthur Aikin, Secrétaire.
Londres, 25 Mars, 1828.
Le même à William Green, Écuyer.
Monsieur—J’ai ordre de vous informer que la Société a reçu et pris en considération votre intéressant écrit sur certaines peintures, produit du Canada. On les a éprouvées, autant que la petite quantité qui a été envoyée le pouvait permettre, tant à l’huile qu’à l’eau, avec des résultats très satisfaisants. La laque brune paraît supérieure à la laque brulée de garance, la seule couleur présentement connue qui puisse lui être comparée. La laque rouge est pareillement supérieure à la plupart des échantillons de la même espèce qui se trouvent dans les boutiques.—L’ochre rouge et l’ochre jaune se travaillent admirablement bien avec de l’eau, et avec de l’huile, elles égalent les meilleures que nous ayons. Comme témoignage du prix que la Société attache à votre communication, elle vous prie d’accepter sa médaille d’or d’Isis.—Elle serait bien aise de recevoir des échantillons plus considérables des articles ci-dessus, particulièrement des racines du gallium tinctorium, pour les mettre entre les mains de Mr. Geo. Field, le plus habile fabricant de laque de garance que nous ayons présentement à Londres.
Arthur Aikin, Secrétaire.
Londres, 25 Mars, 1828.
En conséquence du désir exprimé dans la première lettre, S. E. le Gouverneur Général, à une assemblée récente de la Société Littéraire et Historique de Québec, a pris occasion de présenter la médaille d’or d’Isis à Mr. Green, en accompagnant la cérémonie de remarques dont tous les membres présents out reconnu la justesse et la convenance.—Gaz. de Québec, par autorité, du 12 Juin.
———————
A Ste. Geneviève, le 3 du présent mois de Juin, par Messire Bruneau, Mr. A. T. Kimber, Notaire, de Montréal, à Dlle. Marie Anastasie Berthelot, fille d’A. Berthelot, écuyer, de Ste. Geneviève;
A Montréal, le 10, William Smith, écr., Avocat de Québec, à Dlle. Henrietta Platt, fille de feu G. Platt, écr;
Au même lieu, le 23, par Messire St. Pierre, Mr. W. P. Spink, à Dlle. Joséphine Frechette, tous deux de cette ville;
A la Rivière du Loup, le même jour, par Messire Lebourdais, Mr. Léandre Lemaitre-Auger, Marchand, à Dlle. Elisabeth Ranvoyzé, fille de feu Et. Ranvoyzé, écr.;
A Laprairie, le 24, par Messire Boucher, Mr. Pierre Villeneuve, à Dlle. Mélanie Dupré, fille d’Antoine Dupré, Ecr.
A Québec, le même jour, Mr. Aug. Kelly, Marchand, à Dlle. Marie Adélaïde Drapeau;
Aux Trois-Rivières, le 25, P. N. Rossiter, écr. Avocat, de Montréal, à Dlle. Anne Caroline Cartwright;
A Terrebonne, le 26, par Messire St. Germain, Joseph Ovide Turgeon, écr. membre de la Chambre d’Assemblée, à Dlle. Hélène Olive Turgeon, fille de Michel Turgeon, écr.
Le 12 Décembre, à Laval, département de la Mayenne, en France, Messire Charles Langlois dit Germain, ci-devant Prêtre de ce diocèse;
Le 3 du présent mois de Juin, à Lanoraie, Messire Michel Bezeau, Curé de cette paroisse, âgé de 47 ans;
Le 11, à Contrecœur, Benjamin Leroux, écr., Capitaine de Milice, âgé de 70 ans;
Le 15, à St. Nicholas, Dlle. Adélaïde Levasseur-Borgia, âgée de 20 ans;
Le 21, à Varennes, Mr. Georges Laurent, Marchand, âgé de 50 ans;
Le 24, à St. Laurent, Mr. J. Bte. Groux, Etudiant en rhétorique au Petit-Séminaire de Montréal;
Le 27, à la Pointe aux Trembles, Mr. Joseph Beaudry, âgé de 38 ans;
Le même jour, à L’Assomption, universellement regrettée, Dame Marianne Elisabeth Poudret, épouse de J. E. Faribault, écuyer, âgée de 56 ans;
Le 28, à la Pointe Fortune, Miles M’Donell, écr., âgé de 62 ans;
Le 29, à Montréal, Jean Olivier, enfant de P. L. Letourneux, écr., âgé de 2 ans et 4 mois;
Dernièrement, à Chateauguay, Dlle. Eugénie Demers, âgée de 23 ans.
Mis-spelled words and printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Inconsistency in hyphenation has been retained.
Inconsistency in accents has been corrected or standardised. Inconsistency in accents has been retained.
Because of copyright considerations, the illustrations by X (y-z) have been omitted from this etext.
Illustrations have been relocated due to using a non-page layout.
Some photographs have been enhanced to be more legible.
When nested quoting was encountered, nested double quotes were changed to single quotes.
[The end of La Bibliothèque Canadienne, Tome VII, Numero 1, Juin, 1828. edited by Michel Bibaud]