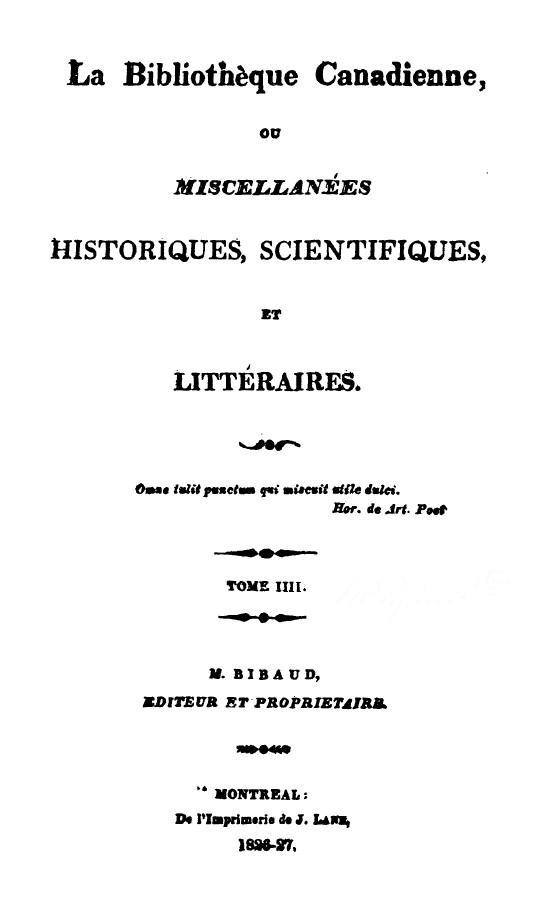
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque Canadienne, Tome IV, Numero 5, Avril, 1827.
Date of first publication: 1827
Author: Michel Bibaud
Date first posted: Apr. 30, 2020
Date last updated: Apr. 30, 2020
Faded Page eBook #20200454
This eBook was produced by: Marcia Brooks, David T. Jones, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
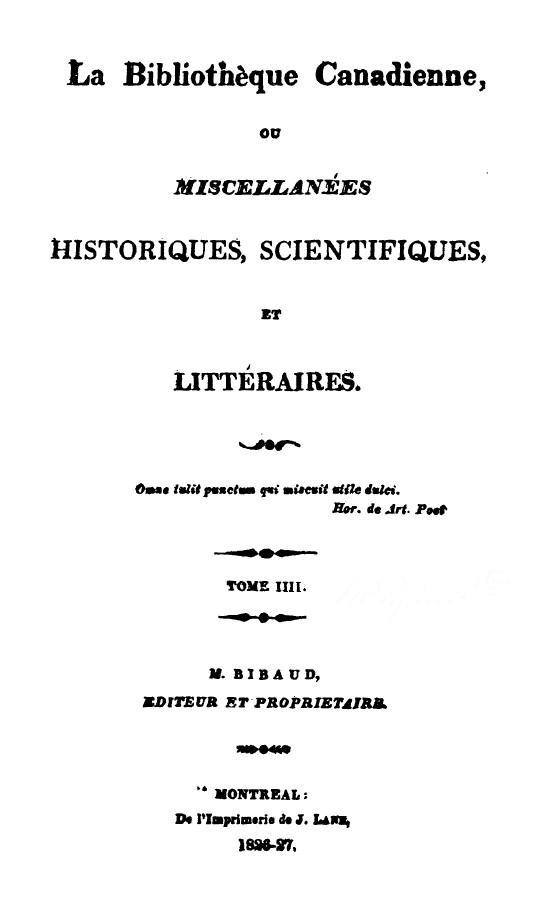
La Bibliothèque Canadienne
| Tome IV. | AVRIL, 1827. | Numero 5. |
M. de Courcelles, persuadé de la nécessité d’opposer une barrière aux Iroquois qui, vainqueurs de tous leurs voisins, et particulièrement des Andastes et des Chaouanons, n’avaient plus guère d’occupation au dehors, fit dire aux principaux chefs des cantons, qu’il avait une affaire importante à leur communiquer, et qu’il irait incessamment les attendre à Catarocouy. Ils s’y rendirent en grand nombre, et le général, après leur avoir témoigné beaucoup de bienveillance, et leur avoir fait de beaux présens, leur déclara qu’il avait dessein de bâtir, en cet endroit même, un fort où ils pussent venir plus commodément faire la traite avec les Français.
Les sauvages ne s’apperçurent pas d’abord que, sous prétexte de chercher leur utilité, le gouverneur avait principalement en vue de les tenir en bride, et de s’assurer un entrepot pour ses vivres et ses munitions, au cas qu’ils l’obligeassent à reprendre les armes. Ils répondirent que ce projet leur paraissait bien imaginé; et sur-le-champ, les mesures furent prises pour l’exécuter; mais M. de Courcelles n’en eut pas le temps: à son retour à Québec, il y trouva le comte de Frontenac, qui venait le relever.—Cependant il n’eut pas de peine à faire gouter à son successeur le projet qui lui avait fait entreprendre son dernier voyage, et dès le printemps suivant, le nouveau gouverneur se sendit à Catarocouy, et y fit construire le fort, qui porta longtems son nom, ainsi que le lac à l’entrée duquel il était situé.
Le départ de M. de Courcelles fut, suivant Charlevoix, une vraie perte pour la Nouvelle France. S’il n’avait pas, dit cet historien, les qualités éminentes de son successeur, il n’eut aussi que les moindres de ses défauts; et il est probable que la paix du Canada n’aurait pas été troublée, comme elle le fut, si ceux qui vinrent après lui, étaient entrés dans ses vues, et avaient marché sur ses traces. Son expérience, sa fermeté et la sagesse avec laquelle il gouverna, l’avaient fait aimer des Français et respecter des sauvages; et ses préventions contre les ecclésiastiques et les missionnaires, si toutefois il en eut, ne l’empêchèrent pas de leur témoigner dans l’occasion l’attention et les égards convenables.
A l’exemple du gouverneur, l’intendant avait aussi demandé son rappel, mais jusqu’au moment de son départ, il ne cessa de s’occuper des moyens de faire prospérer la colonie. On commençait à parler en Canada de la découverte d’un grand fleuve appellé Mississipi, et qui ne coulant ni au nord ni à l’est, devait fournir le moyen de communiquer ou avec le golfe du Mexique, ou avec la mer du sud. M. Talon ne voulut pas partir de l’Amérique sans avoir éclairci ce point important: il chargea de cette découverte le P. Marquette, qui avait déjà parcouru, comme missionnaire, presque toutes les contrées septentrionales du Canada, et qui était fort respecté des sauvages, et il lui associa un bourgeois de Québec, homme d’esprit et d’expérience, appellé Joliet.
Ils partirent ensemble de la baie du lac Michigan, s’embarquèrent sur la rivière des Outagamis ou Renards, puis sur l’Ouisconsing et se trouvèrent sur le Mississipi, vers les 42° 30’ de latitude, le 17 Juin 1673. Ils descendirent ce fleuve l’espace d’environ 200 lieues, jusqu’aux Arkansas; mais alors, comme les vivres et les munitions commençaient à leur manquer; qu’ils ne jugeaient pas prudent de s’avancer davantage avec deux ou trois hommes, qui les accompagnaient, dans un pays dont ils ne connaissaient pas les habitans, et que d’ailleurs ils ne pouvaient plus douter que le Mississipi ne se déchargeât dans le golfe du Mexique, ils reprirent la route du Canada. Arrivés à Chicagou, ils se séparèrent: le P. Marquette resta chez les Miamis, et M. Joliet revint à Québec, pour rendre compte de son voyage à M. Talon, qu’il trouva parti pour la France.
M. Talon, en demandant son rappel, avait promis à M. Colbert de prendre sa route par l’Acadie, et de faire la visite de cette province. Outre les raisons qu’il avait eues d’abord de proposer ce voyage, il en était survenu une autre beaucoup plus importante. Le chevalier Temple avait déclaré à M. Colbert qu’il souhaitait se retirer sur les terres de France; M. Talon eut ordre de traiter avec lui, et de d’assurer que le roi de France lui accorderait des lettres de naturalité, et lui ferait encore d’autres avantages. On espérait que l’Acadie retirerait de grands avantages de cette négociation; mais elle n’eut point de suite.
L’année suivante, M. de Chambly releva le chevalier de Grand-fontaine à Pantagoet. Il y avait tout au plus un an, qu’il était dans ce fort, lorsque le 10 Août 1674, un Anglais, qui était demeuré quatre jours déguisé dans sa place, le vint attaquer avec l’équipage d’un corsaire flamand. Cet aventurier avait cent dix hommes; M. de Chambly n’en avait que trente, et la place n’était pas d’ailleurs en état de défense. Il se défendit néanmoins d’abord avec courage; mais après une heure de combat, il reçut une blessure qui l’obligea de se retirer. Alors tous ses gens, qui étaient mal armés, et mal intentionnés, suivant Charlevoix, se rendirent à discrétion.
Les Anglais envoyèrent aussitôt après un détachement au fort de Gemesie, dans la rivière St. Jean, pour enlever M. De Maison, qui y commandait; ce qui fut exécuté sans résistance. L’auteur de ces hostilités n’avait pas de commission, et fut désavoué; mais le mal était fait, et les troubles où était le Canada ne permirent pas de le réparer de suite.
Nous venons de voir que M. de Courcelles venait d’être remplacé par le comte de Frontenac (Louis de Buade) comme gouverneur-général. “Le caractère de ce dernier, dit l’auteur des Beautés de l’Histoire du Canada, a quelque chose de trop extraordinaire pour être passé sous silence. Les relations le peignent comme un homme doué de grandeur d’âme et d’héroïsme; ferme de caractère, mais altier et indomptable; ayant de grandes vues, mais incapable de céder aux conseils et de modifier ses desseins; courageux, persévérant, homme d’esprit, homme de cour, mais susceptible de préventions; sacrifiant la justice à ses haines personnelles, et le succès d’une entreprise au triomphe de ses préjugés: ambitieux, ardent; homme dont on avait tout à espérer et beaucoup à craindre.”
M. de Frontenac s’était brouillé d’abord avec les ecclésiastiques et les missionnaires; M. de Salignac Fénélon, du séminaire de St. Sulpice, fut mis en prison, sous prétexte qu’il avait prêché contre le comte de Frontenac, et qu’il avait tiré des attestations des habitans de Montréal en faveur de M. Perrot, leur gouverneur, que le général avait fait mettre aux arrêts, apparemment pour avoir pris le parti de ses adversaires, ou être contrevenu à ses ordres. Il se brouilla ensuite avec M. Duchesneau, qui avait succédé à M. Talon, comme intendant. Ce dernier, et ceux des habitans qui avaient à cœur la bonne administration de la justice, se plaignaient surtout que le gouverneur n’avait composé le conseil supérieur que de gens qui lui étaient entièrement dévoués, et que par-là il s’était rendu l’arbitre souverain de la justice, et tenait tout le monde sous le joug; qu’on ne voyait qu’huissiers en campagne, et que depuis six ou sept mois, il y avait eu plus de procès dans la Nouvelle France qu’on n’y en avait vu depuis cinquante ou soixante ans; qu’enfin il régnait partout une telle confusion, que si cet état de choses ne changeait, il y avait tout à craindre pour la colonie.
Il faut pourtant avouer, dit Charlevoix, que tous les coups de vigueur que fit alors le comte de Frontenac ne furent pas repréhensibles, quant au fond; mais, ajoute cet historien, lors même qu’il usait le plus à propos de sévérité, il le faisait avec un air de violence, et des manières si hautaines, qu’il diminuait beaucoup le tort des coupables, en rendant le châtiment odieux; ce qui le jettait souvent, et quelquefois même la cour, dans de très grands embarras.
Le terrain de la Prairie de la Magdeleine ne se trouvant pas favorable aux grains que les sauvages avaient coutume de semer, cette peuplade était menacée d’être détruite par la famine ou par la désertion. Pour éviter ce contretems, (car c’en eût été un alors pour la colonie,) les missionnaires demandèrent au gouverneur et à l’intendant un autre emplacement vis-à-vis du Sault St. Louis. M. de Frontenac ne répondit rien à leur requête; mais M. Duchesneau leur accorda ce qu’ils demandaient, et ils s’en mirent en possession. Autre sujet de brouillerie entre le gouverneur et l’intendant, et d’emportemens inexcusables de la part du premier, suivant l’historien qui nous sert de guide.
Mais le fort de la dispute était toujours au sujet du conseil supérieur, dont M. de Frontenac voulait réduire à lui toute l’autorité, jusqu’à s’approprier le titre et les fonctions de président.—Pour faire cesser ce différent, qui allumait le feu de la discorde dans toutes les parties de la colonie, parce que M. de Frontenac et M. Duchesneau avaient chacun leurs partisans, le roi rendit le 5 Juin 1675, une ordonnance portant, que sa majesté confirmait ce qui avait déjà été décidé, savoir, que le gouverneur général aurait la première place dans le conseil; l’évêque, la seconde, et l’intendant, la troisième; mais que ce serait à ce dernier à demander les opinions, à recueillir les voix, et à prononcer les arrêts.
Le comte de Frontenac ne se rendit pourtant pas, et sous différents prétextes, traita fort mal tous ceux qui, en cela, comme en toute autre chose, se permirent de le contrarier. Il exila de sa propre autorité le procureur-général et deux conseillers; il rompit ouvertement avec l’intendant, et ne craignit pas de dire qu’il regrettait de ne l’avoir pas fait mettre en prison immédiatement après le départ des vaisseaux; qu’il aurait eu le plaisir de l’y tenir deux années entières, parce qu’il fallait ce temps-là pour avoir un ordre de la cour qui l’en fît sortir.
C’est ici le lieu de remarquer que le conseil supérieur siégeait régulièrement, tous les lundis, au palais de l’intendant: s’il était nécessaire de l’assembler extraordinairement, l’intendant en devait marquer le jour et l’heure, et en faire avertir le gouverneur par le premier huissier. La justice s’y rendait suivant les ordonnances du royaume de France et la coutume de Paris. Le nombre des conseillers avait été augmenté de deux, à l’arrivée de M. Duchesneau. Outre le conseil supérieur, il y avait encore, dans la colonie, trois justices subalternes, celle de Québec, celle de Montréal et celle des Trois-Rivières. Elles se composaient d’un lieutenant particulier et d’un procureur du roi. Le premier conseiller, qui était nommé par la cour, avait huit cents livres tournois d’appointemens; les cinq plus anciens avaient chacun quatre cents livres: les autres n’avaient rien, et il n’y avait point d’épices.—Le procureur-général et le greffier en chef avaient aussi des appointemens modiques. Ceux des cours subalternes furent réglés par une déclaration du roi, du 12 Mai 1678. Dans ce temps-là, les notaires et les huissiers ou sergens avaient aussi des salaires; sans quoi, dit notre historien, ils n’auraient pas eu de quoi vivre, le casuel se réduisant presque à rien, dans une colonie si pauvre et si peu peuplée.
Le principal sujet de démêlé entre le gouverneur et l’évêque, était la traite de l’eau de vie, qui avait recommencé depuis quelques années. M. de Laval et les missionnaires se plaignaient que ce commerce causait des désordres scandaleux parmi les sauvages, et sévissaient, autant qu’il était en leur pouvoir, contre ceux qui le faisaient: M. de Frontenac et ceux qui pensaient comme lui, prétendaient que la traite de l’eau de vie était absolument nécessaire pour attacher les naturels du pays aux Français; que les abus dont les ecclésiastiques faisaient tant de bruit, s’ils n’étaient pas imaginaires, étaient du moins fort exagérés, et que leur zèle sur cet article n’était guère qu’un prétexte pour persécuter ceux qui les empêchaient de dominer dans le pays.
Les opinions furent quelque temps partagées, sur ce sujet, à la cour et au conseil du roi: M. Duchesneau ayant écrit à M. Colbert, en termes très forts, pour appuyer le sentiment du prélat, qui avait fait un cas réservé de la traite de l’eau de vie, le ministre lui répondit qu’il n’agissait pas en cela comme devait faire un intendant; qu’il devait savoir qu’avant d’interdire aux habitans du Canada un commerce de cette nature, il fallait bien s’assurer de la réalité des crimes auxquels on prétendait qu’il donnait lieu. En effet, par un arrêt du conseil, du 12 Mai 1678, il fut ordonné qu’il y aurait une assemblée de vingt des principaux habitans de la Nouvelle France, pour donner leurs avis touchant la traite en question. Cela fait, et les raisons apportées de part et d’autre, le roi prit le moyen le plus propre pour donner gain de cause au clergé: il voulut que l’archevêque de Paris et le P. de Lachaise, son confesseur, fussent les juges du différent. Le prélat et le religieux, après avoir conféré avec l’évêque de Québec, qui se trouvait alors en France, jugèrent que la traite de l’eau de vie dans les habitations des sauvages, devait être défendue, sous les peines les plus grièves. Il y eut une ordonnance du roi pour appuyer ce jugement, et il fut expressément enjoint à M. de Frontenac de la faire exécuter, le prélat s’étant engagé, de son côté, à réduite le cas réservé aux termes de cette ordonnance.
Il fallut aussi que le monarque intervînt pour terminer, ou appaiser le différent entre le gouverneur et l’intendant, au sujet du conseil supérieur. Dans une lettre adressée à M. Duchesneau, le roi disait à cet intendant, qu’il aurait évité toutes les violences dont il se plaignait, si, suivant ses ordres, il s’était contenté d’exposer ses raisons au gouverneur, et s’il lui eût obéi, en l’avertissant qu’il donnerait avis de tout au conseil. Il disait en substance à M. de Frontenac, qu’il était contraire à son édit, qu’il se qualifiât de chef et de président du conseil supérieur; que ce titre ne valait pas celui de lieutenant-général et de gouverneur, dont il devait se contenter; que c’était à l’intendant, et non à lui, qu’il appartenait de faire les fonctions de président du conseil, de recueillir les voix et de prononcer les arrêts, et d’avoir chez lui les régistres, &c.
Au mois de Mai 1679, il y eut un édit du roi au sujet des curés que l’on voulait rendre fixes, au lieu d’amovibles qu’ils avaient été jusqu’alors. Cet édit confirma aussi le règlement provisoire du conseil supérieur de l’année 1667, au sujet des dimes.
Ce fut au mois d’Octobre de cette même année 1679, que fut finalement enrégistrée au conseil supérieur de Québec, avec les modifications approuvées par un édit du mois de Juin précédent, l’ordonnance de Louis XIV, du mois d’Avril 1667, concernant la procédure, ou la Rédaction du Code civil, comme on appelle communément cette ordonnance.
(A continuer.)

Quand je lis l’histoire dans les auteurs anciens, des fictions agréables me soutiennent quelquefois contre le récit des atrocités; quand je la lis dans les écrivains modernes, je ne vois qu’une suite effrayante de tableaux, dont rien n’adoucit l’horreur. L’homme paraissant tout seul sur la scène, j’ai honte de sa prétendue perfection, et je préfère des mensonges qui m’amusent à des vérités qui me révoltent.
C’est ce qui m’a fait naître l’idée de rendre à l’histoire ancienne les ornemens dont on l’a dépouillée. Je commence par celle des Romains, et je vais renfermer dans un petit nombre de pages ce qu’elle offre de plus essentiel, depuis la prise de Troie jusqu’à la mort de Romulus.
Dans ce temps-là, vivait un homme qui s’appellait Enée; il était bâtard, dévot et poltron: ces qualités lui attirèrent l’estime de Priam, qui, ne sachant que lui donner, lui donna une de ses filles en mariage. Son histoire commence à la nuit de la prise de Troie. Il sortit de la ville, perdit sa femme en chemin, s’embarqua, eut une galanterie avec Didon, reine de Carthage, qui vivait quatre cents ans après lui; donna des jeux très amusants auprès du tombeau de son père Anchise, mort en Sicile, et parvint enfin en Italie, vers l’embouchure du Tibre, où le premier objet qui frappa ses regards fut une truie qui venait de mettre bas trente cochons blancs.
Là devaient se terminer ses voyages; les oracles l’avaient prédit. Il prit aussitôt possession de la contrée, et commença par tracer l’enceinte d’une ville. Il voulut ensuite savoir à qui ces lieux appartenaient avant son arrivée; on lui dit: “C’est le Latium; ces campagnes offertes à vos yeux sont cultivées par les Latins: la ville que vous voyez sur cette colline s’appelle Laurentum, et le château garni de tours qui la couronne, est le séjour du roi Latinus, fils de la nymphe Marica.”
Latinus était très vieux, et n’avait qu’une fille très jeune, nommée Lavinie. Il l’avait promise à Turnus, roi des Rutules, qui joignait une valeur brillante aux grâces de la jeunesse et de la figure. Cet hymen allait se conclure, lorsque des nouvelles effrayantes en suspendent les apprêts. On apprend que des corsaires, descendus sur le rivage, abattent les forêts, s’emparent des propriétés, et sèment la terreur aux environs. En même temps, l’on voit dans la pleine cent ambassadeurs troyens venir à pas précipités. Latinus n’a que le temps de se jetter sur le vieux trône de ses ayeux, et les Troyens introduits lui déclarent qu’ils sont venus par l’ordre des dieux, sous la conduite du fils de Vénus, s’établir dans ses états, et lui donnent le choix de la guerre ou de la paix. La cour de Laurentum fut étonnée d’un pareil langage; mais elle le fut bien plus, quand elle entendit le roi proférer gravement ces paroles: “Je vous laisse ce que vous avez pris; et je choisis pour gendre le fils de Vénus, à condition qu’il viendra voir le fils de Marica.”
Les cris de la reine, les pleurs de Lavinie, les fureurs de Turnus, rien ne put changer la résolution du roi: on courut aux armes, et la guerre finit par la mort de Turnus, que le vaillant Enée abattit d’un coup de pierre. Devenu possesseur du royaume des Latins, il acheva la ville qu’il avait commencé de bâtir, et qu’il nomma Lavinium, du nom de sa femme. Pendant qu’il s’occupait de ce paisible soin, il fut témoin d’un prodige qui cachait un mystère impénétrable à tout autre qu’à lui. Le feu ayant pris naturellement à un bouquet de bois, on vit, presque dans le même instant, un loup y accourir, et l’alimenter, en y jettant des matières combustibles; un aigle descendre des cieux, pour l’agiter de ses ailes; un renard en arrêter les progrès, en secouant sur la flamme naissante sa queue, qu’il avait trempée dans le fleuve: cette scène se réitéra plusieurs fois. A la fin, le bois fut consumé, et le renard se retira. A l’aspect de cet évènement, qu’on ne peut révoquer en doute, puisqu’on voit conservées, depuis longtems, dans la place de Lavinium, les figures de ces trois animaux en bronze, Enée augura que la colonie trouverait de grands obstacles à son établissement; mais que, par la faveur des dieux, elle triompherait avec éclat de la jalousie des hommes.
Cependant ce sentiment germait parmi les nations voisines. Il fut attaqué par les Etrusques et les Rutules; le combat se donna sur les bords du Numicus, petit ruisseau dont les eaux étaient employées par préférence au culte de Vesta, et qui s’épuisa, dit-on, un jour que les libations devinrent plus fréquentes. Enée, au milieu de l’action, fut poussé dans le ruisseau, et s’y établit si bien qu’il s’y noya.
Ainsi finit l’histoire de ses exploits; celle de sa gloire serait plus étendue et aussi surprenante. Errant, fugitif, ayant besoin de tout le monde, et personne n’ayant besoin de lui, ses voyages laissèrent partout des traces profondes: ceux qui mouraient à sa suite eurent le privilège d’illustrer les lieux témoins de leurs derniers soupirs. Des îles, des promontoires quittèrent leurs anciens noms, et prirent ceux de ses cousines et de ses nourrices, de son pilote, de son trompette; et quoique suivant la remarque d’un écrivain judicieux, on ne puisse être enterré que dans un endroit, plusieurs villes se félicitent de conserver son tombeau.
Ascagne, son fils, se hâta de le mettre au nombre des dieux, de l’enfermer dans les murs de Lavinium, et de proposer la paix aux ennemis. Mézence, roi des Etrusques, en dicta les articles, et exigea pour tribut, tout le vin qu’on recueillerait dans le pays des Latins.
Nous devons cette liqueur, dit le plus savant des anciens naturalistes, au privilège qui nous distingue des autres animaux, celui de boire sans en avoir besoin; c’est de tous les droits de l’homme le plus généralement reconnu. Les Latins allaient en être dépouillés, lorsqu’Ascagne prit le parti de consacrer à Jupiter toutes les vignes de ses états, et d’en avertir Mézence.
La paix se fit à de plus douces conditions. Le vœu d’Ascagne ne fut point exécuté. Il n’empêcha pas les Romains de s’ennivrer du vin du Latium, ni un ambassadeur grec de le trouver aussi mauvais qu’il est en effet; mais il empêcha les généraux romains de former des sermens indiscrets. Papirius, dans sa guerre contre les Samnites, implora l’assistance de Jupiter, et ne lui promit, pour prix de la victoire, qu’un petit verre de vin.
Ascagne se promenait, un jour, sur les bords du lac d’Albano, et racontait, peut-être pour la centième fois, à ses courtisans, les circonstances de son arrivée en Italie. Il observa que depuis cette époque, il s’était écoulé trente ans. Ce mot, en lui rappellant les trente petits cochons blancs qu’il avait vus, au sortir du vaisseau, fut un trait de lumière pour lui, et le germe des plus grandes choses qui se soient faites dans ce monde. Il conclut du nombre de ces animaux, qu’il devait sans différer, bâtir une ville, et de leur couleur, lui donner le nom d’Albe, parce que ce mot, en latin, désigne la couleur blanche. Il en fit aussitôt jetter les fondemens, et cette ville, remplacée aujourd’hui par un couvent de récollets, fut l’origine de Rome et de ses hautes destinées.
Après la mort de ce prince, Albe fut successivement gouvernée par douze rois, pendant l’espace d’environ trois cent cinquante ans: ils régnèrent dans le plus grand silence, excepté Alludius, qui avait trouvé l’art d’imiter la foudre, et qui finit par l’attirer sur sa maison.
Procas, le dernier de ces douze rois, laissa deux fils, Numitor, à qui le trône appartenait, et Amulius, qui s’en empara. Cet usurpateur, dans la crainte que Sylvie, sa nièce, ne trouvât dans un époux le vengeur de son père, l’obligea de se consacrer à Vesta.
Sylvie, chargée du soin de sa virginité et des fonctions du ministère, partageait ses efforts entre ses devoirs. Un jour, que devant offrir un sacrifice, elle allait chercher de l’eau pure, dans une source placée hors de la ville, et entourrée d’arbres touffus, elle vit, à l’entrée de la grotte, au lieu d’une nymphe mollement penchée sur son urne, un grand homme debout, tenant d’une main son bouclier, de l’autre sa lance, la tête couverte d’un casque qui ne laissait entrevoir qu’une barbe noire et fort épaisse: cet homme était le dieu Mars. Elle en fut effrayée; mais ils étaient seuls, et cette solitude, ce gazon, cette fontaine!... Neuf mois après, Sylvie mit au monde deux jumeaux, qui furent nommés Romulus et Rémus. Le roi d’Albe, qui n’avait point été prévenu de leur arrivée, ordonna de les jetter dans le Tibre, et condamna leur mère à passer le reste de ses jours dans une prison où il n’y avait ni dieu ni fontaine.
On mit les enfans dans un berceau, et ce fleuve, après l’avoir balotté pendant quelque tems sur ses flots, grossis par la fonte des neiges, le déposa doucement au pied du mont Aventin, sous un figuier qui, pour prix de l’ombrage qu’il avait prêté, subsistait encore mille ans après. Alors s’approchèrent du berceau deux animaux, une louve, qui leur donna le premier lait, et un pivert, qui de son bec glissait dans leur bouche de petites miettes ramassées ça et là.
(La fin au numéro prochain.)

Le commencement de ce livre donne un pressentiment des maux à venir. Le poëte élève son sujet au-dessus de l’Iliade et de tous les sujets profanes. Satan banni du paradis terrestre essaie à y rentrer, et il y réussit. Il s’introduit dans le corps d’un serpent; mais avant de se métamorphoser, il se parle à lui-même, se déchaîne contre le Tout-puissant, et s’indigne de l’abaissement qu’il est obligé de subir, en entrant dans le corps d’un animal rampant. Enfin il s’empare d’un reptile qu’il trouve endormi. Pendant ce temps, Eve s’adresse à son époux, lui parle de ses fleurs et du travail qu’elle y consacre; elle fait aussi quelques réflexions sur l’insipidité des choses qui ne sont point acquises par le travail.—Adam lui répond qu’il partage ses sentimens; toutefois, il lui fait entendre qu’il craindrait de la voir absente, à cause de Satan, qu’il connaît dans l’intention de la tenter: enfin il la supplie de demeurer continuellement avec lui. Eve aussi surprise qu’affligée de la défiance d’Adam, lui répond qu’elle connait bien les dangers qu’elle peut courir étant seule; mais qu’elle se croit assez de prudence pour s’en tirer: elle lui fait part du chagrin que lui cause son peu de confiance en elle, Adam lui demande en réponse si elle connaît la ruse et le pouvoir de l’ange tentateur: il lui rappelle les esprits célestes qu’il a changés en démons par ses artifices.
Eve se voyant toujours taxée de faiblesse, laisse voir une douleur manifeste de ce qu’elle ne peut sortir impunément, et Adam vaincu par ses plaintes, consent à ce qu’elle s’absente, en lui recommandant de faire usage de sa raison en cas de péril. Eve part en assurant Adam qu’elle se croit capable de résister aux tentations de l’ennemi, et l’ennemi, sous sa figure empruntée, ne tarde pas à la voir. Il admire sa beauté, qui adoucit pour un moment sa fureur; mais bientôt sa rage se rallume; et il s’excite à profiter de l’occasion que lui offre une femme dénuée de tonte protection. En s’occupant ainsi avec lui-même, il s’avance vers la mère des humains; il la regarde, et finit par lui adresser la parole, en lui faisant un discours plein de louanges passionnées. Eve, étonnée de lui entendre articuler des sons humains, lui demande comment il se fait qu’il puisse ainsi exprimer ses pensées par la parole. Le traitre lui répond dans un langage insidieux, que c’est l’effet d’un fruit qu’il avait cueilli sur un arbre. Eve sentant sa curiosité piquée, demande au reptile où est cet arbre: celui-ci s’offre aussitôt à l’y conduire. Eve accepte; ils s’acheminent et arrivent à l’arbre, que l’épouse d’Adam reconnait pour celui de la science du bien et du mal, et elle refuse d’y toucher, alléguant pour raison la défense de Dieu.
Le tentateur montre de la surprise; il parle à Eve d’une manière qui égale, dit Milton, celle des orateurs grecs et romains: il conclut son oraison, en lui promettant la divinité, si elle mange du fruit défendu. L’épouse d’Adam est tentée par le goût et l’odorat, et elle est séduite par l’ambition. Elle parle longtemps; elle se consulte, elle finit enfin par manger. Le serpent se cache, et cependant elle s’épuise en transports de joie: elle rend grâces à genoux à l’arbre producteur des fruits qui lui ont plu; elle part pour aller trouver son époux, qu’elle instruit de ce qu’elle a fait. Adam est rempli de consternation et d’épouvante, mais finit, après une grande perpléxité, par se résoudre à partager le sort de sa moitié. Celle-ci se répand en effusion de sentimens de reconnaissance pour son époux, et lui présente le fruit fatal, qu’il mange aussitôt. Ensuite, ils se retirent tous deux pour se reposer. A leur réveil, Adam sent naître des remords qui, le subjuguant, le font éclater en invectives contre le serpent et ensuite contre sa femme, qui s’émeut, et lui reproche sa propre faiblesse, en maudissant sa coupable indulgence. Adam aigri par cette vive repartie, parle à Eve d’une manière injurieuse, et rejette sur elle toute la culpabilité de leur faute commune. C’est ainsi qu’ils commencent leurs malheurs, en se divisant.
Dès que les anges s’apperçoivent de la désobéissance de l’homme, ils désertent le paradis terrestre. Ils ne peuvent concevoir comment l’ange rebelle a pu s’introduire dans le jardin, à leur insçu. Ils s’appitoient sur le sort de l’homme; mais leur douleur n’altère point leur félicité. Cette pensée est rapportée, avec cette énergie qui est particulière à Milton.
..................Dim sadness did not spare
That time, celestial visages, yet mix’d
With pity, violated not their bliss.
Cependant les anges se rendent devant le trône de l’Eternel, qui leur parle de la chûte de l’homme. Il s’adresse ensuite à son fils, qu’il charge d’aller décider du sort des humains. Le Verbe part seul pour se rendre sur le globe terrestre; et il arrive dans Eden. Là, il appelle Adam, qui fuit aussitôt avec son épouse; mais le fils de Dieu les voit dans l’endroit où ils se sont cachés, et il s’approche, en leur ordonnant de paraître. Adam, pour excuser son retard à obéir, dit que sa nudité l’a empêché de se montrer aussitôt: mais le Seigneur lui demande s’il n’aurait pas mangé du fruit défendu, puisqu’il n’y avait que ce fruit seul qui pût donner connaissance de la nudité. Le père des hommes voulant s’excuser sur son épouse, reçoit une réponse foudroyante. Dieu s’adresse ensuite à Eve, qui rejette la faute sur le serpent. Le Seigneur irrité condamne le serpent à ramper sur la terre, et lui prédit sa défaite future par une femme. Il dit ensuite à Eve qu’elle enfantera dans d’horribles douleurs, et qu’elle sera soumise à son mari. Adam enfin est condamné à gagner son pain à la sueur de son front, et le couple infortuné entend prononcer l’arrêt de mort sur lui et ses descendans.
Le Verbe divin retourne vers son père, et cherche à appaiser sa colère, en faveur de l’homme accablé de maux. Pendant ce temps, la Révolte fait une proposition à la Mort, sa fille; elle l’engage à aller avec elle à la recherche de Satan, son père. La Mort y consent avec joie, et elles partent en volant dans les airs. La Mort, avec sa masse, fait sur l’abîme un pont de glace, dont elle cimente les matériaux avec de l’asphalte. Il aurait été, ce semble, plus commode à la Mort et à la Révolte de faire un saut par-dessus l’abîme; car ce n’est que comme cela qu’elles ont pu faire les fondations du pont. Ce pont est comparé à celui que Xerxes fit bâtir sur l’Hellespont. Le poëte nous informe en sus que Xerxes fit fouetter la mer et la mettre aux fers. Voici les vers qui renferment cet étalage d’érudition.
Xerxes the liberty of Greece to yoke,
From Susa, his Memnonian palace high,
Came to the sea, and over Hellespont
Bridging his way, Europe with Asia
Joined, and scourged with many a stroke
Th’indignant waves.
Le pont achevé, la Mort et la Révolte passent l’abîme, et déploient leurs ailes dans notre univers. Mais elles sont surprises par la rencontre de Satan, qu’elles reconnaissent et à qui elles souhaitent le bonheur. Mais Satan est étonné à la vue du pont qu’elles ont bâti: elles l’informent qu’elles ne l’ont érigé que pour se réunir à lui: il en est charmé. Il leur conseille d’aller visiter le monde, et de se divertir de leur mieux; quant à lui, il retourne dans les gouffres infernaux, à la porte desquels il arrive bientôt. Il trouve que le guet démoniaque en est parti; il entre dans son empire et voit le conseil assemblé. Encore de la géographie et de l’histoire en comparaison.
As when the Tartar from his Russian foe,
By Astracan, over the snowy plains
Retires; or bactrian Saphi from the horns
Of Turkish crescent, leaves all waste beyond
The realm of Aladule, in his retreat
To Taurus or Casbeen.
Satan entre dans le Pandémonium, sous des traits inconnus, redevient aussitôt lui-même, et est applaudi par le peuple des démons. Il leur fait un court récit de ses aventures et de ses travaux, et leur promet le monde terrestre pour s’y réfugier. Il se tait, attendant les louanges et les applaudissemens qu’il croit mériter; mais il n’entend que des sifflemens. Satan en est étonné; mais ils l’est encore davantage, lorsqu’il s’apperçoit qu’il se métamorphose avec ses compagnons en serpens. Les voila tous mêlés les uns avec les autres sans aucune distinction. Ils sortent tous pour aller chercher ceux qui montaient la garde des enfers; mais tous ces superbes régimens laissent tomber leurs armes, et deviennent aussi des serpens. L’arbre de la science du bien et du mal parait dans leur demeure chargé de son beau fruit. Les voila atteints d’une faim et d’une soif dévorantes. Mais quelle est leur douleur, lorsqu’ils trouvent que ces fruits, si blancs en apparence, ne sont que des amas de suie et de cendre, dont l’amertume brulante leur donne un déboire affreux, qui ne les dégoute que pour les abuser encore par une couleur séduisante et perfide.
Cependant la Révolte et la Mort se rendent dans Eden: la première se livre à des transports de joie, en voyant ce monde, dont elle se croit reine: mais la Mort préfère à tout le plaisir d’assouvir sa passion pour le carnage. Dieu en les voyant les montre aux anges. Il prononce un jugement favorable aux hommes. Alors les cieux retentissent de chants d’allégresse, en réjouissance de la décision du Très-haut. Dieu ordonne aux anges de faire divers changemens dans la nature: par son ordre, les saisons commencent et toutes les révolutions des astres. (Suit la description des travaux angéliques, qu’il serait très utile et très excellent de lire auprès d’une sphère armillaire.) Tandis que ces bouleversemens s’opèrent dans le monde, Adam effrayé du désordre qu’il remarque partout, se parle, se rappelle son bonheur passé, et réfléchit avec épouvante à son avenir et à celui de sa postérité. Il s’adresse à tout ce qui l’environne, et Eve voulant le consoler, ne reçoit de lui que de cruels reproches. Elle se jette à ses pieds, le conjure d’oublier sa faute, et l’exhorte à s’unir avec elle, pour repousser l’ennemi commun; enfin elle fait tout pour ranimer ses premiers sentimens envers elle. Adam appaisé lui parle d’une manière plus douce, et s’écrie sur les malheurs de sa race à venir. Eve fait à Adam une proposition qu’il n’approuve pas: il lui indique la seule voie qui peut les garantir des derniers malheurs, et lui parle des moyens auxquels ils auront recours pour suppléer à leurs besoins. En parlant ainsi, ils versent tous deux des pleurs, et se mettent en prière.
(La fin au prochain numéro.)

L’Histoire de Napoléon et de la grande armée, pendant l’année 1812, par M. le comte Ségur, est déjà assez connue: l’Examen critique de cette histoire, par M. le général Gourgaud, ne l’est peut-être pas autant qu’il mérite de l’être: quiconque a lu le premier de ces deux ouvrages doit lire le second, si dans ses lectures, il ne recherche pas uniquement l’amusement, mais encore la vérité et l’instruction. C’est sans doute pour donner le désir de lire l’Examen critique, qu’un de nos abonnés nous a communiqué pour insertion dans la Bibliothèque Canadienne, les passages suivants, (le début et la fin,) de cet ouvrage, qu’il nous dit être à vendre, à Montréal, chez MM. E. R. Fabre et Cgnie., en un volume in 8vo. 3ème. édition, Paris, 1826.
Le général Gourgaud, compagnon d’exil de Napoléon à Ste. Hélène, s’exprime ainsi, dans une espèce d’avant-propos:
“Officier d’ordonnance de l’empereur dans la campagne de 1812, les discussions auxquelles nous avons assisté nous ont laissé de grands souvenirs; mais c’est surtout à Sainte Hélène que nous avons été à même d’amasser des documens historiques. Là nous avons vécu trois ans dans le passé; là nous avons pu recueillir dans les conversations du grand homme, qui nous avait admis dans son intimité, des renseignemens précieux.
“Ces considérations, mais encore plus notre admiration pour l’empereur, nous ont fait un devoir d’entreprendre ce travail. Il faut bien, quand un détracteur compte sur le silence du tombeau, qu’une voix au moins, quelque faible qu’elle soit, fasse entendre les accens de la vérité.
“Nous avons puisé dans les souvenirs de nos amis, et nous avons principalement été secondé dans notre entreprise par un homme qui, placé dans le cabinet de l’empereur depuis la paix d’Amiens jusqu’à la fin de son règne, a été constamment honoré de sa confiance.”
Le général Gourgaud termine ainsi son ouvrage:
“Nous avons remarqué bien rarement les bizareries du style de M. de Ségur, qui heureusement n’aura pas d’imitateurs; notre but était trop élevé pour nous attacher à ces misères. Peu nous importe qu’il prétende aux palmes académiques. Nous avons voulu, non venger la mémoire d’un grand homme, qui se défend d’elle-même, et dont le nom traversera les siècles; non relever la gloire d’une armée dont la renommée est au-dessus de toute atteinte; mais rendre hommage à la vérité; mais appeler les faits, les documens et les hommes, en témoignage contre un écrivain qui, s’abandonnant aux écarts d’une imagination déréglée, ou spéculant sur le besoin des émotions fortes, contracté par la génération présente, s’est joué dans un livre, roman, poème, ou mélodrame, en deux volumes, de tout ce qui est en possession du respect des âmes élevées, le génie, le courage et le malheur. Puissent les soldats de Napoléon, puissent les amis de la gloire française apprécier le sentiment qui a conduit notre plume, et nous savoir quelque gré de nos efforts!”

Mr. Bibaud,
Si je n’y étais pas déjà accoutumé, ce ne serait pas sans surprise que je trouve dans le No. 2, du 4e. tome de vos mélanges intéressants de littérature dédiés à des productions canadiennes, un écrit intitulé, “Quelques réflexions sur l’écrit intitulé” Esquisse de la Constitution Britannique. L’auteur commence par deviner l’écrivain de ce dernier, et loin de le nier, j’en fais gloire. Il est cependant étonnant que l’auteur des “Réflexions” se soit empressé de les mettre au jour, avant de pouvoir juger de tout l’ouvrage qu’il censure. Cette hâte est tout d’un trait avec la conduite que les adversaires des amis de la vérité tiennent journellement. Ne pouvant les combattre victorieusement, ils s’empressent d’en étouffer la voix par leurs clameurs bruyantes, et d’embrouiller la question par un babil décousu et sans suite, et bien propre à dégouter ceux qui se trouveraient autrement disposés à entrer dans le mérite de la question sur le tapis.
En effet, Monsieur, mon critique commence par déclarer dogmatiquement que, “quand on veut traiter les questions importantes qui se rapportent à ces objets,” (la politique et le gouvernement,) “il faut du moins avoir des connaissances positives et ne raisonner que sur des principes exacts; ce qui ne se trouve point dans ce que nous avons vu de l’Esquisse, &c.” On devrait bien, s’attendre, après une sentence aussi positive de l’Esquisse, que notre Aristarque se serait donné la peine de prouver son assertion, en prouvant le manque de “connaissances positives,” et l’inexactitude des “principes” qu’il ne trouve pas dans l’Esquisse. Mais non, comme il en sent l’impossibilité, il adopte le sistême de ses semblables; il fait dire à l’auteur qu’il critique ce qu’il n’a ni dit, ni voulu dire. Par exemple; il dit,[1] “et il fait l’éloge de cette Constitution,” (celle de la France avant la révolution;) et encore,[2] “cependant notre auteur s’extasie sur la Constitution de la France.” Ce que j’ai dit à ce sujet est dans le numéro précédent, et en y renvoyant tout lecteur impartial, je le défie d’y trouver rien d’approchant d’un éloge, et encore moins d’éloge extatique. J’ai soutenu seulement qu’avant la révolution, la France avait une Constitution, (bonne, mauvaise ou indifférente,) ce que mon adversaire nie positivement. Or je demande à ce docte critique, qui a “souvent lu des dissertations” volumineuses, s’il n’y a dans le monde qu’une seule forme de gouvernement à laquelle le mot de constitution ait été jusqu’ici appliqué. J’ai toujours cru que ce mot s’appliquait non seulement à un gouvernement républicain, non seulement à un gouvernement mixte, mais encore à un gouvernement monarchique héréditaire. Il est possible que depuis la révolution française, certains érudits ont rejetté le dernier de la liste, et qu’ils ont peut-être encore assez d’égards pour le second pour l’y souffrir; mais comme je parlais le langage usité avant cette fameuse époque du bouleversement de toutes les idées, j’avais raison de dire qu’alors la France avait une Constitution.—Qu’elle en a changé plusieurs fois depuis, c’est ce que tout le monde sait; que celle qu’elle a actuellement est préférable à l’ancienne, c’est ce que je nie, et c’est ce que l’expérience prouvera tôt ou tard. Et en attendant ce résultat, je m’en rapporte à une comparaison entre cette nouvelle Constitution et la Constitution britannique, la seule capable de faire “naître chez” moi “le sentiment de la plus profonde admiration,” dont notre auteur bien gratuitement, me gratifie pour l’ancienne de la France. La seule phrase qui puisse servir de fondement à l’assertion de mon “extase,” et de mon “admiration profonde” pour l’ancienne Constitution de la France est celle-ci, “la plus grande preuve que la France jouissait même d’une bonne Constitution,” &c.[3] Or je demande si elle porte le moindre caractère d’extase ou d’admiration profonde. D’ailleurs tout n’est que relatif dans le monde, et ce qui, dans certains tems et dans certaines circonstances est bon et même excellent, peut dans d’autres tems et dans d’autres circonstances, devenir défectueux et même mauvais.
Je n’ai non plus dit nulle part que “la force est un droit qui doit tout régler,”[4] mais que de fait la force s’arroge ce droit, ce que la quotation elle-même, que le critique fait de mon écrit dans cet endroit, prouve clairement.
Que j’aie dit que “un pays a une Constitution quand il a des lois fondamentales,” n’est pas plus vrai. Il ne faut avoir que le plus simple bon sens pour comprendre que quelque parfaites que soient les lois, elles sont de nul effet, si l’exécution n’en est pas confiée à une autorité investie d’un pouvoir suffisant pour les faire respecter. Or c’est la Constitution qui crée et consolide cette autorité, et qui la revêt de ce pouvoir, et qui, en fixant les devoirs et les fonctions de tous, garantit les droits de tous: car on a beau alambiquer la question, il n’y a pas de milieu, ou le droit dérive de la force, ou il est assuré par l’exécution stricte des devoirs imposés à chacun; ce que notre auteur, en se contredisant d’ailleurs dans l’espace de peu de lignes, semble entrevoir en disant, “quand les institutions fournissent les moyens de faire respecter les devoirs réciproques qui en sont le résultat,” non seulement comme il ajoute, “entre les gouvernans et les gouvernés,”[5] mais entre tous les individus de la communauté; et cependant il venait de nous dire immédiatement avant que “un état a une Constitution quand les lois assurent les droits de ceux qui le composent.” On ne peut trop le répéter, l’objet des lois est de prescrire les devoirs de tous; et comme ces lois ne peuvent agir par elles-mêmes, leur exécution, c’est-à-dire, le pouvoir nécessaire pour forcer un chacun de remplir les devoirs qu’elles imposent, est confié, par la Constitution, à de certaines institutions, qui sont comprises sous le nom général de gouvernement. C’est sous ce point de vue que le mot droit ou droits, dans l’ordre social, peut avoir une signification claire et distincte. Il est du devoir du gouvernement de me protéger, parce que la Constitution le lui impose, et lui en donne les moyens; sans cela quel droit aurais-je à sa protection? et s’il fait son devoir à cet égard, je jouis de la plénitude de mon droit. Mais si malheureusement la Constitution ne lui avait pas confié une autorité et un pouvoir suffisants pour me protéger; si, par exemple, elle avait placé entre moi et le gouvernement un pouvoir capable d’en paralyser l’action, aurais-je le droit de me plaindre, si je réclamais en vain sa protection? mon droit à cet égard devient de fait absolument nul par l’intervention de ce pouvoir. En un mot, je ne comprends rien du tout à ces mots droits de l’homme, mais bien à ceux de devoirs réciproques, de relations sociales, sur lesquels seuls reposent le bon ordre et le bien-être de toute société. Les premiers isolent l’individu, enfantent l’égoïsme, et procèdent de la vanité; les seconds rapprochent les hommes et cimentent les liens de l’association. Les premiers ne peuvent que créer la discorde; la concorde et l’harmonie ne peut que résulter des derniers. Je m’arrête ici pour le présent, et vous prie de me croire,
Monsieur Bibaud,
Votre obéissant serviteur,
UN VRAI CANADIEN.
|
Page 67, ligne 18. |
|
Page 69, ligne 7, d’en bas. |
|
No. 1—Page 10, ligne 5, et suivantes. |
|
No. 2—Page 68, ligne 12, et suivantes. |
|
No. 2—Page 69, ligne 15, et suivantes. |

Le plus grand nombre des os de ruminants fossiles se trouvent incrustés au milieu des concrétions qui remplissent les fentes que présentent certains rochers, sur les côtes de la Méditerrannée. Ces fentes, auxquelles les os qui les remplissent ont fait donner le nom de brèches osseuses, sont un des phénomènes les plus remarquables de la géologie. On ne peut expliquer, en effet, d’une manière satisfaisante, ni leur production dans les lieux où on les observe, ni pourquoi elles sont bornées aux côtes de la Méditerrannée, ni les ressemblances qu’elles présentent toutes, tant pour la nature des rochers dans lesquels elles sont pratiquées, que pour celle des matières qui les remplissent.
La nature des os qu’elles renferment ajoute encore à l’intérêt qu’elles inspirent, en prouvant que leur formation remonte à une époque beaucoup plus ancienne qu’on ne l’avait cru jusqu’ici. Ils n’appartiennent point, en effet, à des ruminants du pays, mais aux races d’animaux contemporaines des éléphans et des rhinocéros fossiles. De sorte que tout porte à croire que si on n’y rencontre pas des os de ces quadrupèdes, on ne doit chercher la cause de cette absence que dans leurs grandes dimensions, qui seules ont pu les empêcher d’y tomber.
Les principales brèches osseuses sont celles de Gibraltar, d’Antibes, de Nice, &c. Elles ont aidé à perfectionner la zoologie antédiluvienne, en faisant connaître quatorze on quinze espèces d’animaux peu volumineux, qu’on n’avait pas jusque-là trouvés ailleurs.
Si les brèches osseuses nous ont conservé de nombreux débris de ruminants, les cavernes à ossemens nous offrent, de leur côté, des ressources précieuses pour la connaissance des carnassiers leurs contemporains. Il est impossible que vous n’ayez pas entendu parler de ces cavernes fameuses, dont les plus célèbres sont celles qu’on rencontre dans le pays de Blankenbourg et dans l’électorat d’Hanovre, et dont Leibnitz lui-même a donné des descriptions. On se ferait une idée bien fausse de ces anciens repaires d’animaux sauvages, si on se les représentait comme de simples cavités, creusées dans le rocher, à quelques pieds de profondeur: figurez-vous une suite de grottes nombreuses, ornées de stalactites de toutes les formes, dont la hauteur et la largeur sont extrêmement variables, mais qui communiquent les unes avec les autres, par des ouvertures si étroites, qu’un homme ne peut souvent y passer, en rampant, qu’avec la plus grande peine.
Ces grottes, qui communiquent entr’elles, s’étendent souvent à des distances très considérables. Un naturaliste moderne, (M. de Volpi,) en a parcouru une suite qui l’ont conduit trois lieues entières, presque toujours dans la même direction. Il ne fut arrêté que par un lac, qui lui rendit le passage impossible. Ce ne fut qu’après deux lieues qu’il rencontra des ossemens d’animaux qu’il crut appartenir à des palæotherium, et que M. Cuvier a reconnus pour appartenir à la grande espèce d’ours connus sous le nom d’ours des cavernes, et dont les débris sont plus communs, dans ces lieux souterrains, que ceux d’aucune autre espèce.
On rencontre également dans les cavernes, des ossemens de tigres, de loups, de renards, de belettes. Les débris de l’espèce des hyènes y sont surtout très nombreux; ces hyènes de l’ancien monde avaient, comme celles d’aujourd’hui, l’instinct de déterrer les cadavres, pour porter dans leurs tanières les ossemens, qu’elles broyaient avec les dents, que la nature leur accordait d’une forme propre à la mastication des corps les plus durs. Ce sont elles, sans doute, qui ont contribué, plus que tous les autres carnassiers, à remplir d’ossemens d’animaux herbivores et de grands quadrupèdes de toute espèce, les lieux qui leur servaient de refuge. Elles n’épargnaient pas même leur propre espèce; car on a remarqué que leurs os ne sont pas moins brisés que ceux des autres animaux ensevelis avec eux. On a trouvé même un crâne d’hyène fracturé, et portant les marques évidentes de la consolidation de la fracture, qui était probablement le résultat d’un des combats que ces animaux se livrent quelquefois entr’eux.
On ne trouve presque point d’ossemens d’animaux carnassiers dans les grandes couches meubles, où l’on rencontre en si grand nombre leurs contemporains herbivores. Il n’y a guère d’exception un peu marquante, sous ce rapport, que pour l’espèce des hyènes, dont on a trouvé des débris assez nombreux à Canstadt près d’Aichstedt. On a aussi trouvé quelques ossemens d’ours dans d’autres lieux; mais le nombre en est bien petit, en comparaison de la prodigieuse quantité de débris de ces animaux que renferment les cavernes.
Dans les cavernes les plus anciennement connues et les plus fréquentées, on ne trouve presque plus d’ossemens; car ces lieux singuliers ayant depuis longtems frappé l’attention du peuple, on attribuait aux os qu’elles renferment une vertu médicamenteuse qui les faisait rechercher pour les vendre aux pharmaciens, chez lesquels ils étaient conservés sous le nom de licorne fossile.
L’existence des cavernes est un phénomène bien curieux, sous tous les rapports: les débris qu’elles renferment prouvent que des animaux d’espèces, de genres et de classes tout-à-fait différents, et dont les analogues ne pourraient aujourd’hui supporter le même climat, ont vécu pourtant ensemble dans l’ancien ordre de choses. Ainsi les animaux qui ne vivent aujourd’hui que dans la zone torride, ont vécu et habité jadis avec des espèces qu’on ne trouve que dans les régions les plus glacées.
L’histoire naturelle fossile nous offre le même phénomène, en présentant aussi l’aurochs avec l’éléphant, comme on les voit dans le val d’Arno, par exemple.
Mais si des découvertes irrécusables nous prouvent ainsi qu’il existe une grande différence entre le monde antédiluvien et celui que nous habitons, on peut, d’un autre côté, s’en servir pour établir que les carnassiers, dans l’ancien monde, existaient dans une proportion peu différente de celle où ils existent aujourd’hui, et que leur genre de vie était à-peu-près le même. Il y a plus, c’est que ces carnassiers des cavernes, contemporains des éléphans et des rhinocéros de nos contrées, diffèrent beaucoup moins des carnassiers actuels, que les herbivores de la même époque ne diffèrent de ceux qui vivent encore de nos jours. A la vérité, le grand ours, le grand tigre ou lion, et l’hyène fossiles, quoique peu différents de leurs analogues vivants, appartiennent néanmoins à des espèces éteintes; mais tous les autres carnassiers des cavernes ne peuvent être distingués de ceux d’aujourd’hui, d’une manière satisfaisante.—Lettres sur les Révolutions du Globe.

Avril, (en latin Aprilis,) nommé ainsi d’aperire, parce que le sein de la terre s’ouvre alors. Ce mois était sous la protection de Vénus. Ausone le peint comme un jeune homme couronné de myrte, et qui semble danser au son des instrumens. Près de lui est une cassolette d’où l’encens s’exhale en fumée, et le flambeau qui brule dans sa main répand des odeurs aromatiques. Dans Gravelot, couronné de myrte et vêtu de vert, il tient le signe du Taureau garni des fleurs dont la nature commence à se parer. La figure de Cybèle, qui tient une clef, et qui semble écarter son voile, est une allusion ingénieuse à l’étymologie du mot. Une laiterie orne le fond du tableau. Dans Cl. Audran, la déesse des amours tient en main la pomme d’or: elle est assise sur un nuage avec son fils, sous un berceau de myrtes et de fleurs. Plus bas, sont une fontaine, soutenue par des dauphins, et un cygne nageant dans son bassin, autour duquel sont les pigeons de son char. Au-dessus du berceau, des festons de roses sont enrichis de trophées amoureux; à côté sont des moineaux, oiseaux consacrés à la déesse.

Lettre d’un Capitaine des Voltigeurs à un Officier du Régiment de Watteville, alors à bord du transport Ocean, dans la rade de Québec, et partant pour l’Europe.
Montréal, 28 Août, 1816.
Aimable Ami—Depuis votre départ de Montréal, je n’ai reçu de vous qu’un petit bout de lettre du 11 Juillet dernier; pourtant, dans votre billet à Madame R——, du 16 de ce mois, vous avancez hardiment m’avoir écrit trois fois!... Parbleu! je ne puis que vous admirer; vous ne faites rien à demi; et, quelque rôle que vous entrepreniez, vous saisissez le caractère du personnage tout aussi promptement que vous en prenez l’habit. Le rimeur a ses licences, n’est-ce pas?...... Le voyageur à son privilège;—qui en doute?...... Je vois au moins que vous n’en ignorez rien; aussi méritez-vous ce méchant distique:
Qui dit Poëte et Voyageur,
Dit, à coup sûr, double menteur.
Mais amplifions cette idée; et mettant chapeau bas, disons:—
Ecrire avec élégance,
Avec grâce et sentiment...
C’est bien de votre Adjudance
L’incontestable talent:
Mais surtout avec aisance,
Broder le plus noblement...
C’est en ce, par préférence,
(Passez-moi le compliment,)
Que brille, par excellence,
Le Poëte-voyageant!
Quels bouts-rimés! quel poulet! allez-vous dire!—Est-ce ma faute à moi, si je ne puis mieux faire? Et pourquoi faut-il que j’aie la démangeaison de rimailler, sans en avoir le talent; tandis que celui qui a la certitude de plaire, en rimant, n’a point la complaisance de nous procurer plus souvent ce plaisir? Point de rancune au moins; point d’humeur; point de bouderie même: ou bien, si vous ne pouvez vous défendre d’en avoir, exhalez-la bien et dûment sur ma chétive monture, sur votre étroit Océan, sur le sable de Sorel, sur l’anglomanie de Kingston, sur l’humide bivouac de la rivière Niagara, sur les maringouins, les moustiques, les brulots, les neiges, les glaçons, la friduleuse canicule du Canada,[1] &c. &c. &c.
Oh, les Maringouins! Certes! ils feront le sujet d’un poëme.—Comment? un poëme sur des maringouins?—Oui, vraiment.—Mais songez-vous que le sujet est au moins aussi aride que l’objet est maigre?—Il est vrai; mais dans des mains aussi habiles que les vôtres, on verra bientôt ce squelette se couvrir, s’arrondir, et...... quelle gloire pour mon ami—et pour celui à qui il dédiera son poëme étique! Ecoutez bien.
Leurs États.—Vous avez résidé, quelque temps, dans leur domaine principal, tout auprès de leurs états. C’est de ce grouppe d’Iles situées à l’entrée du Lac St. Pierre, près de Sorel, que partent, de temps en temps, ces innombrables Colonies que vous avez vues répandues dans les différentes parties du Canada. Ce sont les Iles aux Maringouins enfin, qui fournissent, depuis un temps immémorial, à ces bruyantes et incalculables émigrations.
Leur Origine.—On lit dans un auteur de la plus haute antiquité,...... dont le nom m’a échappé, dont les mémoires sont assez rares—qu’à une époque,.... dont il n’a jamais pu découvrir la date, mais sous le règne d’un souverain puissant,...... dont le nom n’est pas venu jusqu’à lui, ces Iles, qui jusque-là avaient appartenu à différents peuples, tels que Brulots, Frappe-d’abord, Moustiques, &c. furent soumises par les Maringouins, peuple belliqueux, entreprenant, et le plus nombreux de tous ceux qui, comme eux, habitaient cet Archipel. C’est à compter de cette époque, dont une malheureuse obscurité nous a voilé la date précise, que tous ces différents peuples, jusque-là toujours en guerre, toujours divisés d’intérêts et de politique, se sont formés en une petite république, ont tous pris le nom de Maringouins, et l’ont même donné à leurs états réunis. Ce que nous savons de plus sur le gouvernement de cette nation, si célèbre de nos jours, nous le devons aux rapports assez vagues de voyageurs curieux et observateurs,...... qui n’ont jamais ôsé pénétrer dans le pays. Je dis rapports vagues, et c’est mal dit: s’ils n’ont pas, comme l’auteur dont j’ai déjà fait mention, laissé des mémoires écrits ou imprimés, ils n’ont pas manqué de communiquer, viva voce, à leurs contemporains ce qu’ils avaient vu, et la tradition la plus exacte et la plus fidèle nous a enfin mis en possession de leurs dits précieux.
Leur Gouvernement.—Selon quelques uns de ces voyageurs, le gouvernement maringouin est monarchique; selon d’autres, il est républicain: ceux-ci prétendent qu’il est aristocratique; ceux-là veulent absolument qu’il soit oligarchique, et que les membres de l’administration ne puissent même être choisis que parmi celui de ces peuples qui, avant la conquête, portait exclusivement le nom de Maringouin. Il est un peu délicat d’adopter une de ces opinions à l’exclusion des autres, vu la respectabilité commune des sources où nous puisons. Aidé néanmoins de ces lumières, un observateur doué de votre perspicacité peut bien vite percer le mystère; et je me flatte que, curieux comme vous êtes, ne voyageant que pour vous instruire, content de rencontrer des obstacles, pour pouvoir les surmonter, et aimant à communiquer votre science, nous aurons de vous certainement la solution de ce petit problême.
Leurs Mœurs et leur Caractère.—On sait encore que ces peuples, ou plutôt cette nation, n’est point du tout hospitalière; qu’elle est même féroce. Ce caractère hostile, que tous mes auteurs s’accordent à lui donner, a été la cause que je n’ôsai hazarder une descente dans ces îles, en 1809, durant un séjour de trois jours que je fis alors dans ces parages. Les Maringouins ne sont point, dit-on, anthropophages, quoiqu’ils aiment extraordinairement le sang. On leur reproche généralement d’être adonnés à l’ivrognerie; et c’est de cette liqueur dont ils aiment à s’ennivrer. Ils sont tellement enclins à ce vice, et si peu maîtres de vaincre leur goût pour cette boisson, qu’il est rare, quand elle est à leur disposition, qu’ils ne trouvent leur tombeau dans l’usage immodéré qu’ils en font toujours alors.
Leurs Armes.—Les Maringouins sont guerriers; ils sont au combat d’une ardeur sans pareille. Ni la disproportion du nombre, ni la supériorité des armes de leurs ennemis, ne sauraient ébranler leur courage; et quoiqu’ils n’aient qu’une lance pour toute arme, il n’est point d’antagoniste, fût-il cuirassé et armé de pied en cap, avec lequel ils hésitassent un instant de se mesurer. C’est d’eux que nous vient (dit encore un voyageur dont je tairai le nom, et pour cause,) la vieille devise: Vaincre ou mourir. Chez eux,
Point de retraite,
Comme à Sackette;
Honte à qui montre, aux combats,
Ses pays-bas.
Les femmes et les enfans suivent leurs maris et leurs pères dans toutes leurs expéditions, et sont utilement employés. Une particularité bien extraordinaire chez ces peuples, et qui doit nous faire ressouvenir avec gratitude, que partout où croît le poison, là aussi se trouve l’antidote, c’est que leurs troupes ne peuvent jamais être employées en ambuscade; les attaques par surprise ne leur réussissent jamais. Ceci est dû, sans doute, à leur impétuosité naturelle, ou au brandissement particulier de leurs lances, qui occasionne un cliquetis continuel, assez bruyant pour annoncer toujours leur approche, ou déceler l’ambuscade.
Leur Culte.—Je puis vous assurer, comme l’ayant vérifié moi-même, que ces peuples sont encore idolâtres; et ce qui vous surprendra, c’est que la vue seule de leur dieu, entre les mains de leurs ennemis, suffit pour leur faire cesser tout combat, et même prendre la fuite. C’est à la Fumée qu’ils rendent ce culte de terreur respectueuse. Plusieurs de leurs escadrons étant venus nous attaquer, à notre paisible bord, (en 1809,) nous leur présentâmes la Divinité en question, à qui nous consacrâmes quantité de guenilles, (helas! que ne fait pas faire la crainte du danger!) et dans un instant, nous en fûmes délivrés. Mais c’est assez, c’est trop de fariboles.
J’ai dépêché, dans le temps, an colonel de S——, vos vers sur Chambly, (V. 2o.) après en avoir pris copie, et les avoir lus à nos amis. Vous dire qu’ils ont applaudi, serait vous répéter ce que je vous ai déjà dit cent fois, si je leur ai lu cent fois de vos vers; ainsi je me tairai. Seulement, il me semble que vous avez omis la fin finale de ce petit poëme. Que d——, à vous en croire sur votre parole, c’est un nouvel Eden que ce Chambly! Tout y est beau!... tout y est bon!... les chemins les plus unis ... Ein! les B—— les M—— t, marchant droit comme des I......, he! n’est-ce pas? Ce Chambly, je gage, est bien le lieu le plus superlatif de tous les lieux superlativement superlatifs du Haut et du Bas-Canada!—Mais, mais,......
“Mais ce Chambly, vraiment, est merveilleuse chose!”
dit Colas tout ébahi à Perrette sa compagne, et Perrette lui répond avec certain clin d’œil:
“Mon cher, quand on est gris, tout est couleur de rose.”[2]
Ahi! ahi! qu’en dites-vous? Où cette Perrette a-t-elle pris trouvé cette logique? Allons, mon brave, si le colonel m’écrit, je tâcherai de vous le faire savoir.
Adieu, mon cher ami; adieu pour longtemps, sans doute. Puissiez-vous baiser, dans la quinzaine de votre départ, le sol natal serrer contre votre sein ces excellents dieux pénates! On a trop d’un cœur, quand on est loin de sa patrie, et qu’on désire la revoir; mais il en faudrait une centaine, quand on y rentre après vingt ans d’exil, pour pouvoir savourer, sans en rien perdre, le plaisir indicible, inexprimable, qu’on doit alors éprouver. Oh! ce doit être un délire—une volupté...... indéfinissables! Puissiez-vous jouir bientôt, et longtemps, ... bien longtemps, de ces jouissances extatiques qui vous attendent, vous et votre aimable compagne à Lyon et à Malte. Que les honneurs, juste récompense du vrai mérite et des services importants, pleuvent sur vous et vos enfans, mon cher ami! Que Plutus vous prodigue ses trésors!—Puissiez-vous trouver un bon ami! Et puissé-je, un jour, pour prix de mon amitié sincère envers votre sensible famille, (pardonnez-moi cet égoïsme,) être assez heureux que d’être le témoin oculaire de votre bonheur!
Mes souhaits pour vous, mon cher ami, sont répétés, de tout cœur, de toute âme, par tous les membres de ma famille, grands et petits: vous n’en sauriez douter, je me flatte. Rappellez les donc tous au tendre souvenir de Madame, et embrassez bien cordialement pour eux et pour moi vos intéressants enfans.
Adieu!... adieu!... c’est avec serrement de cœur que j’écris ce triste mot. En quelque lieu que vous soyez, écrivez-moi; tant que vous vivrez, écrivez-moi: soyez heureux, et aimez toujours,
Votre sincère ami,
UN VOLTIGEUR.
Au Lieutenant et Adjudant P. H. C.}
du régt. de Watteville, à Québec.
(*) J’ai vu Chambly; j’ai vu sa fertile campagne,
Sa rivière, ses bois et sa triple montagne.
J’ai vu dans ses jardins la déesse des fleurs
Aux charmes de Pomone unissant ses couleurs.
J’ai, sur ses flots d’argent, vu le canot fragile,
Aux couplets des rameurs, devenir plus docile,
Dans ce site attrayant, tout plaît et tout séduit,
Excepté le temps seul, qui trop vite s’enfuit.
J’ai vu briller partout les plus belles demeures;
J’ai tout compté, tout vu, mais sans compter les heures.
J’ai vu ses habitans, et tous m’ont répété
Que le plus doux devoir est l’hospitalité.
Toujours francs, toujours gais, ils m’ont offert l’image
Des hommes du vieux temps, des héros du bel âge.
C’est là que tout mortel n’obéit qu’à la loi,
Et se donne à lui seul le beau titre de roi.
C’est là qu’un droit égal, une franchise extrême,
En montrant cent maisons, montre toujours la même.
Français de caractère, ils sont Anglais de cœur,
Et doublent leur patrie, en doublant leur bonheur.
C’est ainsi qu’autrefois, au sein de l’harmonie,
Fleurit des premiers Grecs l’heureuse colonie.
J’ai vu, j’ai respecté le ministre du lieu;
Mon âme s’est unie à l’autel du vrai Dieu:
Mais mon cœur des vertus dut admirer le temple.
Là, j’ai vu l’homme heureux, qui prêche par l’exemple:
Et chez lui j’ai connu cette pure amitié
Qu’en tout autre pays on ne voit qu’à moitié.
Héros et citoyen, tendre époux et bon maître,
Il est père de tous, sans vouloir le paraître.
Au camp Léonidas, aux champs Cincinnatus,
Thémistocle au conseil, à table Lucullus;
Sans avoir les défauts de la Grèce et de Rome,
Il réunit en lui les vertus du grand homme.
On voit à ses côtés, l’air pur, l’air grand, l’air gai;
L’air de Chambly s’y joint à l’air de Chateauguay.
On contemple, on admire, et bientôt on s’amuse;
Le héros devient chantre, et fait briller sa muse:
Son aimable compagne aux convives flattés
Présente l’ambroisie, et porte des santés:
L’enfant avec douceur gesticule et sautille;
Et le bon-mot succède au nectar qui pétille.
Je me tais: mais où donc ai-je tant vu, tantri?
Chacun l’a deviné...... c’est chez Salaberry.
P. H. C.
Sorel, 16 Août 1816.
La leçon.—Mr. Ch.....d avait de l’esprit et de la politesse.—Recevant un jour la visite d’un très-grand parvenu, qui venait le consulter, il fut extrêmement choqué de la grossièreté de ce dignitaire, qui avait eu l’impertinence d’entrer chez lui, le chapeau sur la tête, et qui lui parlait sans se découvrir. Mr. C—— sut se contenir néanmoins jusqu’à ce que l’impoli personnage lui eût expliqué le sujet de sa visite, et eût fini ses questions. Il disparait alors un instant, et revenant aussitôt, le chapeau à la main; “Monsieur,” lui dit-il, (en mettant son chapeau,) “je suis fâché de vous avoir fait attendre pour ma réponse, mais j’aurais cru manquer à la politesse et au respect que je vous dois, si je vous eusse répondu nu-tête.”...... Il allait continuer, quand notre important, humilié et confus, crut devoir l’interrompre pour lui faire des excuses et lui demander pardon de son impolitesse.
Indépendance.—Un Électeur du comté de Hertford, ami d’un des candidats pour qui se tenait le poll, se présente pour voter, et donne sa voix contre ce candidat. Ce dernier en est tellement surpris et mortifié, qu’il ne peut s’empêcher de lui reprocher hautement son action, ajoutant:—“Vous oubliez donc que nous sommes amis!”—“Non, monsieur,” reprend le voteur; “mais aujourd’hui, on ne travaille pas pour des amis; on travaille pour son pays.”
Compliment.—Un candidat, suivant la coutume, remerciait un électeur de la voix qu’il venait de lui donner au poll:—“Vous êtes bien bon, monsieur,” reprend le voteur; “je puis vous assurer que je songeais moins à vous, en votant, qu’à mon intérêt personnel.”
Éloge involontaire.—L’Été dernier, à la représentation de la tragédie de King Lear, où le célèbre Kean jouait le rôle du monarque devenu fou, un spectateur, assez peu connaisseur en apparence, dit à Mr. P——, qui se trouvait près de lui: “Ma foi, je ne vois rien là de si merveilleux; qu’on aille aux Loges, chez les Sœurs-grises, et l’on en verra tout autant.”
|
Une froide canicule n’est pas une chose ordinaire en Canada: la pensée sera vraie pourtant, si on l’applique à l’été de 1816. Il fit froid jusqu’à la fin du mois de Juin; et il gela, même plusieurs fois, dans ceux de Juillet et d’Août. Quelques uns attribuèrent cette température extraordinaire aux grandes taches qui se montrèrent alors dans le soleil.—Editeur. |
|
On devine sans peine par ce vers et ce qui le précède, que je fais ici allusion aux joyeuses suites d’une fête, que le colonel de S—— nous avait donnée, le 23 Juin précédent. |

Du Règne Militaire, pendant les quatre années qui ont suivi la Conquête, (1760-1764;) et de quelques Documents inédits, (Sept Régistres de Cour,) qui ont particulièrement rapport au “Gouvernement de Montréal,” durant ce court période de l’Histoire du Canada.
Invenies illîc et facta domestica vobis;
Sæpe tibi pater est, sæpe legendus avus.—Ovid.
Mr. Bibaud.—Les recherches que l’on fait tons les jours sur l’histoire du pays, et dont les résultats sont si satisfaisants dans l’intérêt de nos droits politiques, comme dans celui de notre honneur national, ont donné la preuve non équivoque que notre goût se forme, et que nous avons le bon esprit de mettre dans l’ensemble des connaissances que nous travaillons à acquérir, une méthode qui fait honneur à notre discernement et à notre cœur. Est-il, en effet, une étude qui, dans l’ordre de nos occupations, doive précéder celle de l’histoire de notre patrie? S’il n’en était pas ainsi, nous mériterions ce reproche:
Qui manet in patriâ, et patriam cognoscere temnit,
Is mihi non civis, sed peregrinus erit.
Pour n’en pas partager la honte, permettez que je contribue, autant qu’il est en moi, à dissiper les nuages qui, dans des temps reculés, ont obscurci notre horizon politique, en vous faisant part de quelques uns des élémens qui serviront à jetter de la lumière sur une matière qui semble ne présenter que des notions douteuses et contradictoires. Si mes recherches et mes observations vous paraissent dirigées dans un sens unique et trop exclusif, n’en accusez que mon état, qui m’a dû porter à traiter ainsi le sujet, pour le faire d’une manière plus facile pour moi; persuadé, comme je le suis, que vous et vos lecteurs éclairés saurez faire des faits relatés une application aussi étendue qu’il convient.
Muni de quelques monumens où sont consignés les actes des premiers tribunaux qui administrèrent la justice, aussitôt que le Canada eut changé de souverain, je ne fais que remplir un devoir, en m’empressant de donner de la publicité aux extraits que j’en ai faits. Si dans les observations qui les accompagnent, vous n’appercevez pas le talent qui caractérise les spéculations ingénieuses de votre correspondant L. ni l’esprit admirable d’observation, auquel rien n’échappe, d’un autre contributeur non moins éclairé, pardonnez, au moins, en faveur de ma bonne volonté.
Dans l’histoire du Règne militaire de 1760 à 1764, le dernier de ces correspondans (S. R.) se plaint avec raison de l’absence d’une pièce importante. “Malheureusement, dit-il, je n’ai point l’Ordre-général, l’Ordonnance ou la Proclamation (je ne sais quel nom lui donner,) de Sir Jeffery (Amherst,) établissant l’ordre de choses qui a existé par tout le pays, ou seulement à Montréal, entre le 8 Septembre 1760 et le 13 Octobre 1761. Il est clair même d’après le préambule de l’ordonnance ci-après,” (ordonnance du gouverneur Gage du 13 Oct. 1761. Bib. Can. T. IV, No. 2, p. 57, et suiv.) “que dans ce gouvernement, au moins, on a fait quelque changement à l’ordre de choses préexistant à 1761: quel était-il donc? La publication de l’ordonnance de Sir Jeffery pourrait seule donner la réponse à cette question, s’il était possible d’y avoir accès.”
Déplorant avec S. R. l’absence de ce document constitutif de quelques uns des premiers tribunaux d’après la conquête, je tâcherai d’y suppléer par une autre ordonnance d’une date subséquente, ainsi que par des extraits des procédés des cours qui siégèrent immédiatement après la réduction du pays, et dont l’autorité émanait, il n’en faut pas douter, de quelque acte formel, et consigné en quelque endroit, du pouvoir suprême. L’inspection de sept Régistres déposés au greffe de Montréal, et auxquels j’ai eu accès, prouve que, dès l’origine, le gouvernement de Montréal a été divisé en un nombre inconnu de Districts. (L’ordonnance du gouverneur Gage, du 13 Oct. 1761, le divisa ensuite en cinq districts pour les campagnes, indépendamment de celui de la ville.) A chacun de ces districts était préposé un “Commandant militaire,” auquel on appellait des “Chambres de Justice,” et de ce commandant de district au gouverneur lui-même. On y lit des jugemens rendus en première instance, par des Capitaines de troupes commandant dans certaines paroisses, telles que La Chine, St. Vincent de Paule, &c. dont l’appel se fait au gouverneur.—Quant à Montréal, la justice y était administrée par des Officiers de milice (tous capitaines,) siégeant tous les mardis, (sans compter les audiences extraordinaires,) avec appel directement au gouverneur. Indépendamment de ces cours, le gouverneur s’attribuait juridiction originaire dans certains cas.
Sur le période de 1760 à 1761, nous trouvons dans un régistre intitulé: “Régistre pour servir à enrégistrer les Ordonnances de son Excellence le Gouverneur de Montréal, les Sentences qui seront rendues par le Conseil des Capitaines de Milice, pourvus d’autorité, &c. Commencé le 4 9bre. 1760, et fini le 22 Août 1761,”—d’abord, l’ordonnance suivante du gouverneur Gage, au premier feuillet de ce régistre.
“Par Son Excellence Thomas Gage, Colonel d’un Régiment d’infanterie de ligne, Brigadier-général des armées du Roi, dans l’Amérique Septentrionale, Gouverneur de Montréal et de ses dépendances:
“Savoir faisons, qu’il est défendu à tous habitans, ou autres, de garder chez eux aucuns déserteurs, ou favoriser leur fuite, sous peine de vingt écus d’amende. Il leur est enjoint de dénoncer tous ceux qu’ils soupçonneront pour tels devant le Capitaine de milice, à qui il est ordonné, par ces présentes, de les faire conduire, sous main-forte, devant l’officier commandant le bataillon de la ville.
“Il est aussi défendu à toutes personnes d’acheter ou troquer avec les soldats, leurs armes, habits, souliers, guêtres, fournitures, chapeaux, ou autres choses fournies par le roi, sous peine aux contrevenans de vingt écus d’amende, et de punition corporelle, en cas de récidive.
“Que par le Placard du 22 Septembre, les officiers de milice dans chaque paroisse sont munis d’autorité de terminer les différens qui pourraient survenir parmi les habitans de leurs paroisses, mais que les parties intéressées pourraient rappeller de leurs jugemens pardevant les officiers commandant les troupes du roi dans le district ou cantonnement où les parties résident, et que non contens de cette seconde décision, les parties auraient droit d’en rappeller pardevant nous.
“Nous faisons savoir, en conséquence, que tous appels faits pardevant nous doivent être rédigés par écrit, et remis entre les mains de notre Secrétaire; et le jour que nous destinerons à les écouter et déterminer sera publié et affiché, auquel jour, les parties intéressées, avec leurs témoins, seront ouïes.
“Nous donnons avis à tous les habitans de Montréal, que les officiers de milice de la ville s’assembleront, un jour de la semaine, savoir, le Mardi, pour déterminer toutes les contestations des particuliers.
“Étant nécessaire de faire des arrangemens qui regardent la police de la ville, nous ordonnons que les propriétaires et locataires des maisons seront tenus de faire ramoner leurs cheminées, une fois par mois, à peine de 6 liv. d’amende. Si le feu prend à quelque cheminée après le mois de ramonage expiré, le propriétaire sera condamné à 12 liv. d’amende: si le feu prend avant le mois fini, le ramoneur sera condamné à la même peine. Que tous les charpentiers de la ville et fauxbourgs se trouvent avec leurs haches, au premier annonce de feu, où il sera, à peine de 6 liv. d’amende. Que tous les habitans sont tenus, en cas de feu, de s’y trouver, et de porter avec eux chacun une hache et un sceau, à peine de 6 liv. d’amende.
“Que chaque particulier ait soin, quand il viendra des grands abats de neige, de la faire ôter, de manière que les chemins soient de niveau au-devant de leurs maisons, à peine de 10 liv. d’amende; et que chaque particulier ait soin également d’entretenir, le long des murailles de sa maison, un chemin de deux pieds de large, sous la même peine.
“Que chaque particulier soit tenu, chaque jour, de faire ramasser au-devant de son terrain, les fumiers, immondices et ordures qui s’y trouveront, les mettre en tas et les faire transporter au bord de l’eau, pour être jettés dans la rivière, à peine de 10 liv. d’amende au contrevenant.
“Que chaque particulier ait soin de tenir leurs chemins et ponts en bon ordre. Où il se trouvera des chemins et ponts impraticables, faute de les raccommoder, la paroisse sera condamnée à vingt écus d’amende, et chaque paroisse pourra choisir son voyer ou inspecteur de grands chemins.
“Il est défendu à tous marchands ou autres, d’acheter, ou troquer pour leurs marchandises, les denrées de la campagne, pour les revendre en ville ou ailleurs. Les troupes ont ordre de s’emparer de ceux qui contreviendront, dont les marchandises seront confisquées. Ils seront de plus condamnés d’un mois d’emprisonnement. Que toutes les denrées seront portées sur la place du marché. Ceux à qui il arrivera d’aller au-devant des canots, voitures ou habitans portant leurs denrées au marché, seront condamnés à dix écus d’amende.
“Voulons et entendons que notre présente Ordonnance soit lue, publiée et affichée ès lieux accoutumés. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par notre Secrétaire. Fait à Montréal, le 28 8bre. 1760.
THS. GAGE.”
“Et plus bas,
“Par Son Excellence, G. Maturin.”
On voit que cette ordonnance embrasse des objets divers: l’établissement de certains tribunaux évidemment civils, leurs pouvoirs étant “de terminer toutes les contestations des particuliers,” et des règlemens sur la police correctionnelle et municipale.
Il ne paraît pas que les Chambres des milices aient exercé aucune juridiction criminelle. Dans le Régistre dont je viens de parler, on lit, au 13e. feuillet, une ordonnance du gouverneur Gage du 14 Décembre 1760, enjoignant à toutes personnes d’arrêter un individu consigné chez le Prévôt pour cas de vol, et qui s’était échappé. Cette ordonnance est marquée: “Signé, par ordre de Son Excellence, G. Maturin,” et est signée plus bas par les capitaines de milice.—Que conclure de la présence de cette ordonnance dans le régistre des capitaines de milice? Rien autre chose, ce me semble, sinon que c’était un moyen que l’on prenait de donner de la publicité à ce document.
Tous les jugemens de ce régistre de 107 feuillets, contenant 576 entrées, (presque chacune étant une procédure complète, composée de la demande, de la défense, de l’instruction et du jugement,) et deux ordonnances, sont rédigés en assez bon style, et motivés avec assez de clarté, probablement par Mtre. Pierre Panet, notaire et greffier de cette cour. Leurs dispositions sont assez généralement équitables, et se fondent assez souvent sur des lois positives. Les règles de la procédure n’y sont que rarement violées d’une manière essentielle, lorsque des femmes sous puissance de mari, ou des procureurs, sont parties à un procès, les premières sans l’assistance de leurs maris, et les seconds sans qu’ils agissent conjointement avec leurs commettans.[1]
Il ne faut pas une pénétration bien grande, pour se persuader, après avoir parcouru ces régistres et presque tous les monumens judiciaires de ce temps, que les gouvernans de cette époque n’avaient rien tant à cœur que de nous attacher à eux, en conservant nos usages et nos lois. L’on n’apperçoit nulle part la prétention d’introduire les lois anglaises, et encore moins celle de juger suivant la loi martiale; car si ces juges tombent par fois dans l’arbitraire, il faut bien se garder d’en conclure que la cause s’en trouve dans leur adhésion à une loi qui n’est faite que pour des soldats, mais seulement que leur désir d’atteindre à la justice particulière de chaque cause les force à violer quelquefois les principes généraux des lois. Ces cours n’avaient de militaire que le nom, qu’elles en avaient pris des juges qui y présidaient.[2]
Quoique je puisse fournir des preuves multipliées à l’appui de ces opinions, je me bornerai à quelques extraits, en suivant l’ordre du régistre.
Au Feuillet 4, se trouve l’inventaire (du 17 9bre. 1870,) du mobilier d’un individu dont les héritiers sont absents, et l’établissement d’un gardien à ces effets, pour la conservation de ses biens pour ses héritiers absents. C’est un des capitaines de milice, juge du tribunal, qui est préposé à cette tâche, que remplissaient en France “les gens du roi.”
Aux Feuillets 15 et 17—est une procédure en licitation, des 20 et 23 Déc. 1760. Elle est dans les formes les plus strictes voulues par les lois. L’Interlocutoire qui ordonne la visite d’experts pour constater si l’héritage est partageable commodément et sans détérioration, est motivé en langage précis et technique.
“Audience tenue par MM. Decouagne, Hervieux, frères, Guy, Gamelin, Méziere, Réaume, Le Comte-Dupré, Fonblanche, et Bondy, le 30 Déc. 1760.
“Entre Mre. Daillebout, prêtre, missionnaire de Repentigny, demandeur, comparant par Demoiselle Daillebout de la Madelaine, fondée de son pouvoir, d’une part, et Mr. Daillebout de Périgny, écuyer, défendeur, comparant par Dame Corrault-Lacôte, son épouse, d’autre part. Après que la dite Damoiselle de la Madelaine, pour le dit sieur demandeur a dit qu’elle nous supplie de condamner le dit sieur de Périgny à lui payer la somme de cent-cinquante livres, pour une année de la rente de son titre clérical, qu’il lui doit, échu le 1er. Novembre dernier: la dite dame épouse du dit sieur de Périgny a dit comme en son écrit non signé, dont lecture à été faite. Nous, parties ouïes, attendu que suivant l’usage ordinaire, il n’y a compensation que de liquide à liquide, condamnons le dit sieur de Périgny à payer au dit sieur demandeur, en espèces sonnantes, la somme de cent-cinquante livres, pour une année de la rente de son titre clérical, qu’il lui doit, échu au premier Novembre dernier; sauf au dit sieur de Périgny son recours contre le dit sieur Daillebout, ainsi qu’il avisera, pour raison des comptes de la succession de feue Dlle. Anne de Musseau, avec dépens taxés à trente sols.”
A la fin de chaque audience, le plumitif, ou plutôt le régistre, est signé par tous les juges et le greffier.
Au Feuillet 18, et en maint autre endroit, demande en insinuation d’actes portant donation, accordée par la cour.
Feuillet 50.—“Entre la dame épouse et procuratrice de Mr. Tétard,” (Montigny, en interligne et d’une encre différente,) “écuyer, Capit. d’infanterie du Roi très Chrétien, demandeur, d’une part, et Antoine Leduc, défendeur, d’autre part. Après que la dame demanderesse nous a supplié de condamner le dit défendeur à lui faire et parachever la maison qu’il lui a entreprise, et dont il a reçu le paiement d’avance; conformément au marché passé devant Me. Danré, notaire, le 22 Juin, 1760; le défendeur a dit que le fléau de la guerre l’avait empêché de pouvoir satisfaire au dit marché; qu’il y avait commencé à travailler, mais que par les commandemens qu’il était obligé de faire à toute force pour le service, en qualité de sergent, l’avaient empêché de pouvoir travailler; qu’il est hors d’état de pouvoir continuer la dite bâtisse, dans l’indigence où il est réduit: pourquoi offre d’abandonner à la dite dame Montigny les pièces de bois qui sont sur son terrain, de perdre le temps qu’il a employé, et de lui rembourser les ordonnances qu’elle lui a données. Nous, parties ouïes, attendu que le dit défendeur n’a pu être garant des évènemens qui sont arrivés d’après la passation de son marché, et l’impossibilité manifeste où il a été de travailler aux dits ouvrages, à cause des commandemens, avons déchargé le défendeur de l’entreprise par lui faite, en par lui, suivant ses offres, abandonnant à la dite dame de Montigny les pièces de bois qui sont sur son terrain, et lui remboursant, en ordonnances, la somme de quinze cents livres, au moyen de quoi le dit marché demeurera nul; le condamnons aux dépens taxés à trente sols. Mandons, &c.”
Dans un jugement, motivé au Feuillet 72, ou trouve les expressions suivantes, qui peuvent donner la mesure des connaissances légales de cette époque:
“Et attendu que conformément aux décisions des législateurs et particulièrement de Ferriere, dans la Science parfaite des Notaires,” &c.
Le Feuillet 106, contient une sentence d’ordre et de distribution.
Je viens de rendre compte, Mr. Bibaud, du 1er. Régistre du “Conseil des Capitaines de Milice de Montréal,” commencé le 4 Nov. 1760, et terminant le 22 Août 1761; et je dois ajouter qu’il est accompagné de trois autres, qui contiennent les procédures ultérieures de ce même tribunal (aussi appellé Chambre de Justice, et Chambre de Milice de Montréal,) du 25 Août 1761 au 26 Avril 1764.
Ces trois derniers régistres, comme le premier, sont entièrement écrits en français. Les noms anglais y sont écorchés pour les franciser.
J’ai également eu accès à deux Régistres, peu volumineux, renfermant les sentences rendues en appel, durant le Règne militaire, tant par le “Conseil” ou la “Chambre militaire de Montréal,” que par le “Conseil” ou la “Chambre militaire de St. Sulpice.” C’étaient des tribunaux qui siégeaient le 20 de chaque mois, en vertu de l’Ordonnance du Gouverneur Gage du 13 Oct. 1761, (V. art. 18me.) et qui n’étaient composés que d’Officiers de l’Armée, toujours au nombre de cinq. On appellait à eux des jugements rendus par les Chambres de Milice de districts, et on appellait d’eux au Gouverneur. Leurs jugements étaient qualifiés d’Arrêts, comme on le voit par le titre de l’un de ces deux régistres.[3]—De 81 arrêts rendus par cette Cour de Montréal, (du 21 Nov. 1763 au 21 Juillet 1764,) présidée, tout ce tems, par. le Capit. Ths. Falconer, du 44e. régt.—5 seulement sont en anglais, et dans des causes où les parties, ou l’une d’elles, sont d’origine anglaise. Le régistre du Conseil Militaire de St. Sulpice, dont le premier feuillet manque, se compose de 62 pages, et, commençant le 20 Février 1762, termine le 20 Août 1763. Il contient 68 arrêts, dont un seul est en anglais, dans une cause entre un Officier de l’Armée et un Canadien. Mtre. C. F. Coron, notaire royal, et MM. Daguilhe et Demoulin, ont successivement été les greffiers de ce tribunal.
En parcourant ces cinq derniers régistres, on verra que les observations que j’ai faites sur le premier leur sont applicables.
Le septième registre dont j’ai eu communication au Greffe de Montréal, est celui des “Appels au Gouverneur.”
Il est de 322 pages in-folio, et contient 299 jugements par le Gouverneur Gage, et 95 par le Gouverneur Burton. Ces jugements sont qualifiés d’Ordonnances et Arrêts, (les jugements en dernier ressort prenaient ce titre en France;) ceux des Cours dont l’appel était interjetté—Sentences.
Le 1er. arrêt du Gouverneur Gage est du 6 Déc. 1760, et confirme une sentence de la “Chambre des Milices de Montréal” du 2 du même mois; le dernier arrêt est du 21 Oct. 1763.
Le 1er. arrêt ou ordonnance du Gouverneur Burton est du 31 Oct 1763; le dernier du 10 Août 1764.
Ce Régistre contient, conséquemment, tous les appels du gouvernement de Montréal pendant le Règne militaire.
Des 394 ordonnances ou arrêts rendus par ces deux gouverneurs, du 6 Déc. 1760 au 10 Août 1764, trois seulement l’ont été par le “Gouverneur et son Conseil;” tous les autres par le gouverneur seul. Le langage de ce régistre est encore le français; toutes les causes sont pour affaires civiles, aucunes pour affaires criminelles.
Je terminerai par un seul extrait des jugements d’appel, qui donnera de nouvelles lumières sur la jurisprudence de ce tems.
Par Son Excellence Thomas Gage, &c.“1762.—15 Mai. Entre Charles Robidou. et Jacques Robidou.” Entre Charles Robidou, rappellant d’une sentence rendue par le Conseil militaire de cette Ville, du 20 Avril 1762, d’une part, et Jacques Robidou, défendeur, d’autre part. Après que le dit demandeur nous a supplié de casser la dite sentence rendue par le dit Conseil, qui condamne les dites parties à payer par égale portion la somme de 45 liv. pour les frais qu’elle alloue pour un procès intenté par esprit d’animosité, et les condamne en outre à payer chacun 6 piastres d’amende.
“Il nous aurait été fait en outre des représentations par les Sieurs Officiers de milice du district de la Pointe Claire, qu’ils auraient été également condamnés par la dite sentence à payer les frais mentionnés aux pièces qu’ils nous ont présentées, où il est spécifié qu’ils ont jugé ‘selon leurs lumières, n’ayant jamais étudié le droit;’ et qu’en outre ce n’a été qu’à la persécution des parties qu’ils ont ouï tant de témoins.
“Nous, parties ouïes, vu la justification des Sieurs Officiers de milice et en outre l’extraordinaire qui n’est que suivant les intentions de notre placard de justice, et les papiers à nous présentés, avons ordonné ce qui suit:
“Savoir, que les articles mentionnés dans la dite sentence qui condamne les dits Officiers à des frais, sont cassés et annulés, ainsi que l’article qui spécifie de faire enrégistrer la dite sentence sur le Régistre de la Pointe Claire. Et pour à l’égard de Charles et Jacques Robidou avons ordonné ce qui suit:
“1o. Chaque partie payera les témoins qu’il a menés à la Chambre de la Pointe Claire et les significations des ordres donnés aux dits témoins, et les deux piastres par la dite Chambre seront payées par moitié aux dites parties.
“2o. Les huit piastres d’amende condamnée par la Chambre de la Pointe Claire, qui doivent servir à payer le tems des officiers assemblés, ainsi que le greffier, seront payées par Jacques Robidou, pour avoir eu de si mauvais procédés contre le demandeur.
“3o. Charles Robidou payera une piastre d’amende, pour n’avoir point exécuté les ordres du Capitaine pour tracer les chemins.
“Et pour les six piastres d’amende dont les parties sont également condamnées à payer par le Conseil militaire, ordonnons qu’ils n’en payeront que chacun trois, pour les raisons y contenues et défendons à l’avenir aux dites parties de s’intenter l’une à l’autre aucun procès, sans des raisons solides. Mandons, &c. Donné au Château de Montréal, le 15 Mai 1762.”
“THS. GAGE.”
“Par son Excellence—G. Maturin.”
Si ce jugement contient des singularités, on ne peut s’empêcher d’y voir un désir bien prononcé de réprimer le despotisme de la “Chambre Militaire.”
Avertissement et Signalement—d’un genre singulier, qui se trouve dans le “Régistre des Appels,” avec quelques autres.
“Le nommé Travers, charretier à Québec, a assassiné au dit lieu, le 20 du présent mois, le nommé St. Louis. Ce Travers a cinq pieds de haut, les cheveux châtains, menu du corps, le nez croche, les yeux creux, barbe rousse, visage affreux, et âgé de 30 ans ou environ.”
“Ordre circulaire à tous les Capitaines de milice et autres Officiers du Gouvernement de Montréal.
“Il vous est ordonné de faire appréhender et saisir par corps le dénommé ci-dessus, en quelqu’endroit qu’il se trouve dans le gouvernement de Montréal, et de le faire conduire, sous bonne et sure garde ès prisons royaux de cette ville. Mandons, &c. Donné à Montréal, le 26 Avril 1764.”
(Point Signé.)
En voilà bien long, Mr. Bibaud; mais il convenait de réunir tout ce qui avait rapport à l’Histoire légale du Règne militaire, à laquelle il ne semble plus manquer que le—“Placard du 22 Sept. 1760.”
E. T.
Montréal, 2 Avril 1827.
|
Au reste, cette irrégularité ne serait pas propre à ces tribunaux peu éclairés. Dans la Prévôté de Québec, sous la présidence de deux hommes de loi, (MM. Andre Deleigne et Dain,) deux des plus éminents lieutenans civils et criminels, suivant Mr. Perrault, l’on voit plusieurs exemples de semblables violations des premières règles. V. Extraits des Régistres de la Prévôté de Québec, par J. F. Perrault, Ecr. pp. 54, &c. |
|
L’on s’abuse étrangement sur l’acception des termes militaire et martial employés ici, de même que sur l’autorité de ces tribunaux composés de militaires et d’officiers de milice. Si l’on n’était bien convaincu par plusieurs actes du gouverneur Gage d’une volonté bien prononcée de donner à tous ces tribunaux les anciennes lois du pays pour règles de décision, l’on n’en douterait plus après avoir lu quelques uns de ces jugemens. Ceux qui ont intérêt à montrer que nos vainqueurs voulaient nous dépouiller de tout ce que nous avions de cher, pourraient dire que ces tribunaux n’avaient aucune règle de conduite, avec plus de vraisemblance peut-être, en jugeant sur quelques cas particuliers, que d’en faire les interprêtes de la loi martiale, qui a des règles fixes, et qui n’a rien de commun avec la jurisprudence de cette époque. V. Tyttler on Military Law, p. 2. |
|
Plumitif pour servir aux Arrêts par extrait du Conseil Militaire de Montréal. |

M. Colbert ayant appellé les plus notables marchands de Paris, pour les consulter, les pria de parler librement, et leur dit que celui qui parlerait avec le plus de franchise serait son meilleur ami. Un nommé Hazon prit la parole, et lui dit: “Monseigneur, vous avez trouvé le charriot renversé d’un côté, et vous ne l’avez relevé que pour le renverser de l’autre.” M. Colbert lui répondit avec une vivacité qui témoignait son mécontentement. “Comme vous parlez! mon ami,—Monseigneur, reprit Hazon, je demande très humblement pardon à V. G. de la folie que j’ai faite de me fier à votre parole.”
Gellert, célèbre fabuliste allemand, demeurait à Leipsic. Il arriva un jour dans cette ville, au commencement d’un hiver, un paysan saxon conduisant un charriot de bois de chauffage. Il s’arrêta devant la porte de M. Gellert, et parlant à lui-même, lui demanda: “S’il n’était pas ce monsieur qui faisait de si belles fables?” Sur sa réponse, le paysan, avec des yeux brillants de joie et beaucoup d’excuses de la liberté qu’il prenait, le pria d’accepter sa voiture de bois, comme une faible marque de sa reconnaissance pour le plaisir que lui avaient fait ses fables.
Une demoiselle un peu galante faisait un jour mille questions à Montesquieu, sans qu’il répondît à aucune. Ce grand homme enfin impatienté, saisit le moment où elle lui demandait ce que c’était que le bonheur? “Le bonheur,” lui dit-il, “c’est la fécondité pour les reines, la stérilité pour les filles, et la surdité pour ceux qui sont auprès de vous.”
Montesquieu était très doux envers ses domestiques. Un jour néanmoins, il les gronda vivement; mais se retournant ensuite, en riant vers une personne témoin de cette scène: “Ce sont,” lui dit-il, “des horloges qu’il est quelquefois besoin de remonter.”
M. De Saint-Onge, auteur d’une traduction en vers des Métamorphoses d’Ovide, était le protégé de M. De Laharpe, mais il n’avait pas le bonheur de plaire à son épouse. Un jour, s’étant présenté chez cette dame, il n’en reçut pas un accueil très flatteur: “Pourrais-je parler à M. de Laharpe?” lui dit-il.—“Non, monsieur,” lui répondit-elle.—“Puis-je l’attendre ici?—Non, monsieur.—Mais je suis un de ses amis.—Vous vous trompez; M. de Laharpe n’a pas d’amis.”
On demandait à Sterne, auteur de Tristram Shandy, s’il n’avait pas trouvé à Paris, quelque caractère original, dont il pût faire usage dans son roman? “Non, répondit-il, les hommes y sont comme les pièces de monnaie, dont l’empreinte est effacée par le frottement.”
Un bout de manuscrit sortait de la poche d’un auteur que Freron n’aimait pas. Le malin journaliste dit, en l’appercevant: “Cet auteur est bien (heureux d’être) connu; car on ne manquerait pas de le voler.”
Un Gascon perdait constamment au jeu: touchée de son malheur continuel, une femme ne put s’empêcher de le plaindre.—“Madame, lui dit-il, épargnez-vous ce mouvement de pitié: ce n’est pas moi qu’il faut plaindre; ce sont ceux à qui je dois, qui perdent.”
On vantait devant le comte d’Adhémar, les progrès de madame de Pompadour dans la langue allemande: “Cela n’étonne point,” répondit-il; “car elle écorche joliment le français.”
Un jeune homme présentant une pièce de vers à Crébillon, le papier échappa des mains du censeur, et vola dans le feu:—“Cette pièce,” dit-il en souriant, “n’a pas manqué sa vocation.”
Les paysans ne voient de beautés dans les campagnes, que là où ils voient leurs revenus. Je rencontrai un jour, dit Bernardin de St-Pierre, dans le voisinage de l’abbaye de la Trappe, sur le chemin caillouteux de Notre-Dame d’Apre, une paysanne qui cheminait avec deux gros pains sous son bras. C’était au mois de Mai; il faisait le plus beau temps du monde: “Voila, dis-je à cette bonne femme, une charmante saison; que ces pommiers en fleurs sont beaux! Comme ces rossignols chantent dans ces bois! Ah! me répondit-elle, je me soucie bien de ces bouquets et de ces petits piauleux! c’est du pain qu’il nous faut.”
Un jeune peintre copiait un tableau dans le Vatican; le pape Pie VI l’avait remarqué dans ses promenades, et se plaisait à le voir travailler avec goût et facilité. Un jour, il lui dit de venir le trouver: qu’il lui donnerait accès dans plusieurs endroits qui contenaient des morceaux superbes et précieux. Le jeune peintre, fort embarrassé, balbutia qu’il ne pouvait profiter de la bienveillance du Saint-Père, parce qu’il n’était pas de sa communion. Pie VI, frappant doucement sur l’épaule du jeune peintre, lui dit: “Jeune homme, les arts sont tous de la même communion.” Il insista pour vaincre sa timidité, et il lui fut utile dans ses études.
On regardait la nouvelle compagnie des Indes, créée par M. de Calonne en 1787, comme une charlatanerie; M. de Bievre, partageant l’opinion du public, trouva pour anagramme des mots
Compagnie des Indes Orientales,
Atelier composé d’ânes indignes.
Un officier se présenta un jour devant Joseph II, et implora des secours nécessaires à sa femme et à sa fille malades. “Je n’ai que vingt-quatre souverains d’or,” lui dit l’empereur, “s’ils vous suffisent, les voila.”—“C’est trop,” interrompit sur-le-champ un courtisan, “vingt-quatre ducats seraient suffisants.” “Les avez-vous?” demanda le monarque. Le courtisan officieux s’empressa de les tirer de sa bourse. Le prince les prit, et les joignant à ses vingt-quatre souverains, il les remit à l’officier, en lui disant: “Remerciez monsieur, puisqu’il est bien aise de contribuer aussi à votre soulagement.”
Un homme fort laid venait de recevoir un coup de fouet à travers le visage. Une dame lui dit: “C’est singulier! il suffit qu’on ait mal quelque part pour qu’on s’y attrappe.”
Un médecin soutenait à Fontenelle, que le café était un poison lent: “Oui-dà?” dit le philosophe, en souriant; “il y a plus de quatre-vingts ans que j’en prends tous les jours.” Voila ce qu’on appelle une preuve sans réplique.
Le poëte Charleval, irrité contre une dame qui lui avait joué pièce, fit, pour se venger d’elle, l’épigramme suivante:
Lise a beau faire la mignarde,
Chaque jour elle s’enlaidit:
Ce n’est pas que je la regarde,
Mais tout le monde me le dit.

Monsieur Bibaud,
Pourquoi ne contribuerais-je pas comme un autre à votre Journal? Si je ne puis composer, je puis bien au moins copier ... eh bien! chacun selon son petit talent, et si je sais choisir, j’aurai montré de la lecture et du goût ... Du goût?... mais! n’en a pas qui veut.
VOYONS.
EPIGRAMME.
J’ai vu, me dit un jouvenceau,
A la faveur du clair de lune,
Un revenant sur son tombeau;
Ma frayeur ne fut pas commune:
Le terrible fantôme avait
Longues oreilles, couleur sombre,
Et forme entière d’un Baudet...
“Mon cher,” répondis-je au Cadet,
“Vous avez eu peur de votre ombre.”
Remède pour l’asthme. Williams Masters, Écuyer, qui mourut, en 1799, colonel sous l’ancien Duc de Cumberland, reçut dans un combat, une balle de mousquet à travers les poumons, ce qui le guérit radicalement d’un asthme violent. Le Duc avait coutume de dire, quand quelqu’un de ses officiers se plaignait de cette incommodité, qu’il devait se faire tirer à travers les poumons, comme Masters.
(The Soldiers Companion.)
La Compagnie du Vieillard. Au commencement de la guerre américaine, en 1775, il fut formé à Reading, en Amérique, une compagnie de volontaires, qui fut nommée la Compagnie du Vieillard. Elle se composait de 80 Allemands de l’âge de 40 ans et au-dessus: l’individu qui, à leur premier rassemblement, les conduisit en campagne, était âgé de 97 ans, était depuis 40 ans au service régulier, et s’était trouvé à dix-sept batailles rangées; et le tambour était âgé de 84 ans.
(Ibid.)
QUATRAIN.
Où l’on me verse du bon vin,
Volontiers je fais longue pause;
Comme les fleurs de mon jardin,
Je prends racine où l’on m’arrose.
Blessure singulière. A la mémorable bataille de Leipsic, un soldat reçut à la tête une balle de mousquet qui lui pénétra le crane, mais échappa alors à la recherche du chirurgien. Le blessé se plaignit dès lors de violents et continuels maux de tête, et éprouva, de temps en temps, jusqu’à sa mort, arrivée onze mois après, des accès d’épilepsie. On lui ouvrit la tête alors et l’on trouva la balle dans la cervelle même.
(Hufeland’s Journal of Medicine.)
HUITAIN.
Les regrets avec la vieillesse,
Les erreurs avec la jeunesse,
La folie avec les amours;
C’est ce que l’on voit tous les jours.
L’enjouement avec les affaires,
Les grâces avec le savoir,
Le plaisir avec le devoir;
C’est là ce que l’on ne voit guères.
L’Assomption, 2 Avril, 1827.

MIRTILE, CORILAS, LÉONIDAS.
M. Que cet endroit est beau! Cette belle rivière;
En promenant son eau si tranquille et si claire,
Renferme en ses détours de beaux prés verdoyants.[1]
Des arbres allignés et des saules pliants
Bordent des deux côtés son paisible rivage:
Allons donc nous asseoir sous leur charmant ombrage.
L. Allons donc nous asseoir sur le tendre gazon.
C. O Mirtile, vois-tu ce joli papillon?
Comme il voltige, hélas! il nous voit, il s’envole;
Mais il revient déjà de sa course frivole.
Le voila reposé sur ces charmantes fleurs.
Qu’il montre avec plaisir les superbes couleurs
Qui nuancent si bien ses ailes argentées!
Des lisières d’or, de pourpre tachetées,
Où brille un doux duvet, couvrent légèrement
Les magnifiques bords de ses ailes d’argent.
L. Des plumes, Corilas, en manière d’aigrette,
Parent mignonement sa gracieuse tête.
M. Corilas, Corilas, il est sous mon chapeau!
C. Montre donc, cher Mirtile; ah! vraiment, il est beau.
L. Nous l’avons assez vu; vois sa chère compagne,
Qui semble l’appeller dans la verte campagne.
Serait-il malheureux? Laissons-le donc partir.
M. Eh bien! j’ouvre ma main: vois avec quel plaisir
Il voltige déjà dans la verte prairie;
Il a déjà rejoint sa compagne chérie.
Mais enfin nous voici dans ces charmants endroits,
Où nous voulions venir nous reposer tous trois.
Qu’on est bien, à l’abri de ces épais feuillages!
Le souffle caressant des zéphires volages
Qui règnent dans ces lieux rafraîchit l’air brulant.
L. Il règne autour de nous un agréable vent:
Sous ses légers efforts, vois comme l’herbe épaisse
S’abaisse en ondoyant, se courbe et se redresse.
Son murmure est charmant, et ces jolis oiseaux
Y joignent tendrement leurs ramages nouveaux.
C. Que leur gaîté me plaît! ils volent à l’envie,
Dans ces saules touffus, qui coupent la prairie.
M. On ne peut trop vanter la beauté de ces lieux;
Mais pour qu’ils soient encor pour nous plus précieux,
Sur cet arbre gravons nos noms: leurs caractères
Croîtront de jour en jour: nos amitiés sincères
Croîtront aussi comme eux; et Pan, le dieu des champs,
Sera témoin secret de nos tendres sermens.
C. Oui, gravons y nos noms: l’amitié vertueuse
Ne pourrait entre nous devenir malheureuse.
M. La seule vertu doit toujours régler nos pas.
C. Ah! que le souvenir, mon cher Léonidas,
De ces noms sera doux, si nous sommes fidèles.
Mais si nous oublions des promesses si belles...
Ah! détournons de nous ce funeste penser.
L. Mais déjà le soleil commence à s’abaisser;
L’ombre s’augmente; hélas! il faut qu’on abandonne
Cet endroit enchanteur, et les plaisirs qu’il donne.
M. Nous reviendrons encor revoir ces lieux charmants.
C. Oh! oui, nous reviendrons; mais partons, il est temps.
|
Campagne près de l’ancien pont du Passage, en allant vers l’Hôpital-général de Québec. |
Mis-spelled words and printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Inconsistency in hyphenation has been retained.
Inconsistency in accents has been corrected or standardised.
When nested quoting was encountered, nested double quotes were changed to single quotes.
[The end of La Bibliothèque Canadienne, Tome IV, Numero 5, Avril, 1827. edited by Michel Bibaud]