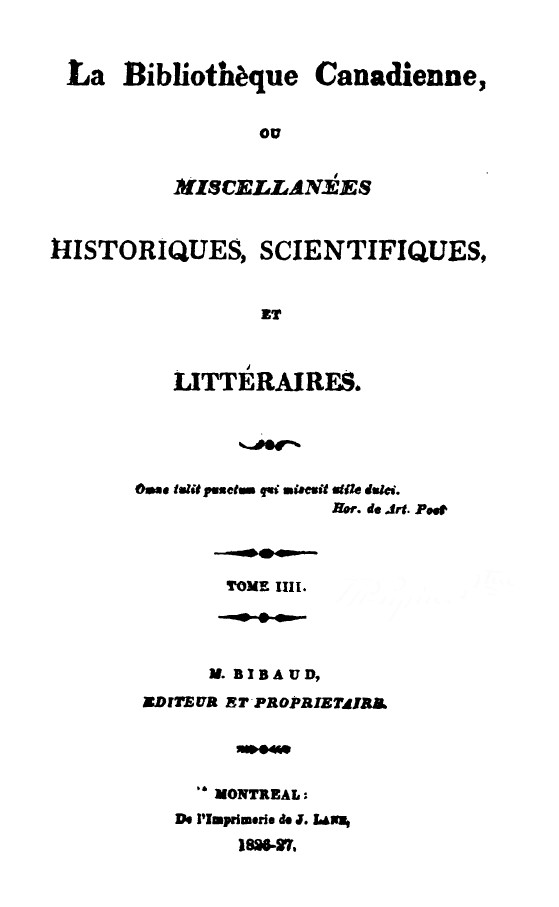
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque Canadienne, Tome IV, Numero 2, Janvier, 1827.
Date of first publication: 1827
Author: Michel Bibaud
Date first posted: Apr. 22, 2020
Date last updated: Apr. 22, 2020
Faded Page eBook #20200445
This eBook was produced by: Marcia Brooks, David T. Jones, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
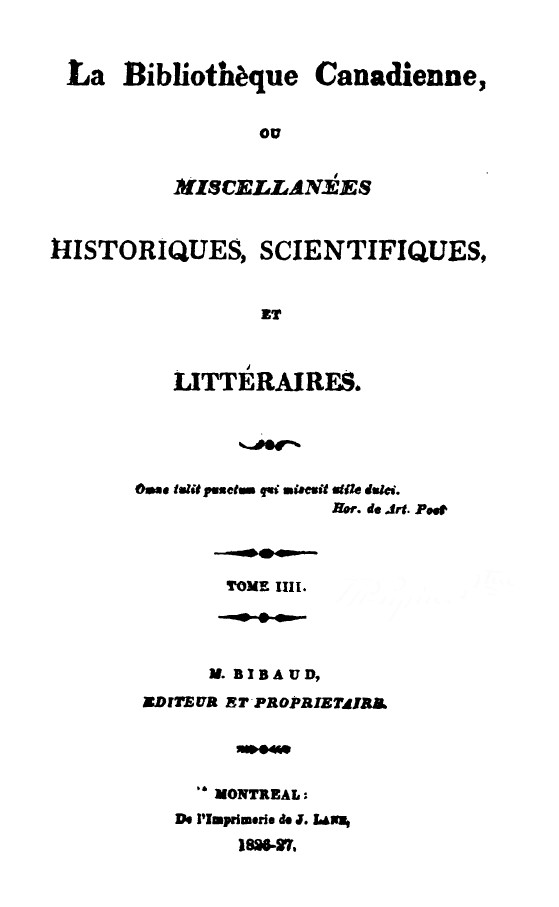
La Bibliothèque Canadienne
| Tome IIII. | JANVIER, 1827. | Numero 2. |
A son retour à Québec, M. de Courcelles trouva les préparatifs de l’armement contre les Agniers et les Onneyouths déjà fort avancés. Six cents soldats du régiment de Carignan, un pareil nombre de Canadiens et environ cent sauvages de différentes tribus, composaient l’armée de M. de Tracy, qui, malgré son âge plus que septuagénaire, voulut la commander en personne. Son artillerie ne consistait qu’en deux pièces de campagne; mais c’en était assez pour forcer tous les retranchemens des ennemis qu’on avait à combattre. Vers la mi-Septembre, comme le vice-roi se disposait à partir, de nouveaux députés des deux cantons arrivèrent à Québec: il les retint prisonniers, et se mit aussitôt en marche.
M. de Courcelles menait l’avant-garde, qui était de quatre cents hommes; M. de Tracy était au centre, avec le chevalier De Chaumont et plusieurs autres officiers de mérite; et les capitaines Sorel et Berthier conduisaient l’arrière-garde. On n’avait pris de provisions que ce qu’il en fallait pour gagner le pays ennemi, où l’on s’attendait à en trouver abondamment; mais comme on n’eut pas soin de les ménager assez, elles manquèrent, lorsqu’on fut à-peu-près à moitié chemin, et l’armée aurait été forcée de se débander pour chercher de quoi subsister, si elle ne fût entrée dans un bois de chataigniers qui lui procura une nourriture assez substancielle pour l’empêcher de périr ou de s’affaiblir, jusqu’à ce qu’elle fût arrivée aux premiers villages iroquois.
Le vice-roi s’était flatté de surprendre ces sauvages; mais des Algonquins, qui avaient pris les devans sans ordre, leur avaient donné l’alarme; de sorte qu’il n’était resté dans les villages que ceux des vieillards et des femmes qui n’avaient pas été en état de suivre les autres dans leur retraite. En entrant dans la première bourgade, l’armée trouva des vivres en abondance; et les soldats, en visitant partout, découvrirent encore des espèces de magazins creusés dans la terre, et tellement remplis de bled, qu’on aurait pu, suivant Charlevoix, en nourrir la colonie entière pendant deux ans. Ces magazins étaient une preuve que les Iroquois ne manquaient pas de prévoyance, comme la plupart des peuples aborigènes de l’Amérique, et les cabannes de cent-vingt pieds de long, et toutes revêtues au-dedans de planches polies, dont parle le même historien, marquaient chez eux de l’industrie et un commencement de civilisation.
Les premières bourgades furent réduites en cendres. Les deux dernières, qui étaient éloignées, auraient peut-être échappé, si une Algonquine, qui avait été longtems esclave chez les Agniers, n’eût servi de guide pour y aller. La première se trouva encore abandonnée, et ce ne fut qu’à la dernière que l’on rencontra enfin les ennemis. Ils s’étaient persuadés qu’on n’ôserait pas les aller chercher jusque-là; et l’appareil extraordinaire avec lequel ils virent les Français s’approcher, les effraya, et ils allèrent se mettre à couvert et dans des lieux où il ne fut pas possible de les aller chercher. On s’en vengea sur les cabannes, dont pas une seule ne resta sur pied dans tout le canton.
Charlevoix pense que si la frayeur ne s’était pas emparée des Agniers, l’armée française eût pu se trouver dans un grand embarras. Il est certain qu’une partie au moins eût pu périr de faim, si les sauvages eussent eu la précaution de détruire les provisions de bouche qu’ils ne pouvaient pas emporter. Mais, ajoute l’historien, la tête leur tourna, et ils ne songèrent point à profiter des avantages que la situation et la connaissance des lieux pouvaient leur procurer. On ne peut même concevoir comment ils purent subsister pendant l’hiver, privés de leurs habitations et de la plus grande partie de leurs vivres, à moins de supposer qu’ils furent recueillis par d’autres cantons.
Quoiqu’il en soit, M. de Tracy se contenta de les avoir humiliés, et de leur avoir appris que les Français étaient en état de les châtier, quand ils le voudraient, et ne jugea pas à propos de s’assurer d’eux par un bon fort, comme il semble qu’il aurait dû le faire: mais il était persuadé que les forts de la rivière de Richelieu mettaient suffisamment la colonie à couvert des incursions des Iroquois, et que ce qui importait le plus c’était de fortifier et d’augmenter les établissemens du fleuve St.-Laurent. C’était en effet ce qui avait été expressément recommandé à MM. de Courcelles et Talon. “L’une des choses qui a apporté le plus d’obstacles à la peuplade du Canada,” disait M. Colbert, dans les instructions qu’il donnait à l’intendant, “a été que les habitans ont fondé leurs habitations où il leur a plu, et sans avoir eu la précaution de les joindre les unes aux autres, pour s’aider et s’entre-secourir. Ainsi ces habitations étant éparses de côté et d’autre, se sont trouvées exposées aux embuches des Iroquois. Pour cette raison, le roi fit rendre, il y lieux ans, un arrêt de son conseil, par lequel il fut ordonné que dorénavant, il ne serait plus fait de défrichemens que de proche en proche, et que l’on réduirait nos habitations en la forme de nos paroisses, autant que cela serait possible. Cet arrêt est demeuré sans effet, sur ce que, pour réduire les habitans dans des corps de villages, il faudrait les assujettir à de nouveaux défrichemens, en abandonnant les leurs. Toutefois, comme c’est un mal auquel il faut trouver quelque remède, sa majesté laisse à la prudence du sieur Talon d’aviser, avec le sieur de Courcelles et les officiers du conseil souverain, aux moyens de faire exécuter ses volontés.”
Le règlement dont parle M. Colbert, fut renouvellé plus d’une fois, au rapport de Charlevoix, mais toujours inutilement; la commodité, et surtout l’intérêt, plus puissant que la crainte, ayant souvent porté des particuliers à se placer dans les endroits même les plus exposés, où la facilité de la traite leur ôtait la vue du péril, en dépit de l’expérience.
Pour revenir à M. de Tracy, il aurait bien voulu pouvoir traiter le canton d’Onneyouth comme il venait de traiter celui d’Agnier; mais la fin d’Octobre approchait; et pour peu qu’il eût différé son retour, il courait risque de trouver les rivières glacées, et d’être harcelé dans sa retraite, par un ennemi plutôt irrité que vaincu. Déjà même les chemins étaient en assez mauvais état; les troupes y essuyèrent beaucoup de fatigues, et un officier et quelques soldats se noyèrent dans le lac Champlain.
A son arrivée à Québec, le vice-roi fit pendre, pour l’exemple, quelques uns de ses prisonniers; croyant apparemment que c’était un des droits des nations civilisées dans leurs guerres avec des peuples barbares; et par un contraste assez frappant, il renvoya de suite tous les autres, avec le Bâtard flamand, après leur avoir témoigné beaucoup de bonté.
Dès que la navigation fut libre, M. de Tracy repassa en France, et le dernier acte d’autorité qu’il fit en Amérique, fut d’établir la Compagnie des Indes Occidentales dans tous les droits dont avait joui celle des cent associés. On espérait beaucoup de la nouvelle compagnie, mais elle ne prit guère plus à cœur les intérêts du Canada, que n’avait fait la précédente, ainsi que M. Talon l’avait prévu; et la colonie continua à languir, bien qu’elle ne soit jamais retombée dans l’état de faiblesse et d’épuisement d’où le roi l’avait tirée.
Ce fut cette année 1667, qu’il fut fait droit aux plaintes dont il a été parlé plus haut, au sujet des dîmes, que l’évêque de Pétrée avait fait taxer au treizième. Au mois de Septembre, le conseil supérieur de la Nouvelle France rendit un arrêt en forme de règlement, qui portait que, par provision, et sans préjudice des lettres patentes accordées par sa majesté, les dîmes ne seraient levées qu’au vingt-sixième; mais qu’elles seraient payées en grains et non en gerbes, et que les terres nouvellement défrichées ne paieraient rien les cinq premières années. Et ce règlement fut exécuté, nonobstant quelques réclamations.
Nous croyons ne devoir point passer sous silence ce que Charlevoix dit de l’île de Montréal, après avoir fait l’éloge de la bonne tenue et de la conduite édifiante de la petite armée de M. de Tracy. “Toute l’île de Montréal,” dit cet historien, “ressemblait à une communauté religieuse. On avait eu, dès le commencement, une attention particulière à n’y recevoir que des habitans d’une régularité exemplaire. Ils étaient d’ailleurs les plus exposés de tous aux courses des Iroquois, et ainsi que les Israëlites, au retour de la captivité de Babylone, ils s’étaient vus obligés, en bâtissant leurs maisons et en défrichant leurs terres, d’avoir presque toujours leurs outils d’une main, et leurs armes de l’autre, pour se défendre d’un ennemi qui ne faisait la guerre que par surprise.”
Parmi les instructions de l’intendant, il y avait un ordre du conseil qui lui enjoignait d’engager les missionnaires à instruire les enfans des sauvages dans la langue française, et à les accoutamer à la façon de vivre des Européens. Les jésuites n’ayant pas réussi, moins, dit Charlevoix, par les difficultés qu’ils avaient rencontrées dans l’exécution du projet, que par les inconvéniens qu’ils y avaient reconnus, M. Talon s’adressa à M. de Pétrée et aux ecclésiastiques de Montréal, qui promirent de faire ce que désirait la cour; mais il paraît que leurs efforts, s’ils en firent, pour parvenir au but désiré, ne furent pas couronnés du succès.
Cependant M. Talon, qu’on peut regarder comme le Colbert de la Nouvelle-France, imaginait tous les jours de nouveaux moyens de faire fleurir ce pays par le commerce et l’industrie. Il avait surtout à cœur les mines de fer, qu’on lui avait dit être abondantes; et dès le mois d’Août 1666, il avait envoyé le sieur De Latesserie dans la Baie St. Paul, où ce mineur découvrit en effet une mine de fer très abondante: il espéra même d’y trouver du cuivre et peut-être de l’argent. M. Talon étant retourné en France en 1668, il engagea M. Colbert à suivre ces découvertes, et le sieur De Lapotadière fut envoyé en Canada dans ce dessein. A son arrivée à Québec, on lui présenta des épreuves de deux mines que M. de Courcelles s’était fait apporter des environs de Champlain et du Cap de la Magdeleine. La Potadière se transporta sur les lieux; et à son retour à Québec, il déclara qu’il n’était pas possible de voir des mines qui promissent davantage, soit pour la bonté du fer, soit pour l’abondance. Cependant, malgré un rapport aussi favorable, ces mines ne furent point alors mises en exploitation.
On avait établi, depuis peu, dans les environs de Québec, une tannerie dont les premiers essais avaient parfaitement réussi; et la liberté du commerce, proclamée cette même année, fit naître de grandes espérances, qui pourtant, s’évanouirent bientôt, ou du moins, ne furent pas pleinement réalisées.
Tandis que ces choses se passaient dans la colonie, il se formait de nouvelles missions dans le nord et chez les Iroquois. Les cantons d’Agnier et d’Onneyouth avaient enfin jugé que le parti le plus sage pour eux était de s’accommoder avec les Français; et peu de tems après le départ du marquis de Tracy pour la France, ils envoyèrent des députés à M. de Courcelles, pour lui faire leurs soumissions, et lui demander des missionnaires. On leur envoya d’abord les PP. Bruyas et Fremin, et ensuite le P. Garnier. Celui-ci étant allé visiter les chrétiens d’Onnontagué, il fut retenu par Garakonthié, qui lui bâtit une cabanne et une chapelle, et lui fit promettre de ne s’en point aller, qu’il ne fût lui-même de retour de Québec, où il devait aller demander des missionnaires pour son canton et pour celui de Goyogouin. Il fit en effet le voyage de Québec dans ce dessein, et s’en retourna avec les PP. De Carheil et Millet. Dans le même tems, l’évêque de Pétrée envoya deux prêtres, MM. De Fénélon et Trouvé, à l’extrémité du lac Ontario, où il s’était établi un grand nombre d’Iroquois, parmi lesquels il y avait plusieurs chrétiens. Vers la fin de l’été, les Tsonnonthouans envoyèrent aussi demander un missionnaire; et on leur accorda le P. Fremin, qui fut remplacé dans le canton d’Agnier par le P. Pearson.
L’année précédente, le P. Allouez était parti avec une troupe d’Outaouais, qui étaient descendus à Québec, pour y vendre leurs pelleteries. Ce missionnaire eut occasion de prêcher l’évangile à plusieurs tribus sauvages jusqu’alors inconnues, telles que les Pouteouatamis, les Miamis, les Mascoutins, les Outagamis, les Sakis, les Illinois, les Cristineaux ou Kilistineaux, &c. Le P. Allouez fit un voyage à Québec, l’année suivante, et emmena avec lui le P. Nicolas. Il laissa ce missionnaire à Chagouamigon sur le lac Supérieur, et alla lui-même s’établir à la Baie des Puants sur le lac Michigan. À-peu-près dans le même tems, les PP. Dablon et Marquette allèrent prendre leur poste au Sault de Sainte Marie.
La Nouvelle-France jouissait alors d’une paix profonde: ceux qui la gouvernaient faisaient tout ce qui dépendait d’eux pour tirer avantage de cet heureux état de choses, et faire prendre à cette colonie une forme solide et un degré d’importance qui la rendissent digne de l’attention que le roi continuait à lui donner. La meilleure partie du régiment de Carignan était restée dans le pays, ou y était revenue: tous les soldats qui voulurent se faire cultivateurs ou artisans eurent leur congé à cet effet; les officiers, qui avaient obtenu des terres en fief et seigneurie, s’y établirent et s’y marièrent presque tous. Charlevoix remarque que la plupart de ces officiers étaient gentilshommes, et en prend occasion de dire que la Nouvelle-France a eu plus de noblesse ancienne qu’aucune autre colonie française, et peut-être que toutes les autres ensemble. Il ajoute que le terrain se trouvait bon partout où l’on faisait de nouveaux défrichemens, et que comme les nouveaux colons s’efforçaient d’égaler les anciens par la bonne conduite, l’industrie et l’amour du travail, ils se trouvèrent bientôt tous en état de subsister.
Il parut, au mois d’Avril de cette année, une nouvelle comète, en forme de lance, selon que s’exprime notre auteur, qui suivait le soleil couchant, et disparaissait, dès que la lune était levée. Le peuple crut qu’elle lui avait annoncé quelques secousses de tremblement de terre, qui se firent sentir, quelque tems après, et des maladies, qui coururent, l’automne suivant. Il avait aussi beaucoup appréhendé pour sa récolte, qui néanmoins fut des plus abondantes.
Cette même année, M. Talon repassa en France, pour des affaires de famille, qui rendaient sa présence nécessaire à Paris, et à cause de certains mécontentemens qu’il avait eus en Canada, et qui lui faisaient désirer de s’en éloigner pour un tems. Il paraît qu’il avait, ou croyait avoir à se plaindre des manières de M. de Courcelles à son égard; ce général, suivant l’historien qui nous sert de guide, à d’excellentes qualités joignait quelques défauts, dont un des plus marqués était de manquer quelquefois d’activité, et de ne vouloir pas néanmoins qu’on y suppléât, lorsque les affaires paraissaient l’exiger. D’un autre côté, M. Talon croyait pouvoir aller toujours son chemin, sans la participation ou l’aveu du gouverneur, lorsqu’il craignait un retardement préjudiciable au service du roi et au bien de la colonie. Il paraît aussi que M. de Courcelles n’était pas toujours d’un commerce aisé, et qu’il n’approuvait pas les ménagemens qu’on semblait avoir pour le clergé, contre lequel il s’était laissé un peu prévenir.
M. Talon eut pour successeur, ad interim, M. De Bouteroue, à qui il fut particulièrement recommandé de modérer sagement la trop grande sévérité des confesseurs et de l’évêque, et de maintenir la bonne intelligence entre tous les ecclésiastiques du pays.—De fortes et nombreuses réclamations avaient donné lieu au premier article des instructions de M. De Bouteroue; mais le dernier, suivant notre historien, n’était fondé sur aucune plainte, l’union étant parfaite alors entre tous les corps qui composaient le clergé séculier et régulier.
L’année 1669, fut pour le Canada, une des moins fécondes en évènemens importants, ou même en incidens remarquables. Ce fut en 1670, que fut consommée l’affaire de l’érection de Québec en évéché. Cette affaire, qui était depuis longtems sur le tapis, avait trainé en longueur, en conséquence des grandes contestations qu’il y avait eu sur la dépendance immédiate du St. Siège, dont le pape (Clément IX,) ne voulut jamais se départir. Cette dépendance immédiate de Rome, à laquelle le roi consentit, à la fin, n’empêcha pourtant pas que l’évéché de Québec ne fût uni à l’église de France, en la même manière que celui du Puy, qui relevait aussi immédiatement du St. Siège. M. de Laval fut obligé de passer en France, afin de demander au roi de l’argent pour payer les bulles, et ce ne fut qu’en 1774, qu’il put les obtenir.
Cette même année 1770, M. de Maisonneuve ayant signifié qu’il désirait se retirer, M. De Bretonvilliers, supérieur-général du séminaire de St. Sulpice, nomma de droit, pour le remplacer dans le gouvernement de Montréal, M. Perrot, qui avait épousé la nièce de M. Talon. Mais ce nouveau gouverneur jugeant que la commission d’un simple particulier ne lui donnait pas un caractère convenable à un officier du roi, et craignant peut-être que les services qu’il pourrait rendre dans ce poste ne lui fussent pas comptés, demanda et obtint des provisions royales, où il était néanmoins expressément marqué qu’elles avaient été données sur la nomination de M. de Bretonvilliers.
(A continuer.)

Mais nous voici arrivés à cette époque glorieuse dont la nation anglaise seule peut se vanter. Ce n’est plus un roi conquérant qui impose des lois à une nation que la victoire à mise à ses pieds; ce n’est plus une multitude révoltée qui enchaine l’autorité royale, après l’avoir abattue; ce ne sont plus ces nobles, fiers de leur force et de leur pouvoir, dictant à un souverain humilié l’acte de son abdication, ou de sa renonciation à cette suprémacie qui offensait leur orgueil. Non, c’est le spectacle auguste d’une convention nationale siégeant tranquillement dans le sanctuaire des lois, offrant à un prince auquel la défection de la branche régnante donnait des droits fondés sur ceux de son auguste épouse, la couronne volontairement et peut-être trop lâchement abandonnée.—Voulez-vous régner sur nous?—Oui.—Signez ce contrat. Et les noms de Guillaume et Marie apposés au Bill des Droits qui leur fut alors présenté, les mirent en possession du trône d’Angleterre. Rien dans cette transaction ne porte le caractère de la compulsion: tout y fut absolument libre et volontaire. Les parties contractantes se trouvèrent donc également liées, et la constitution établie sur le consentement unanime de tous les intéressés.
L’expérience désastreuse de plusieurs siècles avait démontré le danger résultant d’un défaut d’équilibre dans l’influence respective des différentes branches de la législature nationale. Il était donc nécessaire d’assurer cet équilibre d’influence, sans cependant en établir un de pouvoirs, puisque celui-ci tendant à les paralyser, devait nécessairement détruire l’action du gouvernement. Il fallait donc combiner cette influence de manière a ce qu’elle pût opérer tout le bien qu’on en attendait, sans craindre les abus qui en pourraient résulter. Le moyen le plus simple fut de les réunir dans un seul et même coups, dans lequel serait concentrée toute la majesté et toute la puissance nationale. Et, soit dit en passant, c’est dans ce sens que Blackstone applique l’attribut de toute-puissance au parlement impérial. La constitution cependant reconnait trois branches dans cette incorporation, à chacune desquelles elle attribue des pouvoir bien distincts et bien déterminés. Au roi, comme chef de l’état, elle attribue l’étendue de pouvoirs nécessaire pour faire exécuter les lois du royaume; mais en même tems, elle met une barrière impénétrable à l’abus qu’il pourrait faire de ses pouvoirs, sans néanmoins déroger à la majesté royale, en la soumettant à une responsabilité avilissante.—Elle prononce positivement l’inviolabilité du souverain, et elle déclare qu’il ne peut faire de mal; par là elle le soustrait à la malignité et à la jalousie si naturellement dirigées contre l’autorité. Mais cependant, comme un roi n’étant qu’un homme peut errer, elle lui impose l’obligation de n’agir que par des ministres, sur lesquels repose toute la responsabilité. Nul acte émané de l’autorité royale n’a de force qu’autant qu’il porte la signature d’un ou de plusieurs des serviteurs de confiance de la couronne: moyen aussi ingénieux qu’efficace pour contenir l’autorité royale sans l’affaiblir.
La constitution défère encore au roi l’administration de la justice. Mais attendu qu’il n’est pas possible à un seul individu d’exercer les fonctions judiciaires dans un empire aussi étendu, et vu aussi que les erreurs possibles de la part d’un roi dans les jugemens qu’il pourrait prononcer, seraient sans remède, étant sans appel, non seulement il a le pouvoir, mais même la constitution l’oblige de confier à des délégués cette branche si importante de l’administration. De là la gradation des divers tribunaux disséminés dans l’empire britannique, dont l’accès est ouvert à tous.
La troisième branche du corps constitutionnel consiste dans les députés librement élus par le peuple. Quoique cette branche ne tienne de la constitution aucune agence sur l’action du gouvernement, elle jouit de prérogatives qui assurent son influence dans le jeu de la grande machine. D’abord, elle fait partie du corps législatif, et comme telle, nulle loi ne peut se faire ou se changer sans elle; en second lieu, elle a le pouvoir de paralyser l’action du gouvernement, en refusant les taxes, qu’elle seule a le droit d’accorder; moyen immense d’influence, et qui serait déjà suffisant pour la rendre redoutable; troisièmement, si elle ne possède aucun pouvoir actif, elle jouit d’un attribut qui met un nouveau poids considérable dans la balance d’influence en sa faveur; c’est celui de constituer la grande enquête nationale. Par la constitution même, la chambre des communes est reconnue comme le grand-juré devant lequel sont amenés tous les grands officiers de l’état, et autres malfaiteurs que leur crédit et leur autorité pourraient soustraire aux jurisdictions ordinaires, et elle se porte leur accusatrice devant le haut tribunal dont nous parlerons tout à l’heure. C’est dans cette branche seule de la législature que la constitution a placé cette inhérence de fonctions de grands-jurés; mais l’on ne voit pas qu’elle puisse la déléguer ou la transmettre ailleurs que dans son enceinte. Ces fonctions sont aussi importantes que redoutables; car si leur résultat est contre l’accusé, que n’a-t-il pas à craindre dans une lutte dans laquelle toute la puissance nationale est armée contre un individu isolé! D’autres moyens d’influence résultent du nombre, des richesses, des talens et de la popularité que cette branche renferme, et il ne serait pas difficile de prévoir qu’elle aurait bientôt usurpé tous les pouvoirs sur la couronne, si la constitution n’avait pas pourvu aux moyens de balancer cette influence gigantesque. En effet, que pourrait contre elle un homme seul et isolé, quelque élevé qu’il soit? Quel est l’être assez hardi pour ôser venir se mettre entre lui et cette phalange formidable, prête à l’écraser sous le poids d’une responsabilité rigoureuse? Il faut des motifs bien puissants pour porter à ce degré de hardiesse; eh bien, la constitution, qui a tout prévu, a pourvu à ces motifs puissants, en déposant entre les mains du souverain la disposition des honneurs, des grâces et des faveurs. Ces honneurs et ces grâces, en étendant la sphère d’influence de ceux qui les reçoivent, les mettent en état, non seulement de se défendre eux-mêmes, mais de venir à l’appui du trône.
Mais cette contrebalance serait encore bien loin d’être efficace, si la constitution ne l’avait augmentée par l’introduction d’une branche intermédiaire, et qui complète le trépied sacré. Cette branche intermédiaire, et la seconde en rang, consolide l’ouvrage, en créant une influence indépendante des deux autres, et qui devient par là l’influence modératrice. Elle consiste, comme l’on sait, dans la chambre haute ou des pairs du royaume, qui y siègent de droit. L’influence dont cette branche jouit dérive d’abord de ce droit inhérent à la pairie; ensuite de la masse de richesses et de lumières que ses membres possèdent, et du crédit que leur rang leur assure. J’ai dit que cette influence était indépendante: en effet, quelques soient les voies par lesquelles un noble est parvenu à obtenir de son souverain les honneurs de la pairie, une fois conférés, il ne dépend plus du caprice ou de la volonté du souverain de les retirer; et à moins qu’un jugement de ses pairs ne le dégrade, ils passent de génération en génération. Leur élévation n’apporte aucun changement dans leurs intérêts comme sujets, et ne les dégage d’aucune obligation légale, ni ne les exempte de partager en commun avec tous le fardeau des charges publiques. Sous ce dernier point de vue, il est clair que leur influence se porterait naturellement du côté des communes, dans tous les cas où la couronne chercherait à outrepasser les bornes de sa prérogative. D’un autre côté, comme le trône réfléchit une partie de son éclat sur eux, il est pareillement naturel de croire qu’autant qu’ils le pourront, ils supporteront cet éclat, toutes les fois que l’influence démocratique cherchera à le ternir.
Cette influence modératrice et si essentielle au maintien de la constitution, n’est pas le seul attribut dont cette seconde branche soit revêtue: elle possède, en outre, par son essence constitutionnelle, un pouvoir d’action qui lui est inhérent. Elle constitue le plus haut tribunal dans le pouvoir judiciaire: et ceci prouve encore la sagesse de notre constitution. C’est devant ce tribunal, aussi auguste qu’éclairé, que se portent les accusations intentées sous le nom d’impeachments par la chambre des communes. C’est le seul tribunal dont l’influence est assez indépendante et assez puissante pour rassurer un accusé contre celle de ses accusateurs. A eux seuls appartient pareillement le droit de juger toute accusation portée contre un pair du royaume, pour tout crime capital.
Tel est le tableau raccourci de cette constitution, qui pourrait être dite parfaite, si quelque production humaine avait droit à la perfection. Elle l’est cependant à ce degré, que tout essai tenté pour l’améliorer n’aurait qu’un effet contraire; et son éclat n’est pas plus terni par les petites imperfections, que l’œil le plus exercé, armé du télescope de la malveillance, peut y découvrir, que celui de l’astre lumineux qui nous éclaire ne l’est par les petites taches que l’on découvre sur son disque. Je ne m’étendrai pas davantage sur ce sujet, et renverrai le lecteur aux auteurs, tels que Blackstone, Delolme, et autres, quant aux autres attributs, prérogatives et privilèges de moindre importance, qui assurent à chacune des branches de la trinité constitutionnelle, la jouissance libre et entière de leurs pouvoirs respectifs. Je dois pourtant ajouter ici une réflexion bien importante, savoir, que ce n’est que dans le parlement impérial que la constitution reconnait cette suprémacie de pouvoir et de souveraineté, qui ne peut-être déléguée à nulle autre personne, ni à aucun autre corps politique, dans l’étendue de l’empire britannique.
(La suite au numéro prochain.)

C’est une comparaison assez amusante, (dit Mr. J. Lambert,) que celle des mœurs et des habitudes des dames canadiennes d’aujourd’hui, avec ce qu’en disait le professeur Kalm, il y a soixante ans, (présentement près de quatre-vingt,) lorsque le Canada était entre les mains des Français.
“Il faut,” dit-il, “distinguer parmi les dames du Canada, et celles qui viennent de France, et celles qui sont nées dans le pays: les premières ont toute la politesse qui est particulière à la nation française; les dernières se distinguent encore en dames de Québec, et dames de Montréal: les premières n’en cèdent point aux Françaises en politesse, en belles manières et en bonnes grâces; et cela parce qu’elles ont l’avantage de converser fréquemment avec les messieurs et les dames qui viennent tous les étés sur les vaisseaux du roi, et qui passent plusieurs semaines à Québec, mais vont rarement à Montréal. Les Français accusent les dames et les demoiselles de cette dernière ville d’avoir quelque chose de la fierté des sauvages, et de n’avoir pas des manières assez polies. Ce que j’ai dit plus haut, en parlant du trop grand soin qu’elles donnent à leur coiffure, doit s’appliquer à toutes les dames du Canada. Elles s’habillent superbement le dimanche, et bien que, les autres jours, elles ne paraissent pas s’occuper beaucoup du reste de leur toilette, cependant elles aiment à être en tout tems bien coiffées; aussi ont-elles toujours les cheveux frisés et poudrés, et ornés d’aigrettes et d’aiguilles de tête.
“Les jours qu’elles font ou reçoivent des visites, elles s’habillent si élégamment, qu’on dirait que leurs parens sont revêtus des plus grandes dignités de l’état. Les Français qui considèrent les choses dans leur vrai jour, se plaignent beaucoup qu’une grande partie des dames du Canada aient pris la mauvaise habitude, de donner trop à leur toilette, de dépenser leur fortune, et quelquefois au-delà, pour être richement mises, sans rien réserver pour l’avenir. Elles ne sont pas moins attentives à la mode, et se raillent les unes les autres sur leurs façons de s’habiller; mais ce qu’elles regardent comme la dernière mode a déjà vieilli, et n’est plus d’usage en France; car les vaisseaux ne venant qu’une fois l’an, les habitans regardent comme étant à la nouvelle mode les habits que portent ceux qui viennent dans ces vaisseaux, et en portent de pareils pendant toute l’année.
“Les dames et demoiselles du Canada, et particulièrement celles de Montréal, sont très portées à rire des fautes que les étrangers font en parlant. En Canada, la langue française n’est parlée que par des Français; car il y va rarement des étrangers, et les sauvages, naturellement trop fiers pour apprendre la langue des Français, obligent ceux-ci à apprendre la leur. Il suit de là que les dames canadiennes du bon ton ne peuvent rien entendre de peu ordinaire, sans en rire. Une des premières questions qu’elles font à un étranger, c’est de lui demander s’il est marié; puis comment il trouve les demoiselles du pays; enfin, s’il se propose d’en emmener une dans son pays?
“Il y a quelque différence entre les demoiselles de Québec et celles de Montréal: celles de la dernière de ces deux villes me paraissent plus jolies généralement que celles de la première; les manières m’ont aussi semblé plus libres à Québec, et plus modestes à Montréal. Les dames, et surtout les demoiselles de Québec sont peu adonnées au travail. On y a une bien pauvre idée d’une jeune personne de dix-huit ans, si elle ne compte au moins vingt amans. Les demoiselles, celles du haut ton surtout, se lèvent à sept heures, et sont à leur toilette jusqu’à neuf, qu’elles prennent leur café. Quand elles sont habillées, elles s’asseyent près d’une fenêtre qui donne sur la rue, prennent dans leurs mains quelque chose à coudre, font un point de tems à autre, et ont presque continuellement les yeux tournés du côté de la rue. S’il entre un jeune homme bien mis, qu’elles le connaissent ou qu’elles ne le connaissent pas, elles mettent leur ouvrage de côté, s’asseyent près de lui, et se mettent à folâtrer, à chuchoter, à ricaner, et à inventer des doubles ententes, et c’est ce qui s’appelle montrer de l’esprit. Elles passent souvent la journée entière de cette manière, laissant à faire à leurs mères tout l’ouvrage de la maison.
“A Montréal, les demoiselles sont moins volages et plus travaillantes. Elles sont presque toujours à leur couture, ou à quelque autre affaire du ménage. Elles paraissent gaies et contentes, et l’on ne peut pas dire qu’elles manquent d’esprit ou de charmes. Elles ont généralement bonne opinion d’elles-mêmes. Cependant, les jeunes personnes de tout rang vont au marché, et apportent à la maison ce qu’elles y ont acheté. Elles se couchent et se lèvent d’aussi bonne heure que pas un de la famille. J’ai appris avec certitude que les fortunes n’étaient pas considérables, et qu’elles devenaient proportionnément moindres par le nombre des enfans, et le peu de prix des maisons. Les demoiselles de Montréal ne voient pas sans déplaisir que celles de Québec trouvent à se marier plutôt qu’elles. La raison en est que plusieurs jeunes messieurs, qui viennent de France avec les vaisseaux, se prennent d’amour pour des demoiselles de Québec, et les épousent; mais comme ces messieurs montent rarement à Montréal, les demoiselles de cette dernière ville ont moins de chances de se marier jeunes que celles de Québec.”

Mr. Bibaud—Depuis que la Bibliothèque Canadienne est commencée, vous avez souvent invité vos abonnés et autres à devenir avec vous des collaborateurs à cet intéressant Journal. Cet appel a été suivi d’un succès assez flatteur, pour devoir vous encourager dans la tâche patriotique que vous vous êtes imposée—“d’accueillir et faire connaître les talents de votre Pays.” Chacun, devinant votre pensée, s’est empressé de répondre à votre invitation, en vous adressant des Essais littéraires en tous genres, en vous communiquant même des Manuscrits, &c. Des commencements aussi heureux doivent vous faire présager un bel avenir pour votre journal, comme ils devraient, ce semble, porter ceux de vos concitoyens qui ne l’ont pas fait encore, à contribuer de tous leurs moyens à le rendre de plus en plus utile et honorable pour le pays; et propre à faire naître chez l’étranger (où, tel qu’il est, il a déjà reçu un accueil favorable,) une idée avantageuse de vos compatriotes. Qui peut douter, sous ce dernier rapport, que les écrits politiques de votre correspondant D. (toujours reconnaissable, quoiqu’il ne signe pas toujours,) ne soient pas seuls capables d’ajouter à la réputation de votre journal?...... Pourtant, il a son défaut, que je ne lui déguiserai pas.... il n’écrit pas assez souvent sur ce sujet, qu’il traite avec autant d’habileté que de savoir.
Vous donnez à vos lecteurs une “Histoire du Canada:”—il est bien connu que Mr. Berthelot D’Artigny a déjà rassemblé de nombreux matériaux sur le même sujet; et que le Dr. Labrie, qui prépare aussi une histoire de ce pays, en était, au mois d’Août dernier, rendu à l’époque de la conquête. Quelles consolantes réflexions ces entreprises de la part d’Enfants du sol ne sont-elles pas propres à nourrir dans le cœur de tous les Canadiens!
Quelques soins que vous et ces messieurs vous soyiez néanmoins donnés, quelques recherches que vous ayiez pu faire, n’est-il pas à craindre, peut-être, que vous ne soyiez pas en possession de tous les matériaux nécessaires pour compléter l’édifice dont vous avez eu le mérite de concevoir le plan et d’entreprendre la construction? Quiconque a les plus petits moyens de vous aider, doit donc s’empresser de seconder vos généreux efforts. Pour moi, je suis prêt à commencer, de ce jour; en vous faisant part de ce que la tradition m’a appris—en vous communiquant quelques publications anciennes ou peu communes au pays—en vous adressant, des extraits de quelques Mémoires et autres Manuscrits, auxquels je puis avoir accès, ou dont je suis seul en possession. Parlez, Mr. Bibaud, et...... tous mes trésors sont à votre disposition; mais au moins, que chacun, qui le peut, en fasse autant que moi.
Les quatre années qui suivirent immédiatement la conquête du Canada, forment un période vulgairement connu sous le nom du “Règne Militaire;” parce que, durant tout ce tems, la justice fut administrée par des tribunaux auxquels présidèrent des Officiers de Milice, et même de l’armée, qui, pourtant, devaient juger, d’après les lois, formes et usages du pays, mais qui n’en étant pas trop instruits, comme on le peut aisément supposer, durent, plus d’une fois, s’en éloigner pour suivre l’arbitraire, ou, suivant eux, sans doute, l’équité. Je vous dirai d’abord ce que la tradition et l’histoire nous ont conservé de cette époque relativement à ces tribunaux, et vous donnerai à la suite, un document historique, inédit, qui a particulièrement rapport à leur organisation pour le “Gouvernement de Montréal,” du 13 Octobre 1761 au 10 Août 1764. Je pourrais le faire suivre, si vous le trouviez bon, de douze à quinze autres pièces également inédites et authentiques, qui se rattachent toutes à l’administration de la justice, durant ce période dans le gouvernement particulier de Montréal.
| Du Règne Militaire, pendant les quatre années qui ont | ||
| suivi la Conquête, (1760—1764;) et de quelques Documents | ||
| inédits qui ont particulièrement rapport au | ||
| “Gouvernement de Montréal” durant partie de cette | ||
| courte période de l’Histoire du Canada, (1761-1764.) | ||
Toute personne instruite de l’histoire de ce pays sait, qu’après la reddition de Montréal aux armes anglaises, le 8 Septembre 1760, et la réduction du Canada, qui en fut la suite, Sir Jeffery Amherst, lieutenant-général et commandant en chef des forces britanniques de l’Amérique du Nord, avant son retour à New-York, divisa la partie habitée du Canada en trois “gouvernements militaires,” savoir, ceux de “Québec,” de “Montréal” et des “Trois-Rivières;” qu’il nomma pour gouverneurs, au 1er, le général James Murray—au 2d, le général Thomas Gage,—et au 3e. le colonel Ralph Burton; qu’il établit dans ces gouvernements des tribunaux tenus et présidés par les officiers de milice, qui devaient juger sommairement tous procès civils et criminels portés devant eux, avec appel aux gouverneurs; et que sa majesté, en approuvant, plus tard, les arrangements de Sir Jeffery à tous ces égards, voulut qu’ils eussent force et effet jusqu’à la paix, et l’établissement d’un gouvernement civil au pays, s’il devait demeurer à l’Angleterre.
La tradition et Mr. Smith,[1] sont parfaitement d’accord sur tout ce que je viens de dire; mais Raynal différant sur l’un de ces points, je reviendrai tout-à-l’heure à cet historien.
On sait encore, que le Canada ayant été cédé à l’Angleterre par le traité définitif de paix du 10 Février 1763,[2] dont les ratifications furent échangées le 10 Mars suivant, la paix fut proclamée à Westminster et à Londres, le 20 du même mois; qu’information officielle de cette cession fut donnée aux habitans de la colonie, (au moins à ceux du gouvernement de Montréal,) le 17 Mai de la même année, par proclamation du gouverneur Gage de cette date émanée à cet effet;[3] et que celle du roi George III, divisant les possessions cédées à l’Angleterre, par le traité de paix, en quatre gouvernemens civils, savoir, de Québec, de la Floride orientale, de la Floride occidentale, et de la Grenade, ne sortit et ne fut publiée à Londres que le 7 Octobre 1763.
Quoique la nouvelle de la cession du Canada à l’Angleterre eût été signifiée aux “Chambres de Justice” de Montréal, le 17 Mai 1763, comme je viens de le dire, et qu’on pût croire, dès lors, (d’après ce qui a été dit plus haut,) qu’au gouvernement militaire allait immédiatement succéder le gouvernement civil, néanmoins la forme de l’administration du pays et de ses divers tribunaux ne fut pas en même tems changée. Les “Chambres de Justice” établies le 13 Octobre 1761, (voir l’ordonnance ci-après,) continuèrent en existence jusqu’au 10 Août 1764;[4] et les “Cours civiles” qui les remplacèrent, ne leur furent substituées que le 17 Septembre de la même années, par l’Ordonnance de cette date du général Murray et de son conseil, établissant des Cours du Banc du Roi et des Plaidoyers communs.
Ce délai peut s’expliquer ainsi: Le major-général J. Murray avait été fait, il est vrai, “Capitaine-général et Gouverneur en chef de la Province de Québec,” le 21 Novembre 1763; mais il ne reçut et ne publia sa commission, en Canada, que le 10 Août 1764; il est donc probable que quoiqu’il dût connaître depuis longtems, la cession faite du Canada à l’Angleterre, il ne se crut par autorisé à rien changer de l’administration du pays, avant qu’il eût reçu et publié cette commission.
Tels sont à-peu-près les seuls détails connus, ou du moins constatés par des pièces officielles, (précitées,) qui ont rapport au “règne militaire.” Revenons maintenant à Raynal, et parlons des documens ignorés et conservés, dont la publicité pourrait jeter une plus grande lumière sur ce période de notre histoire.
J’ai dit plus haut que l’abbé Raynal différait sur un seul point avec la tradition et Mr. Smith: c’est sur la composition des tribunaux établis par Sir Jeffery Amherst, immédiatement après la prise de Montréal. Et en effet, cet écrivain dit, en parlant de ces tribunaux: “C’étaient des officiers de troupes qui jugeaient les causes civiles et criminelles, à Québec et aux Trois-Rivières, tandis qu’à Montréal, ces fonctions augustes et délicates étaient confiées à des citoyens.”[5] Malheureusement, je n’ai point l’Ordre-général, l’Ordonnance, ou la Proclamation de Sir Jeffery, (je ne sais quel nom lui donner,) établissant l’ordre de choses qui a existé par tout le pays, ou seulement à Montréal, entre le 8 Septembre 1760 et le 13 Octobre 1761. Il est clair, même d’après le préambule de l’ordonnance ci-après (de cette dernière date,) que dans ce gouvernement au moins, on a fait quelque changement à l’ordre de choses préexistant à 1761; quel était-il donc? La publication de l’ordonnance de Sir Jeffery pourrait seule donner la réponse à cette question; et s’il est possible d’y avoir accès, on doit sentir combien il serait désirable de publier, en toutes lettres, ce document intéressant, la première loi que nos pères reçurent de leurs vainqueurs. Et comme Raynal est à-peu-près le seul historien qui ait écrit sur cette époque de notre histoire, il serait aussi facile qu’important de rectifier l’erreur, s’il y est tombé, par la publication d’un document historique qui doit exister en Canada. Au reste, l’ordonnance de Sir Jeffery, (relativement au gouvernement de Montréal,) ne peut-être nécessaire que pour constater quelle y a été la forme de l’administration judiciaire du 8 Septembre 1760 au 13 Octobre 1761; car à compter de cette dernière date jusqu’au 10 Août 1764, les documens officiels que je possède ne laissent aucun doute sur la manière dont la justice a été administrée dans ce gouvernement.
Le plus important de ces documens historiques est, sans contredit, “l’Ordonnance du Gouverneur Gage, du 13 Octobre 1761.” Le motif qui y donna lieu fait, sans doute, l’éloge du général; mais les détails dans lesquels elle entre sur la division du gouvernement de Montréal en cinq jurisdictions civiles et criminelles pour les campagnes, indépendamment de celle de la ville; sur les cours d’appel ambulantes qu’elle établit; sur la classe (non équivoque,) de citoyens qu’elle appelle à composer les “Chambres de Justice,” comme elle les nomme;—tout en la rendant précieuse pour l’historien, et curieuse pour l’habitant du pays, doivent en faire surtout désirer l’impression, dans un moment où notre compatriote, Mr. Plamondon, avocat aussi éclairé qu’orateur distingué, paraît s’occuper d’approfondir en particulier l’Histoire légale du Canada.[6]
Je vous dois peut-être, et à vos lecteurs, Mr. Bibaud, un mot sur la source à laquelle j’ai puisé le document historique que je vous envoie aujourd’hui. Je l’ai copié, ainsi que quelques autres, dont je vous ai déjà fait offre, d’un des régistres du tems: ils sont donc authentiques. Chacune des cinq “Chambres de Justice” de campagne établies par l’ordonnance ci-dessous transcrite tenait un tel régistre, dont suit le titre: “Régistre de la Chambre de Justice de——, établie par son Excellence Monsieur Thomas Gage, Gouverneur de Montréal et de ses dépendances, &c. le 13 Octobre 1761, par son Ordonnance enrégistrée sur le dit Régistre, sur la page numérotée et paraphée première page, par un des Capitaines de la dite Chambre.” En marge de celui qu’on m’a communiqué sont les initiales Fr. G. du nom du Capitaine de milice Fr. Guy. Au haut, il est écrit: “1761, 24 Oct.” et immédiatement en tête de l’Ordonnance est le signe religieux, d’une †. On n’y parle qu’une seule langue, la française.
S. R.
Montréal, 1er. Décembre 1826.
———————
| Fr. G. | “Extrait[7] de l’Ordonnance et Réglement des | |
| Chambres de Justice du Gouvernement de Montréal, | ||
| par son Excellence Monsieur Thomas Gage, | ||
| Gouverneur du dit Montréal et ses dépendances, &c. | ||
| “Par Son Excellence Thomas Gage, Gouverneur | ||
| de Montréal et de ses dépendances, | ||
| &c. &c. &c. | ||
“Sçavoir:—Nous étant fait rendre compte de l’état actuel de l’administration de la Justice dans les Campagnes de Notre Gouvernement, et recherchant avec zèle les moyens de la rendre plus prompte, plus aisée et moins couteuse à ceux qui seront dans l’obligation d’y recourir,—Nous avons fait le présent Règlement que Nous voulons être suivi et exécuté suivant sa forme et teneur.
“Notre Gouvernement sera divisé pour l’administration de la Justice en cinq Districts, que nous avons placés au centre des campagnes de chaque district, afin de faciliter ceux qui seront obligés d’y avoir recours.
“Pour le premier District, la Chambre d’Audience se tiendra à la Pointe-Claire, et les habitants des Cédres, Vaudreuil, Isle Perreault, (Perrot,) Ste.-Anne, Ste.-Geneviève, Sault-au-Récollet, La Chine et St.-Laurent seront justiciables de cette Chambre.
“Pour le second District, la Chambre d’Audience se tiendra à Longueuil, pour les habitants de Chambly, Châteauguay, Laprairie, Boucherville et Varennes.
“Pour le troisième District, la Chambre d’Audience se tiendra à St.-Antoine, pour les habitants de Sorel, St.-Ours, St.-Denis, Contrecœur, St.-Charles et Verchères.
“Pour le quatrième District, la Chambre d’Audience se tiendra à la Pointe-aux-Trembles, pour les habitants de la Longue-Pointe, la Rivière-des-Prairies, Ste.-Rose, St.-Frs. De Sales, St.-Vincent de Paule, Terrebonne, La Mascouche et La Chenaie.
“Pour le cinquième et dernier District, la Chambre d’Audience se tiendra à La Valtrie, pour l’Assomption, La Nauraie, Repentigny, St.-Sulpice, Berthier, Isle Dupas et autres îles dans cette partie.
“Dans chacune de ces Chambres il s’assemblera un Corps d’Officiers de Milices, tous les premiers et quinze de chaque mois; si ces jours arrivent Dimanche ou fête, l’audience sera remise au lendemain.
“Ce Corps d’Officiers de Milices sera composé au plus de sept et au moins de cinq, du nombre desquels il y aura toujours un Capitaine: s’il s’en trouvait plusieurs, le plus ancien présidera.
“Les Officiers de Milice de chaque district s’assembleront avant toutes choses dans les paroisses ci-mentionnées, pour le 24e Octobre, afin de régler leurs assises aux Audiences à tour de rôles, afin qu’ils se trouvent toujours à leur tour le nombre de sept.
“Chacune Chambre aura soin de tenir un Régistre numéroté par première, et dernière page, et paraphé à chaque page d’un des Capitaines de la Chambre; dans lequel régistre seront enrégistrés tous les jugements de la dite Chambre et les ordonnances qui seront par Nous rendues.
“Lorsqu’il conviendra parvenir à quelques ventes par décrêts ou retraits, il faut qu’elles soient faites dans les manières accoutumées.
“Dans les affaires où il y aura nécessité d’avoir des témoins, la partie qui succombera sera tenue de les payer à raison de 3 liv. par jour, et si la distance excède 5 lieues, les dits témoins seront payés 6 liv. par jour. Les plaideurs de mauvaise foi seront contraints de payer les dépenses de leurs parties adverses, suivant l’arbitrage qui en sera fait par les dites Chambres.
“Chacune Chambre est autorisée à faire paroître les dits témoins malgré qu’ils demeurent dans un autre district, à peine contre chacun des témoins qui refuseront d’obéir, de 5 piastres d’amende pour la première fois, et de 10 en cas de récidive.
“Lorsqu’il y aura des procès entre des particuliers de différents districts, le demandeur s’adressera à la Chambre d’où dépendra le défendeur.
“Nous exceptons cependant les habitants de Montréal, à qui Nous conservons le privilège de faire venir à leur Chambre les particuliers des campagnes.
“Nous fixons le délai pour appeller des jugements de chaque Chambre à un mois du jour qu’ils seront rendus, passé lequel tems tous les dits jugements seront exécutés; en conséquence les Officiers des Chambres assemblés donneront ordre au Capitaine du perdant de le contraindre par corps ou par saisie de ses biens.
“Afin de décider sur les Appels qui seront faits, Nous prévenons que tous les vingt de chaque mois il s’assemblera un Conseil d’Officiers des Troupes de Sa Majesté, savoir, un à Montréal pour le premier district—un autre à Varennes pour le second et troisième district—et un autre à St.-Sulpice pour le quatrième et cinquième district.
“Les parties qui voudront encore appeller du jugement des dits Officiers, seront tenues de le faire dans la quinzaine, pardevant Nous, et à cet effet ils remettront leurs pièces en Notre Secrétariat dans le dit délai, faute de quoi ils n’y seront plus reçus.
“Lorsqu’il se trouvera dans quelques paroisses des gens sans aveu ou des scélérats, ils seront conduits devant la Chambre du district où ils seront pris, laquelle les condamnera, soit au fouet, prison ou amende, suivant l’exigence du cas.
“S’il se commettait quelques crimes atroces, comme assassin,[8] viol, ou autres capitaux, chaque Officier de Milices est autorisé à arrêter les criminels et les complices et les faire conduire sous bonne et sure garde à Montréal, avec l’état du crime et la liste des témoins.
“Lorsqu’il s’agira de procès qui n’excéderont pas 20 liv., chaque Officier de Milices pourra seul les décider, et les parties ne pourront appeller de leurs décisions qu’à la Chambre du District seulement.
“Pour indemniser les Officiers de Milices des Chambres de chaque district, de la perte de leur tems, abandon de leurs travaux, entretien de leur Chambre, et subvenir aux dépenses d’icelles pour bois et chandelles nécessaires,—Nous leur allouons ce qui suit:
“La partie qui aura succombé dans un procès de la valeur de 20 liv. jusqu’à 50 liv., payera une demi-piastre—depuis 50 liv. jusqu’à 100 liv., une piastre—depuis 100 liv. jusqu’à 250 liv., une piastre et demie—depuis 250 liv. à 500 liv., deux piastres et demie—de 500 liv. à 1000 liv., quatre piastres—de 1000 liv. à 3000 liv., six piastres—de 3000 liv. à 7000 liv., huit piastres,—de 7000 liv. à 10,000 liv., dix piastres—et au-dessus de 10,000 liv., vingt piastres.
“Les amendes que les particuliers auront encourues, faute d’avoir satisfait à Nos Ordonnances, leur seront allouées.
“Chaque Chambre nommera un trésorier qui touchera l’argent des parties et des dites amendes, en tiendra un compte exact et en rendra compte tous les trois mois aux Officiers des dites Chambres, entre lesquels le total sera partagé eu égard au nombre de leurs assises aux Audiences et à la distance du chemin, qu’ils auront fait; les frais de l’entretien de leur Chambre préalablement déduits.
“Nous ne pouvons trop recommander aux dits Officiers de Milices de maintenir le bon ordre dans leurs compagnies, d’accommoder autant qu’il leur sera possible tous les différents à l’amiable, enfin de tenir la main à l’exécution du présent Règlement, lequel sera enrégistré, en tête de leurs Régistres.[9]
“Mandons que Notre présente soit lue, publiée, et affichée ès lieux accoutumés.
“Fait à Montréal, le 13e Octobre 1761. Signé de Notre main, scellé du sceau de Nos armes et contresigné par Notre Secrétaire.
“THOS. GAGE.
“Par Son Excellence, G. Maturin.”
|
History of Canada, Québec, J. Neilson, 1815, en deux vols. |
|
La signature des articles préliminaires de la paix est du 3 Novembre 1762. |
|
Cette Proclamation (que j’ai manuscrite,) fat adressée dans le tems par le gouverneur Gage aux “Chambres de Justice” seulement: c’est ainsi qu’on appellait les Cours d’alors dans le gouvernement de Montréal. |
|
Voir l’Ordonnance du gouverneur et conseil, du 20 Septembre 1764. |
|
Hist. Philos. tome VIII. Édition corrigée de 1780. |
|
Voir Leçons de Droit, &c. Bib. Can., T. IIII, No. 1. p. 36. |
|
Ce mot veut dire copie. |
|
On trouve ce même mot employé pour assassinat dans tous les Manuscrits du tems que j’ai en ma possession. |
|
Ces mots en tête de leurs Régistres indiquent bien la première opération d’un tribunal de nouvelle création. Quels étaient donc les tribunaux antérieurement existants? La Proclamation ou Ordonnance de Sir Jeffery Amherst le ferait voir; il est donc bien à désirer qu’on la rende publique. |

Milton, après avoir parlé d’un trône magnifique sur lequel est assis Satan, lui fait débiter un discours pompeux, par lequel il ouvre la séance. Il propose une alternative, et finit par ces mots:
.....................Who can advise may speak.
Moloch opine, et la manière énergique dont il s’exprime dévoile presque toute l’horreur de sa situation.
Bélial parle ensuite. Mais avant de rapporter son discours, le poëte nous le dépeint comme le plus beau des anges révoltés. Il lui donne de superbes traits, quoiqu’un peu altérés par l’action du feu infernal et obscurcis par la fumée.—Un autre pair se lève, dont Milton dit:
To vice industrious, but to nobler deeds
Timorous and slothful...................
Le premier attribut convient à un démon; mais le bien répugnant directement à sa nature, il était inutile de lui donner les épithètes timide et paresseux pour la perpétration des actes plus nobles que le vice. Son discours est très ingénieux; il y règne une éloquence marquée. Mais en même tems, le poëte n’aurait pas dû placer des tours au ciel, avec un guet armé; car toutes ces fortifications, en rabaissant la majesté de Dieu, tendent plutôt à nous faire rire qu’à effrayer les assaillans.
...............The towers of heaven are fill’d
With armed watch, that render all access
Impregnable...............................
La fin du discours est marquée au coin d’une impiété contradictoire avec la science qu’ont les démons de l’immutabilité de Dieu.
...............When the raging fires
Will slacken, if his breath stir not their flames,
Our purer essence then will overcome
Their noxious vapour, or inured, not feel,
Or change at length......................
Qu’on ne dise pas que if his breath stir not their flames, rend l’impiété conditionnelle; car Dieu leur avait expressément prédit que jamais les feux de l’enfer ne s’amortiraient, et que leurs souffrances seraient toujours égales. Conséquemment les démons, qui étaient intelligents et qui avaient sans doute la mémoire en partage, n’ayant pu oublier cette malédiction, ne pouvaient proférer sans impiété réelle les paroles mentionnées plus haut.
Après Bélial, Mammon prend la parole: il propose, en termes magnifiques, d’égaler l’enfer aux cieux. Il opine à la paix, et tous d’une voix unanime adoptent son avis. Le poëte, après un beau portrait de Belzébuth, lui fait prononcer un assez long discours, qui tend à faire attaquer, par force ou par adresse, le monde des humains. Son conseil est approuvé et reçu avec enthousiasme; et les applaudissemens rendant Belzébuth plus orgueilleux, il reprend la parole sur un ton plus fier et plus élevé; il discute sur le choix de celui qui sera chargé d’aller à la recherche du monde terrestre. Satan parle, et prend sur lui d’aller chercher le globe sur lequel il fonde ses projets de vengeance. Son discours fini, il rompt la séance. Par son ordre, l’arrêt est publié au son de trompe, et l’armée y répond par de grands cris. Dans le cours du récit, on nous parle de combattans qu’on voit s’entre-choquer dans le firmament, présage de guerre; ce qui nous fait croire que Milton, en cette occasion comme en plusieurs autres, ressent l’effet des préjugés superstitieux des tems où il a vécu.
Nous voyons de plus que les démons, sans s’amuser à souffrir les tourmens imposés par l’Être suprême, prennent des divertissemens; les uns font des concerts en orchestre, mariant leurs voix aux sons des instrumens; d’autres n’étant point sensibles à l’harmonie musicale, se distraient en faisant usage de la dialectique: on en voit d’autres qui, préférant la promenade aux autres amusemens, font des voyages de plaisir le long du Styx, du Cocyte, du Phlégéton, du Léthé, de l’Achéron; et s’ils n’y naviguent pas, c’est probablement parce qu’ils n’avaient point de canots, et n’en savaient point faire; par la raison que Milton ne connaissait pas un canot sauvage du Canada. Mais nous ne voyons pas dans la théologie qu’il y ait jamais eu des fleuves en enfer, et Dieu n’en avait certainement pas créés pour raffraichir les démons.
Satan se trouve dans le même cas que Jupiter, en ce que sa tête enfante un ange féminin. Vient ensuite un conte immoral d’une hardiesse inconcevable, et qui dégoute également le métaphysicien, le théologien et le philosophe. Nous nous abstiendrons de le rapporter, comme en étant doublement indigne, par son indécence et par son défaut de justesse. En un mot, à l’exception de la beauté des vers, ce passage est indigne de son auteur.
Satan répond à sa fille la Mort, et l’instruit de ses vues, ainsi que la Révolte. Il les engage toutes deux à lui donner une issue, afin de pouvoir continuer son voyage. Il y réussit, et ayant surmonté ces obstacles, il poursuit sa marche. Ayant accompli son trajet, il arrive à la demeure du Chaos, qui se présente à lui aussitôt. Le roi infernal lui adresse quelques mots, afin de l’engager dans ses intérêts: le Chaos, quoiqu’embarrassé, lui répond d’une manière qui comble ses désirs, et lui enseigne où est le globe terrestre. Satan, dans son empressement, ne lui réplique rien, et vole au lieu indiqué. Après beaucoup de difficultés, il entrevoit la terre.
Nous ne saurions poursuivre sans nous arrêter un moment, pour contempler et admirer la sublimité des pensées de Milton, et la beauté qu’il mêle aux récits les plus futiles. Il y met une importance que lui seul peut ajouter, et sans laquelle une grande partie de son poëme serait vide de sens. C’est là surtout que l’on voit sa grande supériorité sur tant d’autres, qui ont voulu briller dans le genre où il a excellé.
Milton, avant de reprendre son récit, fait une digression touchante sur son aveuglement. Il y met une sensibilité qui charme, et qui fait sentir la grandeur de son infortune. Nous en citerons quelques vers:
But cloud instead, and ever during dark
Surrounds me, from the cheerful ways of men
Cut off, and for the book of knowledge fair
Presented with a universal blank
Of nature’s work, to me expung’d and rais’d,
And wisdom at one entrance quite shut out.
Le poëte décrit avec grandeur les chœurs célestes, l’espace entre l’abîme et l’enfer, et Satan qui arrive aux extrémités du monde. L’Eternel s’adresse à son fils, lui représente l’excès de la rage dont est dévoré Satan, ses tentatives futures pour effectuer la chûte de l’homme, qui sera la victime de ses trompeuses amorces. Il lui rappelle ensuite ses motifs en créant l’homme; la liberté qu’il lui a accordée, et qui seule sera cause d’une faute qu’il pourrait éviter.
Le Fils fait une réponse égale en beauté au discours de son père. Le Père reprend la parole; son discours excite un vif intérêt, et fait naître une inquiétude sur celui qui devra mourir pour opérer la rédemption de l’homme. Mais le discours que fait ensuite le Fils porte dans l’âme une douce consolation, dissipe nos appréhensions sur notre sort futur, et nous remplit de joie et d’espérance. Il parle d’avance de ce qu’il fera à son avènement dans le monde; il s’offre au trépas pour racheter les hommes, prédit la victoire qu’il remportera sur Satan, son entrée triomphante dans les cieux, ainsi que le pardon céleste accordé par le Très-Haut. Son discours est mystérieux; il pique la curiosité des anges, qui désireraient le comprendre. Le Père accepte ses offres, dans la réponse qui commence ainsi:
O Thou in heaven and earth the only peace
Found out for mankind under wrath, o thou
My soul complacent.........................
Après, lui avoir exprimé la douleur que lui causera son absence, il lui explique le but de sa mission, son incarnation, la naissance d’une femme qui, sans cesser d’être vierge, enfantera le rédempteur des humains; la mort qu’il souffrira, le pardon qu’elle méritera aux hommes; son réinstallement dans sa gloire première. Il lui décrit, en termes magnifiques, le jugement dernier, l’éclat de sa gloire, la séparation des élus d’avec les réprouvés, le bonheur ineffable et éternel des premiers. Après cette conversation entre l’Eternel et son fils, les anges pénétrés et ravis les adorent et, chantent leur grandeur. C’est là où brille le génie de Milton.
Dans la reprise de sa narration, le poëte nous démontre, rebus ipsis, qu’il connaît l’Hydaspe et le Gange; qu’il croit les Chinois, voyageurs en des sables mouvants, comme les Arabes et les Africains; qu’il suppose une espèce de paradis des fous, où il place Empédocle, Cléombrote, ceux qui cherchent la pierre philosophale, les partisans du luxe. Il ne veut pas donner, en dépit de St. Pierre, entrée aux récollets, aux dominicains dans le paradis, et il dépeint les reliques, les indulgences, les bulles, les dispenses, que le vent arrache à ces pauvres rebutés qui tourbillonnent dans les airs. Il les met dans le paradis des fous. Il nous décrit ensuite une échelle toute éclatante par sa richesse, et qui va du paradis terrestre jusqu’au ciel. Satan, après l’avoir admirée, regarde les planètes, en poursuivant sa marche. Milton nous donne ici à entendre qu’il se connaît en hypothèses; il suppose qu’il pourrait habiter quelque peuple dans les étoiles. Il parle ensuite du soleil en grand poëte; mais il reprend aussitôt la qualité d’astronome, en raisonnant sur la cause du mouvement des astres. Nous sommés gratifiés enfin d’une petite leçon de chimie, mais qui, finissant prématurément, ne met dans l’esprit qu’une très faible idée de cet art
Satan parle à Uriel. Le rang et la qualité de celui-ci sont mentionnés brièvement: Satan lui adresse un discours pour l’engager à lui enseigner lequel des globes qu’il voyait était la terre. Uriel trompé par ces paroles captieuses, lui répond avec cette, franchise qu’inspire un cœur généreux. Il lui fait une courte narration de l’histoire de la création. Il lui montre l’endroit où sont les premiers hommes, qu’il décrit ainsi:
That spot to which I point in paradise,
Adam’s abode, those lofty shades his bower:
Thy way thou canst not miss, me mine requires.
Satan s’incline, part, se rend promptement sur la terre, et en y arrivant, il met le pied sur le mont Niphatès.
(La suite au numéro prochain.)
Compliment d’un Abénaquis.—Le P. Germain était, en 1757, missionnaire chez les Abénaquis, quand, dans le mois de Juillet, il crut devoir accompagner le parti de ces sauvages qui fut en expédition contre le fort George. Arrivé à Carillon, il y trouva le marquis de Montcalm. “Je m’empressai, dit-il, d’aller lui rendre mes devoirs. Les Abénaquis, moins pour se conformer au cérémonial, que pour satisfaire à leurs obligations et leurs devoirs, ne tardèrent pas à se présenter chez leur général. Leur orateur le complimenta brièvement, comme on l’en avait prié.—‘Mon père, lui dit-il, n’appréhende pas, ce ne sont pas des éloges que je viens te donner; je connais ton cœur, il les dédaigne; il te suffit de les mériter. Eh bien! tu me rends service, car je n’étais pas dans un petit embarras de pouvoir te marquer tout ce que je sens. Je me contente donc de t’assurer que voici tes enfans, tous prêts à partager tes périls, bien sûrs qu’ils ne tarderont pas à en partager la gloire.’ ”
Marsolais.—Marsolais était un Canadien d’une bravoure à toute épreuve; mais s’il ne craignait pas le feu, la bouteille, d’un autre côté, ne l’effrayait pas non plus.—Au mois d’Avril 1760, il marcha avec l’armée française destinée à reprendre Québec.—Après l’affaire du 28, où les Anglais furent défaits et contraints de rentrer dans la place, le chevalier de Lévis se détermina à en faire le siège. On ouvrit donc la tranchée devant Québec. Le service était par fois très dangereux, car les assiégés faisaient de leurs batteries un feu terrible et constant sur les travailleurs. De jour, de nuit, Marsolais était toujours prêt, quand son tour de service venait. Il ne s’en tenait point là: quelqu’un voulait-il s’exempter du devoir, quand il en redoutait, surtout de jour, les conséquences; il appellait aussitôt notre milicien:—“Marsolais, veux-tu aller à la tranchée pour moi?—Volontiers.—Qu’exiges-tu?—Deux bouteilles et la bouche pleine.” Jamais il ne demandait autre chose. On lui donnait donc deux bouteilles d’eau de vie, qu’il mettait dans son estomac, et la bouche pleine, (une troisième bouteille,) il l’avalait sur le champ, puis marchait intrépidement à l’ouvrage.
Il y a façon pour tout.—Un nommé Jean Picotte était au lit mourant: c’était un de ces hommes qui, comme on dit au pays, n’ont jamais engendré la mélancolie. Un prêtre l’assistait dans ses derniers momens. Il lui parlait de la justice de Dieu, et lui disait combien il était difficile d’entrer au ciel. “Ah! oui, monsieur,” interrompit le mourant, “je le sais bien; mais si je ne puis y aller seul, je tâcherai d’y entrer par occasion.”
A chacun son arme.—Le Dr. H........ assistait à une vente publique. Le courtier offre enfin une paire de pistolets superbement montés en argent. Chacun veut les voir; on se les passe; ils viennent entre les mains de Mr. D ...d, qui étant auprès du docteur, qu’il savait parfaitement entendre le badinage, se tourne vers lui, et lui dit d’un ton goguenard, en les lui présentant: “Docteur, voici de jolis et d’excellents pistolets; n’en auriez-vous pas besoin?—Oh! ma foi, non,” repartit aussitôt le chirurgien, avec un clin d’œil significatif, “j’ai bien assez de ma lancette.”
Ce que c’est que la politesse.—MM. G...... et S...... jouaient au whist: Mr. G. jeune et gai, mettait peu d’intérêt à la partie, et jouait assez négligeamment: il fait une faute, et il en rit tout le premier. Il en fait une seconde: “Bon dieu! que je suis bête;” dit-il, avec un éclat de rire. On sourit de la saillie, sans rien répondre. Bientôt une troisième faute de la part de Mr. G. accompagnée d’un joyeux—“Mais, bon dieu! que je suis bête!” ... “dites-le donc, Mr. S., dites-le donc.”—“Eh! vraiment, monsieur,” répondit enfin celui-ci, “je suis trop poli pour vous démentir”...... et tous les joueurs quittent la table, en riant aux éclats bien cordialement.
Bibliographie.—Un monsieur américain écrit de Paris, le 26 Septembre 1826, une lettre dont ce qui suit est extrait:
“Je fus aussi voir la librairie de M. Bossange, père. Il y a une étrange contradiction dans tout ce qui concerne le peuple français. Il est rare de trouver une maison propre, encore moins élégante et de bon goût; et néanmoins vous rencontrez souvent des boutiques tenues dans le plus bel ordre. Tel est le cas à l’égard de la librairie de M. Bossange. L’établissement est dans la force du terme élégant. Il a des peintures, des statues, des globes, des sphères, &c. et un salon de lecture; mais ce qui a le plus attiré mon attention, ce sont deux livres que j’ôserai dire uniques.
“L’un est un Pseautier romain: il est du siècle de Louis XIV, et enluminé avec une délicatesse de coloris et une beauté de dessin qu’on ne saurait décrire avec la plume. M. Bossange a fait relier ce livre magnifiquement, et l’a offert en présent au roi, à l’occasion du sacre: il a été refusé, parce qu’il n’a pas voulu y mettre de prix. On dit que ce livre a coûté 2000 piastres.
“L’autre est la Grande Charte, (Magna Charta,) superbement écrite sur papier velin. On le donne pour le livre le plus superbement relié qu’il y ait au monde. Il est renfermé dans une boîte qui a elle-même l’apparence d’un des livres les plus magnifiques qui puissent se voir. Lorsqu’on l’ouvre, on apperçoit le mince volume, embelli par un travail d’une délicatesse, d’une correction et d’une complication qu’il serait impossible de décrire. Ce livre, qui n’a pas plus de trente pages, a couté 3000 piastres. On m’a dit qu’il avait été fait pour un duc anglais, qui ne put pas, ou ne voulut pas le payer; et il est devenu, d’une manière assez singulière, la propriété d’un Français.”—New-York Spectator, du 10 Nov. 1826.
Epitre à Mr. J. S. R. à l’occasion de la rentrée des Bourbons en 1814.
(*) L’ANGLETERRE TRIOMPHANTE ET LA FRANCE HEUREUSE.
Oui, triomphe, Albion! oui, ta terre propice
Des orphelins français fut la tendre nourrice.
Oui, tu sus oublier qu’ils furent tes rivaux:
Tu sus les recevoir comme amis, comme égaux.
Ta gloire est à son comble. Enfin l’heure est venue:
L’orage se disperse et le ciel est sans nue.
On rentre de l’exil; le vaisseau touche au port.
C’est près de son berceau qu’on attendra la mort.
L’orphelin détrompé voit arriver son père:
Le fils qu’on déplorait vient consoler sa mère.
La sensible Philis pend au cou d’un amant
Qu’une trop longue absence a rendu plus constant.
Tout renaît; tout revit. La sombre politique
Quitte l’habit de deuil qui la rendait inique:
Sa voix devient plus douce, et lasse de tromper,
Du bonheur des états elle va s’occuper.
Le tyran disparait: la discorde tremblante
De ses flambeaux usés voit la flamme expirante.
L’autel est relevé; le trône est raffermi.
Louis de ses sujets est le père et l’ami.
Généreuse Albion! le bonheur de la France
N’est dû qu’à tes trésors, n’est dû qu’à ta constance.
Tu parlas à l’Europe, et l’Europe, à ta voix,
S’allia pour venger les peuples et les rois.
Le ciel la seconda, le ciel la rendit libre;
Et l’univers enfin reprend son équilibre.
Puisse, après tant de maux, l’olive de la paix
Succéder aux lauriers, et revivre à jamais!
P. H. C.
Kingston, (H. C.) 1er Juin 1814.

Il a paru dans la Bibliothèque Canadienne, une production dont le style indique, à ne pouvoir guères s’y méprendre, l’auteur de quelques morceaux qui ont paru, assez récemment, dans la Gazette de Québec par autorité, et qui ont, à juste titre, excité des réclamations. C’est la même abondance d’expression, la même légèreté. L’écrivain a du talent et de la facilité. Pourquoi ne s’exerce-t-il pas dans un genre qui lui soit propre, au lieu de s’embarasser dans des discussions dont les sujets lui sont étrangers? La littérature n’offre-t-elle pas un champ assez vaste à son imagination? Ses écarts seraient sans conséquence. Il n’en est pas ainsi de la politique et du gouvernement, dont la science tient à tout ce que l’homme a de cher dans la société, et qui, si l’on donne une fausse direction à ses idées, conduiraient, dans la pratique, aux plus funestes résultats. Quand on veut traiter les questions importantes qui se rapportent à ces objets, il faut au moins avoir des connaissances positives, et ne raisonner que sur des principes exacts; ce qui ne se trouve point dans ce que nous avons vu de l’Esquisse de la Constitution Britannique.
L’auteur, au lieu de s’attacher d’abord au sujet qu’il nous annonce, débute par nous parler de tout autre chose que de l’Angleterre et de sa constitution. Il commence par disserter sur la constitution d’un pays qui n’en avait pas, et il fait l’éloge de cette constitution. Il nous dit, en même temps, que ce pays était assujetti à un gouvernement qui, suivant lui, n’était absolu qu’en apparence, parce qu’il était restreint dans de certaines bornes qu’il laisse chercher au lecteur. On peut supposer que par ces bornes, il entend certaines lois. Mais il n’indique aucune institution, dans ce gouvernement, pour servir de contre-poids à l’exercice de l’autorité, pour la contenir dans des bornes connues et réglées par les lois elles-mêmes. Mais la Loi Salique et les principes de l’hérédité de la souveraineté suivant l’ordre de primogéniture ont été suivis et observés; en voilà assez, suivant lui, pour former une constitution, et faire naître chez lui le sentiment de la plus profonde admiration!
D’un autre côté, notre écrivain, après avoir indiqué rapidement quelques faits de l’Histoire d’Angleterre, ne voit pas, nous dit-il, la moindre apparence d’une base constitutionnelle dans la Grande Charte. C’est au moins un étrange aveu dans un homme qui prétend nous donner une Esquisse de la Constitution Britannique.—Nous reviendrons sur ce sujet, quand il nous aura réellement ébauché son esquisse de cette constitution, dont les traits ne sont pas encore assez marqués, pour qu’on puisse se permettre de s’y arrêter dans ce moment.
Avant de revenir à ses idées sur la constitution, un mot qui pourtant suivant lui, n’est pas encore bien défini, et ne peut présenter en général qu’une idée vague et indéterminée, il est juste de remarquer que pour nous faire connaître apparemment le moyen d’y entendre quelque chose, et pour terme de comparaison, il nous dit que tout le monde, en ouvrant une montre, peut facilement se mettre au fait du méchanisme de son organisation. Nous aurions cru exactement tout le contraire, et que comme il le dit lui-même, en changeant seulement les mots, il faudrait un horloger consommé pour se mettre au fait, au premier coup d’œil, de ce méchanisme et de cette organisation. Un individu qui n’aurait jamais étudié l’horlogerie, pourrait-il, en ouvrant une montre, se mettre au fait de son méchanisme et de son organisation? Ne serait-ce pas avant d’avoir lui-même approfondi par l’étude ses connaissances en fait de constitution et de gouvernement, qu’il a cru pouvoir parler avec exactitude de choses, suivant lui, vagues et indéterminées, qu’il indique lui-même par des mots qui ne peuvent même présenter des idées exactes, et dont le sens n’est pas encore fixé?
Il est flatteur néanmoins de voir cet écrivain, après nous avoir parlé de la force comme d’un droit qui doit tout régler, reconnaître formellement qu’elle n’est qu’un droit de fait et non d’équité; que ce droit ne lie qu’autant que la chaine est assez forte pour résister aux efforts de celui qui la porte; qu’une fois rompue, son effet n’existe plus. Cela veut dire que ce n’est qu’un “pouvoir enfant de la barbarie et né pour elle.”
Si les termes dont l’auteur s’est servi ne sont pas d’une rigoureuse exactitude, la pensée qu’il met au jour est vraie. Le lien de la force n’a d’autre principe que la nécessité du moment. Il n’en subsiste rien, dès l’instant où cette nécessité cesse d’agir. Quand ce lien est le résultat d’un devoir, c’est tout le contraire. La violence peut le briser, ou détruire son action actuelle; mais le lien du devoir, ou si l’on veut, l’obligation morale qu’il comporte, n’en subsiste pas moins: il est toujours le même.
Mais examinons quelques unes de ses doctrines sur les constitutions. Suivant lui, un pays a une constitution quand il a des lois fondamentales. Il en est une dans tous les états despotiques; c’est que la volonté de celui qui gouverne fait tout. Celle-ci est l’essence de cette espèce de gouvernement. Elle se retrouve dans la pratique de tous les gouvernemens asiatiques, si on peut donner ce nom au despotisme. Mais si c’est là une constitution, il faudrait donc dire que ce sont les gouvernemens les plus parfaits de l’univers. Cette opinion n’a pas besoin d’être réfutée.
Dans ces états, il se peut qu’il y ait des lois plus ou moins fixes ou connues. Mais ces lois peuvent n’être que des règles de droit privé, sans fixer l’étendue ou les limites de l’autorité, ou sans assurer aucun moyen de la faire respecter, non plus que de la contenir dans des bornes prescrites. Peut-on dire que ces états aient une constitution, une forme de gouvernement réglée? Jamais peuple n’eut des lois privées plus parfaites et un code de lois plus complet que les Romains sous les derniers empereurs, et après eux, les Grecs du Bas-Empire. Peut-on dire que ces peuples avaient une constitution? Mais s’il était suffisant pour un pays d’avoir des lois fondamentales pour avoir une constitution, il s’ensuivrait que les Turcs auraient, sous ce rapport, l’avantage sur tous les autres peuples. Le Coran est un code immuable et unique dans l’état: il règne sans partage: son empire est constant et invariable, depuis Mahomet. Dira-t-on que les peuples soumis à ce code ont une constitution? Oui, si l’on pouvait donner ce nom à un gouvernement ou le sabre règle tout.
Cependant l’auteur en vient à hazarder, dit-il, une définition du mot de constitution. C’est apparemment une découverte. Il doit s’entendre, dit-il, “de la coordination de tous les élémens organiques qui entrent dans la composition d’un tout; de manière qu’ils tendent tous à un but unique, et que par l’harmonie et la régularité de leurs fonctions respectives, l’existence et la durée soient assurées et consolidées.” On ne s’arrêtera pas à discuter sur l’exactitude ou la clarté de la définition: on se contentera de dire plus simplement, qu’un état a une constitution, quand les lois assurent les droits de ceux qui le composent, et quand les institutions fournissent les moyens de faire respecter les devoirs réciproques qui en sont le résultat entre les gouvernans et les gouvernés. L’auteur de l’essai a pris l’effet pour la cause. Ce sont ces lois et ces institutions qui produisent cette coordination. Si on a pourvu aux moyens d’en assurer l’exécution, si le systême est habilement combiné, il y a coordination; si les lois sont mauvaises, il y a divergence. Enfin, s’il n’y a point de ces lois, si elles sont vicieuses, ou si elles sont violées ou perdues de vue, il y a anarchie ou despotisme. Le gouvernement est sans frein et sans ressort; il n’y a pas de constitution. Examinons ce que nous dit l’auteur sur ce qu’il appelle la constitution ancienne de la France.
Où se trouve cette constitution? Aucun corps de lois que je connaisse, aucun recueil de principes exacts relatif à cet objet ne se rencontre nulle part. J’ai souvent lu des dissertations de l’espèce de celle de l’auteur, dans un assez grand nombre d’ouvrages dont quelques uns étaient amples et se composaient de plusieurs volumes, et j’ai toujours fini par me faire la même demande.—Disons qu’il n’y avait aucune loi qui fixât en France les bornes de l’autorité, ou en réglât l’exercice, ni aucune institution propre à faire respecter les droits réciproques des gouvernant et des gouvernés. Si cette constitution avait existé en effet, il y avait longtemps qu’elle était devenue nulle dans la pratique. Cela est si vrai qu’on était venu à regarder cette maxime, si veut le roi, si veut la loi, comme loi fondamentale dans l’état, et on s’y conformait dans la conduite. Cependant notre auteur s’extasie sur la constitution de la France!
Les lois fondamentales d’un état constitué doivent avoir quelque rapport à l’autorité que celui qui gouverne peut exercer sur les citoyens, à la levée des impôts, à l’emploi des deniers pour subvenir aux besoins de l’état ou à l’administration de la justice. Quelles étaient, en France, les règles ou les institutions relatives à ces objets?
(A Continuer.)

L’usage des leçons publiques, qui remonte à l’antiquité la plus reculée, et que l’on a regardé si longtems comme un ressort essentiel dans l’œuvre de l’instruction et dans la constitution des maisons d’éducation du premier ordre, a rencontré, comme beaucoup d’autres institutions anciennes et modernes, des septiques qui ont révoqué en doute son utilité; qui ont même condamné sa tendance sur l’esprit humain. L’on a dit que les connaissances acquises de cette manière sont le plus souvent très superficielles; que le donneur de leçons n’étant, après tout, qu’un auteur qui n’ose se livrer à l’impression, mérite peu la confiance, puisqu’il peut braver plus impunément l’opinion publique que si son travail était soumis à l’inspection de chacun; qu’à ces leçons, dont la rapidité laisse à peine le temps de la réflexion, l’esprit n’a d’autre alternative que celle de souscrire implicitement aux opinions du professeur, (jurare in verba magistri,) ou de nier sa doctrine dans tous les points; d’où l’on infère que ces leçons sont au moins sans utilité.
Cette opinion, qui n’est pas sans quelque vérité, ne saurait être admise sans modification; et si le défaut de publicité permanente était le seul reproche qu’on pût faire à ce genre de travail, les observations suivantes prouveraient seules que les opinions d’un donneur de leçons publiques sont, tout aussi bien que les écrits d’un auteur, justiciables de l’opinion, et qu’il est aussi facile de citer celles-ci que ceux-là à son tribunal.
Ce n’est plus le même motif qu’autrefois qui élève l’homme savant dans une chaire, pour en faire jaillir, comme d’un foyer commun, les lumières qu’il aurait concentrées. Jadis, point d’imprimeries, peu de livres, point de critiques. De nos jours, au contraire, où toutes ces choses abondent, quelle découverte, quelle pensée neuve, quelle expression même d’invention récente, ne parcourt pas le monde avec une rapidité presque magique. La goutte vous fixe-t-elle dans votre cabinet, qui vous empêche d’entasser sur votre bureau la science et la sagesse de l’univers? Mais malgré ces avantages que nous avons sur les anciens, nous avons su tirer parti des leçons publiques sur un autre principe, celui de la subdivision du travail appliquée aux besoins de l’esprit; application tout aussi évidente qu’elle est précieuse, dans ce siècle de lumières, où l’esprit humain n’étant plus regardé comme un vase d’une capacité connue, dans lequel de nouvelles connaissances ne se logent qu’en chassant les anciennes, atteste que l’intelligence croît avec la science dont on l’enrichit; dans ce siècle de libéralité, qui a vu disparaître, entre mille préjugés barbares, la doctrine absurde de l’infériorité intellectuelle de la plus belle, comme de la plus aimable moitié du genre humain. Car, disons-le à la gloire des temps modernes, si comme dans les beaux jours de la chevalerie, nous faisons des sacrifices moins couteux dans le service de la beauté, nous leur rendons un hommage plus flatteur; et soumis aujourd’hui plus à la séduction de leur esprit, qu’autrefois à l’empire de leurs charmes, nos offrandes leur font exercer cette délicatesse de pensées et cette subtilité de raisonnement qui leur donneraient à juste titre la supériorité sur l’autre sèxe, si d’autres facultés liées à son organisation physique, n’assuraient à l’homme l’ascendant que sa destination lui marque.
Les leçons publiques sont à la fois un moyen d’instruction et une source recréative. Si la lecture est pour plusieurs un travail fatigant, si la conversation est bornée dans son influence, les leçons publiques, sans provoquer l’esprit à de grands efforts, communiquent à des centaines d’individus le travail et les lumières des temps passés et présents. Comme objet d’amusement, elles font diversion à des plaisirs d’un genre moins innocent. En réveillant une noble ambition, elles font naître le goût des sciences, et servent à propager des opinions utiles et honorables, surtout lorsque le professeur possède, comme Mr. Viger, des idées libérales et étendues jointes à un désir de servir son pays qui n’a besoin que d’être plus commun.
Dans le sujet qu’il traite, Mr. Viger s’élève, à chaque instant, à des considérations nobles et importantes. Il appuie judicieusement et avec force sur l’indispensable nécessité de la connaissance de l’histoire pour interpréter surement les lois; vérité frappante dans ce pays, où notre code, composé du Droit de plusieurs peuples, nous force à chercher ailleurs que dans nos mœurs, nos usages, notre localité et nos annales mêmes, les motifs de plusieurs lois, qui n’en sont pas moins pour nous des règles d’action, pour avoir vu le jour sous des circonstances qui nous sont étrangères. L’exemple le plus sensible que Mr. Viger pût trouver pour prouver sa doctrine, est bien choisi dans l’origine du droit féodal en Europe, comparé avec son introduction dans ce pays. Là c’était un droit, dérivant de l’esclavage, embrassant d’un côté tout les droits, tous les privilèges, et laissant à peine, de l’autre, les moyens d’existence; mais ici les fiefs, en aggrandissant leurs possesseurs, n’ont point restreint chez leurs vassaux la jouissance des droits civils. Cependant quelque heureuse que soit l’idée de Mr. Viger, en comparant la concession des fiefs de ce pays à un fidéi-commis, nous ne pouvons dire qu’elle rencontre la nôtre, à moins que l’obligation d’exécuter le fidéi-commis ne se restreigne aux premiers temps de l’établissement de la colonie.
Entr’autres époques que Mr. Viger a fixées dans l’histoire légale du Canada, l’établissement de l’évéché en 1659, d’où peut dater l’introduction du droit canonique qui a force en ce pays; du conseil supérieur en 1663, et la nomination du premier intendant en 1665, attirent notre attention, dans la première séance. Les pouvoirs légitimes et usurpés du conseil supérieur, comme de l’intendant, ont été discutés, sur le texte de l’autorité qui les établit, et aussi sur le droit public de l’état. La conclusion qu’a tirée Mr. Viger de cet examen prouve les abus qu’entraine l’absence de principes fixes et certains en administration, et le danger qui résulte toujours du concours monstrueux des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui se trouvaient alors réunis dans les mêmes mains. Dans la subdivision du droit public, où Mr. Viger introduit le jus inter gentes du chancelier d’Aguesseau, nous ne voyons qu’une nomenclature dont nous n’avons jamais pu concevoir l’utilité. Il nous a toujours semblé que ce jus inter gentes, que les Anglais n’ont jamais distingué du droit des gens, pour l’avoir appellé international law, était une branche distincte et toute indépendante du droit public, qui règle, dans nos idées, les relations entre les gouvernans et les gouvernés. Si l’on a dit “le droit public de l’Europe,” c’est que regardant tous les peuples de cette partie du monde comme une seule famille, l’on a voulu sous ce titre désigner un code de lois qui régissait les nations Européennes d’une manière opposée au droit des autres continens.—L’Europe en ce sens n’est qu’un seul empire dont les différents états ne sont plus que des individus.
Il serait trop long de s’arrêter à tous les détails historiques dont le savant jurisconsulte a fait le rapprochement d’une manière habile, pour soutenir les principes certains et lumineux qui dominent sans cesse dans cette intéressante matière. La misère et la dépopulation d’un pays qui n’a pas de lois; l’espèce d’anarchie qui a suivi la conquête; l’établissement projetté de cours d’équité fondé sur l’ignorance de nos lois municipales; le portrait des individus qui remplirent d’abord les premières places en Canada; l’établissement des tribunaux qui jugèrent après la conquête, (et sur lesquels surtout un de nos concitoyens aussi judicieux qu’infatigable dans ses recherches sur l’histoire du pays, a recueilli des documens curieux, dont il doit faire part au public,) tous ces traits, avec d’autres pour leur servir de pendans, remplissent admirablement le cadre que s’est tracé l’orateur.
L’éloge de la profession d’avocat et de celle de notaire, dans lequel nous concourons beaucoup plus volontiers que dans celui des lois criminelles d’Angleterre, quelque restreint qu’il soit, a provoqué des mouvemens oratoires qui placeraient notre professeur à un degré bien élevé dans des pays où le goût est plus formé qu’il ne peut l’être en Canada.
Nous conseillons à nos compatriotes de ne pas perdre l’occasion d’assister aux leçons sur le droit. Elles n’ont rien de la sécheresse qu’on attribue généralement aux matières légales; elles sont instructives sur une foule de sujets qui sont liés à notre bonheur et à nos intérêts les plus chers; et méritent à Mr. Viger un tribut de reconnaissance qu’il sera difficile à ses auditeurs, et au public en général, d’acquitter.
Montréal, 2 Janvier, 1827.

Par Mme. Vve. du général Durand. 2e édition: en deux vols. in-12, pp. 339. A vendre, à Montréal, chez MM. E. R. Fabre & Cie.
Parmi les mille et un volumes de Mémoires, de Souvenirs, de Portraits, &c. dont, avec un assez grand nombre d’ouvrages d’imagination, se compose presque exclusivement la littérature de ces dernières années, il en est qui se distinguent d’une manière avantageuse, et qui ont attesté le vif intérêt avec lequel ils ont été accueillis, par les éditions multipliées par lesquelles ils ont passé, et les traductions en toutes les langues, qui les ont fait connaître dans l’étranger. Si les Mémoires de Mme. De Genlis, du comte de Ségur, de Goerthe, de Fouché, &c. obtiennent la prééminence parmi les ouvrages de ce genre, les Souvenirs sur Napoléon n’exciteront peut-être pas un intérêt moins puissant, quoiqu’ils s’annoncent avec des prétentions plus modestes, et sous un nom dont l’obscurité dans le monde littéraire n’en peut imposer à personne. Qu’il nous suffise d’être convaincus que l’auteur se trouvait dans une position à ne pouvoir se tromper, sur les détails qu’elle nous met sous les yeux, et que l’ensemble de son ouvrage nous prouve également qu’elle n’avait nul intérêt comme nul motif de tromper ses lecteurs.
Il était, sans doute, bien intéressant de contempler dans son domestique, cet homme extraordinaire, que nous n’avons jusqu’à présent connu qu’au milieu des camps, et dans ses relations politiques avec les souverains et les peuples; et comme l’a dit l’éloquent auteur de la vie de Hoche, “L’observateur ne dédaignera par les détails intimes et secrets. Il est curieux de voir dans la coulisse l’acteur qu’on a vu sur la scène. Il n’est guères possible de démêler l’homme qu’après l’avoir déshabillé, pour ainsi dire, et dépouillé de son manteau.”
Sans nous étendre davantage sur le mérite général des ouvrages de ce genre, dont la cour de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI ont abondé, nous allons donner à nos lecteurs les extraits qui nous ont paru les plus intéressants dans ces petits volumes, dont le style est vif, clair et dénué d’affectation, quoique souvent rempli d’élégance. L’auteur débute ainsi:
“On était à la fin de 1809: Napoléon venait de cueillir de nouveaux lauriers; rien ne manquait à sa gloire; mais un héritier manquait à son ambition. Il ne pouvait plus en espérer de son union avec Joséphine, et la mort venait de moissonner le fils ainé de son frère Louis. On regardait généralement cet enfant comme devant être le successeur de son oncle; on allait même jusqu’à dire qu’il était son fils, et que l’empereur n’avait donné Hortense Beauharnais en mariage à Louis, que pour cacher le résultat de ses liaisons avec elle. A l’appui de ce qui ne pouvait être qu’une conjecture, on disait que Louis n’avait jamais pu souffrir sa femme; et c’est ainsi que la vérité sert quelquefois à propager le mensonge. Il est certain que Napoléon n’eut jamais d’intimité avec Hortense Beauharnais, qu’il aimait comme Eugene, parce qu’ils étaient les enfans de son épouse. Dans les divers mariages qu’il décida, soit dans sa famille, soit même parmi les personnes de sa cour, jamais il n’écouta l’inclination: il n’écoutait que les convenances.”
Ce passage, qui réfute d’abord une calomnie atroce, confirme l’opinion qu’on s’est déjà formée depuis longtems des motifs qui influèrent sur l’Empereur des Français, dans les alliances auxquelles il força plusieurs membres de sa famille. L’auteur cite Jérome et Mdlle. Patterson. Ce qui démontre pourtant que, les desseins de sa politique remplis, Napoléon n’était pas dénué des affections ordinaires de l’humanité, c’est qu’il est bien connu aux Etats-Unis, que le fils de Jérome et de Mdlle. Patterson reçut des bienfaits et des présens sans nombre de son oncle, qui envoya même d’Europe un célèbre professeur pour soigner son éducation.
Dans les détails sur son divorce avec Joséphine, celle-ci paraît en avoir été prévenue quelque temps avant que Napoléon lui-même lui en annonçât la nouvelle, ce qui eut lieu dans un rendez-vous qu’il lui donna à Fontainebleau, où l’impératrice s’étant fait attendre, Napoléon lui en fit des reproches, dont Joséphine étant blessée, “laissa échapper quelques paroles un peu dures. On se dit des choses que rien ne répare, et que rien ne fait oublier.—Le mot de divorce fut prononcé......... et fut peut-être l’origine de sa chûte, par l’essor immense que son second mariage donna à son ambition.”
Vient ensuite la négociation pour unir Bonaparte à une princesse de Russie, qui manqua par l’opposition de l’impératrice douairière. On ne pouvait conjecturer quelle princesse était destinée à porter la couronne de France, “quand on apprit que Napoléon avait obtenu celle à qui personne n’avait songé, une princesse de la maison d’Autriche, une petite-nièce de Marie-Antoinette,” dont Mme. Durand fait ainsi le portrait:
“Marie-Louise avait alors dix-huit ans et demi, une taille majestueuse, une démarche noble, beaucoup de fraicheur et d’éclat, des cheveux blonds qui n’avaient rien de fade, des yeux bleus mais animés, une main et un pied qui auraient pu servir de modèles; un peu trop d’embonpoint peut-être, défaut qu’elle ne conserva pas longtems en France.......... Calme, réfléchie, bonne et sensible, quoique peu démonstrative, elle avait tous les talens agréables, aimait à s’occuper, et ne connaissait pas l’ennui...... Pour mettre le comble au bonheur de Napoléon, le destin voulut que cette jeune princesse, qui aurait pu ne voir en lui que le persécuteur de sa famille, l’homme qui l’avait obligée deux fois à fuir de Vienne, se trouvât flattée de captiver celui que la renommée proclamait comme le héros de l’Europe, et éprouvât bientôt pour lui le plus tendre attachement.”
La pensée suivante n’est pas originale, mais elle est forte et touchante.
“Toutes se représentaient le chagrin que devait éprouver Marie-Louise, en venant s’asseoir sur un trône arrosé du sang de sa grande-tante.”
Un mot sur Madame Murat:
“M. de Talleyrand disait qu’elle avait la tête de Cromwell sur le corps d’une jolie femme.”
Elle ambitionnait de prendre de l’ascendant sur Marie-Louise; mais elle se trompa sur son caractère. “Elle prit sa timidité pour de la faiblesse, son embarras pour de la gaucherie; elle crut n’avoir qu’à commander, et elle se ferma pour toujours le cœur de celle qu’elle prétendait dominer.”
Le portrait que notre auteur nous a fait de la jeune épouse de Napoléon, nous porte à excuser la vanité dont on accuse celui-ci, quoique la vanité soit toujours un sentiment puéril dans un grand prince. “De son côté, Napoléon brulait du désir de voir sa jeune épouse: sa vanité était plus flattée de ce mariage, qu’elle ne l’aurait été de la conquête d’un empire.”
Nous sommes plus indulgents, quand nous voyons l’amour prendre la place de la vanité. Nous lisons dans la première entrevue des époux:
“Il y eut un moment d’examen et de silence: l’impératrice le rompit la première, d’une manière flatteuse pour l’empereur, en disant: ‘Sire, votre portrait n’est pas flatté.’ Il l’était pourtant; mais déjà l’amour exerçait sa douce influence, et elle voyait l’empereur avec des yeux prévenus. Napoléon la trouva charmante.”
Après avoir parlé de l’assiduité de Napoléon auprès de l’impératrice, pendant les trois premiers mois de son mariage, et de son peu d’attention aux affaires durant cet intervalle, on nous dit qu’il était “gai et familier dans son intérieur; qu’il aimait à tirer les oreilles et pincer les joues: ce qui lui arrivait très souvent envers Duroc, Berthier, Savary, &c. même envers l’impératrice. Si elle se fâchait, il la prenait dans ses bras, l’embrassait, l’appellait grosse bête, et la paix était faite.”
Pour prouver qu’il était bon et aimable pour ceux qui l’entourraient, Mme. Durand cite, entre mille exemples, une petite supercherie que pratiqua Berthier, qui aimait mieux faire la chasse seul dans sa terre de Grosbois qu’avec l’empereur, pour se dispenser d’accompagner Napoléon, et dont celui-ci ne se fâcha pas, après l’avoir découverte. p. 49. D’autres traits, qui viennent à la suite de celui-ci, rendent témoignage à sa bienfaisance. pp. 50, 51, 52, 53.
Nous passerons sous silence les détails de la minutie que mettait Napoléon dans l’étiquette, de sa cour, et des précautions qu’il prenait, “quoiqu’il ne fût pas jaloux, pour placer la souveraine d’un grand empire hors de l’atteinte du soupçon.” Ceux qui en seront curieux les trouveront de la page 53 à la page 64.—Dans les mœurs de notre pays, ces soins excessifs nous parraissent beaucoup plus outrés et plus souverainement ridicules que la surveillance d’un sérail asiatique.
Il est curieux de voir figurer ensemble une dame de l’ancienne cour avec une de la nouvelle. C’est le parallèle de la dame d’honneur et de la dame d’atour de l’impératrice.
“Madame de Montebello (veuve du maréchal Lannes, duc de Montebello,) était sortie de la classe bourgeoise. Madame Guéheneue, sa mère, femme estimable d’ailleurs, avait présidé à l’éducation de sa fille, et n’avait pu lui donner que celle qu’elle avait reçue elle-même. Elle parut à la cour comme épouse du général Lannes. Elle avait une figure de vierge et un grand air de douceur. Elle plut généralement, quoiqu’elle eût dans le caractère beaucoup de froideur et de sécheresse. On la vit très peu à la cour dans le commencement de son mariage....... Elle avait toujours joui de la meilleure réputation....... Mme. de Montebello habituée à son intérieur, aimant ses aises, détestant toute espèce de gêne, naturellement indolente et sans activité, ne pouvait se plaire dans des fonctions qui la mettaient hors de ses habitudes....... Elle ne savait pas, ou ne voulait pas, adoucir un refus. Les siens étaient courts et secs. Obtenait-elle une faveur, ou était-elle chargée d’annoncer une grâce obtenue, c’était avec le même ton, et comme une chose qui lui était parfaitement étrangère.
“Madame de Luçay est douce, bien élevée, d’une conduite parfaite, incapable de nuire même à son ennemie, (si elle pouvait en avoir,) n’ayant de force et de courage que pour défendre les absents, et nullement pour se défendre elle-même; possédant enfin toute la tenue et l’usage nécessaires pour vivre à la cour, où elle était depuis bien des années.”
Or ces dames ne s’étaient jamais aimées, la première ayant rendu de très mauvais services à l’autre. Mais Napoléon ayant bientôt repris ses anciennes habitudes, l’impératrice éprouva le besoin d’une amie, et Mme. de Montebello “écouta avec complaisance les épanchemens du cœur de sa souveraine.”
Murat était remarquable par un grand courage. Rien ne s’allie mieux à la bravoure véritable qu’un cœur généreux.
“Murat ayant été nommé prince, se rendit dans le département de l’Aveyron, où il était né, et où était encore toute sa famille. Il en réunit tous les membres, riches ou pauvres, dans un diner qu’il leur donna. Il se fit rendre compte de la situation de chacun; plusieurs étaient très misérables; mais le nouveau prince eut le bon esprit de ne rougir de personne. Tous, jusqu’aux plus petits cousins, trouvèrent dans ses bienfaits une existence douce et heureuse.”
(La fin au prochain numéro.)
Trois raisons nous engagent à mettre sous les yeux de nos lecteurs la pièce suivante, publiée dans le Courier de Québec, il y a une vingtaine d’années: la première, c’est qu’elle est canadienne; la seconde, qu’elle nous a semblé bien faite; la troisième, qu’elle nous a paru convenir à la saison où nous sommes.
AU COURIER DE QUÉBEC.
Aimable fils de la gaîté,
Et de Thalie enfant gâté,
J’ai deux mots à te dire;
Chez toi seul, j’en disais merci,
J’avais rencontré jusqu’ici
Le petit mot pour rire.
Lorsque dans d’aimables chansons
Tu donnes d’utiles leçons,
Je t’aime et je t’admire!
On peut se permettre à propos
Sur les méchants et sur les sots,
Le petit mot pour rire.
Sois toujours gai, toujours badin,
Et par fois même un peu malin,
Mais jamais de satire;
Elle a l’air sombre et sérieux;
Sais-tu ce qui te sied le mieux?
Le petit mot pour rire.
Toi dont l’esprit national
Fait le mérite principal,
Est-ce à toi d’en médire?
Le despotisme qui te hait,
Bientôt, mon cher, t’interdirait,
Le petit mot pour rire.
Pourquoi donc, au sacré vallon
Du tendre et paisible Apollon
Ensanglanter la lyre?
Dans une arène de combats,
Les muses ne trouveront pas
Le petit mot pour rire.
De deux partis trop en fureur
Ah! plutôt tempère l’aigreur,
En blâmant leur délire:
Au nom de l’ordre et dans son sein
Ramène le bon canadien
Au petit mot pour rire.
———————
BOUTS-RIME’S,
Remplis par un Poëte gelé.
Logé moins chaudement que l’abeille en sa ruche,
Je passe mon hiver toujours sombre et sournois,
Sans ôser au-dehors produire mon minois,
N’ayant plus au-dedans ni falourde ni buche.
La glace, avant-hier, fit éclater ma cruche;
Pour en avoir une autre il faut six sols tournois.
Six sols! c’est un objet. Sous mon pauvre harnois,
J’ai du pain; mais encore il gèle dans ma huche.
Le grand froid m’a rendu paresseux comme un chien,
Dans un lit sans rideaux je dors ou ne fais rien;
Je serais moins brisé, si je courais la poste.
Je n’avais qu’un chassis, le vent me l’a crevé.
L’air me perce, et tu veux qu’à tes vers je riposte?
Attends, cruel ami, jusqu’au dégel. Ave.
———————
ROMANCE.
Air: Je suis isolé sur la terre.
N’étouffons pas ce sentiment
Qui l’un vers l’autre nous attire:
Sympathie, ô charme puissant.
Tu nous soumets à ton empire.
Profitons des instans heureux
Qu’un sort bienfaisant nous amène:
La raison ne blâme nos feux
Que s’ils préparent notre peine.
Soyons sages, soyons discrets;
Que d’amour le tendre langage
Par les yeux dise ses secrets;
De nos cœurs voyons y l’image.
Qu’ainsi de notre amour constant
La flamme toujours s’alimente:
Qu’y pourrait le regard gênant
De plus d’une Argus impuissante?
D. D.

Restes fossiles.—Nous avons parlé, il y a quelque temps, d’os fossiles d’animaux de grandes dimensions, qu’on a découverts dans une formation de roche calcaire, près de cette ville, en tirant de la pierre pour les ouvrages du canal de Pensylvanie. Mardi dernier, on a trouvé des os d’autres animaux, à environ vingt pieds des premiers. Les os qu’on a trouvés d’abord avaient appartenu à un animal herbivore en apparence, et étaient entièrement pétrifiés. Ceux qu’on vient de trouver appartenaient évidemment à des animaux de la classe des carnivores. Ils ne sont point pétrifiés, et lorsqu’ils sont exposés a l’air, ils deviennent si fragiles qu’une des défenses, ou longues dents, fut brisée facilement par l’application du pouce et de l’index.
Dans la formation de pierre à chaux dont on vient de parler, il doit y avoir eu, autrefois, une caverne assez étendue pour servir de retraite aux bêtes carnacières dont on y a trouvé les os; et c’est une conjecture probable que les animaux plus grands, qui se nourrissaient d’herbe, ont été la proie des autres, et trainés par eux dans cette caverne, qui était leur repaire. Les grands os peuvent avoir appartenu à une espèce de buffle, et les petits à une espèce de panthère; lesquelles espèces sont probablement toutes deux éteintes. Les os du buffle, ou de l’animal dévoré, étaient à vingt pieds plus loin de l’entrée de la caverne que ceux des autres animaux.
Nos études ne nous mettent pas en état de faire des conjectures sur l’espace de temps qui doit s’être écoulé depuis que les animaux auxquels ces os appartenaient ont cessé d’exister. Le sol autour de la pierre calcaire est alluvial. De grandes stalactites pendent du roc qui servait de toît à la caverne, et le fond était couvert d’un sable noir et pur. Il s’est sans doute écoulé bien des siècles, depuis que cette caverne s’est fermée sur ses habitans; mais si ce fut en conséquence de l’irruption subite des eaux, par les montagnes à quelques milles au-dessus de cet endroit, ou de quelque convulsion de la nature, c’est sur quoi nous ne prendrons pas sur nous d’offrir même une conjecture.—Journal d’Harrisburg (Pen.) du 6 Nov. 1826.
Exemple extraordinaire d’affection naturelle et de férocité dans un chat.—Les faits suivants sont bien avérés. Il y avait, dans une famille de la Basse-ville de Québec, une chatte qui avait des petits d’environ deux mois. Un jour, la maîtresse de la maison ayant ouvert un buffet où il y avait des provisions, prit un des petits chats dans la porte, en la refermant. Le petit animal jetta un cri fort et perçant. La femme l’ayant mis en liberté, sans qu’il eût eu beaucoup de mal en apparence, s’éloigna du buffet. Aussitôt, la mère du petit chat entre, va à lui, puis se précipite avec fureur sur la maîtresse de la maison, lui mord et lui graffigne les jambes, les cuisses et les bras, et lui saute au cou, où elle s’attache. La femme se couvre les yeux avec la main, et baisse la tête pour se garantir la gorge. Ses cris alarmèrent son mari, qui vint à son secours. La chatte lâcha prise alors, reçut un coup de pied, passa par dessous le poële de l’autre côté, où elle fut suivie par l’homme; puis repassa du côté ou était la femme, pour se jetter de nouveau sur elle; mais étant poursuivie, elle sortit par la porte, qui fut fermée aussitôt. Elle se mit alors à grimper sur la porte, en poussant des cris effrayants. La famille alarmée appella au secours, et finalement la chatte fut tuée en voulant entrer par la porte, qu’on avait entr’ouverte à dessein. La femme avait eu beaucoup de mal; mais ses blessures sont presque guéries. La chatte avait souvent donné des marques d’audace et de férocité, lorsqu’elle était irritée, mais jamais, jusqu’alors, de manière à jetter l’effroi dans la famille.—Gaz. de Québec, (du 21 Dec. 1826.)
Longévité.—Louis Gauthier, habitant respectable de Berthier-Belle-chasse, (district de Québec,) est mort subitement, le 17 Décembre, à l’âge avancé de 100 ans, 4 mois et 12 jours.—Ibid.
Education.—Les habitans du comté de Cornwallis se sont assemblés en grand nombre, à Kamouraska, le 23 Décembre dernier, pour délibérer sur l’établissement d’un collège dans le comté. L’assemblée a paru unanime en faveur de la mesure, et il doit être ouvert une souscription pour mettre à effet un dessein aussi louable. Le Dr. Blanchet, de Québec, était présent à l’assemblée, et s’est montré favorable au projet. Ce monsieur s’est donné beaucoup de peines, depuis quelques années, pour l’avancement de l’éducation.—Mercury.
Mis-spelled words and printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Inconsistency in hyphenation has been retained.
Inconsistency in accents has been corrected or standardised.
When nested quoting was encountered, nested double quotes were changed to single quotes.
[The end of La Bibliothèque Canadienne, Tome IV, Numero 2, Janvier, 1827. edited by Michel Bibaud]