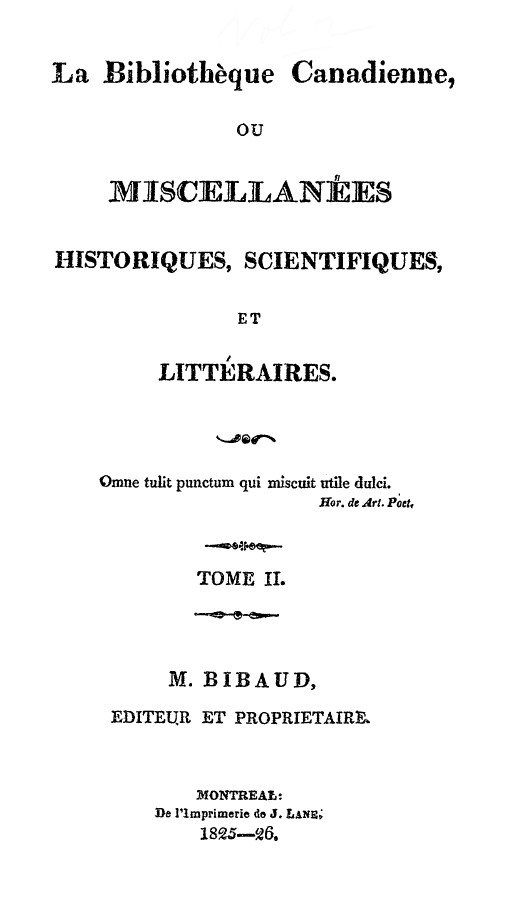
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: La Bibliothèque Canadienne, Tome II, Numero 5, Avril, 1826.
Date of first publication: 1826
Author: Michel Bibaud (editor)
Date first posted: Apr. 13, 2020
Date last updated: Apr. 13, 2020
Faded Page eBook #20200423
This eBook was produced by: Marcia Brooks, David T. Jones, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
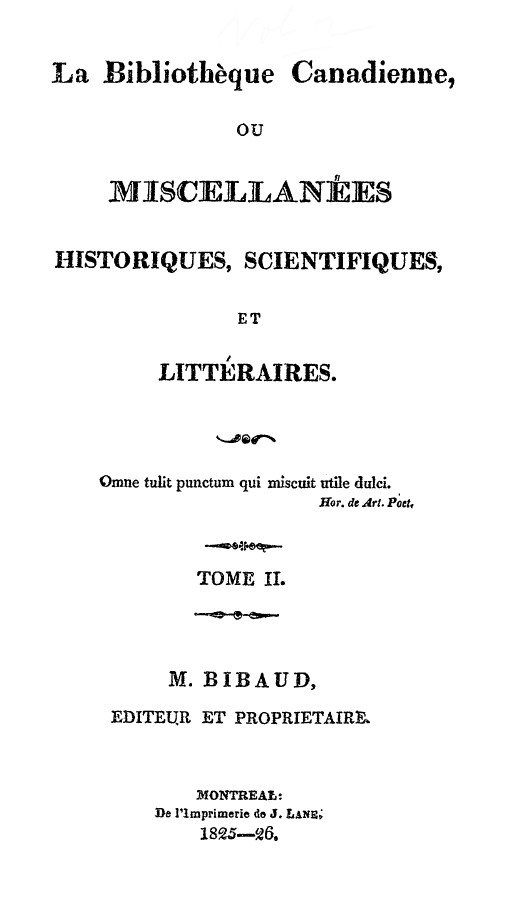
La Bibliothèque Canadienne
| Tome II. | AVRIL, 1826. | Numero 5. |
La fondation des Ursulines souffrit plus de difficultés: l’affaire avait déjà été plus d’une fois à la veille d’être consommée, et avait toujours échoué au moment qu’on se croyait assuré du succès. La Compagnie du Canada ne s’en était pas mêlée, apparemment parce qu’elle ne la croyait pas d’une nécessité aussi pressante. Enfin une jeune veuve de condition nommée Madame de La Peltrie, fut la personne dont les mesures se trouvèrent plus justes, et dont le courage fut plus constant. Cette illustre fondatrice, après avoir surmonté tous les obstacles qui s’opposaient à son dessein, consacra ses biens et sa personne même à cette œuvre méritoire.
D’Alençon, où elle demeurait, elle se transporta à Paris, pour y régler les affaires de sa fondation; puis à Tours, pour y chercher des religieuses ursulines. Elle en tira la Sœur Marie de l’Incarnation, que le P. Charlevoix appelle la Thérese de la France, et la Sœur Marie de St. Joseph, dont le même historien fait aussi le plus grand éloge. De là elle se rendit à Dieppe où elle avait donné ordre qu’on lui frétât un navire. Elle y acquit une troisième Ursuline, et le 4 Mai 1639, elle s’embarqua avec les religieuses hospitalières, et le P. Barthélemy Vimond, qui allait succéder au P. Lejeune dans l’emploi de supérieur général des missions, et qui conduisait avec lui une nombreuse recrue de missionnaires. Le vaisseau n’arriva à Québec que le 1er Août, ayant eu une longue et périlleuse navigation.
On n’omit rien pour faire comprendre aux sauvages combien il fallait qu’on eût à cœur leurs intérêts et le salut de leurs âmes, puisque des femmes mêmes, et de jeunes filles, élevées dans l’abondance et la délicatesse, quittaient une vie douce et tranquille, et affrontaient les périls de la mer, pour venir instruire leurs enfans, et prendre soin de leurs malades. Le jour de l’arrivée de tant de personnes si désirées fut pour toute la ville un jour de fête; tous les travaux cessèrent, toutes les boutiques furent fermées. Le gouverneur reçut ces héroïnes sur le rivage, à la tête de ses troupes, qui étaient sous les armes, et au bruit du canon. Après les premiers complimens, ils les mena au milieu des acclamations du peuple, à l’église, où le Te Deum fut chanté en actions de grâces. Les religieuses, de leur côté, ainsi que leur généreuse conductrice, voulurent, dans le premier transport de leur joie, baiser cette terre, après laquelle elles avaient soupiré si longtems; qu’elles se promettaient bien d’arroser de leurs sueurs, et qu’elles s’attendaient même peut-être à teindre un jour de leur sang. A la vue des cabanes sauvages où on les mena le lendemain de leur arrivée, elles se trouvèrent saisies d’un nouveau transport de joie: la pauvreté et la malpropreté qui y règnaient, loin de ralentir leur zèle, ne le rendirent que plus ardent, et elles témoignèrent une grande impatience de commencer l’exercice de leurs fonctions.
Madame de la Peltrie poussa son zèle et sa charité jusqu’à se dépouiller du peu qu’elle s’était réservé pour son usage, à se réduire à manquer du nécessaire, et même à cultiver la terre de ses propres mains, pour avoir de quoi soulager et vêtir les néophytes et les enfans pauvres qu’on lui présentait. Ce zèle peut paraître bien excessif, et même peu éclairé, puisqu’on se réservant un revenu même modique, elle se fût trouvée en état de subvenir aux besoins des indigens bien plus efficacement qu’elle ne le pouvait faire par le travail de ses mains, et surtout par la culture de la terre.—Mais l’intention était excellente, et nous ne devons pas lui en avoir moins de reconnaissance, ni en priser moins sa bonne œuvre, dont le fruit s’est perpétué jusqu’à présent au grand avantage du pays.
Après les visites dont on vient de parler, les religieuses des deux instituts se séparèrent pour s’aller renfermer chacune dans leurs cloîtres, les ursulines à Quebec, et les hospitalières à Sylleri, où le nombre des sauvages croissait de jour en jour, et où elles étaient à portée de recevoir les malades de la ville et de la campagne.
Pendant que la colonie recevait ces secours spirituels, la Compagnie des cent associés demeurait dans une inaction incompréhensible. La guerre recommençait plus vivement que jamais entre les Iroquois et les Hurons; ces derniers n’avaient pas encore perdu leur ancienne bravoure; mais leurs ennemis l’emportaient et par le nombre et par l’art, et avaient le plus souvent le dessus. Vers 1640, les Iroquois étant tombés inopinément sur une tribu éloignée, y firent un massacre épouvantable, et contraignirent ceux qui eurent le bonheur d’échapper, à chercher une retraite ailleurs. Ils la trouvèrent chez les Hurons, qui n’eurent pas plutôt appris leur disgrâce, qu’ils envoyèrent audevant d’eux avec des rafraichissemens, et les recueillirent avec une affection qui aurait fait honneur à des peuples chrétiens et civilisés. Quelque tems après, trois cents guerriers hurons et algonquins s’étant mis en campagne, une petite troupe d’aventuriers prit les devants et rencontra un parti de cent Iroquois: ceux-ci chargèrent cette troupe; mais malgré l’inégalité du nombre, ils ne purent lui prendre qu’un seul homme. Contents néanmoins de ce petit succès, et craignant, s’ils allaient plus loin, d’avoir affaire à trop forte partie, ils songeaient à se retirer, quand leur prisonnier s’avisa de leur dire que la troupe dont lui et ses camarades avaient été détachés était beaucoup plus faible qu’eux. Sur sa parole, ils se déterminèrent à attendre l’ennemi dans un lieu où ce même captif les assura qu’il devait passer: la seule précaution qu’ils prirent fut d’y faire une espèce de retranchement, pour se garantir d’une surprise. Les Hurons et les Algonquins parurent bientôt, et les Iroquois au désespoir de s’être laissé duper, s’en vengèrent d’une manière terrible sur celui qui les avait engagés dans ce mauvais pas. La plupart furent ensuite d’avis qu’il fallait tâcher de se sauver; mais un brave, élevant la voix, s’écria: “Mes frères, si nous avons envie de commettre une telle lâcheté, attendons du moins que le soleil soit sous l’horison, afin qu’il ne la voie, pas”. Ce peu de mots eut son effet; la résolution fut prise de combattre jusqu’au dernier soupir; et elle fut exécutée avec toute la valeur que peuvent inspirer le dépit et la crainte de se déshonorer, en fuyant devant des ennemis si souvent défaits; mais ils avaient affaire à des gens qui les égalaient en courage, et qui étaient trois contre un.—Le retranchement fut forcé; une vingtaine d’Iroquois demeurèrent sur la place, et les autres furent désarmés et emmenés prisonniers.
Si la Grèce eût été le théâtre d’une action semblable, dit l’auteur des Beautés de l’Histoire du Canada, le prisonnier qui se sacrifie à la gloire de son pays; l’homme éloquent qui arrête, par deux ou trois paroles, ses compagnons prêts à fuir; les braves qui se défendent contre des troupes quatre fois plus fortes, eussent été immortalisés par tous les arts, et consacrés comme des héros demi-dieux.
Cependant les alliés ne profitèrent point de l’avantage qu’ils venaient de remporter, ce qui vint de ce qu’ils n’agirent pas de concert. De leur côté, les Iroquois plus animés que jamais par l’échec qu’ils avaient reçu, se promirent d’en tirer une vengeance éclatante; mais pour ne pas s’attirer en même tems sur les bras trop de forces réunies, ils mirent tout en usage pour faire prendre aux Hurons et autres de l’ombrage des Français. Ils firent partir trois cents des leurs, qu’ils divisèrent en plusieurs troupes, et tous les sauvages qui tombèrent entre leurs mains furent traités avec toute l’inhumanité ordinaire à ces barbares; tandis que quelques Français qui furent pris par eux, aux environs des Trois-Rivières, ne reçurent aucun mal.
Quelque tems après, plusieurs partis d’Iroquois parurent aux environs du même fort; ils y tinrent plusieurs mois en échec toutes les habitations françaises; puis, lorsqu’on s’y attendait le moins, ils offrirent de faire la paix avec les Français, mais à condition que leurs alliés n’y seraient pas compris. Cette proposition fut faite à M. de Champflours, qui avait succédé, depuis peu, au Chevalier Delisle dans le gouvernement des Trois-Rivières, et ce fut un prisonnier, nommé Marguerie, qui lui en porta la parole. Cet homme ajouta que lui-même et les compagnons de sa captivité n’avaient qu’à se louer du traitement qu’ils avaient reçu des Iroquois, mais qu’il ne croyait pourtant pas qu’il y eût trop de sureté à traiter avec eux.
L’avis était sage, mais on n’était point en état de faire la guerre; ainsi on crut devoir entrer en négociation, en se tenant néanmoins sur ses gardes. Le Chevalier de Montmagny, que M. de Champflours avait fait avertir de ce qui se passait, monta jusqu’aux Trois-Rivières, dans une barque bien armée, et envoya de là aux Iroquois, le sieur Nicolet et le P. Ragueneau pour leur redemander les prisonniers français qu’ils retenaient, et savoir leurs dispositions touchant la paix. Ces députés furent bien reçus: on les fit asseoir en qualité de médiateurs, sur un bouclier; on leur amena ensuite les captifs liés, mais légèrement, et aussitôt un chef de guerre fit une harangue fort étudiée, dans laquelle il s’efforça de persuader que sa nation n’avait rien tant à cœur que de vivre en bonne intelligence avec les Français.
Au milieu de son discours, il s’approcha des prisonniers, les délia, et jetta leurs liens pardessus la palissade, en disant: “Que la rivière les emporte si loin qu’il n’en soit plus parlé”. Il présenta en même tems un collier aux deux députés, et les pria de le recevoir comme un gage de la liberté qu’il rendait aux enfans d’Ononthio.[1] Puis prenant deux paquets de castors, il les mit aux pieds des captifs, et ajouta qu’il n’était pas raisonnable de les renvoyer tout nus, et qu’il leur donnait de quoi se faire des robes. Il reprit ensuite son discours, et dit que tous les Cantons iroquois désiraient ardemment une paix durable avec les Français, et qu’il suppliait en leur nom Ononthio de cacher sous ses habits les haches des Algonquins et des Hurons, tandis qu’on négocierait cette paix, assurant que de leur part, il ne serait fait aucune hostilité.
Il parlait encore quand deux canots d’Algonquins ayant paru à la vue de l’endroit où se tenait le conseil, les Iroquois leur donnèrent la chasse. Les Algonquins qui ne voyaient nulle apparence de résister à tant de monde, prirent le parti de se jetter dans l’eau, et de s’enfuir à la nage, abandonnant leurs canots, qui furent pillés sous les yeux du gouverneur-général. Un procédé aussi indigne montra le peu de fond qu’il y avait à faire sur la parole de ces barbares, et la négociation fut rompue sur le champ. Les Iroquois n’ayant plus de voiles pour cacher leur perfidie, levèrent entièrement le masque, et parlèrent avec beaucoup d’insolence. M. de Montmagny voulait en tirer raison, mais ils lui échappèrent au moment qu’il croyait les tenir; et pour surcroît de chagrin, il apprit presque en même tems que quantité de canots hurons qui descendaient à Québec chargés de pelleteries, étaient tombés entre leurs mains.
C’était sans doute une situation bien triste que celle où se trouvait le gouverneur-général de la Nouvelle-France, exposé tous les jours à recevoir de pareils affronts, faute d’avoir assez de troupes pour tenir seulement en équilibre la balance entre deux partis de sauvages, qui tous ensemble n’auraient pas pu tenir contre quatre ou cinq mille Français. Mais la Compagnie des cent associés ne revenait point de son assoupissement, et la colonie française diminuait de jour en jour en nombre et en force, au lieu d’augmenter, comme elle aurait dû faire.
Avant de passer plus loin, disons encore un mot des missions, objet principal alors pour une grande partie des Français qui demeuraient en Canada, ou qui y avaient des relations. Pendant que les PP. de Brébeuf, Jérôme Lallemant, frère du P. Charles Lallemant, dont-il a déjà été parlé, et autres, faisaient tous les efforts possibles pour convertir au christianisme, les Hurons, les Algonquins et les Outaouais, les P. Charles Tursis, Julien Perrault, et Martin Lionnes, travaillaient dans le même but, mais avec encore moins de succès, chez les tribus sauvages des environs du golfe de St. Laurent, désignées alors sous le nom général de Gaspésiens, à cause de la baie de Gaspé, où la plupart des vaisseaux qui fréquentaient ces parages venaient jetter l’ancre.—Ces sauvages étaient les mêmes que ceux de l’Acadie, dont-il a déjà été parlé: ils étaient doux, intelligents et dociles; mais ils changeaient si souvent de demeure, qu’il était comme impossible aux missionnaires de les instruire des dogmes et des préceptes de la religion chrétienne.
Il y avait aussi une mission à Tadoussac, lieu plus fréquenté qu’aucun autre, depuis longtems, par les Montagnais, les Papinachois, comme Charlevoix les appelle, les Bersiamites, ou Betsiamites, et la tribu du Porc-épic. Ils arrivaient quelquefois tous ensemble, et quelquefois les uns après les autres; mais, à l’exception d’un petit nombre, aussitôt la traite finie, ils s’en retournaient chez eux, ou plutôt ils se dispersaient dans les montagnes et les forêts. Plus tard, les jésuites furent audevant de ces sauvages, jusqu’à Chicoutimy, sur le Saguenay, où ils eurent un établissement considérable et en très bon état.
Aux Trois-Rivières, outre les Algonquins qui y étaient d’ordinaire en assez grand nombre, plusieurs tribus des quartiers les plus reculés vers le nord commençaient à se montrer, et prenaient l’habitude d’y passer toute la belle saison. Ces sauvages, et surtout les Attikamègues étaient très dociles, et s’étaient pris d’une grande affection pour les Français, de même que ceux de l’Acadie; mais comme ils s’en retournaient dans leur pays, aux approches de l’hiver, les missionnaires ne parvenaient que difficilement à les instruire assez pour en faire des néophytes.
Nous arrivons enfin à une époque remarquable de l’histoire du Canada, celle de la fondation de la ville, et de l’établissement de l’île de Montréal.
M. de Champlain avait d’abord compris de quelle importance il serait, pour la sureté de la colonie française du Canada, d’occuper et de fortifier l’île de Montréal; et il avait conçu le dessein d’y commencer lui-même un établissement: plusieurs des missionnaires jésuites avaient été du même avis, suivant Charlevoix; mais la Compagnie de la Nouvelle France n’entra point dans leurs vues; et il fallut que ce fussent encore des particuliers qui se chargeassent de l’exécution de ce projet; mais plutôt dans des vues de religion et de piété, que par des motifs d’intérêt ou de politique. Des personnes puissantes, tant ecclésiastiques que laïcs, mais tous animés d’une dévotion et d’un zèle religieux peu communs, même dans ce tems-là, s’associèrent sous le nom de Compagnie de Montréal, “pour le soutien de la religion catholique en Canada, et la conversion des sauvages”. Suivant le plan de cette nouvelle Compagnie, il devait y avoir dans l’île de Montréal, une ville, ou plutôt une bourgade française bien fortifiée et à l’abri de toute insulte; les pauvres devaient y être reçus et mis en état de subsister de leur travail; l’on projettait de faire occuper le reste de l’île par des sauvages, de quelque nation ou tribu que ce fût, pourvu qu’ils fussent chrétiens, ou voulussent le devenir; et l’on était d’autant plus persuadé qu’ils y viendraient en grand nombre, qu’ils pourraient se promettre d’y trouver des secours prompts dans leurs maladies et contre la disette. On proposait même, comme à Sylleri, de les policer avec le tems, et de les accoutumer à ne plus vivre que du travail de leurs mains.
Le nombre de ceux qui entraient dans cette nouvelle association était de trente-cinq:[2] c’était beaucoup trop, dit l’historien, pour qu’elle agît longtems de concert; néanmoins, continue-t-il, elle commença de manière à donner lieu d’en bien augurer.—Dès cette année 1640, en vertu de la concession que le Roi venait de lui faire de l’île, elle en fit prendre possession, à l’issue d’une messe solennelle qui fut célébrée sous une tente. L’année suivante, Paul Chaumeday, ou Chomedey, sieur de Maison-Neuve, y conduisit plusieurs familles de France avec Mademoiselle Manse qui était destinée à prendre soin des personnes de son sexe. Arrivé à Québec à la fin de Septembre 1741, quoiqu’il fût parti de la Rochelle au mois de Juin, M. de Maison-Neuve jugea que la saison était trop avancée pour entreprendre de monter de suite à Montréal, où il n’y avait pas encore d’habitation, et prit le parti de passer l’hiver à Québec avec sa troupe, se contentant d’envoyer quelques défricheurs dans l’île, pour y abattre quelques arbres pendant l’hiver, et y préparer une place de débarquement pour le printems suivant. Ce débarquement se fit le 17 Mai 1642, à l’embouchure de la petite rivière, sur la pointe qui a été nommée depuis Pointe à Callières, du nom d’un des gouverneurs de Montréal, en présence du supérieur général des jésuites et de M. de Montmagny, qui avait bien voulu accompagner M. de Maison-Neuve, quoiqu’il se fût montré d’abord opposé à l’établissement de Montréal, et eût fort sollicité les nouveaux venus de se fixer plutôt dans l’île d’Orléans alors encore toute inculte. Le supérieur des jésuites célébra aussitôt la messe dans une petite chapelle qui y avait été bâtie à cette fin, et on ne négligea rien de ce qui pouvait donner aux sauvages présents une haute idée de la religion chrétienne.
Sur le soir du même jour, M. de Maison-Neuve voulut visiter la montagne qui a donné son nom à l’île, et deux vieux sauvages qui l’y accompagnèrent, l’ayant fait monter jusque sur la cîme, lui dirent qu’ils étaient de la tribu qui avait autrefois habité ce pays: “Nous étions,” ajoutèrent-ils, “en très-grand nombre; toutes les collines que tu vois à l’orient et au midi étaient couvertes de nos cabanes. Les Hurons en ont chassé nos ancêtres, dont une partie s’est réfugiée chez les Abénaquis, une autre chez les Iroquois, et le reste est demeuré avec nos vainqueurs.” Le P. Charlevoix conjecture que cette tribu pouvait être celle qu’il appelle de l’Iroquet, et qui avait été en effet détruite ou dispersée par les Hurons. Quoiqu’il en soit, le gouverneur pria ces sauvages d’avertir leurs frères de se réunir dans leurs anciennes possessions, les assurant qu’ils n’y manqueraient de rien, et qu’ils y seraient en sureté contre quiconque entreprendrait de les inquiéter. Ils promirent de faire tout ce qui dépendrait d’eux pour cela, mais il parait qu’ils ne purent venir à bout de rassembler les débris de leur tribu dispersée.
Il arriva bientôt une nouvelle recrue, avec M. d’Aillebout de Musseau, un des associés, et une troisième, l’année suivante.—L’établissement, qui fut nommé Ville-Marie, prit la forme d’un commencement de ville, et fut entourré d’une enceinte de pieux debout.
(A continuer.)
|
Ononthio, en langue huronne et iroquoise veut dire Grande Montagne, et c’est ainsi qu’on leur avait dit que se nommait M. de Montmagny. Depuis ce tems, ces sauvages, et à leur exemple, tous les autres, ont appellé Ononthio le gouverneur-général du Canada, et ont donné aux Roi le nom de Grand Ononthio. |
|
Peut-être ne sera-t-on pas fâché de voir ici les noms des principaux: c’étaient, parmi les ecclésiastiques, MM. J. J. Ollier, fondateur et premier supérieur du Séminaire de St. Sulpice; A. le Ragois de Bretonvilliers, Gabriel de Quélus, Nicholas Barreau et P. D. Le Prêtre, prêtres du même Séminaire; parmi les laïcs, MM. J. Leroyer de la Dauversière, qui fut le premier moteur et comme l’agent général de la Compagnie, P. Chevrier de Fancamp, Le prêtre de Fleury, M. Royer Duplessis de Liancour, J. Girard de Callières, Bertrand Drouart, H. L. Habert de Montmort, C. Duplessis de Montbart, A. Barillon de Morangis, Jean Galibal, L. Seguier de St. Firmin, Daillibout de Coulonges, Paul Chaumeday de Maison-Neuve; et Madame la Duchesse de Bullion représentée par Mademoiselle Jeanne Manse. |

Il a déjà été fait mention dans la Bibliothèque Canadienne des Chûtes, ou Cataractes, du Saguenay, de Montmorency et de la rivière de St. François: il reste à parler de celles de la Chaudière, qui ne sont pas peut-être les moins curieuses. “J’aurais pu, dit un voyageur, les contempler quatre heures durant avec plaisir, et je ne m’en éloignai qu’avec la plus grande répugnance, dans la pensée que très probablement je ne les verrais plus de ma vie.”
La rivière Chaudière qui traverse la seigneurie (de Lauzon,) et tombe dans le St. Laurent à environ deux lieues audessus de Québec, est d’une grandeur considérable; et quoiqu’elle ne soit navigable ni pour les bateaux ni pour les canots, à raison du grand nombre de rapides, de chûtes et d’autres obstacles, cependant elle ne laisse pas d’être d’une certaine importance, et elle mérite quelques observations. Elle prend sa source dans le lac Mégantic, et coule au nord l’espace de 41 milles, jusqu’à la seigneurie d’Aubert Gallion; de là au nord-ouest, elle serpente à travers les seigneuries de Vaudreuil, de St. Joseph, de Ste. Marie, de St. Etienne, de Joliet et de Lauzon, jusqu’au St. Laurent, l’espace de 61 milles, formant en tout un cours de 102 milles, depuis le lac Mégantic jusqu’à son embouchure. Sa largeur varie de 200 à 300 toises: son courant est souvent divisé par des îles, dont quelques unes contiennent plusieurs acres de terre, et sont couvertes de bois de construction; les bords en sont généralement élevés, pleins de rochers et escarpés, et couverts de bois assez épais, mais d’une espèce assez indifférente. Le lit en est inégal et très resserré par des rochers qui saillent de ses côtés, et qui occasionnent des rapides violents; le courant en descendant sur les différents rochers occasionne des chûtes d’une hauteur considérable; les plus remarquables sont celles appellées de la Chaudière, à environ quatre milles avant que la rivière se décharge dans le St. Laurent. Rétréci par des pointes saillantes, qui s’avancent de chaque côté, le précipice sur lequel les eaux s’élancent n’a guère plus de 65 toises de largeur, et la hauteur d’où elles tombent est d’environ 130 pieds. De grandes masses de rochers qui s’élèvent audessus de la surface du courant, tout a l’entrée de la chûte, partagent les eaux en trois portions, qui forment des cataractes distinctes, qui se réunissent avant d’arriver dans le bassin qui les reçoit audessus. L’action continuelle de l’eau a creusé dans le rocher de profondes excavations qui font prendre une forme arrondie aux corps roulants d’écume blanche et brillante, à mesure qu’ils descendent, et rehaussent beaucoup le superbe effet de la chûte; le rejaillissement de l’eau étant promptement dispersé par le vent, produit à la lumière du soleil une diversité des plus brillantes couleurs prismatiques. La teinte sombre du feuillage des bois qui de chaque côté s’étendent jusqu’au bord de la rivière, forme un contraste frappant avec la blancheur aussi éclatante que la neige du torrent; le mouvement précipité de la rivière qui s’agite parmi les rochers et les creux, à mesure qu’elle s’ouvre un passage vers le St. Laurent, et le bruit continuel occasionné par la cataracte elle-même, forment un ensemble qui fait une forte impression sur les sens, et qui satisfait amplement la curiosité du spectateur étonné. Les bois sur les bords de la rivière, malgré le voisinage de la capitale, sont d’un accès si difficile, qu’il est nécessaire pour les étrangers qui visitent les cataractes, de se pourvoir d’un guide.
Bouchette, Topographie du Canada.
Tandis que je demeurais à Québec, (dit M. Lambert,) j’en pris occasion d’aller voir les chûtes de la Chaudière, qui, selon moi, surpassent de beaucoup celles de Montmorency. Accompagné de Mr. Hawdon, premier garde-magazin au département des sauvages, et du lieutenant Burke de 100e. régiment, je partis de Québec, par une belle matinée, dans le mois d’Août 1807, dans un canot d’écorce conduit par deux sauvages du camp de Micmacs qu’il y avait vis-à-vis de la ville.
Étant arrivés à une baie où la rivière Chaudière se décharge et mêle ses eaux à celles du St. Laurent, nous débarquâmes, tirâmes le canot sur la grève, et montâmes par un sentier assez roide, qui conduisait chez l’homme qui devait être notre guide, à un mille dans le bois. Nous le trouvâmes à la maison, et suivis de nos deux sauvages, qui étaient aussi curieux de voir la chûte, nous enfilâmes un sentier étroit à travers un bois touffu, composé de presque toutes les espèces d’arbres et d’arbrisseaux. La saison était très-favorable à notre excursion; car les moustiques, les maringouins, et tous les autres insectes nuisibles avaient disparu, le froid du matin et du soir leur ayant paralysé les membres, et les ayant chassés dans leurs retraites accoutumées. Les prunes, les framboises, les mûres, et autres fruits sauvages, quoique sur leur déclin, étaient encore en grande abondance, et plus d’un de notre parti fut souvent tenté de s’arrêter pour en cueillir. Heureusement, aucun de nous ne perdit notre guide de vue, autrement les conséquences auraient pu être fatales.
On en a vu, il y a quelques années, un triste exemple; celui d’un capitaine de vaisseau, qui ayant accompagné un parti pour voir les chûtes, s’égara dans le bois, à son retour en ville, et périt. On suppose qu’il était resté derrière pour cueillir des fruits, et qu’il avait perdu de vue le reste de la troupe, qui avait marché devant en suivant le guide. Aussitôt que ceux-ci se furent aperçu de son absence, ils crièrent de toutes leurs forces, mais inutilement; puis retournèrent sur leurs pas à une distance considérable, sans pouvoir ni le voir ni l’entendre. Le lendemain, des partis de sauvages furent envoyés dans toutes les directions, mais ne réussirent pas davantage; et ce ne fut que quelques mois après, que son squelette fut trouvé à un mille ou deux du véritable sentier.

Le 29, nous arrêtâmes pour faire du bois. On m’indiqua un antre qui était à peu de distance de là, environ douze milles audessus du campement du Marais. Un petit vallon sur le bord est y conduit. Des cèdres, des sapins et des cyprès semblent y avoir été placés exprès par la nature, pour que l’accès annonçât la vénérable majesté de ce lieu sacré. L’entrée est spacieuse et percée dans un tuf aussi blanc que la neige. Un ruisseau, dont les eaux sont aussi limpides que l’air, en découle du milieu. On marche commodément pendant cinq ou six toises, et là un pas étroit, mais qui n’est difficile que pour les êtres que rien ne touche, conduit dans une vaste caverne elliptique, où les eaux du ruisseau se précipitant avec bruit d’une cascade, et réfléchissant les rayons des flambeaux qui nous éclairaient, faisait sur l’âme un effet inexprimable. On grimpe au haut d’un petit rocher pour atteindre le niveau du lit de cette Castalie, dont le murmure ravissant entraîne, et encourage à franchir les difficultés qui s’opposent parfois à vos pas, et l’on arrive à ses sources qui jaillissent à l’endroit où l’antre finit. On calcule qu’il peut avoir environ un mille de profondeur.
Les anciens faisaient tous les ans leurs lustrations, pour purifier les villes, les champs, les troupeaux, les maisons, les armées, et les personnes. Les Péruviens en faisaient aussi presque pour le même but. L’Église catholique a ses rogations au moyen desquelles elle demande les mêmes grâces au vrai Dieu; et ces sauvages se rendent toutes les années à cet antre, et y font également leurs lustrations; et, ce qui est plus étonnant, dans la même saison, c’est à dire au printems, et de la même manière que les Catholiques, les Péruviens et les Anciens, c’est à dire par l’eau et le feu. Ils trempent leurs hardes, leurs armes, leurs sacs de médecine, et leurs personnes dans l’eau de ce ruisseau; ensuite ils passent leurs sacs de médecine, leurs armes et leurs hardes à travers un grand feu, qui n’était pas encore éteint lors de ma visite. Cette cérémonie est toujours accompagnée d’une danse autour du feu sacré, formée aussi en chaîne mystique, comme celle de médecine. Il parait que cette lustration est leur purification corporelle.
Cet antre sert aussi à d’autres cérémonies dans le cours de l’année. Les sauvages s’y rendent pour consulter ou le grand Manitou, ou leurs Manitoux particuliers; et leurs chefs, comme Numa Pompilius, y font aussi parler leurs nymphes Egéries, lorsqu’ils désirent persuader à leurs peuples ce dont ils ne voudraient point être persuadés; et ils font tous leurs lustrations avant de consulter l’oracle, comme faisaient les Grecs, avant d’entrer dans l’antre de Trophonius.
Les Scioux appellent cet antre, ou ce nymphée Ouacoune Thiiby, ou la Loge des Manitoux. Ses parois sont toutes couvertes d’hyéroglyphes. Ce sont peut-être leurs ex voto.
Beltrami, Découverte des Sources du Mississippi, &c.

Le Lin et le Chanvre, dit Mr. J. Lambert, sont deux plantes natives du Continent de l’Amérique Septentrionale. Le Pere Hennepin trouva du chanvre crû de lui-même dans le pays des Illinois, et sir Alexander M’Kenzie dans son voyage à l’Océan Pacifique, rencontra du Lin dans l’intérieur où aucun Européen n’avait encore mis le pied. Il y a une autre plante native du Canada et autres parties de l’Amérique du nord, appellée le chanvre sauvage. Il en est parlé de la manière suivante, dans les transactions philosophiques américaines, publiées à Philadelphie:—“Cette plante croît en plusieurs endroits; mais elle se plaît particulièrement dans les sols légers et sabloneux. L’écorce en est si forte que les sauvages s’en servent pour leurs cordes d’arc. Si l’on pouvait trouver une méthode pour en séparer et en adoucir les fibres de manière à la pouvoir filer, on pourrait s’en servir au lieu de lin et de chanvre. Cette plante mérite d’être cultivée pour une autre cause: la cosse qu’elle porte contient une substance qui par sa molesse et son élasticité pourrait tenir la place du plus beau duvet. La culture en est d’autant plus facile que la racine qui pénètre avant dans la terre, brave le froid de l’hiver, et produit de nouvelles tiges tous les printems. Cinq ou six ans après avoir été semée elle est dans sa plus grande perfection.”—On peut donc dire véritablement que le Canada est le pays du chanvre, plus encore que la Russie et la Pologne. Cependant, croira-t-on que quoique nous possédions les deux provinces depuis un demi siècle, nous n’en avions pas encore exporté un tonneau de chanvre en 1808, tandis que nous avons donné à des puissances étrangères, souvent nos ennemis, plus d’un million et demi chaque année pour cet important article.
Les Canadiens ne cultivent le lin que pour leur usage domestique, mais on exporte quelquefois de Québec quelques centaines de minots de graine de lin. On voit le chanvre croître sans culture autour de leurs maisons, où il forme de grandes plantes de sept à huit pieds de hauteur; mais ils ne s’en occupent que par rapport à la graine qu’il leur fournit pour leurs oiseaux, ne l’employant jamais à d’autres usages. Le climat et le sol sont admirablement bien adaptés à la crue du chanvre, autant pour le moins qu’en Russie et en Pologne. C’est une plante très tenace, et qu’on extirpe difficilement là où elle a crû pendant quelque tems. Dans la ville et les environs des Trois-Rivières, quoique le terroir soit sabloneux, et stérile pour tous les autres grains, il croît dans presque tous les jardins, et couvre les rives du fleuve presque jusqu’au bord de l’eau. Cependant on n’en fait pas d’autre usage que celui dont je viens de parler. Ils n’est peut-être pas hors de propos de remarquer qu’en Canada on nourrit tous les oiseaux, de quelque espèce qu’ils soient, avec de la graine de chanvre.
Le chanvre est une des plus précieuses et des plus profitables productions de la terre: elle enrichit le cultivateur, et fournit aux vaisseaux la partie la plus utile et la plus importante de leurs agrêts. La culture du chanvre enrichit l’état en employant des bras qui ne pourraient être occupés à autre chose avec autant d’utilité et de profit. L’avantage qu’un pays retire de la culture et de la manufacture du chanvre dans toutes ses branches, ne peut-être révoqué en doute, et est suffisamment prouvé par l’importance que la Russie a acquise par le commerce de cet article, par lequel elle a en quelque sorte rendu la plus grande marine du monde dépendante de sa volonté et de son caprice.
Tandis que nos relations avec les puissances du nord étaient précaires, et les moyens de nous procurer de quoi équipper notre marine et surtout du chanvre, incertains, ce devait être pour tous un sujet de surprise et de regret de voir que le gouvernement ne fût pas en état de tirer ces articles essentiels de nos colonies. On savait que le Canada en particulier pouvait en fournir en aussi grande quantité et d’une aussi bonne qualité que ceux qu’on tirait de la Baltique, pourvu qu’on regardât la chose comme une affaire nationale. Il était clair qu’il fallait que le gouvernement s’en mêlât; car s’il y avait des individus assez habiles, il n’y en avait pas d’assez riches pour venir à bout d’une entreprise si importante.
Enfin le gouvernement parut convaincu de la nécessité de tirer le chanvre de quelques uns de nos établissemens, et dans l’année 1800, les lords du conseil pour le commerce et les plantations, prirent en considération les moyens par lesquels ils pourraient introduire la culture de cette plante dans les Iles et dans les colonies de l’Amérique du nord. Avant cette époque, on avait fait indirectement en Canada plusieurs tentatives, et dépensé beaucoup d’argent, mais on n’avait offert d’autre encouragement que des primes et des médailles, compensations trop faibles pour influencer un peuple naturellement indolent, et pour surmonter une variété d’obstacles d’une autre sorte. Les deniers publics se dépensèrent chaque année, on envoya de la graine de chanvre en abondance, et les instrumens nécessaires à la manufacture de cette plante; les agens du gouvernement parurent s’employer activement à avancer cette importante entreprise; mais tout fut inutile; au bout de dix-huit ou vingt ans, il n’avait pas été envoyé un quintal de chanvre en Angleterre.
Ce fut à cette époque que la Chambre du Commerce s’efforça de faire réussir la culture du chanvre, et se détermina à ne pas borner ses expériences au Canada seulement; elle en fit faire plusieurs dans les Iles: et pendant deux ou trois ans, ses efforts furent infatigables. Elle ne réussit pas mieux pourtant bien qu’elle eût envoyé de nouvelles machines, et offert de plus grandes récompenses, qu’elle n’avait fait en Canada. Pourquoi la culture du chanvre n’a-t-elle pas réussi dans les Iles, c’est ce dont je n’ai jamais pu m’assurer, mais j’ai entendu dire que le climat était trop chaud, et que le chanvre y venait trop menu pour les gros cordages. Quant au Canada, on trouvait une variété d’obstacles qui empêchaient qu’il ne réussît dans ce pays; et entr’autres, Mr. Vondenvelden de Québec écrivit à la Société d’Agriculture, que si le chanvre n’avait pas réussi en Canada, on devait l’attribuer à l’attachement des Canadiens aux anciens usages; à l’opposition des curés, des marchands de bled, et des seigneurs; les premiers ayant besoin de dîmes, les seconds de succès dans le commerce, et les troisièmes d’abondantes récoltes de bled pour l’emploi de leurs moulins, la principale source de leur revenu; ressources qu’ils pensaient que la culture du chanvre diminuerait beaucoup, si elle ne les détruisait pas entièrement.[1] L’indolence des Canadiens, la paucité des bras, et la faiblesse de la population, étaient aussi énumérées parmi les plus grands obstacles à la culture du chanvre en Canada. Ainsi, après avoir fait des efforts extraordinaires pendant plusieurs années, et dépensé plus de £40,000, nous sommes encore obligés d’avoir recours pour nous procurer cet article essentiel, à une puissance étrangère, qui quelle qu’ait pu être son inclination ou son intérêt réel, a été plusieurs fois obligée de devenir notre ennemie.
Il parait pourtant par plusieurs volumes récents des Transactions de la Société pour l’encouragement des Arts, &c. que la culture du chanvre en Canada, n’était pas une entreprise désespérée, et qu’il ne fallait que des gens capables de la conduire, et un capital pital suffisant pour la mettre à exécution. Dans la préface du volume 21, la Société dit: “qu’elle s’est assurée par des expériences que le Canada peut fournir du chanvre égal en qualité pour les usages de la marine, à celui qu’on tire de la Baltique; et qu’il est à espérer que le gouvernement fera attention à ce point sur lequel la balance est à présent suspendue, et qu’il pourra faire pencher en faveur de l’avantage national s’il veut acheter de nos colonies, à des prix raisonnables et argent comptant, et par le canal d’agents convenables, cet article pour lequel nous donnons actuellement les mêmes sommes à des puissances étrangères.”
|
Si ces Messieurs (avons nous dit ailleurs,) avaient raison d’appréhender cet effet de l’introduction de la culture du chanvre dans ce pays, ils ont bien fait de s’y opposer fortement: leur intérêt particulier était alors étroitement lié à l’intérêt général. La culture du froment est la première et la plus essentielle de toutes les cultures; et dans tout pays où ce grain précieux réussit, on doit en recueillir au moins autant qu’il en faut pour la nourriture des habitans. Que deviendrait le Canada, s’il était obligé de faire venir le bled d’ailleurs? On ne pourrait recommander la culture de chanvre dans ce pays, qu’en supposant qu’elle ne ferait pas un tort considérable à celle des autres grains; ce qui serait le cas, si la plante croissait là où les autres grains ne viennent point, ou ne viennent pas bien. |
Aubépine,—Espérance.—Que tout s’anime d’espérance et de joie: l’hirondelle a paru dans les airs, le rossignol a gémi dans nos bocages, les fleurs de l’aubépine ont annoncé la durée des beaux jours. Pauvres vignerons, rassurez-vous, la froide bise ne viendra plus détruire le tendre bourgeon, espoir de vos longs travaux. Heureux laboureurs, le souffle du rude aquilon ne jaunira point vos plaines verdoyantes; vous les verrez, quand le tems sera venu, se dorer sous les rayons du soleil. Trop heureux, si en cultivant votre héritage, vous en avez marqué les bornes par une haie d’aubépine: de tristes murs ne viendront point vous attrister. La verdure, les fleurs et les fruits vont tour à tour réjouir vos yeux; sans cesse environnés de brillants concerts, vous verrez le pinson, la fauvette, le chardonneret, le rossignol et le tarin embellir votre enclos, au retour de leurs longs voyages: accueillez avec joie ces hôtes charmants; ils viennent pour vous servir, et non pour vous dépouiller. La chenille qui ravage vos arbres, le ver qui pique vos fruits, voila la seule pâture qu’ils destinent à leurs familles. L’hiver, attirés par les snélas (senelles) éclatantes qu’une main trop économe n’aura pas recueillies, vous verrez le merle et la grive, dont les tardives amours auront empêché le départ; ils vous apprendront qu’il ne faut rien craindre des rigueurs du froid; car une saison trop dure les éloigne toujours de nos champs; mais alors même, ils ne sont point abandonnés: l’aimable rouge-gorge, quittant ses bois solitaires, s’approchera peut-être de vos rustiques foyers. Surtout que vos enfans n’attentent point à sa liberté: qu’à la vue de sa confiance et de son malheur, leurs cœurs s’ouvrent à la pitié, que leurs petites mains s’avancent avec précaution pour soulager la misère d’un pauvre oiseau. Hélas! il ne demande que quelques miettes inutiles. Que vos enfans les lui accordent; il ne faut souvent qu’une bonne action pour faire germer la vertu dans de jeunes âmes.
Les Troglodites, qui rappellèrent l’âge d’or sur la terre par des mœurs simples, couvraient en riant les parents que la mort leur avait enlevés de branches d’aubépine; car ils regardaient la mort comme l’aurore d’une vie où on ne se séparerait plus. A Athènes, de jeunes filles portaient aux noces de leurs compagnes des branches d’aubépine; l’autel de l’hyménée était éclairé par des torches faites du bois de cet arbuste, qui, comme on le voit, a toujours été l’emblème de l’espérance. Il nous annonce de beaux jours; ils promettait aux belles Grecques d’heureux mariages, et aux sages Troglodites une vie immortelle.
Myrte—Amour.—Le chêne de tout tems fut consacré à Jupiter, le laurier à Apollon, l’olivier à Minerve, et le myrte à Vénus---- Une verdure perpétuelle, des branches souples, parfumées, chargées de fleurs, et qui semblent destinées à parer le front de l’Amour, ont valu au myrte l’honneur d’être l’arbre de Vénus. A Rome, le premier temple de cette déesse fut environné d’un bosquet de myrte: en Grèce, elle était adorée sous le nom de Myrtie. Quand Vénus parut au sein des ondes, les Heures allèrent audevant d’elle, et lui présentèrent une écharpe de mille couleurs et une guirlande de myrte. Après sa victoire sur Pallas et Junon, elle fut couronnée de myrte par les Amours. Surprise un jour, en sortant du bain, par une troupe de Satyres, elle se réfugia derrière un buisson de myrte: ce fut aussi avec des branches de cet arbre qu’elle se vengea de l’audacieuse Psyché, qui avait osé comparer sa beauté passagère à une beauté immortelle. Depuis lors la guirlande des Amours a quelquefois orné le front du guerrier. Après l’enlèvement des Sabines, les Romains se couronnèrent de myrte en l’honneur de Vénus guerrière, de Vénus victorieuse: cette couronne partagea ensuite les priviléges du laurier, et brilla sur le front des triomphateurs. L’ayeul du second Africain vainquit les Corses, et ne parut plus aux yeux publics sans une couronne de myrte.
Aujourd’hui qu’on ne triomphe plus au Capitole, les dames romaines ont conservé un goût très-vif pour ce joli arbuste; elles préfèrent son odeur à celle des plus précieuses essences, et elles versent dans leurs bains une eau distillée de ses feuilles, persuadées que l’arbre de Vénus est favorable à la beauté. Si les anciens ont eu cette idée, si l’arbre de Vénus était encore pour eux l’arbre des amours, c’est qu’ils avaient observé que le myrte, en s’emparant d’un terrain, en écarte toutes les autres plantes.—Ainsi l’amour, maître d’un cœur, n’y laisse de place pour aucun autre sentiment.
Acanthe—Les Arts.—L’acanthe se plaît dans les pays chauds, le long des grands fleuves.
Le Nil du vert acanthe admire le feuillage.—Cependant il croît facilement dans nos climats; et Pline assure que c’est une herbe de jardin qui sert merveilleusement bien à les vignetter et historier en verdure. Les anciens, si pleins de goût, ornaient leurs meubles, leurs vases et leurs vêtemens précieux de ses feuilles si agréablement découpées. Virgile dit que la robe d’Hélène était bordée d’une guirlande d’acanthe en relief. Ce poëte divin veut-il louer un ouvrage de grand prix, c’est encore d’acanthe qu’il le décore:
Du même Alcimédon je garde un même ouvrage;
L’anse de chaque vase offre à l’œil enchanté,
De la plus souple acanthe un feuillage imité.
Ce charmant modèle des arts est devenu leur emblême, et il pourrait l’être aussi du génie qui fait qu’on y excelle. Si quelque obstacle s’oppose à l’accroissement de l’acanthe, on le voit redoubler ses efforts et végéter avec une nouvelle vigueur. Ainsi, le génie s’élève et s’accroît par les obstacles mêmes qu’il ne saurait vaincre.
On raconte que l’architecte Callimaque, en passant auprès du tombeau d’une jeune fille, morte peu de jours avant un heureux mariage, ému d’une tendre pitié, s’approcha pour y jetter des fleurs. Une offrande avait précédé la sienne. La nourrice de cette jeune fille rassemblant les fleurs et le voile qui devaient servir à la parer le jour de ses noces, les plaça dans un petit panier, et mit le panier auprès du tombeau, sur une plante d’acanthe; puis elle le recouvrit d’une large tuile. Au printems suivant, les feuilles d’acanthe entourrèrent le panier, mais, arrêtées par les bords de la tuile, elles se recourbèrent, et s’arrondirent vers leurs extrémités. Callimaque, surpris de cette décoration champêtre, qui semblait l’ouvrage des Grâces en pleurs, en fit le chapiteau de la colonne corinthienne, charmant ornement que nous admirons et que nous imitons encore.
Chèvre-feuille des jardins—Liens d’amour.—La faiblesse plaît à la force, et souvent elle lui prête ses grâces. J’ai quelquefois vu un jeune chèvre-feuille attacher amoureusement ses tiges souples et délicates au tronc noueux d’un vieux chêne; on eût dit que ce faible arbrisseau voulait, en s’élançant dans les airs, surpasser en hauteur le roi des forêts; mais bientôt, comme si ses efforts eussent été inutiles, on le voyait retomber avec grâce, et environner le front de son ami de doux festons et de guirlandes parfumées. Ainsi l’amour se plaît quelquefois à unir une timide bergère à un superbe guerrier. Malheureuse Desdemona! c’est l’admiration que t’inspirent le courage et la force, c’est aussi le sentiment de ta faiblesse qui attache ton cœur au terrible Othello; mais la jalousie vient te frapper sur le sein même de celui qui devait te protéger. Voluptueuse Cleopatre, tu subjuguas le fier Antoine, et le sort n’épargna ni tes charmes, ni la grandeur de ton soutien. Renversés du même coup, on vous vit tomber et mourir ensemble. Et toi, humble et douce Lavalliere, l’amour du plus grand roi put seul subjuguer ton faible cœur et l’arracher à la vertu. Pauvre liane, le vent de l’inconstance te priva bientôt de ce cher appui, mais tu ne rampas jamais sur la terre; ton noble cœur, élevant ses affections vers le ciel, fut porter son tendre hommage à celui seul qui est digne d’un immortel amour.

Mr. Bibaud.
Monsieur—On sait qu’il existe des carrières de marbre sur les bords de la Grande-Rivière, ou Rivière des Outaouais, et dans l’intérieur du pays au nord de cette rivière. Désirant me procurer des renseignemens sur ce sujet, je priai, il y a quelque tems, Mr. G***, un de mes amis, qui demeure assez près des lieux, et que je savais s’entendre en minéralogie, de me communiquer ce qu’il connaissait de ces carrières, ou de quelques unes d’elles. Il a eu la complaisance d’aller lui-même examiner celles du township de Grenville; et à son retour, il m’a fait part, dans une lettre que je vous adresse pour la Bibliothèque Canadienne, du résultat de ses observations, en m’envoyant des échantillons des différentes variétés de marbre que fournissent ces carrières. En publiant cette lettre, vous ferez sans doute plaisir à vos lecteurs, et rendrez en même tems justice au mérite d’un homme qui en remplissant les devoirs nombreux et variés de son état, sait encore s’occuper d’études sérieuses et utiles.
S. R.
“St. Benoit, Janvier, 1826.
“Enfin, Monsieur, je vais donc vous prouver que je suis un homme de parole. Vous recevrez sous enveloppe six morceaux de marbre de la carrière de Mr. C***, dans le township de Grenville, comté d’York.
“Outre les cinq variétés produites par les nuances du vert, du bleu, du blanc, &c. on en trouve beaucoup de tout blanc, de gris, de pivelé et de serpentin: mais c’est surtout dans le lit du ruisseau qui divise le rocher, que se trouve le plus beau marbre vert.—Vous en trouverez un fragment bien veiné parmi les morceaux que je vous envoie. Je n’ai pu unir ces échantillons sur une ou deux faces que bien imparfaitement; vous pourrez néanmoins juger, par ce que j’ai pu faire, que ce marbre est susceptible d’un très beau poli. La carrière se trouve en majeure partie au bord ouest de la Rivière au Calumet, qui se précipite du haut des montagnes du nord dans la rivière des Outaouais.[1]
“On commence à rencontrer du marbre à environ quatorze arpens de la Grande-Rivière: on le trouve par larges couches, dont on ne connaît pas la profondeur, quoiqu’on en ait tiré à plus de dix pieds. La carrière se découvre à plus de cent pieds de largeur, quelquefois bien davantage, et se continue, en suivant la Rivière au Calumet, bien avant dans les montagnes.
“Les environs offrent plusieurs autres espèces de pierres calcaires, et quelques blocs de granit sur un lit sabloneux.
“Mr. C*** me paraît tout à fait décidé à mettre cette carrière en pleine exploitation, dès le printems prochain: il a commencé les préparatifs d’un moulin à scier le marbre. C’est un monsieur de bonne éducation et de beaucoup d’intelligence, qui sans doute poussera cette entreprise de manière à lui faire honneur, et à vous procurer bientôt des matériaux pour vos édifices et votre ameublement.”
|
On sait qu’un peu au delà du Lac des deux Montagnes, la Rivière des Outaouais divise les deux provinces, et que le township de Grenville est sur la rive gauche ou septentrionale, dans le Bas Canada. |

L’Alarme et ses suites. “Le 29 Avril, j’étais officier-de-jour et couchais à la garde, quand, au milieu de la nuit, l’alarme sonna et tout le monde courut aux armes. On venait d’apprendre la nouvelle de la prise d’York, par les Américains,[1] et l’on disait Jonathan dans les environs de Kingston.
“La nouvelle de la prise d’York et du premier succès des Américains de ce côté occasiona beaucoup de rumeur et fit une impression profonde sur tous les esprits. York de lui-même est peu de chose, mais on perdait avec ce poste un vaisseau armé et un autre prêt à être lancé: c’était d’ailleurs le dépôt des approvissonnemens en tous genres de nos armées plus en avant.
“Le tumulte et la confusion, qui doivent naturellement suivre d’une alarme, furent la cause, dans celle-ci, de la mort d’un de nos V——; c’est le premier que nous ayons perdu depuis que nous sommes montés ici. Chacun s’empressait de sauter sur ses armes: un de nos hommes s’empare malheureusement d’un fusil, autre que le sien, qui était chargé à balle; voulant essayer la pierre, il tire inconsidérément la gâchette;—la détente se fait,—le coup part, et la balle, reçue dans les reins, blesse à mort le jeune Laframboise..... qui expire peu d’heures après!
“Semblable accident faillit arriver à un soldat du 104e Régiment, dans une chambre voisine: heureusement que la balle vint se loger dans une brique de lard qu’un de ses compagnons tenait à la main!—ils en furent tous deux quittes pour la peur.
“Nous eûmes le plaisir de rester sur nos pieds, ou (pour parler plus dignement,) sous les armes, jusqu’au point du jour, sans sortir de l’enceinte de nos Quartiers. Ce n’était qu’une fausse alarme, pour me servir d’un mot technique; ou, si vous aimez mieux, une des mille-et-une petites espiégleries dont le génie militaire fait de temps en temps usage pour tâter la patience du soldat et l’accoutumer à être preste et alerte. Dites, après cela, si vous l’osez,—qu’un camp n’est pas aussi une école de vertus, un lieu de salut”!
La Tête-du-Pont.—“Le 1er Mai, dans la nuit, nous eûmes une seconde alarme. Je n’avais pas mis, je crois, trois minutes à m’habiller et me rendre aux casernes, et déjà tous nos V—— étaient en rang dans le Quarré. Le Colonel Halketh, qui commandait alors à Kingston, arriva bientôt après. Il me donna l’ordre d’aller prendre poste au Centre-Bridge, avec 30 V——, plus—un subalterne et 10 hommes du 104e Régiment. Pour le coup, je m’attendais à quelque chose de sérieux. On disait, ce jour là, avoir vu des vaisseaux ennemis s’approchant de Kingston, et l’on pouvait supposer avec raison que les Américains, voulant couper la retraite au Général Sheaffe, étaient venus débarquer des troupes entre la ville et les débris de sa petite armée. Nous nous rendîmes donc en toute diligence au poste assigné, par des chemins affreux et une nuit de goudron.
“A trois milles environ de Kingston, il y a une petite rivière qui a retenu le nom de Catarocoui, sur laquelle il y a trois ponts. Tandis que je me rendais à celui du milieu, deux autres officiers allaient occuper les deux autres avec des troupes. Le chemin que l’armée battue devait prendre dans sa retraite (et par lequel en effet Sir Rodger Sheaffe est arrivé depuis, de York,) était celui où j’étais posté, cette nuit. La tête du pont, du côté de la ville, est très susceptible de défence. C’est un petit retranchement en charpente et fascines, percé d’embrasures pour deux pièces de canon. La rivière, passablement large en cet endroit, a en outre, un lit extrêmement vaseux, et les bords sont hérissés de broussailles.
“Mon premier soin, en arrivant, fut de défaire le pont; c’est-à-dire d’en ébranler le plancher, (j’étais autorisé à le faire passer ... par la hache,) sans en jetter les pièces à l’eau comme on voulait d’abord que je fisse. L'Echo,—Télégraphe sonore,—messager actif,—coursier vite et rapide dans le silence de la nuit, nous chuchotait bien clairement à l’oreille que les deux autres ponts gémissaient déjà sous les coups redoublés de la cognée: bientôt ils écroulèrent. Je commandai qu’on respectât le Centre-bridge.
“J’avais pour raisons de ne pas détruire ce pont: 1º de ne point empêcher le Général Sheaffe d’effectuer sa retraite, s’il venait effectivement à nous, cette nuit; 2º de ne point faciliter à l’ennemi le passage de cette rivière, nulle part guéable, au moyen de madriers flottants qu’il pourrait rassembler et former en radeau.—On se rendit...... Un chef a tant d’esprit!—Du moins on obéit.
“On mit donc les madriers du plancher de ce pont en état d’être enlevés facilement; et, à la nouvelle de l’approche de l’ennemi, s’il se présentait le premier, on se proposait de les rassembler en un tas en avant de la tête du pont, et de mettre un parti d’hommes derrière cette première ligne. Au monde que j’eus bientôt c’eût été l’affaire de deux minutes; car je dois vous dire que je reçus dans le cours de peu d’heures, un renfort de milice de 40 hommes sous un capitaine, et que le Chevalier de Lorimier vint me rejoindre avec 20 sauvages.
“J’allai planter moi-même six sentinelles, deux à deux de l’autre côté de la rivière, à 300 pas de distance les unes des autres; j’envoyai en avant, pour reconnaître, un des Dragons à mes ordres, et je détachai quelques sauvages pour la découverte.
“Durant mon absence, le lieu. Le Couteur avait fait mettre 20 pieds du centre bridge en état d’être enlevés dans un clin-d’œil. De retour, j’assignai la place de chacun en cas de besoin, et fis allumer quelques petits feux pour nous sécher de la pluie dont nous étions trempés. Je me trouvais commander alors,
| 1 | capitaine, | 3 | subalternes, |
| 10 | soldats du 104e régiment, | 30 | V——, |
| 40 | miliciens, | 20 | sauvages, |
| —— | —— | ||
| Totale | 104 braves. | ||
“Il ne nous manquait plus que nos deux bouches-à-feu.... et puis, vienne qui l’ose.—Certes!
“Disons pourtant à l’honneur de notre petite troupe, que, ne croyant point l’alarme fausse pour cette fois, elle montra beaucoup de bonne volonté, d’activité, de vigilance et de discipline dans le service assez pénible qu’elle eut à faire toute la nuit; signes assez indicatifs de la résolution qu’elle aurait mise à l’action, si l’occasion de se battre se fût présentée, comme tout le monde s’y attendait.—Mais enfin il était écrit au Grand Livre sans doute, que le Centre bridge de la rivière Catarocoui ne serait jamais qu’un Monument ignoble ou roturier, obscurément célèbre par son utilité seule à faire sûrement et commodément franchir au voyageur et au pâtre un courant fangeux; car, dragons, patrouille, sentinelles,...... pas une âme, en un mot,—ne vit ombre de l’ennemi. Le jour nous surprit sur nos pieds, (excepté l’ami T——, qu’on trouva ronflant, à joue nue sur la croupe rebondie d’un Iroquois...... Chut! ne l’éveillons pas;) et nous regagnâmes nos quartiers, plus transis de froid que de peur, plus enclins à dormir qu’à rire.”
|
Cette Capitale du Haut-Canada s’était rendue, par capitulation, aux Américains, le 27 de ce mois. L’ennemi avait dix vaisseaux de guerre sous les ordres du Commodore Chauncey, et 2,500 hommes de troupes de débarquement sous le commandement en chef du Général Dearborn; tandis que l’officier anglais chargé de la défense de ce poste nullement fortifié (le Général Sheaffe) n’avait à opposer à de pareilles forces que 600 hommes, dont la moitié seulement était de troupes réglées. Malgré tous ces désavantages, le général Sheaffe ne balança pas à livrer bataille. Le débarquement, comme chacun sait, se fit sous les ordres du général Pike, qui périt au moment de la victoire, par l’explosion d’une Poudrière à laquelle nos troupes, qui eurent le bonheur d’effectuer leur retraite, mirent le feu en abandonnant la place. |

Les Aborigènes de ce continent, lorsqu’ils furent connus des Européens, n’avaient que peu d’arts; et le peu qu’ils en avaient se réduisaient à la construction des articles de nécessité première. A l’exception des Méxicains et des Péruviens, toutes les tribus des naturels de l’Amérique en étaient encore au premier dégré de la vie sauvage. Les arts mécaniques leur étaient entièrement inconnus; ils n’avaient point inventé la charue ou la roue, et n’avaient pas fait la conquête des animaux ruminans, le premier objet de la civilisation. Une petite espèce de chien était le seul animal que l’homme s’était associé. Une cabane légère formait la demeure ambulante de l’espèce humaine sur une étendue de plus de 8,000,000 de milles quarrés. L’usage des chevaux, l’introduction des armes à feu, et la culture de quelques légumes, sont les seuls changemens importants qui jusqu’à présent aient été opérés en un certain dégré dans l’état moral des tribus sauvages de l’Amérique: leurs relations politiques sont, à peu de chose près, ce qu’elles étaient il y a trois cents ans. Les lettres, qui sont le partage des propriétés foncières individuelles, et de la résidence permanente qui en est la suite, sont encore, à quelques exceptions près, inconnues parmi ces nations qui disparaissent rapidement de dessus la surface de la terre; et leurs arts et leur langage se perdent avec elles.
C’est un phénomène sur ce théâtre obscur et grossier, où l’homme et les régions dans lesquelles il existe, semblent dans la rudesse primitive, de voir sur les personnes, les habits et les colifichets des sauvages, des couleurs plus brillantes et plus durables que celles qui se voient chez les nations du monde les plus civilisées. Si les naturels ont découvert eux-mêmes l’art de la teinture, ou l’ont appris d’ailleurs, c’est ce que j’ignore; mais je ne puis douter qu’il existe en un haut dégré de perfection, ayant souvent vu des effets teints ou peints élégamment, au moins quant à la couleur.
Des deux sortes de cuir dont les hommes se servent, les sauvages de l’Amérique n’ont jusqu’à présent connu que l’espèce molle et élastique qu’on pourrait appeller parchemin. Lorsqu’ils furent découverts par les Européens, ils ignoraient absolument l’art de tanner les peaux d’animaux au moyen d’écorces d’arbres; ils ne connaissent encore que très-imparfaitement les principes de cet art. C’est un fait curieux que les sauvages font presque toujours du cuir de parchemin pour l’usage, et le préservent ensuite au moyen du tan. Il n’est pas rare de leur voir tremper leurs hausses et leurs souliers dans une décoction d’écorce de chêne: coutume qu’ils ont sans doute apprise des chasseurs ou commerçans européens.
Les peaux dont ils font leur cuir sont celles du buffle, de l’élan, du caribou et du chevreuil. La peau du buffle se fend par une opération très laborieuse; et ainsi que les autres travaux domestiques parmi les sauvages américains, cette opération est faite par les femmes. Le dedans ou la partie charnue est corroyée, et le dehors ou la partie poilue fait l’extérieur de la chaussure. Ils rendent le parchemin très pliable et très élastique, et lui donnent la propriété, peu commune à cette espèce de cuir, de conserver sa texture molle et élastique, après avoir mouillé et séché.
C’est sur ce parchemin délicat et bien préparé que sont appliquées ces teintes mentionnées par le Dr. S. L. Mitchill, et celles que j’ai vues moi-même. L’art de préparer le cuir et de l’empreindre de couleurs aussi durables que la substance du cuir même est connu depuis les villages des Panis sur la Rivière-Rouge, jusqu’aux endroits les plus éloignés de l’Amérique au Nord-Ouest. Les tribus du Sud-Ouest, voisines des Etats-Unis, telles que les Chéroquis, les Chicassas, les Choctas, les Muscoses, ou Criques, et les Cados, ne connaissent rien des arts en question. En remontant le Mississippi, les Panis ou sauvages Towiaches, sur la Rivière-Rouge sont les premiers chez lesquels on trouve des peaux préparées et teintes. Les Panis émigrèrent des bords du Missouri, il y a environ un siècle. Au delà d’eux sont les Hiétans qui parcourent tout le vaste espace qui se trouve entre les Panis et les montagnes du Chippewan ou Missouri. Les Hiétans ont apprivoisé le cheval, et j’ai vu quelques unes de leurs brides; elles sont faites avec beaucoup de goût et sont surtout remarquables par la force des couleurs jaunes et bleues dont sont peints les crins, le cuir et autres matériaux.
On pourrait faire plusieurs demandes concernant les couleurs en question: mais ce qu’il y a de certain, c’est que les matériaux sont indigènes: qu’ils sont dissiminés sur une immense étendue de pays, et qu’il faut peu de tems et de peine pour les préparer et s’en servir; et je suis porté à croire qu’on peut ajouter qu’il n’y a que les sauvages qui en font usage. Quoique de ce que l’art de teintre n’est guères connu que des tribus du Nord-Ouest, on soit porté à croire qu’elle le tiennent de l’Asie, cependant s’il en était ainsi, nous devrions conclure que raisonablement parlant, quelqu’autre art de l’Asie, plus utile en apparence, aurait été connu des Américains; ce qui n’est pas.
Les plantes de la classe de la Syngénésie, sont très abondantes sur toutes sortes de sols depuis l’embouchure du Mississippi jusqu’à sa source. On voit partout quelques unes de ces fleurs radieuses particulièrement en automne. On commence à trouver le Cactus à Natchitoches sur la Rivière-rouge, mais on le trouve en plus grande quantité en avançant vers l’Ouest ou le Nord-Ouest, et il couvre les plaines jusqu’aux côtes de la presqu’île de Californie et jusqu’aux sources du Missouri.
Ces plantes croissent si naturellement qu’en plusieurs endroits l’Anthémis borde les chemins: cette fleur se fait souvent appercevoir à plusieurs milles de distance, par sa forte teinte de jaune brillant. Mais on voit partout le Cactus s’élever en pyramides aiguës dans les déserts incultes.
Les sauvages ont toujours eu grand soin de ne donner aucun renseignement concernant leurs drogues et leurs teintures; mais l’art de décomposer les substances végétales est arrivé à une telle perfection, qui si l’on faisait des essais ou des expériences sur les différentes feuilles et fleurs qu’on trouve dans leurs pays, il est hors de doute qu’on découvrirait la plante ou les plantes dont ils se servent. Le plus grand nombre des personnes qui vont chez les sauvages, sont absolument incapables de faire aucune découverte ni aucune observation utile à leurs concitoyens: on ne peut rien attendre de ces gens-là.
Le nombre et la variété presque infinis des fleurs radiées et liliacées qu’il y a dans la Louisiane, passent toute croyance. Elles sont la plupart intièrement jaunes; et dans un grand nombre les parties contrales sont d’un très beau brun. Quand on voyage par les bois et les prairies, entre Opelousas et les villages des Panis, l’œil est à tout moment réjoui par la beauté et l’éclat des plantes et des fleurs. Il ne paraît pas pourtant que dans la basse Louisiane, les sauvages connussent aucune espèce de teinture particulière. Comme parmi nous, les matériaux se trouvaient partout en abondance, mais on n’en connaissait pas la valeur.
Il n’est peut-être pas hors de propos de remarquer que toutes les substances sur lesquelles les sauvages appliquent leur teinture, sont des substances animales: la laine, le poil, le parchemin ou peaux préparées, et les plumes ou piquans du Porc-Épic, sont celles que j’ai vues. Les couleurs sont le jaune, le bleu, le rouge et le noir; mais le jaune et le rouge prédominent. Je suis fâché de ne pouvoir pas vous donner des renseignemens plus satisfaisants:—des sujets d’une nature fort différente, et des circonstances souvent impérieuses, m’ont contraint de me borner à des recherches géographiques et politiques.
P. S. Je me suis servi du terme de parchemin dans un sens bien différent de son acceptation ordinaire; mais je n’ai pu trouver d’autre terme pour distinguer cette espèce de cuir de celui qui se fait par le moyen du tan.
———————
Déjà nous sommes prêts, déjà de la maison,
On descend en chantant dans le riant vallon;
On passe avec plaisir d’agréables campagnes,
D’où l’on monte bientôt sur de hautes montagnes;
Quel aspect enchanteur s’offre alors à mes yeux!
Avec quel charme on voit ce fleuve spacieux
Arroser de ses eaux de fertiles prairies,
Où l’herbe verdoyante et les moissons mûries
Courbent en endoyant au gré d’un doux zéphir.
Entre ces prés jaunis, qu’on voit avec plaisir
Mille petits ruisseaux rouler avec murmure
Sur des lits de cailloux une onde claire et pure!
Mais quittons ces beaux lieux, montons vers ces forêts
Azile de la nuit, azile de la paix!
Quels pensers enchanteurs, quelle charmante ivresse,
Ressent alors mon âme! oh paix enchanteresse!
O silence profond de ces bois ténébreux,
Vous plongez tout mon cœur dans un transport heureux!
Les seuls cris des oiseaux cachés dans les feuillages
Ou, qui cherchent leur proie en ces endroits sauvages,
Font retentir au loin de leur lugubre voix
L’écho sourd et lointain qui règne dans ces bois.
Mais nous montons, toujours, et d’une source obscure,
Cherchant le filet d’eau que couvre la verdure......
Ah, le voila! c’est lui; son nom est Cabaret,
Car à son eau stagnante on mêle le clairet.
Plus loin nous arrivons auprès d’une rivière,
Qui dans son lit étroit roule une eau toujours claire;
On s’arrête pour boire, et l’on se raffraichit
Sur ses bords enchanteurs que l’écume blanchit.
De souvenirs charmants la douce rêverie
Fait goûter à mon âme une joie infinie;
Ces lieux me présentaient cet endroit si charmant
Dans lequel, cher Papa,[1] vous m’emmeniez souvent.
Un arbre s’offrait-il tout à coup à ma vue,
Une grappe de fruit aux branches suspendue,
Je pensais à l’instant si charmant et si doux
Où je me reposais sous l’ombrage avec vous;
Et tout ce qui s’offrait alors en ma présence,
Rappellait les plaisirs de ma plus tendre enfance,
Mais nous nous relevons, il faut enfin partir.
L’aquilon souffle et gronde; on écoute frémir
Le feuillage tremblant: à travers la verdure,
Le vent parcourt le bois qui s’abaisse et murmure,
Mais nous voyons enfin à travers les roseaux,
La bleuâtre lueur des christallines eaux
Du beau lac, qui coulant à travers les montagnes,
Va de son onde pure arroser les campagnes.
On jette un cri de joie en saluant ces lieux;
L’écho des bois répond à nos accens joyeux.
Nous nous précipitons, à travers le feuillage,
Et d’un pas plus pressé nous gagnons le rivage.
En hâte nous jettons, par terre nos paquets,
Joyeux de voir ce lac, qui comble nos souhaits.
A l’envie aussitôt dans notre ardeur première,
Mêlant à nos plaisirs l’amour de la prière,
Du divin Rédempteur, nous élevons la croix,
Que par o crux, ave, nous saluons trois fois.
Ce chant mélodieux s’unit à l’écho même,
S’élevant dans les airs jusqu’à l’Etre Suprême.
Que tu charmes nos cœurs, quelle douce onction,
Tu fais alors goûter, sainte religion!
Puis nous jettant par terre, et nous couchant sur l’herbe,
Nous cherchons le repos sous quelque arbre superbe.
Mais un instant après, nous nous levons gaîment,
Et la hache à la main, nous courrons, en chanchant,
Ou poussant des cris gais, couper dans la savanne,
Les perches qu’il nous faut pour faire une cabanne.
Un, le briquet en main, frappant sur le caillou,
Présente à l’étincelle un tondreux amadou.
Les uns coupent le bois, d’autres sur leurs épaules
L’apportent au bûcher qu’entourrent de noirs saules;
Déjà le feu pétille, et montant dans les airs,
La flamme va dorer ces vieux pins toujours verts.
Nous plantons quatre pieux avec beaucoup de force,
Pour faire la cabanne, et la couvrons d’écorce;
Dedans, un lit mollet de branches de sapin
Nous promet pour la nuit un repos tout divin.
Mais de ses aiguillons déjà la faim nous presse;
Un, qui pour cuisinier montre le plus d’adresse,
A déjà fait rôtir sur les tisons ardents,
Du lard et du jambon les morceaux succulents.
Nous souppons à l’antique assis sur la verdure;
Bacchus, le bon Bacchus de riante figure
Nous verse en abondance un vin délicieux,
Qui nous fait-à-tour pousser des cris joyeux
Oui, pendant ce repos, la gaieté, l’allégresse
Remplissent tous nos cœurs d’une agréable ivresse.
On se relève enfin, chacun suit ses désirs:
Les uns vont dans les bois, objet de leurs plaisirs,
D’autres du haut d’un quai, qu’ils font au bord de l’onde,
Jettent à l’eau la ligne errante et vagabonde,
Tirent en quantité ces voraces poissons
Qui restent suspendus aux fatals hameçons.
Le fusil sur le dos d’autres vont à la chasse
Observent le hibou, le héron, la bécasse;
Le fusil au niveau de l’œil qui le conduit,
Le coup part, et le plomb perce l’oiseau qui fuit.
Mais, pour moi, je les quitte, amant de la nature,
Je vais sous un haut pin dont l’épaisse verdure,
Nourrit ma rêverie au milieu des forêts.
Avec quel agrément alors je regardais
Le soleil éclairant les campagnes voisines,
Descendre doucement derrière les collines!
A son riant aspect, de leurs charmantes voix
Mille oiseaux différents font résonner les bois.
Mais je ne le vois plus, il finit sa carrière,
En colorant encor de sa douce lumière,
Et d’un éclat moins vif, les nuages dorés
Et de mille couleurs richement empourprés.
La lune alors se lève: ah, sa lueur est douce!
Sa lumière s’étend sur des tapis de mousse,
Et se joue à travers les feuillages tremblants
Qu’agitent mollement les zéphirs inconstants.
Quels agrémens, hélas! ce spectacle m’inspire!
Tels que je les ressens, que ne puis-je les dire!
Mais il est déjà tard, et l’on ne pêche plus;
Les autres de chasser sont déjà revenus.
Alors au bord du lac, on joue, on saute, on danse;
Puis, avec quel plaisir, dans un profond silence,
On écoute répondre à nos perçantes voix
Les échos d’alentour, qui prolongeant sept fois,
Leurs gémissantes voix sur les hauteurs voisines,
Parcourent en volant sept lointaines collines.
Cependant, il est tems de prendre du repos,
Morphée appesantit nos yeux de ses pavots:
Le reste de la nuit un sommeil agréable
Vient délasser nos corps d’une fatigue aimable.
Déjà le jour paraît, et le brillant soleil
Vient pour nous arracher des bras d’un doux sommeil.
Alors tous à genoux, dans une humble prière;
Nous saluons le Dieu qui créa la lumière,
On se disperse ensuite; et dans le fond des bois
Et sur les bords du lac, on fait ouïr nos voix.
Enfin nous déjeunons, et la joie ordinaire
Réveille l’appétit, et tout alors sait plaire.
Mais nous nous disposons à la fin pour partir,
Et du lac on revient encore avec plaisir.
|
Cette pièce était adressée au père de l’auteur, en 1806. |
———————
Quelle douleur, Ah! ciel, quelle tristesse
Chez Apollon et ses augustes sœurs!
On n’entend plus sur les bords du Permesse
Ces chants si doux, ces concerts enchanteurs;
Thalie est inconsolable;
Des pleurs coulent de ses yeux:
Sa voix triste et lamentable
Se fait entendre en ces lieux.
Tout est sensible à sa peine,
Tout partage sa douleur;
Vous, Euterpe et Melpomène,
Pleurez avec votre sœur.
Q.....l n’est plus ... la parque impitoyable
Tranche le fil qu’ornaient tant de vertus.
Et les échos d’une voix déplorable,
Répètent tous: Q.....l, Q.....l n’est plus!
Dans ses écrits imitant la nature,
Il peignait tout d’après la vérité;
De nos défauts il faisait la censure,
De nos vertus il chantait la beauté.
Sur sa lyre harmonieuse
Résonnait les plus beaux airs;
Et la nature joyeuse
Souriait à ses concerts.
Mais tout est dans le silence,
Aujourd’hui tout est en deuil;
Coulez, pleurs, en abondance,
Q.....l est dans le cercueil.
———————
L’ANTI-FRANCAIS,
ou Mr. Q.....l et Mr. O.....e.
Pourquoi, diable, êtes-vous Français?
Vous savez bien comme on les aime!
Me dit un jour un Ecossais,
Avec une franchise extrême.
Vous avez fort mal fait, l’ami,
De vous venir fixer ici,
Où leur présence est importune.
Passe encor pour un Canadien:
Mais un Français, il fera bien
D’aller ailleurs chercher fortune.
Vous vous plaignez, vous pestez; mais,
Pourquoi, diable, êtes-vous Français?
Soit dit, entre nous sans rancune.
Je sais bien que fuyant Paris,
Condamnés par la république,
Vos pareils furent accueillis
Au sein de l’île britannique;
Je conviens que sa majesté
Eut pour eux tout plein de bonté.
Enfin, il en était le maître;
Chacun a ses raisons; mais moi,
Je crois que si j’eusse été roi,
Je les aurais envoyé paître,
Sans autre forme de procès.
Pourquoi, diable, êtes-vous Français?
On veut bien vous rendre justice;
Vous vous comportez assez bien:
On ne vous peut reprocher rien
Qui soit à votre préjudice:
Et si vous étiez seulement
Ou Suisse, ou Danois, ou Flamand,
On pourrait vous rendre service.
Mais à Français de nation
Témoigner la moindre tendresse!
Non, non, un enfant d’Albion
Ne peut avoir cette faiblesse.
C’est un peu dur, j’en conviens, mais,
Pourquoi, diable, êtes-vous Français?
N’espérez ici nulle grâce;
Vous parens sont nos ennemis:
Peut-être qu’en votre pays,
Vous eussiez rempli quelque place.
Mais ici c’est bien vainement
Que vous montreriez du talent.
De vous on ne s’occupe guère:
Et puisque généreusement
On vous souffre, soyez content;
Filez doux, et sachez vous taire.
Allez, ne vous plaignez jamais:
Pourquoi, diable, êtes-vous Français?
———————
LE PROCUREUR CUPIDE.
Un jour Damon, l’avide Procureur,
Voyant conduire un ignoble voleur
De la prison au lieu de son supplice,
Disait: cet homme avait moins de malice
Que de bêtise. On lui dit bonnement:
Il n’avait pas comme vous la science,
En derobant, d’éviter la potence.
———————
Mr. Bibaud.
Le Canadien, Journal politique, littéraire et polémique, publié à Québec en 1807, annonce le décès d’un nommé Simon Latresse, mort à l’hotel-dieu, le 13 Septembre, des suites d’un coup de feu qu’il avait reçu dans la nuit du Samedi précédent, de la main d’un des soldats presseurs du vaisseau de sa Majesté le Blossom, commandé par George Picket, écuyer. “Latresse, dit le journal, était à danser dans le fauxbourg St.-Jean, lorsque la presse y entra, sous les ordres du lieutenant Andrel. On s’empara d’abord de lui; mais il parvint à se débarrasser des mains des soldats, par sa force et son activité, et se sauvait à la course, lorsqu’un d’eux lui tira un coup de pistolet, dont la balle lui traversa le corps. Il était âgé de 25 ans, Canadien, natif de Montréal, voyageur dans les environs de Michillimakinac, depuis sept ans; jouissait d’un caractère fidèle et attaché à ses maîtres, et laissait, pour déplorer sa perte, une mère veuve, âgée de 75 ans, qu’il soutenait de ses épargnes.”
Voici le discours qu’un de nos poëtes du tems met dans la bouche de ce malheureux jeune homme, dans ses derniers momens.
De l’auteur de ma vie adorant les décrets,
Puisqu’il faut la quitter, j’y souscris sans regrets:
Mais je te laisse seule, ô mère respectable!
Et c’est, en expirant, le souci qui m’accable.
Jusqu’ici, grâce aux cieux, par de tendres secours,
J’aidais à prolonger la trame de tes jours.
Tu lisais dans mon cœur, lorsque, chaque semaine,
Du fruit de mon travail j’adoucissais ta peine.
Le ciel en te laissant sans moyens, sans amis,
Du moins sur tes vieux jours te conservait un fils!
Faut-il qu’un sort cruel en ce jour nous sépare!
Jouet infortuné d’une loi trop barbare,
D’un homicide plomb l’on a percé mon sein;
Hélas! qu’avais-je fait au perfide assassin?
Il voulait que sur mer on servît la patrie......!
Mais avait-il le droit de m’arracher la vie?
O George, roi pieux, monarque juste et bon,
Que de forfaits divers on commet en ton nom!
Abrégez, Dieu vengeur, mon tourment effroyable,
J’appelle à mon secours la mort inéxorable...!
Mais je la sens venir...ô ciel, quelles douleurs!
Adieu donc, c’en est fait, ma mère, je me meurs....
On a attribué ces vers, dans le tems, à Mr. Q.....l; et en effet, ils ne me paraissent pas indignes de ceux dont ce poëte aimable et facile nous gratifia de tems à autre.
UN COPISTE.
———————
Chanson, sur l’Air, De la Pipe de Tabac.
Un jeune homme auprès d’une femme,
Lui répétait dans son transport:
“Ah, je te jure sur mon âme
De t’adorer jusqu’à la mort.”
Je t’aime aussi, lui dit la belle,
Mais de grâce point de babil;
Serment de tendresse éternelle
Est bien un vrai Poisson d’Avril.
Un vieux barbon, glacé par l’âge,
Cajolait fillette un beau jour:
“Ah! cesse enfin d’être sauvage,
Et partage mon tendre amour.”
Non, répond la beauté sévère,
Dont le coup-d’œil était subtil,
Vous pourriez fort bien à Cythère,
Me donner un Poisson d’Avril.
Ivre d’encens et de suffrages,
Un Poète écrit sans repos;
Il est content de ses ouvrages,
Dont il ne voit pas les défauts;
Le Public les voit à sa place;
J’entends le sifflet incivil!......
Un Auteur ne peut sans grimace
Avaler ce Poisson d’Avril.
Je veux à tous rendre justice,
Dit le Rédacteur d’un Journal;
Sur chaque Acteur, sur chaque Actrice,
Je promets d’être impartial.
C’est à qui grossira la liste;
Mais de la Seine jusqu’au Nil,
Ah! qui sait mieux qu’un Journaliste,
Nous donner des Poissons d’Avril!
La vertu de femme jolie,
La fidélité d’un mari;
D’un Poète la modestie,
La sincérité d’un ami,
D’un Crésus l’esprit et la grâce,
D’un fat le courage viril,
La probité d’un homme en place,
Bon Dieu! que de Poissons d’Avril!
Un plaideur pour très peu de chose
Croit s’assurer d’un prompt succès:
L’avoué promet gain de cause,
Et puis se chargeant du procès,
Prend frais de cour, gros honoraire;
Mais loin d’en dérouler le fil,
Traîne, intrigue, embrouille l’affaire:
C’est encore un Poisson d’Avril.
D’un vain jargon fesant parade,
Un docteur de la faculté,
Promet à son pauvre malade
Qu’il va lui rendre la santé.
Le malheureux le laisse faire,
Ne se doutant pas du péril;
Le médecin le met en terre;
C’est le dernier Poisson d’Avril.
———————
L’ANNONCE DU PRINTEMS.
L’hiver a peine à fuir, mais il combat en vain;
Bientôt il va céder à la toute-puissance
De cet astre brillant dont la douce influence
Console la nature et réchauffe son sein.
Elle languit encor sans aucune parure.
L’arbuste dépouillé n’offre point de verdure.
Tout repose et tout dort: mais malgré ce sommeil,
Tout semble pressentir le moment du réveil.
L’oiseau vole incertain, traverse la campagne,
Revient, chante, se tait, cherche et fuit sa compagne.
Rien ne s’anime encor: mais tout va s’animer;
Tout paraît sans amour, mais tout est prêt d’aimer.
———————
SONNET,
Imité du commencement de l’Ode d’Horace, Justum et tenacem, etc.
Celui que la nature en sagesse féconde,
Doua d’une âme forte et d’un cœur généreux,
Inébranlable aux coups du sort capricieux,
Franchit comme un torrent cette scène du monde.
Que le ciel, en courroux tonne, frappe, confonde
Les divers élémens; qu’en un désert affreux
Se changent nos cités, nos palais fastueux;
Il vit sur ces débris dans une paix profonde.
Il contemple sans crainte et d’un œil assuré,
Les fureurs d’un tyran, ou d’un peuple égaré;
Sa vertu lui suffit, il souffre sans murmure.
Planant sur l’avenir, il reste indifférent
Aux cris des factieux, à leur lâche imposture;
Et sans daigner le voir, foule aux pieds le serpent.

J’ai toujours singulièrement aimé à lire les prospectus, parcequ’ils sont presque toujours écrits dans un style pur, élégant et fleuri, qui gagne l’esprit, et qui va au cœur. Cette lecture m’a couté beaucoup d’argent, à la vérité, car je n’ai jamais manqué de me laisser aller à la séduction, et de porter mes fonds à tous les établissemens qui se sont présentés, sans que jamais il me soit resté autre chose que le souvenir que laisse une lecture délicieuse. Mais cela ne m’a point dégoûté, Dieu merci. La tontine Lafarge s’est offerte à moi avec des périodes extrêmement arrondies, harmonieuses, et embellies de tous les prestiges de l’éloquence.—D’ailleurs, elle promettait des avantages pécuniaires audessus de ceux des autres tontines, et qui semblaient avoir une base d’autant plus solide qu’elle était fondée sur la fragilité de la vie humaine. On me flattait, d’après les calculs perfectionnés de MM. Buffon et Parcieux, que, sur cent actionnaires, il en mourrait régulièrement six par an, et qu’il y aurait par conséquent une réversibilité constante et uniforme des actions des morts sur les actions des vivants.—Pour m’assurer de la justesse de ce calcul, j’allai vérifier les régistres mortuaires de St. Eustache, (c’est ma paroisse,) et je m’assurai, par mes yeux, qu’au lieu de mourir à raison de six pour cent, on y mourait volontiers à raison de huit.—Alors je me précipitai sur la banque Lafarge, et je priai ces messieurs de vouloir bien convertir sur le champ le reste de mon bien en tontine; à quoi ils voulurent bien consentir, en me gratifiant, par dessus le marché, de plusieurs exemplaires de leur prospectus, dont l’élégance me frappa de nouveau.
Je me retirai tranquille chez moi, en attendant qu’il plût à mes camarades de s’éteindre dans la proportion stipulée dans mon bref. Au bout de l’année, me trouvant avoir besoin de fonds, je me présentai à la banque: je demandai honnêtement si la mortalité humaine allait son petit train, s’il y avait de quoi vivre avec les morts, et je m’informai avec empressement de la santé de cent dix-neuf mille quatre cent soixante-huit personnes, composant la masse des actionnaires, sans me compter. Un commis, à qui je m’adressai, me dit, qu’il m’était bien obligé, de leur part, de ma politesse, que tous se portaient à merveille, et il m’exhiba des régistres mortuaires en blanc. A la bonne heure, lui dis-je, l’année suivante me dédommagera; car il faudra nécessairement qu’on y meure à douze pour cent, autrement, il y aurait erreur et lésion. Je repassai en effet, six mois après, ayant senti augmenter mes besoins; j’obtins la même réponse, et les actionnaires semblaient s’être donné le mot pour jouir de la meilleure santé. Pour le coup, je me retirai un peu piqué; j’en voulais surtout à MM. de Buffon et de Parcieux, que je regardais comme les seuls coupables, et comme ayant induit en erreur Mr. Lafarge, sur la moyenne proportionnelle de la longévité des hommes, et sur la délicatesse de leur santé. Cependant j’étais talonné par mille besoins, et j’avais pour mon compte la mort sur les lèvres. C’était bien une espèce de consolation pour moi, qui suis né bon et sensible; car, disais-je, si personne ne veut mourir pour m’obliger, je mourrai moi-même, et cela obligera quelque malheureuse famille sur qui retombera mon action. J’ai dit que j’avais la mort sur les lèvres, mais elle ne voulut pas aller plus loin; je restai debout, et assez vivace: cela me parut d’autant plus étonnant, que je ne mangeais presque point, n’ayant pas l’occasion de diner gratis, et n’étant affilié à aucune société épicurienne. Il ne restait presque plus rien dans mon domicile qu’une couchette et des prospectus. Je jugeai qu’il y avait là-dessous quelque chose de surnaturel, mais ne pouvant deviner ce que c’était, le désespoir me prit un matin; je formai le projet de me jetter par la fenêtre, qui était située avantageusement à cinquante degrés audessus de l’entresol. Après avoir fait quelques dispositions testamentaires, je me mis en train et pris mon élan; je ne languis pas beaucoup en l’air; cependant j’eus encore le tems d’y faire quelques réflexions sur les tontines en général, et sur la tontine Lafarge en particulier; je sentis parfaitement que ma vitesse était multipliée par ma masse, et je m’attendais bien à arriver sur le pavé en capilotade; mais voyez un peu la singularité de ma destinée; au moment de ma chûte, une charrette à foin passa sous mes fenêtres; je tombai dessus, et au lieu de me faire le moindre mal, je me donnai au contraire une secousse agréable, qui me remit les humeurs en équilibre et qui me fit un bien infini. Cela me raccommoda un peu avec la vie; ainsi je résolus de la conserver, quoiqu’elle fût à charge à plus de cinquante familles honnêtes, intéressées comme moi à la mortalité humaine. Je me mis à voyager pour m’étourdir sur ma situation, espérant trouver, du moins, à mon retour, les régistres de la banque en meilleur état, d’autant mieux que je laissai alors mon pays, (c’était en 1793,) dans des dispositions assez meurtrières. Je partis après avoir emprunté quelque argent, et avoir donné pour caution mes espérances bien légitimes. Je n’avais d’autre passeport que mes coupons d’actionnaire. Je fus arrêté à toutes les municipalités de ma route; mais sur la simple vue de mes coupons, on jugea que je n’étais pas né dans la classe suspecte des riches; on crut que je n’avais rien, et on me relâcha partout.
J’arrivai à Bordeaux, où, après m’être reposé un instant, j’allai m’informer s’il ne partait pas quelque vaisseau pour les Antilles. On me dit que la frégate l’Impérissable était sur le point de faire voile pour St. Domingue, et que j’avais une heure pour faire mes malles. Je n’en pris pas tant, et je fus prêt à être embarqué sur le champ. Après trois jours de navigation heureuse, nous fûmes accueillis par une tempête horrible, qui nous mit bientôt dans le plus grand danger. L’Impérissable avait déjà beaucoup souffert dans ses autres voyages, et ne put lutter longtems contre la tourmente. Elle finit par couler à fond, et par périr toute entière.—L’équipage périt aussi. Seul, je m’accrochai, comme par miracle, au mât de misaine, qui flottait au gré des ondes déjà appaisées. Ensuite, m’étant saisi d’une longue perche qui me servit de balancier, je me mis à me promener, tout droit, de long en long, sur ce mât, à l’imitation du fameux danseur de corde Forioso.
On juge des réflexions que je dus faire dans cette position extraordinaire, au milieu de l’immense océan, et ne devant pas espérer de faire une promenade bien longue, faute de nourriture, et pouvant perdre l’équilibre à tout moment, malgré le secours de mon balancier. Mais quelle fut ma surprise de voir arriver de loin un petit vaisseau. Je me hâtai de faire des signaux de détresse, et d’arborer, pour ainsi dire, pavillon d’actionnaire, en faisant brandir en l’air mes coupons de banque et mon mouchoir de poche. Je fus donc encore miraculeusement sauvé, recueilli, et emmené sain et sauf à ma destination, ne sachant que penser et que dire d’une aussi incroyable aventure.
St. Domingue était, au moment où j’arrivai, dans l’état le plus déplorable. Je me fis conduire au quartier Jémérie, ou je devais avoir quelques colons de ma connaissance. Je n’y fus pas plutôt arrivé, que des Nègres furieux et révoltés se mirent à égorger tous les blancs, sans distinction de sèxe ni d’âge. J’étais assurément plus blanc que personne, d’après mon extrême paleur et l’air exténué que j’avais. J’attendais mon tour avec résignation, et je tendais la gorge de la meilleure grâce du monde. Je la tendis inutilement. Je dis à un Nègre marron qui s’avançait vers moi, ennivré de carnage, qu’il était bien malheureux pour un actionnaire de la banque Lafarge de mourir à la fleur de son âge, uniquement parce qu’il avait eu le malheur de naître avec une peau un peu plus belle que celle d’un Africain. Je n’eus pas plutôt dit ces paroles, que le Nègre prit une figure riante et me sauta au cou, pour m’embrasser de la manière la plus aimable, au lieu de m’égorger et de me mettre en pièces. Il me prit dès lors sous sa protection, et je restai seul de ma couleur, dans le quartier Jérémie, avec la plus parfaite sécurité.
Ennuyé de ce séjour, aussi triste que son nom semblait l’annoncer, je profitai du premier vaisseau qui partait pour la France, songeant que j’avais assez voyagé. Je fus bientôt de retour à Bordeaux, sans avoir éprouvé le moindre accident. Me trouvant au spectacle dans cette ville, le jour de mon arrivée, j’eus le malheur de marcher, par mégarde, sur le pied d’un Gascon qui était à côté de moi. Il trouva en cela son honneur tellement compromis, qu’il me dit à l’oreille que j’étais un lourdeau, que j’aurais la bonté de le suivre, et qu’il allait m’apprendre à marcher. Je le suivis: il fut convenu que nous nous enfoncerions l’un ou l’autre une épée dans le corps jusqu’à ce que mort s’en suivît: arrivé sur le champ de bataille, je dis à mon homme: “Mon cher, je me bats à regret contre vous, je vous tuerai, j’en suis sûr, les actionnaires de la banque Lafarge sont heureux, et j’ai l’honneur d’être un des actionnaires de cette banque.” “Eh! qu’a de commun,” me répondit-il, “cette banque avec notre affaire? Il n’y a pas d’actionnaire qui tienne; allons, en garde!” Il n’y avait rien à répliquer, je me mis en garde. Je n’avais jamais manié d’épée, ayant passé ma vie la plume à la main, dans les calculs et les spéculations. Je n’eus pas plutôt allongé le bras, que mon Gascon se trouva enfilé jusqu’à la garde, comme si on l’avait enfilé exprès. Je retirai mon épée de son corps avec beaucoup de peine, et il tomba mort et noyé dans son sang. Cela m’affecta vivement, d’autant mieux qu’il n’était pas actionnaire, et que je ne gagnais absolument rien à sa mort. Je n’eus rien de plus pressé, après cette affaire, que d’arriver à Paris. Mon premier soin, comme on peut croire, fut de me présenter à la banque où j’avais affaire. J’avais, en entrant, le pressentiment singulier que je trouverais les choses dans l’état ou je les avais laissées. On me dit en effet qu’il n’y avait rien de nouveau, qu’on en était désolé, mais que les actionnaires de la banque avaient tous l’âme chevillée dans le corps. Cela ne m’étonne point, répondis-je, je l’aurais parié.—Vous pouvez vous flatter d’avoir une banque unique dans son espèce, et je ne voudrais pas pour un empire, n’être pas couché tout de mon long sur votre grand livre.
Enfin, après des réflexions plus profondes, rentré chez moi, il ne me fut pas difficile de reconnaître, comme on dit, le doigt de Dieu dans la banque Lafarge, et de voir que décidément l’immortalité nous était accordée en faveur de nos bonnes actions......Ce qui fait bien voir qu’il ne faut jamais, encore une fois, négliger de lire les prospectus, et de porter son argent aux différents particuliers qui font des affaires de finance. F.

Abus de mots.—Quelques écrivains donnent souvent aux Algériens, aux Maroquins, et à tous les Musulmans le nom de Turcs, qui ne convient qu’aux peuples de la Turquie.—Pareillement les Asiatiques désignent tous les Européens sous le nom de Francs. Cependant les Russiens, les Autrichiens, les Anglais ne sont pas Francs.
Amour.—L’Amour de bon Ton.
Alfred, à genoux.—M’aimez-vous, adorable Léontine?... Répondez, de grâce.... Tirez-moi enfin des tourmens affreux où me plonge votre cruel silence.... Vous savez que je vous chéris, que je vous adore, que je vous idolâtre, que je ne respire plus que pour vous...., pour vous seule..... Mais, parlez, je vous en conjure ...au nom de l’amour, au nom de tout ce qui vous est cher, au nom de vos yeux divins, adorables ..., si vous ne voulez pas que je meure, m’aimez-vous?
Léontine.—Mais ..., Monsieur, si vous en êtes digne ...Oui ..., je vous aimerai....
Alfred—Oui! O aveu digne d’adoration! O moment natal de mon bonheur! O divin Oui! O bouche pleine de charmes, qui me rendez la vie, qui me mettez dans le délire!...Oiseaux chantres ailés des bocages, chantez mon bonheur, ma joie, mon ivresse, mes transports!...Allez dire à l’univers que je suis heureux, que je suis aimé, que je suis fou, que la tête me tourne, que je suis Roi, que je suis Dieu, &c.—(Feu de paille, qui durera bien deux mois.)
L’Amour Rustique.
Colas.—Margot, m’aimes-tu?
Margot.—Oui.
Colas.—A la bonne heure. Tu n’as pas à faire à un ingrat; viens-t’en faire écrire nos bancs.—(Feu pacifique et bien tempéré, qui ne s’éteindra qu’avec les glaces de l’âge.)
Anneau d’Alliance.—C’est souvent l’intérêt qui le donne et l’amour qui le reçoit. Il faut le dire à notre honte, dans les mariages d’intérêts, et ils sont nombreux, la vilénie est presque toujours du côté de l’homme. Une femme cherche moins un riche époux, qu’un amant qu’elle puisse aimer. Pourquoi cela? C’est que la plupart du temps, lorsqu’un homme se marie, son cœur est usé sur l’amour, tandis que le cœur d’une femme est encore neuf.
Extrait des admirables secrets de Th. Wecker.
Quand le prêtre a conjoint les deux époux, le mari, tout frais béni, donne à sa femme l’anneau d’alliance, pour sceller cette conjonction. Ce moment est du plus grand intérêt pour les femmes, et mérite toute leur attention. Si le mari arrête l’anneau à l’entrée du doigt, et ne passe pas la seconde jointure, la femme sera reine et maîtresse de tout ce qui se fera dans le ménage.—Mais lorsqu’un homme a l’impolitesse d’enfoncer l’anneau jusqu’à l’orrigine du doigt, et de le fixer lui-même à la place qu’il doit occuper, cet homme sera le souverain seigneur et maître de tout ce qui se fera chez lui.
Ainsi les demoiselles bien nées ont soin de courber le doigt annulaire, au moment où elles reçoivent l’anneau conjugal, de façon qu’il s’arrête au bout du doigt; et c’est à ce petit moyen qu’elles doivent le plaisir de gouverner encore leur mari, qui se vante toutefois de conduire sa barque tout seul.
Bien.—Il y a autant de sentimens que de personnes, touchant le souverain bien; car chacun le trouve dans ce qui fait l’objet de ses affections.—Eschine le plaça dans le sommeil; les Espagnols, flegmatiques et paresseux comme lui, ont adopté son systême, du moins en pratique.—Zénon mit le souverain bien dans les coups de poing et les jeux de crocheteur: la populace anglaise a pensé comme Zénon.—Epicure plaça le souverain bien dans les plaisirs: il a chez les Français bon nombre de partisans.—Aristote enfin, qui avait de l’âme cette noble idée que doit s’en faire un sage, trouva le souverain bien dans la sagesse et la vertu....Il a peu de sectateurs.
L’orgueilleux ne soupire qu’après les honneurs. Tout est bien pour l’avare, s’il se voit entourré de monceaux d’or. La coquette ne voit de souverain bien qu’une foule d’adorateurs soumis. Un homme de lettres se console de la misère, en mâchant du laurier, comme disait Dufresny; et un véritable ami de la patrie est heureux, au sein de l’indigence, s’il voit son pays florissant.
Capitulation.—Une fille et une femme attaquées doivent se défendre. Prises de force, elles doivent se tuer comme Lucrèce, ou se bruler comme Moscou.—Cette maxime est un peu rude; mais on ne capitule point avec le déshonneur.
Comédie Universelle.—Le monde en est le théâtre, et les hommes en sont les acteurs. Les hazards composent la pièce; la fortune distribue les rôles; les théologiens gouvernent les machines, et les philosophes sont les spectateurs: L’homme recherche l’erreur, et l’erreur l’environne. On paie à la porte une monnaie qu’on nomme peine, et on reçoit en échange un billet marqué inquiétude.—Les riches occupent les loges; les puissans l’amphithéâtre; le parterre est pour les malheureux. Les femmes portent les rafraichissemens à l’entour, et les disgrâciés de la Fortune mouchent les chandelles. Le temps tire le rideau. La comédie commence par des larmes et des soupirs; viennent ensuite les projets chimériques, et les folies qui composent les chœurs. Les insensés applaudissent, et les sages sifflent la pièce. On voit paraître des géans, qui tout d’un coup deviennent pygmées, et des nains qui grandissent imperceptiblement, et s’élèvent à une hauteur extraordinaire. On aperçoit des gens d’esprit, qui retombent en enfance; des savans qui n’ont jamais rien appris; des politiques qui ne savent pas gouverner leur maison, et qui veulent gouverner l’état, de pieuses figures qui prêchent la vertu avec un cœur tout noir de crimes; de petits esprits qui font les athées en public, qui ont peur des revenans quand ils sont seuls, et qui tremblent au bruit du tonnerre. On entend partout des cris et des plaintes. Le sang coule; on se bat, on se déchire, on vieillit sans avoir trouvé la paix du cœur; et la mort baisse la toile.
Celui qui veut se divertir de ce drame, n’a qu’à se mettre dans quelque petit coin, d’où il puisse commodément voir tout, sans être vu, et se moquer d’une extravagance qui le mérite si bien.

La Reine Elisabeth voyageait souvent dans les différentes provinces de l’Angleterre. Un jour qu’elle passait par Coventry, le corps municipal vint la complimenter, et le maire finit sa longue et ennuyeuse harangue par ces mots: “Nous n’avons plus qu’une grâce à demander à V. M. c’est qu’elle veuille bien nous permettre de la conduire jusqu’au gibet”. (A une lieue de la ville.)
Cette princesse revint une seconde fois dans la même ville; le maire se hâta de débiter un compliment en vers préparé depuis longtems, et qui commençait ainsi:
We, men of Coventry Nous, gens de Coventry
Are very glad to see Sommes bien aises de voir
Your royal majesty. Votre royale majesté.
Good lord, how fair you be! Grand dieu! que vous êtes belle.
La Reine l’interrompit, en répondant sur le même ton:
My royal majesty Ma royale majesté
Is very glad to see Est bien aise de voir
Ye, men of Coventry. Vous, gens de Coventry,
Good lord, what fools you be! Grand dieu! que vous êtes bêtes!
On raconte du maire de Coventry un autre trait qui ne fait pas honneur au génie des habitans de cette ville. Georges I avait accordé une somme considérable pour rebâtir leur hôtel de ville.—Lorsque le bâtiment fut achevé, on mit une inscription dans laquelle on lisait ces mots: Anno Domini, &c. Le corps municipal s’assembla, et décida qu’au lieu d’Anno Domini, il fallait mettre Georgio Domini, attendu que la Reine Anne était morte, et que le don avait été fait par Georges.
Le Comte de Rochester rencontrant un jour Isaac Barrow, dit aux personnes avec lesquelles il se trouvait: Il faut que je m’amuse de cet original; puis s’approchant de lui: Docteur, s’écria-t-il, je me prosterne devant vous jusqu’aux cordons de mes souliers.—Milord, reprit Barrow, en otant son chapeau, je me prosterne devant vous jusqu’à terre.—Rochester recommença ses salutations, en disant: Docteur, je suis à vous jusqu’au centre de la terre.—Milord, je suis à vous jusqu’aux antipodes. Rochester presqu’au bout de son rôle s’écria: Docteur, je suis à vous jusqu’au fond des enfers.—Milord, reprit Barrow, je vous y laisse; et, en disant ces mots, il s’en alla.
Quand Georges II nomma le général Wolfe pour commander l’expédition contre Québec, le duc de Newcastle représenta à sa Majesté le danger de cette nomination, attendu que Wolfe n’était pas un général, mais un fou, un enragé. “Est-il bien vrai qu’il soit enragé, demanda le roi? Eh bien! je souhaite qu’il morde tous mes autres généraux, et qu’il leur communique sa maladie.”
Expliquez-moi, je vous prie, dit un jour Louis XV à M. de Vergennes, la différence qu’il y a entre un whig et un tory en Angleterre.—La différence est absolument dans le nom, reprit le ministre: les torys sont whigs quand ils ont besoin de places; et les whigs sont torys quand ils les ont obtenues.
En 1764, un habitant de Londres, nommé J. Bond, homme d’esprit et grand amateur de la déclamation, prit tellement en affection la tragédie de Zaïre de Voltaire, que non seulement il l’apprit toute par cœur, mais la fit traduire en anglais par un des meilleurs poëtes de Londres. Il mit tout en œuvre pour faire représenter cette traduction au théâtre de Drury-lane; les directeurs s’y refusèrent, et pendant deux ans, M. Bond les sollicita en vain de se rendre à ses désirs. Enfin, voyant qu’il n’en pouvait rien obtenir, il prit le parti de représenter lui-même, avec quelques autres amateurs, sa pièce favorite.
Il y a dans le quartier de Westminster, une grande salle où l’on donne ordinairement des concerts publics. M. Bond la loue pour une seule soirée aussi cher qu’elle était louée pour l’année entière; il distribue les rôles à ses amis et réserve pour lui celui de Lusignan qu’il croit plus convenable à son âge que tout autre; il avait alors plus de soixante ans. Le jour pris pour la représentation, la salle fut remplie de spectateurs qui payèrent tout ce qu’on leur demanda pour voir cette nouveauté. La pièce commença, et tout le monde applaudit aux talens des acteurs autant qu’aux beautés de la pièce. Lusignan paraît, les applaudissemens redoublent; son imagination s’enflamme, il se croit dans le palais du soudan; son âme identifiée avec celle de Lusignan, se livre toute entière aux sentimens de la religion et de la paternité. La vue de Zaïre lui donne une telle émotion, que son corps, trop faible, ne peut soutenir tant d’agitation; ses forces l’abandonnent; il tombe sans connaissance; on applaudit beaucoup. L’évanouissement qu’on ne croit qu’imité, paraissait si naturel, qu’on ne pouvait trop admirer la supériorité du talent de l’acteur à rendre la nature.—Cependant la longueur de cette situation commençant à fatiguer, Châtillon, Nérestan, Zaïre elle-même avertirent M. Bond qu’il était tems d’y mettre fin: il ouvre les yeux, mais les fermant presqu’aussitôt, il tombe dans son fauteuil sans prononcer une parole, étend les bras comme pour embrasser Zaïre, et ce mouvement fut le dernier de sa vie.
M. Pitt, père du dernier ministre de ce nom, et le Duc de Newcastle, Président de l’Amirauté, étaient d’un avis opposé sur la sortie d’une flotte. Le premier, retenu au lit par la goutte, se trouvait obligé de recevoir ceux qui avaient à lui parler, dans une chambre à deux lits où il ne pouvait souffrir de feu. Le Duc de Newcastle, qui était très frileux, vint le voir. A peine fut-il entré, qu’il s’écria tout grelottant de froid: Comment, vous n’avez point de feu! Non, répondit M. Pitt, je ne puis le supporter quand j’ai la goutte. Le Duc, obligé d’en passer par là, s’assit à côté du malade, enveloppé dans son manteau, et commença à entrer en matière; mais ne pouvant résister plus longtems à la rigueur de la saison; permettez, lui dit-il, que je me mette à l’abri du froid, dans le lit qui est à côté du vôtre; et aussitôt, sans quitter son manteau, il s’enfonça dans le lit de Lady Esther Pitt, et continua la conversation au sujet de cette flotte qu’il n’était pas d’avis d’envoyer en mer. Tous deux s’agitèrent avec chaleur.—Je veux absolument que la flotte parte, disait M. Pitt, en accompagnant ses paroles des gesticulations les plus vives. Cela est impossible, elle périra, répliquait le Duc, en faisant mille contorsions. Le chevalier Charles Frederick, arrivant là-dessus, les trouva dans cette posture ridicule, et il eut toutes les peines du monde à garder son sérieux, en voyant les deux ministres d’état délibérer sur un objet aussi important, dans une situation si nouvelle et si particulière.
M. Sharp, le chirurgien, ayant été appellé chez un lord, pour une blessure trop légère, envoya néanmoins son domestique chez lui, en toute hâte, pour y prendre un tonique convenable. Le soi-disant malade, effrayé de cette précipitation devint pâle, et demanda au chirurgien, avec anxiété, s’il y avait quelque danger dans son cas. “Oui, milord, répondit le chirurgien; si ce garçon ne court pas à toutes jambes, il y a à craindre....—Quoi donc?—Que la blessure ne soit guérie avant qu’il soit de retour.”
Mis-spelled words and printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Inconsistency in hyphenation has been retained.
Inconsistency in accents has been corrected or standardised.
Space between paragraphs varied greatly. The thought-breaks which have been inserted attempt to agree with the larger paragraph spacing, but it is quite possible that this was simply the methodology used by the typesetter, and that there should be no thought-breaks.
[The end of La Bibliothèque Canadienne, Tome II, Numero 5, Avril, 1826. by Michel Bibaud]